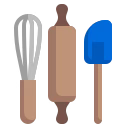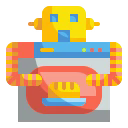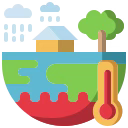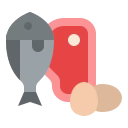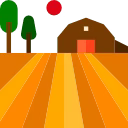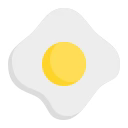🌾🍇🐄 Eat's business on the beach 🍕🍷🧀 2025-23
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Unilever, Kraft Heinz, Kellogg… l'heure des grandes manoeuvres a sonné pour les géants des supermarchés, 18/07/2025
The Guardian, Rising food prices driven by climate crisis threaten world’s poorest, report finds, 21/07/2025
New York Times, America’s Protein Obsession Is Transforming the Dairy Industry, 16/07/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Stéphane Le Bras, historien : « L’alimentation joue un rôle essentiel dans les échanges entre les cultures », 12/07/2025
Dans cet entretien l’historien Stéphane Le Bras, maître de conférences à l’Université Clermont-Auvergne, explore les multiples dimensions culturelles, sociales et politiques de l’alimentation. Loin d’être un simple acte biologique ou quotidien, manger est un fait social total, qui façonne l’imaginaire collectif, structure les identités individuelles et cristallise des tensions historiques.
Stéphane Le Bras retrace d’abord le rôle de la nourriture dans la construction des repères culturels depuis l’Antiquité, soulignant sa présence constante dans l’art, la littérature, le cinéma et, aujourd’hui, sur les réseaux sociaux. Il évoque la madeleine de Proust comme archétype d’un repère sensoriel et identitaire profondément ancré dans la mémoire collective française. Mais ces représentations sont aussi à l’origine de normes contraignantes, comme l’idéal de minceur contemporain, qui alimente des troubles alimentaires chez des centaines de milliers de jeunes.
L’alcool, autre pilier symbolique, est présenté comme un révélateur culturel, oscillant entre valorisation esthétique (poésie, peinture, chanson) et dénonciation morale (ligues antialcooliques). Stéphane Le Bras défend également l’idée que la cuisine peut être un art, tant par la maîtrise des gestes que par l’esthétique des plats, aujourd’hui sublimée sur Instagram. Il rapproche la quête des chefs de celle des artistes, dans une logique de distinction, d’innovation et d’héritage.
L’entretien aborde ensuite les représentations négatives de la malbouffe, analysées à la fois comme une crainte hygiéniste moderne et comme une forme de mépris social. Les choix alimentaires sont des marqueurs d’identité et de classe, comme le théorisait Pierre Bourdieu, et bien manger demeure un privilège inégalement réparti. La montée des fast-foods et des plats industriels est ainsi contrebalancée par une revalorisation des produits de terroir et du « fait maison ».
Enfin, Stéphane Le Bras examine l’internationalisation des pratiques alimentaires, à travers la diffusion planétaire de produits comme le burger ou les sushis, mais aussi la résurgence des cuisines communautaires, dans un contexte d’hybridation et de repli identitaire. Il souligne les dérives capitalistes du goût, manipulé depuis le XIXe siècle par l’agro-industrie via le marketing, la publicité et même la littérature. À ses yeux, réhabiliter le goût comme sens majeur pourrait permettre une redécouverte du lien sensoriel et culturel que chacun entretient avec la nourriture.
Le Monde, Ferrero achète les céréales de Kellogg et se renforce aux Etats-Unis, 10/07/2025
Le groupe Ferrero poursuit son expansion agressive sur le marché nord-américain avec l’acquisition de WK Kellogg, la branche céréalière américaine issue de la scission du groupe Kellogg’s. Pour un montant de 3,1 milliards de dollars, le géant italien de la confiserie, déjà connu pour ses marques emblématiques comme Nutella, Kinder ou Tic Tac, s’empare de marques historiques tels que Corn Flakes, All-Bran et Rice Krispies. Cette opération stratégique doit encore être validée par les actionnaires de WK Kellogg, mais elle devrait aboutir au second semestre 2025.
Ce rachat s’inscrit dans une politique de croissance externe entamée depuis plusieurs années par Ferrero. Après avoir acquis Fannie May en 2017 puis des marques américaines de confiserie cédées par Nestlé (Butterfinger, Baby Ruth…), Ferrero s’est progressivement imposé comme un acteur majeur de la grande consommation outre-Atlantique. L’acquisition de WK Kellogg permet au groupe de consolider sa présence dans un secteur en mutation, marqué par une baisse de consommation des céréales du petit-déjeuner et une préférence croissante des consommateurs pour des produits d’entrée de gamme ou alternatifs.
WK Kellogg souffre actuellement d’une perte de vitesse, conséquence directe d’un changement d’habitudes alimentaires aux États-Unis, où le petit-déjeuner classique perd de son attrait. La forte inflation de ces dernières années a également renforcé l’attrait pour les marques distributeurs. Ce contexte délicat n’a cependant pas freiné Ferrero, qui voit dans cette acquisition une opportunité d’élargir sa gamme de produits et de diversifier son portefeuille au-delà des confiseries sucrées.
Le groupe dirigé par Giovanni Ferrero a quasiment doublé son chiffre d’affaires en dix ans, atteignant 18,4 milliards d’euros en 2024. Sa stratégie repose sur une forte diversification : Ferrero a racheté les biscuits Michel et Augustin, les biscuits belges Delacre, un fournisseur turc de noisettes (Oltan), ou encore un fabricant américain de crèmes glacées (Wells Enterprises). En parallèle, il investit massivement dans le marketing, à l’image de sa présence estivale à Paris Plages avec Kinder.
Enfin, Ferrero demeure hostile à l’étiquetage nutritionnel Nutri-Score, que ses produits – riches en sucre et en huile de palme – arboreraient souvent avec un score E. Le groupe s’oppose activement à toute régulation européenne en ce sens, tout en misant sur l’innovation marketing (Nutella vegan, version au beurre de cacahuètes…) pour séduire de nouveaux consommateurs.
Les Échos, Unilever, Kraft Heinz, Kellogg… l'heure des grandes manoeuvres a sonné pour les géants des supermarchés, 18/07/2025
Face à une conjoncture difficile et à l’évolution rapide des comportements des consommateurs, les géants de la grande consommation entament une vaste réorganisation stratégique. Unilever, Kraft Heinz, Kellogg ou encore Reckitt revoient leurs portefeuilles de marques, vendent des segments jugés moins rentables ou envisagent des scissions pour mieux répondre aux attentes des marchés financiers.
L’exemple de Kellogg illustre cette tendance : la scission du groupe en deux entités distinctes, Kellanova (snacking) et WK Kellogg (céréales américaines), a permis une valorisation significative. Kellanova a été vendue à Mars pour 36 milliards de dollars tandis que WK Kellogg a été racheté par Ferrero pour 3,1 milliards. Ces mouvements, salués par les analystes, visent à recentrer les groupes sur des segments à plus forte marge et croissance.
Unilever, de son côté, prépare l’introduction en Bourse de sa division glaces (Magnum, Ben & Jerry’s) à Amsterdam, une activité jugée trop spécifique pour s’intégrer dans l’ensemble du portefeuille. Reckitt, quant à lui, se déleste de ses produits d’entretien les moins performants pour renforcer sa position sur le marché du soin personnel.
Kraft Heinz, en difficulté depuis sa fusion orchestrée par 3G Capital et Warren Buffet, envisage également une séparation. L’objectif serait de regrouper les marques de sauces, repas et snacks d’un côté, et de céder les produits alimentaires standardisés de l’autre. L’entreprise veut ainsi redevenir un acteur spécialisé plus agile et plus compétitif.
Ces grandes manœuvres reflètent une conviction stratégique partagée : mieux vaut dominer un segment spécifique que d’être présent de manière superficielle dans plusieurs catégories. L’exemple de la glace, qui nécessite une logistique et des savoir-faire spécifiques, illustre bien ce raisonnement.
Enfin, ces mouvements pourraient préfigurer de futures fusions. Certains analystes évoquent un rapprochement potentiel entre Unilever et Reckitt, ou entre Heinz (séparé de Kraft) et McCormick (leader mondial des épices). Le marché est en pleine recomposition, et les mastodontes de l’agroalimentaire cherchent à s’adapter à un monde post-Covid, inflationniste et fragmenté.
Le Figaro, 70 grands chefs alertent sur le risque de «dégastronomisation» de la France, 25/07/2025
Dans cette tribune, soixante-dix grands chefs français, dont Anne-Sophie Pic, Alain Ducasse, Hélène Darroze, Yannick Alléno ou encore Philippe Etchebest, lancent un « cri d’alarme » face à ce qu’ils qualifient de « dégastronomisation » de la France. Rassemblés par le think tank gastronomique Le Passe, les signataires appellent les pouvoirs publics à reconnaître la gastronomie comme une « exception culturelle » au même titre que le cinéma ou la musique.
Les chefs déplorent l’accumulation de contraintes administratives, fiscales et sociales qui fragilisent durablement le secteur de la restauration artisanale. Parmi ces freins, sont cités : le plafonnement de la prime Macron, la réduction des aides à l’apprentissage, ou encore la fiscalisation des pourboires. Autant de mesures qui limitent la capacité des restaurateurs à valoriser leurs équipes et à pérenniser leur activité. Ils revendiquent un soutien spécifique au « fait maison », avec une fiscalité différenciée par rapport à la restauration industrielle, ainsi qu’un renforcement de l’éducation alimentaire dès l’école.
Les auteurs de la tribune insistent sur l’importance de la gastronomie comme pilier du patrimoine national, vecteur de lien social et de rayonnement international. Bien qu’elle soit inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, cette reconnaissance reste symbolique, selon eux, et ne suffit pas à protéger un modèle en danger. L’uniformisation de l’offre alimentaire, la pression des chaînes de restauration rapide et la montée de la malbouffe sont autant de menaces contre lesquelles ils s’élèvent.
Le texte évoque également la crise des vocations, la fermeture de nombreuses tables indépendantes et le poids croissant des contraintes économiques. Pour les signataires, il est urgent de restaurer la valeur culturelle, sociale et économique de la cuisine française. Ils défendent une gastronomie d’auteur, fondée sur la créativité, l’exigence, le savoir-faire artisanal et la transmission.
Ce manifeste collectif, rare par son ampleur et la notoriété de ses auteurs, constitue une tentative de remobilisation face à un affaiblissement structurel du tissu gastronomique français. Il traduit l’inquiétude d’un milieu qui se sent à la croisée des chemins, entre excellence artisanale et pressions industrielles.
Les Échos, Les confitures menacées par une pénurie de fruits en Europe, 24/07/2025
Dans un contexte climatique particulièrement défavorable, l’industrie européenne de la transformation de fruits, notamment pour les confitures et compotes, fait face à une pénurie inquiétante de matières premières en 2025. Selon la Fédération des industries d’aliments conservés (Fiac), cette situation résulte d’une succession de mauvaises récoltes liées à des conditions météorologiques extrêmes : gel, pluies abondantes, grêle ou sécheresse selon les régions.
La France, tout comme d’autres pays producteurs européens, est directement touchée. En Pologne, pays leader pour l’exportation de fraises, la production a chuté de moitié à cause d’un printemps pluvieux et froid. En Serbie, grand fournisseur de framboises, la sécheresse a provoqué une baisse similaire. Les récoltes de rhubarbe, cerises, cassis ou abricots sont également compromises. Pour ce dernier fruit, bien que la production française soit bonne, les abricots sont orientés vers le marché du frais, laissant peu de volumes pour la transformation. Ailleurs, en Espagne, Grèce ou Turquie, les intempéries ont anéanti une partie des cultures.
Cette pénurie entraîne une flambée généralisée des prix des fruits, impactant fortement la rentabilité des entreprises du secteur. La Fiac s’alarme du fait que certaines espèces, comme les cerises griottes, pourraient tout simplement ne pas être disponibles cette année. En parallèle, les industriels sont confrontés à une pression de la grande distribution, qui exige des baisses de tarifs alors même que les coûts de production explosent.
Le secteur, qui pèse environ 1,7 milliard d’euros et emploie près de 10 000 personnes en France, se retrouve dans une impasse. Les entreprises tentent de sécuriser des approvisionnements à l’international, mais les conditions sont tendues sur tous les marchés. Certaines envisagent des reformulations de recettes, voire l’arrêt temporaire de certaines références.
Pour la Fiac, cette crise dépasse la simple logique conjoncturelle. Elle reflète la fragilité croissante des filières agricoles européennes face au dérèglement climatique. L’enjeu est aussi celui de la survie de nombreuses PME agroalimentaires, qui peinent à absorber les chocs répétés liés à la météo, aux coûts de l’énergie, à la pression des prix et à la volatilité des matières premières.
Les Échos, A Tours, au coeur des serres où Nestlé invente le café du futur, 23/07/2025
Dans les serres discrètement installées à proximité de Tours, Nestlé développe une stratégie agronomique ambitieuse pour faire face aux défis climatiques qui menacent la culture mondiale du café. Ce centre de recherche international, dédié principalement au café, concentre ses efforts sur la création de nouvelles variétés de caféiers plus résilientes, plus productives et adaptées aux conditions environnementales de demain.
Les scientifiques y cultivent environ 120 variétés d’arabica et de robusta, sélectionnées selon leurs performances en matière de rendement, de résistance aux maladies et au stress hydrique, et bien entendu, de qualité gustative. L’objectif est de combiner des traits génétiques complémentaires pour créer des variétés capables de produire davantage de grains tout en réduisant l’usage d’eau et d’intrants, contribuant ainsi à une réduction de l’empreinte carbone de la filière.
Le processus, long et méticuleux, passe par des croisements contrôlés, une sélection génomique assistée par des marqueurs ADN, et une multiplication intensive en laboratoire via le bouturage. Ces techniques permettent de produire des plants sains, homogènes et parfaitement traçables, aptes à être diffusés ensuite dans les pépinières partenaires de Nestlé à travers le monde, notamment en Côte d’Ivoire, en Équateur et en Thaïlande.
Cette innovation agronomique s’inscrit dans une logique économique et stratégique : le café représente un pilier essentiel du chiffre d’affaires de Nestlé, avec la marque Nescafé en tête, consommée dans plus d’une tasse sur sept dans le monde. Pour faire face à la réduction possible de 50 % des zones propices à la culture du café d’ici 2050, le groupe a investi massivement dans la recherche et l’adaptation variétale, avec un plan de soutien global à la filière.
Deux variétés issues de ce centre sont déjà en exploitation commerciale : le « Roubi » au Mexique et le « Star 4 » au Brésil. L’enjeu est autant économique qu’environnemental et social, puisqu’il s’agit aussi de garantir la sécurité des revenus des producteurs de café à travers le monde, en leur fournissant des plants plus adaptés aux conditions climatiques changeantes.
Ce centre de Tours incarne ainsi une innovation discrète mais essentielle, à la croisée de la biotechnologie végétale, de la souveraineté agricole et de la durabilité.
Le Monde, La pâtisserie allégée a du mal à faire recette, 26/07/2025
La pâtisserie française, reconnue mondialement pour son raffinement esthétique et gustatif, fait face à une contradiction croissante : malgré son aura de prestige, elle s’inscrit de plus en plus dans la catégorie des aliments ultra-transformés, riches en sucres, graisses et pauvres en fibres. L’article explore cette tension entre plaisir, santé et tradition.
Alors que la cuisine salée française a connu une révolution diététique dans les années 1970 – tournant vers les produits frais, les saisons et la légèreté –, le monde de la pâtisserie reste, lui, globalement inchangé. Certes, les quantités de sucre ont été progressivement réduites dans certaines recettes, comme le rappelle le chef Christophe Michalak, mais les ingrédients de base (beurre, farine blanche, sucre raffiné, crème) dominent toujours largement.
Des pâtissiers comme Frédéric Bau, qui prône une « gourmandise raisonnée », expérimentent de nouvelles approches : réduction du sucre, remplacement de certaines matières grasses, introduction d’ingrédients à plus forte valeur nutritionnelle. Mais ces tentatives restent marginales, car elles se heurtent à plusieurs obstacles : la complexité technique, le coût élevé des alternatives, la résistance du public à des textures et saveurs différentes.
Le plaisir sucré reste profondément ancré dans la culture française. Il incarne la fête, la récompense, le savoir-faire. Les émissions de télévision à succès, les vitrines de grandes maisons et la littérature culinaire célèbrent encore une pâtisserie où l’abondance et l’esthétique priment. Le déséquilibre nutritionnel est rarement mis en question dans l’espace médiatique, sauf dans les cercles scientifiques ou de santé publique.
L’article interroge donc la possibilité d’une mutation durable de la pâtisserie française vers un modèle plus sain. Il souligne aussi les paradoxes : une demande croissante de transparence, d’authenticité, de bien-être, mais une tolérance persistante envers les excès sucrés dans le domaine du dessert.
En définitive, la pâtisserie reste un terrain culturel sensible, où la réforme est lente, tant les enjeux identitaires, esthétiques et sensoriels y sont puissants. Transformer la pâtisserie française sans trahir son essence demeure un défi majeur.
Inc, The Robot Revolution Is Already Happening in Restaurants. Here’s What It Looks Like, 22/07/2025
L’article explore l’essor des robots dans l’industrie de la restauration, un phénomène qui dépasse désormais le simple gadget médiatique pour s’imposer comme une réponse structurelle aux défis du secteur. L’exemple le plus marquant est celui du robot humanoïde Optimus de Tesla, vu en train de servir du popcorn dans un diner de Hollywood, événement symbolique d’une tendance plus large : l’intégration de robots dans des tâches de service et de cuisine.
Le recours à l’automatisation s’explique principalement par la pénurie chronique de main-d’œuvre dans le secteur de la restauration. En 2024, près de la moitié des restaurateurs américains déclaraient vouloir recourir davantage à l’automatisation. Ces robots ne sont pas là pour remplacer les humains, mais plutôt pour améliorer la productivité, alléger certaines tâches pénibles ou chronophages, et augmenter la sécurité en cuisine. Des machines comme Flippy, déployées chez White Castle ou Jack in the Box, s’occupent ainsi de la cuisson des aliments frits avec régularité et sans risque de brûlure.
Des entreprises comme Bear Robotics ont développé des robots de service autonomes – non humanoïdes – comme le robot Servi, utilisé dans des milliers de restaurants pour acheminer les plats ou débarrasser les tables. Chipotle, de son côté, expérimente des machines capables de préparer les avocats pour gagner du temps.
L’article souligne également que l’utilisation de robots dans la restauration s’inscrit dans une logique économique et culturelle. Les robots ne demandent ni pourboires ni pauses, ne tombent pas malades, et offrent une constance précieuse. Par ailleurs, leur présence dans les établissements suscite l’intérêt des clients et renforce l’attrait marketing des lieux, à l’image du diner Tesla au look rétro-futuriste.
Enfin, l’article ouvre la réflexion vers d’autres secteurs. Le secrétaire américain à la Marine évoque par exemple les apports des robots dans l’industrie navale, en perte de compétences, et Boris Sofman, fondateur de Bedrock Robotics, imagine des robots sur les chantiers de construction pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. Elon Musk, quant à lui, continue de promouvoir Optimus comme figure de proue d’un futur où les robots humanoïdes feront partie du quotidien.
Le message sous-jacent : la révolution robotique dans la restauration n’est que le début d’un bouleversement industriel bien plus vaste.
The Guardian, Rising food prices driven by climate crisis threaten world’s poorest, report finds, 21/07/2025
Un rapport alarmant met en lumière l’impact croissant des événements climatiques extrêmes sur les prix alimentaires mondiaux, avec des conséquences dramatiques pour les populations les plus vulnérables. Les auteurs, issus de plusieurs instituts de recherche dont l’Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), ont documenté entre 2022 et 2024 une corrélation forte entre pics de température, sécheresses, inondations et flambées des prix.
Parmi les cas étudiés : le triplement du prix du cacao à cause de la sécheresse en Côte d’Ivoire et au Ghana, l’explosion des prix de l’oignon en Inde, de la pomme de terre au Royaume-Uni ou du chou en Corée du Sud. Ces hausses réduisent l’accès à une alimentation saine, entraînent un basculement vers des produits moins nutritifs et accentuent la malnutrition.
Les effets ne sont pas seulement sanitaires : ils sont aussi politiques. L’étude suggère que l’inflation alimentaire a joué un rôle dans certaines élections récentes, comme aux États-Unis. Historiquement, on observe que les flambées du prix du blé ont pu déclencher des émeutes, comme au Mozambique en 2010, lorsque la Russie avait interrompu ses exportations.
Le rapport souligne aussi un effet économique global : l’augmentation du coût des denrées de base alimente l’inflation générale, ce qui freine les baisses de taux d’intérêt et compromet la reprise économique. En mai 2024, une sécheresse au Royaume-Uni a ainsi contribué à un pic d’inflation inattendu.
Enfin, les auteurs insistent sur l’urgence climatique : tant que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites drastiquement, ces événements météorologiques extrêmes se multiplieront. L’alimentation devient l’un des marqueurs les plus visibles des effets du changement climatique : pour les citoyens, la hausse des prix alimentaires arrive juste après les vagues de chaleur comme impact perçu du dérèglement climatique.
CNBC, Protein has become America’s latest obsession. Companies like General Mills and PepsiCo are capitalizing on it, 22/07/2025
L’article décrypte l’engouement massif des consommateurs américains pour les produits enrichis en protéines, devenu un axe stratégique majeur pour les grands groupes agroalimentaires. Des entreprises comme General Mills, PepsiCo ou Kellogg reformulent leurs offres pour y intégrer plus de protéines, surfant sur une tendance qui dépasse largement le cercle des sportifs.
La demande en protéines touche désormais tous les publics : seniors soucieux de préserver leur masse musculaire, jeunes adultes influencés par les régimes “healthy”, adeptes du régime keto ou consommateurs d’Ozempic, médicament anti-obésité qui nécessite une alimentation riche en protéines pour éviter la fonte musculaire. Les linéaires s’enrichissent de produits protéinés inattendus : céréales, yaourts, barres, snacks, voire desserts.
Cette stratégie répond aussi à une logique marketing puissante : le mot « protéine » est devenu synonyme de santé, d’énergie, de performance. Les entreprises l’intègrent dans leurs packagings, slogans, publicités, jusqu’à en faire un argument de vente central.
Mais cet engouement soulève plusieurs enjeux. D’une part, les nutritionnistes rappellent que la majorité des Américains consomment déjà assez, voire trop de protéines, et que c’est la qualité globale de l’alimentation (fibres, légumes, modération du sucre) qui fait défaut. D’autre part, la course à la protéine pousse les industriels à multiplier les isolats, additifs et procédés de transformation, ce qui va parfois à l’encontre d’une alimentation réellement naturelle.
Sur le plan environnemental, l’explosion de la demande en protéines, notamment animales, interroge sur la soutenabilité du système. Les sources végétales de protéines, comme les pois ou les lentilles, peinent encore à s’imposer dans les produits ultra-transformés.
En résumé, la protéine est devenue la nouvelle star du marketing nutritionnel, dans un pays à la recherche de repères alimentaires simples. Mais cette tendance, si elle n’est pas mieux encadrée, pourrait accentuer la confusion du consommateur et détourner l’attention des véritables piliers d’une alimentation saine.
New York Times, America’s Protein Obsession Is Transforming the Dairy Industry, 16/07/2025
L’article explore en profondeur comment l’obsession croissante des Américains pour les protéines transforme l’industrie laitière, notamment par le biais de la valorisation du lactosérum, ou whey, un sous-produit de la fabrication du fromage. Autrefois considéré comme un simple déchet ou vendu à bas prix pour l’alimentation animale, le lactosérum est aujourd’hui une matière première précieuse, transformée en poudres protéinées et en ingrédients fonctionnels utilisés dans une multitude de produits de nutrition sportive ou de consommation courante.
Le reportage prend pour exemple la fromagerie familiale Nasonville Dairy, située dans le Wisconsin, État emblématique de la production laitière. Alors que le prix du lait reste bas depuis des décennies, la transformation du whey en produits à haute valeur ajoutée permet à l’entreprise de maintenir sa rentabilité. La demande pour la protéine de lactosérum explose, portée par une population soucieuse de sa santé, adepte des régimes hyperprotéinés, du fitness, ou consommatrice de médicaments comme Ozempic qui modifient la manière de manger.
Le phénomène dépasse le cercle des athlètes : de plus en plus de consommateurs recherchent des produits riches en protéines, associés à des bienfaits tels que la satiété, la préservation de la masse musculaire ou la perte de poids. Ce virage pousse l’industrie laitière à adapter ses infrastructures, à nouer des partenariats avec des entreprises de nutrition et à faire évoluer ses priorités. À Nasonville, la valorisation du lactosérum représente désormais une part importante de l’activité, et des entreprises spécialisées comme Actus Nutrition se sont développées pour maximiser ce potentiel.
Toutefois, cette réorientation ne va pas sans risques. Une surproduction de whey pourrait faire chuter les prix, et la course à la protéine conduit à une standardisation croissante de l’offre. Par ailleurs, l’impact environnemental de la production laitière reste une préoccupation majeure.
En parallèle, l’industrie cherche à se diversifier, en valorisant également les fromages artisanaux ou la viande bovine issue des vaches laitières. L’article met ainsi en lumière un changement structurel dans l’économie laitière américaine, désormais réorganisée autour d’un nouveau produit vedette : la protéine, devenue bien plus qu’un simple nutriment – un véritable moteur de transformation industrielle.
New York Times, The Hottest New Cafe Is in Someone’s Living Room, 22/07/2025
L’article met en lumière un phénomène croissant : des particuliers transforment leur salon en véritables cafés éphémères, accueillant amis, voisins ou abonnés des réseaux sociaux autour de boissons maison et pâtisseries artisanales. Loin des enjeux commerciaux, ces “home cafés” sont avant tout des projets communautaires, souvent motivés par un besoin de lien social, une passion pour la cuisine ou une volonté d’explorer une identité créative.
À Des Plaines, Illinois, Nate Crawford et Justen Lambert organisent les événements “Morning Jays” : menus personnalisés, merchandising, newsletter, branding… tout y est, à l’exception du statut légal d’un commerce. Ils voient dans ces cafés domestiques une alternative plus chaleureuse et accessible aux restaurants classiques, alliant convivialité, cuisine de qualité et faible coût.
À Montréal, deux jeunes femmes, Victoria Da Silva et Kate McDevitt, ont lancé “Saturday Café”, un rendez-vous mensuel qui rassemble un public hétéroclite, avec comme but assumé de recréer du lien post-Covid. Leur concept s’est enrichi d’objets dérivés (mugs), de collaborations avec des artisans (ateliers céramique) et d’une forte présence en ligne.
D’autres exemples cités, comme celui de Ryan Nordheimer à New York ou de Faye Abad à Bristol, montrent que le mouvement est international. Il offre un espace de créativité, sans la pression financière d’un commerce classique, tout en répondant à une envie de communauté, de convivialité et de simplicité. Certains hôtes y trouvent même une rampe de lancement pour une carrière dans les métiers de la food ou de la création de contenu.
Ce phénomène reflète aussi les mutations de la consommation urbaine : dans un contexte d’inflation, les consommateurs sont en quête d’alternatives au restaurant traditionnel. L’essor de ces cafés d’appartement montre à quel point le besoin de lien social et d’expérience culinaire personnalisée reste fort, même dans un monde de plus en plus numérique.
Forbes, Coffee: The Essential ‘Perk’ Of A Perfect Hotel Or Resort Stay, 14/07/2025
Dans l’hôtellerie de luxe, le café n’est plus un simple service annexe, mais un levier stratégique d’expérience client. L’article de Forbes explore comment les hôtels et resorts haut de gamme repensent leur offre café pour en faire un « petit luxe » déterminant dans la perception du séjour. Le café devient un marqueur de qualité, d’attention aux détails et de personnalisation.
Certains établissements nouent des partenariats exclusifs avec des torréfacteurs locaux ou artisanaux, installent des équipements haut de gamme dans les chambres (machines à expresso, moulins à grains, tasses design), ou proposent des menus de cafés rares comme pour le vin. D’autres vont plus loin, en intégrant des ateliers de dégustation, des expériences sensorielles autour du café, voire des prestations de barista à la demande.
Cette évolution reflète la montée en gamme des attentes post-Covid : les clients veulent plus d’authenticité, de réconfort, de repères sensoriels. Le café incarne parfaitement cette quête d’émotion quotidienne, de rituel personnel et de réassurance. Il participe à l’ambiance générale de l’hôtel, du lobby au room service, en passant par les petits déjeuners ou les pauses bien-être.
Au-delà du goût, c’est aussi un outil de storytelling : un café équitable, sourcé auprès de coopératives, transformé sur place, raconte une histoire qui valorise l’image de marque. Cela s’inscrit dans une tendance plus large où les produits de consommation deviennent des supports d’expérience.
L’article montre que le café est devenu, dans l’hôtellerie, un indicateur de standing autant qu’un acte d’hospitalité. Bien pensé, il fidélise, surprend, engage. Négligé, il peut laisser une impression décevante, même dans un établissement cinq étoiles. La nouvelle culture du café, héritée de la « third wave », s’impose donc comme une opportunité pour réinventer les standards de l’accueil.
Inc, Meet the CEO Turning Chicken Farmers Into ‘Rock Stars’, 02/07/2025
Dans un secteur dominé par quatre géants — Tyson Foods, Pilgrim’s Pride, Perdue Farms et Sanderson Farms — qui concentrent à eux seuls près de 60 % du marché américain de la volaille, Stephen Shepard, PDG de Farmer Focus, veut bousculer les règles du jeu. Ancien salarié de l’industrie, notamment chez Pilgrim’s Pride, Shepard a gravi les échelons depuis ses années de lycée en occupant tous les postes, de la production à l’encadrement, avant de lancer sa propre entreprise. Ce parcours de terrain lui a permis de prendre conscience des limites du modèle industriel, notamment en matière de bien-être des éleveurs et de durabilité.
Farmer Focus s’inscrit dans une approche totalement différente du modèle d’intégration verticale classique. Plutôt que de contrôler l’ensemble de la chaîne de manière centralisée, l’entreprise collabore avec des exploitations familiales indépendantes situées en Virginie et Virginie-Occidentale. Elle leur garantit des prix d’achat 25 à 35 % supérieurs au marché, une transparence totale sur les conditions de production et un partenariat fondé sur la confiance. Ce système est vérifié par des tiers indépendants et a permis d’attirer un nombre croissant d’éleveurs — au point que l’entreprise fonctionne avec une liste d’attente, sans avoir besoin de campagnes de recrutement.
Shepard souligne que ce modèle répond à une urgence structurelle : près de 150 000 fermes familiales ont disparu aux États-Unis entre deux recensements agricoles, et 83 % des exploitants doivent travailler hors de leur ferme pour survivre. Farmer Focus veut inverser cette tendance en permettant aux éleveurs de vivre décemment de leur métier, tout en protégeant les fermes familiales sur plusieurs générations. Près de 20 % des fermes partenaires sont dirigées par des primo-installants, et l’entreprise favorise la transmission familiale : six exploitations ont été reprises par une nouvelle génération au cours des douze derniers mois.
Plutôt que de démanteler l’industrie, Stephen Shepard veut en proposer une version plus humaine, plus durable et plus équitable, en réorientant le centre de gravité du système autour de ceux qui produisent réellement : les éleveurs.
Eater, How Seedless Watermelon Took Over the Grocery Store, 24/07/2025
L’article retrace l’histoire fascinante de l’ascension fulgurante de la pastèque sans pépins, aujourd’hui omniprésente dans les rayons des supermarchés américains. Initialement perçue comme une curiosité botanique, cette variété triploïde — stérile et donc incapable de produire des graines — a été le fruit de décennies de recherche agronomique, popularisée dans les années 1990 grâce à des croisements complexes entre variétés diploïdes et tétraploïdes.
Ce succès commercial n’était pas acquis d’avance. Les pastèques sans graines sont en effet plus difficiles à produire, nécessitent un environnement contrôlé pour la germination, des pollinisateurs spécifiques, et leur culture est plus onéreuse. Cependant, leur côté pratique, notamment pour les enfants, les pique-niques ou les découpes rapides, a rapidement conquis les consommateurs. Les efforts de communication des producteurs, associés à un marketing ciblé, ont permis de faire de cette innovation une norme.
Aujourd’hui, plus de 90 % des pastèques vendues aux États-Unis sont sans pépins. Cette hégémonie repose sur une transformation silencieuse mais radicale du marché, dans laquelle les distributeurs ont joué un rôle-clé en exigeant une standardisation des produits plus pratiques à vendre, à stocker et à conditionner.
Mais cette révolution pose aussi des questions. D’un point de vue agronomique, la diversité variétale s’est considérablement appauvrie. De nombreuses variétés anciennes de pastèques à graines, souvent plus résistantes, plus savoureuses ou mieux adaptées à certains terroirs, ont été marginalisées, voire disparues. De plus, les semences de variétés sans pépins ne peuvent pas être replantées : les producteurs doivent chaque année racheter les semences hybrides auprès de multinationales, renforçant leur dépendance.
L’article aborde également les questions écologiques et éthiques liées à ce modèle agricole intensif : usage d’intrants, impact environnemental, pouvoir des semenciers. La pastèque sans pépins devient ainsi un symbole emblématique des compromis entre innovation, confort de consommation, dépendance industrielle et perte patrimoniale.
Wall Street Journal, Why It Actually Makes Sense to Pay $40 for an Omelet—Occasionally, 25/07/2025
Longtemps reléguée au statut de plat de petit-déjeuner simple et abordable, l’omelette fait un retour inattendu dans les plus grands restaurants gastronomiques américains… et au dîner. À travers une enquête menée dans plusieurs établissements renommés, l’article décrypte comment ce plat humble est devenu un emblème du « quiet luxury » — ce luxe discret, sobre et technique qui séduit une clientèle en quête d’authenticité et de maîtrise culinaire.
À 1906, le restaurant du Longwood Gardens en Pennsylvanie, l’omelette à quatre œufs garnie de homard du Maine et nappée de béarnaise est servie au prix de 38 dollars. Le chef George Murkowicz en fait un pilier de sa carte du soir. Chez Chez Fifi à Manhattan, l’omelette à plat à 40 dollars est garnie de crevettes carabinero et d’oursin. Son chef, Zack Zeidman, la compare à une tortilla espagnole librement interprétée. Dans ces établissements, l’omelette est élevée au rang de plat signature, côtoyant filets mignons et poissons nobles.
L’omelette devient un test culinaire et émotionnel. Facile à reproduire chez soi, elle prend une toute autre dimension quand elle est exécutée à la perfection par un chef. Elle procure un sentiment d’attention, de soin, presque maternel. Chez Le Veau d’Or, l’omelette baveuse au Comté et aux herbes, issue du répertoire Escoffier, s’intègre au menu à 125 dollars. Pour les chefs Riad Nasr et Lee Hanson, elle incarne une élégance réconfortante, parfaitement compatible avec un grand vin ou un Champagne.
Le phénomène dépasse la cuisine française. À Chez Noir en Californie, le chef Jonny Black propose une version roulée au crabe et à l’oursin violet local. À Sap Sua, restaurant vietnamien de Denver, les œufs doux trúng và trúng sont servis sur du riz avec poisson, jalapeños marinés et œufs de truite. À Gado Gado, à Portland, une omelette aux herbes indonésiennes enrichit le festin rijsttafel.
Ce retour en grâce n’est pas anodin : dans un contexte où les œufs atteignent des prix records, ils sont redécouverts comme ingrédient noble. Pour les chefs, l’omelette est aussi un test de compétence, un révélateur du savoir-faire culinaire. En somme, l’omelette se révèle aujourd’hui comme le reflet d’une sophistication sans ostentation.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A dans un mois!
O. Frey