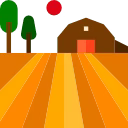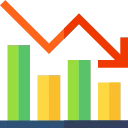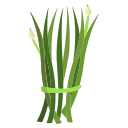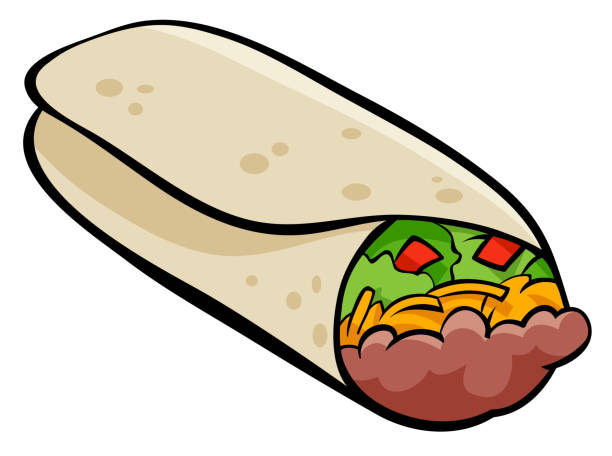🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-34
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la version audio :
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
L’Usine Nouvelle, Mercosur : Le Brésil, ce géant qui a toujours plus d’appétit pour nourrir le monde, 14/11/2025
Les Échos, Fromages, foie gras… ces crises sanitaires qui ont joué un mauvais tour à la balance commerciale de la France, 19/11/2025
Wall Street Journal, Sauerkraut, Kimchi and…Gut Nuts? Fermented Foods Are Having a Moment, 11/11/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Figaro, César Troisgros, cuisinier de l’année 2026 pour le Gault&Millau, 17/11/2025
Le guide Gault&Millau a nommé César Troisgros « Cuisinier de l’année 2026 », consacrant un chef dont la carrière s’inscrit dans l’héritage d’une dynastie gastronomique tout en marquant une évolution notable dans l’identité de la Maison Troisgros. Installé à Ouches, dans la Loire, l’établissement familial demeure l’une des grandes références de la haute cuisine française, mais l’article souligne comment César, désormais en première ligne, y impose progressivement une vision personnelle. Sa cuisine se caractérise par une approche plus végétale, une recherche d’équilibre et une mise en valeur des produits locaux, dans un registre plus épuré que celui de ses prédécesseurs.
La collaboration entre Michel et César apparaît comme une transition harmonieuse, où le père, garant d’un patrimoine culinaire reconnu, accompagne l’ascension du fils tout en lui laissant une grande liberté créative. Cette complémentarité évite la rupture générationnelle et permet à la maison de conserver son identité tout en s’adaptant aux attentes actuelles : davantage de sobriété, une attention accrue à la durabilité et une sensibilité plus marquée aux influences internationales.
Le reportage met également en lumière la dimension symbolique de cette récompense. À l’heure où les guides culinaires cherchent à refléter une scène gastronomique plus diversifiée et ouverte, la nomination de César Troisgros incarne une forme de renouvellement au sein des grandes institutions. Le chef représente une génération qui conjugue excellence technique et simplicité apparente, sans renoncer à l’exigence historique de la maison.
Ce prix renforce aussi la position de la Maison Troisgros dans un secteur où la concurrence s’intensifie et où le public se montre plus attentif à l’authenticité. Il confirme la capacité de l’établissement à se réinventer, alors que les repas gastronomiques doivent désormais convaincre par leur sens plutôt que par leur seule virtuosité. Enfin, l’article suggère que cette distinction pourrait étendre encore le rayonnement de la maison à l’international, tout en ouvrant une nouvelle étape dans l’histoire de cette famille emblématique.
Le Figaro, «À Singapour, il pousse partout» : le pandan, cette plante verte d’Asie du Sud-Est qui séduit les gastronomes, 13/11/2025
L’article dresse un portrait détaillé du pandan, plante aromatique largement utilisée en Asie du Sud-Est et devenue emblématique de la cuisine singapourienne. Appréciée pour son parfum mêlant notes de vanille, de jasmin et d’amande, cette herbe est omniprésente dans la vie quotidienne : desserts, boissons, bouillons, pains, currys… Sa polyvalence en fait un ingrédient clé de la culture culinaire locale.
À Singapour, le pandan est à la fois un produit du quotidien et un vecteur de créativité pour les chefs. Plusieurs restaurateurs et pâtissiers cités dans l’article expliquent comment ils réinterprètent cet ingrédient traditionnel dans des recettes modernes. Le pandan est ainsi décliné en glaces, entremets, cocktails ou viennoiseries. Cette capacité à circuler entre street food, pâtisserie premium et gastronomie étoilée témoigne de son importance culturelle.
L’article met en avant sa dimension identitaire : le pandan incarne un lien entre les différentes communautés qui composent Singapour — chinoise, malaise, indienne — et sert de point d’ancrage à une cuisine métissée. Les familles l’utilisent depuis des générations, et son parfum est associé à une forme de mémoire culinaire.
Son succès dépasse désormais les frontières régionales. Les exportations progressent et les chefs occidentaux s’y intéressent de plus en plus, notamment en Europe et aux États-Unis, où l’on voit émerger des desserts au pandan dans des restaurants asiatiques contemporains. Cet engouement s’inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des ingrédients tropicaux.
L’article souligne cependant que le pandan reste un produit délicat à travailler. Il est rarement vendu prêt à l’emploi : pour exprimer son arôme, il faut souvent en extraire manuellement le jus à partir des feuilles fraîches. Les versions industrielles, moins aromatiques, ne restituent pas toujours la complexité du produit traditionnel.
En conclusion, le pandan apparaît comme un symbole de la scène culinaire singapourienne : un ingrédient modeste devenu emblème gastronomique. Sa popularité croissante illustre la manière dont la cuisine d’Asie du Sud-Est influence progressivement les tables du monde, tout en mettant en lumière la capacité de Singapour à se positionner comme un laboratoire de tendances culinaires.
Libération, «Libre, engagé, hors cadre» : le Fooding, 25 ans de choix culinaires qui ont changé la gastronomie, 17/11/2025
L’article retrace les 25 ans du Fooding et s’attache à mesurer son impact sur la cuisine française contemporaine. Créé à la fin des années 1990 pour rompre avec les codes jugés élitistes et figés de la gastronomie traditionnelle, le Fooding a imposé une nouvelle manière d’évaluer les restaurants, basée sur le dynamisme, la créativité et l’accessibilité plutôt que sur les critères classiques des grands guides.
Le reportage revient sur l’esprit originel du mouvement : défendre le « goût de l’époque », valoriser des chefs jeunes ou autodidactes, encourager les lieux hybrides mêlant influences internationales, street food et cuisine bistronomique. Le Fooding a ainsi contribué à faire émerger une génération de restaurateurs qui proposaient une cuisine plus libre, souvent moins coûteuse, plus proche du quotidien des urbains.
L’article met en avant plusieurs évolutions majeures attribuées au Fooding : la dédramatisation de la gastronomie, la reconnaissance de cuisines métissées autrefois marginalisées, l’essor des restaurants conviviaux plutôt que formels, ou encore une nouvelle attention portée à l’ambiance, à la playlist et à l’expérience globale du repas. Le guide a également joué un rôle dans la mise en lumière des engagements sociaux et environnementaux de certains chefs, anticipant des préoccupations aujourd’hui centrales.
Bien que parfois critiqué pour son ton décalé ou son positionnement marketing, le Fooding demeure un acteur structurant du paysage culinaire. L’article souligne que le guide a su influencer jusqu’aux institutions qu’il voulait bousculer : les guides traditionnels, dont Michelin (qui a fini par racheter Le Fooding), ont eux aussi intégré davantage de diversité, de cuisines du monde et de jeunes adresses dans leurs sélections.
Pour ses 25 ans, le Fooding apparaît comme un mouvement arrivé à maturité, dont l’influence dépasse largement la simple recommandation de restaurants. Il a contribué à faire de la gastronomie un reflet de la société, plus inclusif et plus représentatif des mutations culturelles. L’article conclut en rappelant que, face à une scène culinaire toujours en transformation, le Fooding continue de défendre une vision vivante, mobile et désacralisée du goût, fidèle à son ambition première : capturer l’époque à travers ses assiettes.
Libération, Danone, Charal, Bel : les arrière-cuisines des géants de l’agro-industrie pour vendre leurs produits protéinés, 14/11/2025
L’article analyse la stratégie des grandes entreprises agroalimentaires pour s’imposer sur le marché en forte croissance des produits riches en protéines. Danone, Charal et Bel cherchent à répondre à une demande accrue du public pour des produits perçus comme plus nutritifs, énergisants ou adaptés à un mode de vie actif. Ce marché attire aussi l’attention des marques face au recul de certaines catégories traditionnelles ou à la concurrence grandissante des alternatives végétales.
Le reportage dévoile les mécanismes de communication utilisés pour promouvoir ces produits, notamment à travers des partenariats avec des influenceurs dont la parole est jugée crédible par les consommateurs. Jessie Inchauspé, alias « Glucose Goddess », figure très suivie sur les réseaux sociaux, est citée comme exemple d’une influenceuse sollicitée pour valoriser les qualités nutritionnelles de certains produits laitiers. Ces collaborations permettent aux marques de bénéficier d’un discours pseudo-scientifique susceptible de légitimer leurs messages.
Les industriels investissent également dans des opérations d’influence plus institutionnelles. Charal organise régulièrement des rencontres et des tables rondes pour promouvoir les bienfaits des protéines animales, en s’appuyant sur des chercheurs ou nutritionnistes présentés comme indépendants. L’article montre cependant que ces intervenants sont souvent rémunérés, ce qui soulève des interrogations sur la transparence des liens d’intérêts.
L’article insiste sur la dualité du marché : d’un côté, une demande forte pour plus de protéines ; de l’autre, une défiance croissante envers l’ultra-transformation et les discours de santé associés au marketing. Les groupes doivent ainsi composer avec une opinion publique sensible aux enjeux environnementaux et à la qualité nutritionnelle réelle des produits.
Le texte examine également la manière dont la viande tente de résister à la montée des alternatives végétales. Les initiatives de communication de Charal sont décrites comme des tentatives de recentrer le débat sur la valeur nutritionnelle des protéines animales, en s’opposant implicitement aux substituts industriels.
Au final, l’article met en lumière une guerre d’influence dans laquelle les entreprises cherchent à orienter la perception du public autour de la notion de « bonne protéine ». Il souligne la nécessité d’une meilleure transparence et d’une distinction claire entre communication scientifique et marketing, dans un contexte où l’alimentation devient un enjeu de réputation autant que de consommation.
Libération, Cuisiner avec les enfants, «ça les fait grandir et ça les rend autonomes, 14/11/2025
L’article explore les bénéfices éducatifs, sensoriels et affectifs associés à la pratique culinaire chez les enfants, en s’appuyant sur les témoignages de chefs, de parents et de professionnels. Contrairement à l’idée répandue que la cuisine pourrait être trop complexe ou dangereuse pour les plus jeunes, plusieurs intervenants expliquent qu’elle constitue au contraire un terrain d’apprentissage particulièrement riche. Les enfants montrent en effet une grande curiosité pour les aliments, les textures et les gestes culinaires, souvent avec un enthousiasme supérieur à celui des adultes.
La cheffe Julia Sedefdjian insiste sur l’importance de ne pas chercher la perfection technique lorsqu’on cuisine avec un enfant. Les gestes approximatifs, les morceaux de légumes inégaux ou les préparations légèrement détournées du résultat attendu font partie intégrante du processus. L’enjeu est moins d’obtenir un plat impeccable que de permettre à l’enfant de manipuler, d’observer et de comprendre. Selon elle, lorsqu’on confie une mission précise à un enfant, celui-ci se concentre, s’implique et gagne en autonomie.
L’article montre également que la cuisine renforce la confiance en soi. De nombreux parents témoignent que leurs enfants se sentent valorisés lorsqu’ils contribuent au repas familial, qu’il s’agisse de préparer un gâteau, d’assaisonner une salade ou de surveiller une cuisson simple. Cette participation crée une dynamique positive et renforce le sentiment de responsabilité.
Au-delà des aspects pratiques, la cuisine sert de support à la transmission culturelle et familiale. Les enfants apprennent à reconnaître les produits, à comprendre la saisonnalité et à développer un rapport plus sain et moins anxieux à l’alimentation. Ils sont aussi plus enclins à goûter des plats variés lorsqu’ils participent à leur élaboration.
L’article souligne enfin que cuisiner ensemble favorise la créativité et encourage les échanges intergénérationnels. Cette activité devient un espace d’expérimentation où l’enfant peut adapter une recette, proposer des idées ou découvrir des techniques simples. Dans un quotidien souvent rythmé par la rapidité et l’efficacité, la cuisine apparaît comme un moment de ralentissement utile, permettant de construire une relation plus apaisée à la nourriture. L’article conclut que cuisiner avec les enfants constitue une pratique formatrice, enrichissante et accessible, contribuant à développer autonomie et plaisir de faire.
L’Usine Nouvelle, Mercosur : Le Brésil, ce géant qui a toujours plus d’appétit pour nourrir le monde, 14/11/2025
L’article propose une immersion dans les régions agricoles du Brésil pour analyser les dynamiques qui font du pays l’un des principaux moteurs de l’agroalimentaire mondial. Première puissance exportatrice pour de nombreuses commodités – soja, sucre, café, jus d’orange, bœuf, poulet, coton –, la nation consolide année après année un modèle fondé sur l’ampleur de ses surfaces cultivables, la compétitivité de ses exploitations et une stratégie assumée d’internationalisation. Le reportage suit notamment le trajet d’un camion chargé vers le port de Santos, symbole des flux colossaux qui irriguent la filière exportatrice. Dans l’État de São Paulo, région pivot pour l’agriculture et la transformation agroalimentaire, la productivité s’impose comme un objectif cardinal.
Sur le terrain, les exploitants décrivent un système exigeant mais performant, porté par un climat permettant plusieurs récoltes annuelles et par des investissements constants dans les technologies agricoles. Le soja, culture reine, illustre cette dynamique : largement tourné vers la Chine, son débouché principal, il devrait connaître une croissance continue dans les prochaines années. Les industriels anticipent même un doublement des broyages grâce à la progression des agrocarburants. Plus largement, les projections à l’horizon 2035 annoncent une augmentation sensible de la production de bœuf, de poulet et de maïs, confirmant la place centrale du pays dans l’alimentation mondiale.
L’article montre également l’intérêt accru des grandes multinationales, attirées par le potentiel du marché brésilien. Nestlé prévoit plus d’un milliard d’euros d’investissements pour moderniser et étendre ses capacités de production locales, notamment dans le café et le chocolat en poudre. D’autres groupes, comme Tereos ou Louis Dreyfus, renforcent eux aussi leur présence via de nouveaux sites ou centres logistiques.
Toutefois, cette expansion n’est pas sans controverse. L’Union européenne, et en particulier la France, maintient une position critique vis-à-vis du Mercosur, notamment en raison des préoccupations environnementales. La réglementation européenne contre la déforestation importée est perçue au Brésil comme un frein injuste à ses exportations. Sur place, les acteurs insistent sur les progrès réalisés en matière de pratiques agricoles, comme le zéro labour ou le stockage de carbone dans les sols, tout en reconnaissant la place dominante des pesticides.
L’article conclut que le Brésil, porté par une stratégie politique stable et une compétitivité agricole unique, continuera d’accroître son influence dans les échanges agroalimentaires mondiaux, indépendamment des hésitations européennes.
Les Échos, Fromages, foie gras… ces crises sanitaires qui ont joué un mauvais tour à la balance commerciale de la France, 19/11/2025
L’article analyse l’impact des épizooties successives — grippe aviaire, maladie hémorragique épizootique (MHE), fièvre catarrhale ovine (FCO) et dermatose nodulaire contagieuse (DNC) — sur les exportations françaises de produits animaux et la balance commerciale. Ces crises, qui fragilisent durablement l’élevage, entraînent des restrictions imposées par plusieurs pays importateurs, provoquant une chute notable des ventes de certains produits emblématiques comme le foie gras ou les fromages au lait cru.
Le secteur du foie gras illustre l’ampleur de ces conséquences. Le Japon, qui représentait 15 % des exportations françaises en 2015, a suspendu toute importation depuis fin 2023, au début de la campagne de vaccination des canards. Cette décision a porté un coup sévère à une filière déjà fragilisée par les abattages massifs liés à la grippe aviaire.
Les fromages au lait cru, dont le comté, le roquefort ou le rocamadour, sont également touchés. Plusieurs pays, dont le Canada et le Royaume-Uni, ont fermé leur marché à ces produits après les alertes liées à la DNC dans les deux Savoie, région fortement productrice. Chaque année, plus de 18 000 tonnes de fromages au lait cru sont exportées, et les restrictions représentent une perte coûteuse pour les filières concernées.
L’article rapporte les inquiétudes du Conseil national des appellations d’origine laitières (CNAOL), qui alerte sur une possible disparition du lait cru si aucun plan de sauvegarde n’est mis en place. Les éleveurs doivent composer avec des coûts sanitaires élevés, une intensification des mesures de précaution et des pertes importantes liées à la destruction de lots.
Malgré les campagnes de vaccination, les difficultés persistent, car certains pays refusent d’importer des animaux ou produits issus d’animaux vaccinés. L’Italie et l’Espagne maintiennent par exemple un blocage sur les bovins vaccinés contre la DNC.
Enfin, les autorités vétérinaires françaises mènent un travail diplomatique pour convaincre les partenaires commerciaux de la sécurité sanitaire des produits. Certaines avancées sont observées, notamment la réouverture partielle de marchés autrefois fermés aux volailles françaises.
L’article conclut que la répétition des crises sanitaires fragilise durablement la compétitivité des filières animales françaises et que leur avenir dépendra de la capacité à restaurer la confiance internationale grâce à des protocoles sanitaires reconnus et une communication renforcée.
Les Échos, Le plan d’attaque de Picard pour gagner un million « d’aficionados », 17/11/2025
L’article analyse la stratégie mise en place par Picard pour élargir significativement sa base de clientèle fidèle, avec un objectif ambitieux d’un million de nouveaux adeptes. L’enseigne, leader français du surgelé, profite de la période festive — qui représente près d’un quart de son chiffre d’affaires annuel — pour déployer une offre renforcée, comprenant environ 150 produits spécialement conçus pour les fêtes. Ces innovations, qui s’inscrivent dans l’ADN culinaire créatif de la marque, doivent séduire une clientèle à la recherche de praticité mais aussi de produits qualitatifs.
Sous la direction de Cécile Guillou, arrivée en 2023, Picard cherche à moderniser son image tout en maintenant son positionnement fondé sur la simplicité d’usage, la maîtrise des recettes et la fiabilité de l’offre. La directrice générale doit également composer avec une croissance ralentie, dans un contexte de reflux de l’inflation. Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a progressé que de 1,2 % sur l’exercice 2024-2025, malgré l’ouverture de 40 magasins.
L’article souligne que la poursuite du développement du réseau reste une priorité. L’enseigne prévoit d’intensifier les ouvertures, notamment via la franchise, afin de consolider sa présence sur le territoire. Cette stratégie s’accompagne d’une réflexion plus large sur le modèle économique, Picard devant gérer une dette importante héritée du rachat via LBO. Une normalisation des coûts de l’énergie lui a permis de dégager de nouvelles marges de manœuvre.
L’international constitue un autre axe majeur. Bien que la présence de Picard en dehors de la France reste limitée, l’entreprise multiplie les partenariats avec de grandes enseignes étrangères, telles que Ahold Delhaize aux Pays-Bas, Ocado en Grande-Bretagne et AEON en Asie. L’objectif est d’accroître la visibilité de la marque dans les rayons surgelés de marchés porteurs et de développer un canal de croissance complémentaire.
L’article conclut que la stratégie de Picard repose sur une combinaison d’innovation culinaire, d’expansion du réseau et de développement international. L’objectif du million d’« aficionados » se fonde sur l’idée que la marque peut renforcer son attractivité en consolidant son identité tout en adaptant son modèle à un marché en mutation, où le surgelé gagne en légitimité et en diversité.
Les Échos, Vico joue la carte France sur un marché du snacking très disputé, 13/11/2025
L’article analyse la stratégie de Vico, marque historique du snacking salé, qui célèbre ses 70 ans dans un marché en forte croissance mais marqué par une concurrence accrue. Deuxième acteur du segment des chips et produits apéritifs en France, la marque s’appuie sur un ancrage national fort et sur une diversification continue de son offre pour attirer les consommateurs. L’article rappelle que Vico profite de l’essor du rituel de l’apéritif, devenu un moment clé de sociabilité, notamment chez les 25-34 ans. Le marché, qui pèse près de 3 milliards d’euros annuels, est en progression régulière, ce qui ouvre des opportunités pour les marques les plus dynamiques.
Vico, propriété du groupe européen Intersnack, a élargi sa gamme bien au-delà de ses chips originelles. Curly, Monster Munch, les mélanges Apérifruits ou la gamme Natur’&Bon permettent à la marque de couvrir tous les segments, des produits les plus gourmands aux options perçues comme plus saines. L’entreprise mise aussi sur la créativité gustative, avec des innovations inspirées des cuisines du monde. L’exemple de la gamme Vico Street Food illustre cette stratégie d’innovation, qui vise à séduire un public jeune par des saveurs originales et « dépaysantes ».
L’article met en avant l’importance du modèle d’approvisionnement, fondé sur des filières locales. Vico travaille avec environ 45 agriculteurs dans les Hauts-de-France, parfois depuis trois générations. Cette relation de long terme permet d’assurer traçabilité, qualité et sécurité d’approvisionnement. La marque valorise cet engagement comme un argument différenciant par rapport aux concurrents internationaux, notamment PepsiCo, qui domine le marché mais n’a pas d’usines en France.
Sur le plan industriel, Vico a investi 100 millions d’euros en cinq ans pour moderniser ses lignes de production, réduire sa consommation énergétique et améliorer la qualité de ses produits. Ses deux usines françaises, situées à Vic-sur-Aisne et Charvieu-Chavagneux, produisent 45 000 tonnes par an.
Dans ce contexte concurrentiel, Vico mise à la fois sur l’ancrage national, le renouvellement constant de l’offre et une communication événementielle appuyée, comme son partenariat récent avec le Tour de France. L’ensemble de ces éléments permet à la marque de conforter sa position et de se développer dans un marché où l’innovation et la transparence sont devenues essentielles.
Les Échos, Bernard Magrez réinvente le bordeaux pour séduire la génération Z, 11/11/2025
Face à une filière viticole bordelaise en crise, marquée par des arrachages de vignes et une baisse de consommation chez les jeunes, Bernard Magrez lance une nouvelle gamme baptisée « bordeaux n°12 ». L’article présente ce projet comme une tentative de reconquête d’un public âgé de 25 à 35 ans, souvent peu attiré par les vins de Bordeaux, jugés trop tanniques ou trop codifiés. Magrez, propriétaire de quarante châteaux dont quatre grands crus classés, cherche à proposer un produit plus accessible, tant par le goût que par le prix.
Le vin se décline en rouge et en blanc, avec une composition pensée pour offrir une dégustation plus légère et fruitée. Le rouge associe merlot et cabernet sauvignon, tandis que le blanc est un sauvignon pur. Proposé autour de 5 euros, ce vin doit permettre à la marque de toucher une clientèle moins habituée à consommer des bouteilles d’appellation bordelaise.
L’article insiste sur l’importance du design dans la stratégie de Magrez. L’étiquette, conçue à partir d’une œuvre du street-artiste JonOne, introduit un style visuel coloré et contemporain, en rupture avec les codes traditionnels du vignoble bordelais. Dans un rayon où les références se comptent par centaines, cet habillage représente un levier déterminant, d’autant que 70 % des achats se font sur ce critère.
Le lancement de bordeaux n°12 intervient dans un contexte difficile pour la région. Le vignoble bordelais souffre à la fois de la concurrence internationale, de l’évolution des goûts des consommateurs et d’une image perçue comme élitiste. En proposant un produit plus ludique, moins intimidant, Magrez entend réintroduire Bordeaux dans les habitudes des jeunes adultes, qui se tournent davantage vers les bières artisanales, les cocktails ou les vins du Nouveau Monde.
Certains experts cités dans l’article saluent l’initiative, considérant qu’elle peut remettre Bordeaux en phase avec les tendances actuelles. D’autres y voient un risque d’affaiblir l’identité historique du vignoble. L’article souligne toutefois que le défi n’est pas tant de rompre avec la tradition que de redonner de la visibilité à un vin emblématique en adaptant ses codes aux attentes contemporaines. Pour Magrez, cette stratégie pourrait ouvrir la voie à un renouvellement plus large de la filière.
The Guardian, Ultra-processed food linked to harm in every major human organ, study finds, 19/11/2025
L’article présente les conclusions de la plus vaste revue scientifique jamais réalisée sur les effets des aliments ultra-transformés (AUT) sur la santé humaine. Publiée dans The Lancet, cette série de trois études rassemble les travaux de 43 experts internationaux et met en évidence un lien entre la consommation d’AUT et des atteintes touchant l’ensemble des organes majeurs du corps humain. Les auteurs estiment que ces produits constituent une « menace sismique » pour la santé mondiale, en raison de leur omniprésence dans les régimes alimentaires contemporains.
Les AUT—plats préparés, céréales sucrées, sodas, snacks emballés, barres protéinées ou fast-food—remplacent progressivement les aliments frais dans l’alimentation des enfants et des adultes. Dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, ils représentent plus de la moitié des apports quotidiens, avec des niveaux pouvant atteindre 80 % dans les populations jeunes ou défavorisées. Selon la revue, les régimes riches en AUT sont associés à une douzaine de pathologies : obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, dépression, troubles métaboliques, et risque accru de mortalité toutes causes confondues.
Une méta-analyse de 104 études de cohorte montre que 92 d’entre elles signalent une augmentation du risque de maladies chroniques. L’un des auteurs, le professeur Carlos Monteiro, rappelle que les humains « ne sont pas biologiquement adaptés » à consommer des aliments conçus industriellement avec additifs, arômes artificiels ou émulsifiants. Monteiro est également l’auteur du système de classification Nova, qui distingue quatre niveaux de transformation, dont le dernier correspond aux AUT.
L’article souligne que les AUT ne se contentent pas d’être très caloriques et pauvres en nutriments : ils sont aussi conçus pour être hyper-appétents et pour remplacer les repas traditionnels, favorisant la surconsommation. Les entreprises alimentaires mondiales sont accusées d’alimenter activement cette évolution en mobilisant marketing intensif, lobbying politique et financement de recherches favorables. Selon la troisième étude de la série, ce sont ces stratégies corporatives, davantage que les comportements individuels, qui expliquent la montée des AUT.
Face à l’ampleur du phénomène, les auteurs appellent à des mesures rapides : étiquetage des ingrédients caractéristiques des AUT, restrictions publicitaires—notamment envers les enfants—, interdiction dans les écoles et établissements publics, et réduction de leur présence dans les supermarchés. Le Brésil est cité comme exemple positif, avec un programme scolaire excluant la plupart des AUT.
Des scientifiques indépendants saluent la revue, tout en rappelant que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour préciser les mécanismes causaux.
Financial Times, In Paris, the next coffee revolution is quietly brewing, 18/11/2025
L’article décrit l’émergence d’une nouvelle dynamique au sein de la scène café parisienne, marquée par une montée en gamme, une recherche accrue de précision et une exploration des techniques les plus pointues du secteur. Alors que Paris était encore considérée dans les années 2000 comme un bastion du mauvais café, dominé par les robustas amers servis dans les bistrots, la capitale s’impose désormais comme l’un des foyers les plus innovants du café de spécialité. Ce renouveau s’inscrit dans une évolution en plusieurs vagues : après l’ère du café industriel, puis l’apport des espresso bars inspirés des modèles italiens et anglo-saxons, Paris entrerait aujourd’hui dans une « quatrième vague » centrée sur la technicité, la transparence et l’expression du terroir.
L’article s’appuie sur plusieurs acteurs représentatifs de cette mutation. Joachim Morceau, fondateur de Substance Café — un bar à dégustation sur réservation uniquement — incarne cette volonté d’épure, privilégiant des extractions minimalistes et des cafés floraux provenant principalement d’Éthiopie ou du Panama. Il rejette toute forme d’ajout, y compris le sucre, afin de laisser les arômes s’exprimer dans leur pureté. À ses côtés, Alexis Gagnaire et ses cafés Tanat représentent une approche plus expérimentale fondée sur les fermentations avancées, qu’il s’agisse de macération carbonique ou de co-fermentations avec d’autres fruits. Ce travail vise autant à diversifier les profils aromatiques qu’à offrir des opportunités à des producteurs de plus basse altitude, confrontés aux effets du changement climatique.
L’article évoque aussi Terres de Café et L’Arbre à Café, deux pionniers de la scène parisienne, qui misent sur la biodynamie, la traçabilité et une attention forte au terroir. Leur démarche, plus classique dans sa philosophie, promeut une approche visant à révéler l’origine agricole du café plutôt qu’à multiplier les expérimentations.
Selon les professionnels interrogés, cette nouvelle scène parisienne se distingue par un niveau de précision rarement observé, que ce soit dans les profils de torréfaction, les méthodes d’extraction ou la sélection variétale. Les cafés légers, floraux, presque « théiformes », deviennent un signe distinctif de la capitale. Les établissements pratiquent des prix élevés, mais misent sur un public prêt à considérer le café comme un produit premium, comparable au vin.
L’article conclut que cette « quatrième vague » ne repose pas sur un seul style mais sur la coexistence de démarches variées — innovation, pureté, terroir — qui, ensemble, forgent une identité désormais pleinement parisienne.
Slate, Does the Grocery Cart Actually Need a Makeover?, 16/11/2025
L’article retrace l’histoire du chariot de supermarché et analyse pourquoi, malgré des décennies d’innovations technologiques dans la distribution, cet objet central de l’expérience d’achat a si peu évolué. Alors que les magasins se sont transformés — multiplication des rayons, automatisation, self-checkout, surveillance accrue — le chariot demeure largement inchangé depuis son invention dans les années 1930. L’auteur souligne que cette résistance technologique tient en grande partie à son efficacité : le chariot fonctionne, coûte peu à produire, supporte un usage intensif et répond à un besoin simple et universel.
L’article rappelle que le concept de self-service ne date que du début du XXe siècle, avec l’ouverture de Piggly Wiggly en 1916. Avant cela, les clients donnaient leur liste à un employé qui assemblait les produits. L’essor des supermarchés dans les années 1930 a nécessité un outil permettant aux clients de transporter davantage d’articles — d’où l’invention du chariot par Sylvan Goldman, propriétaire de la chaîne Humpty Dumpty. Son modèle initial, composé d’un cadre de chaise pliante muni de paniers, a d’abord été accueilli avec scepticisme, perçu comme peu masculin ou trop proche des poussettes. Goldman a dû recourir à des mannequins pour normaliser son usage. L’innovation suivante majeure, en 1946, a été le système d’emboîtement des chariots conçu par Orla Watson, qui a permis leur stockage en série et ouvert la voie à la diffusion massive du concept.
Depuis lors, le chariot a peu changé. Des versions miniatures ont été introduites, puis les sièges-enfants, mais sa fonction reste la même : faciliter la consommation massive dans un modèle économique fondé sur les achats en volume. Selon des chercheurs cités, cet outil a même transformé les comportements d’achat en encourageant la déambulation, la distraction visuelle et les achats impulsifs, une logique aujourd’hui prolongée par les interfaces de commerce en ligne.
Face à cette stabilité, de nouvelles entreprises tentent aujourd’hui d’imposer des « smart carts » intégrant pesée automatique, scan des articles, systèmes de paiement embarqués ou écrans cartographiant le magasin. Amazon teste par exemple le Dash Cart, tandis que Woolworths et Walmart expérimentent leurs propres modèles. Mais leur adoption reste marginale : coûts élevés, risques de pannes, faible rentabilité et réticence des clients à changer leurs habitudes freinent leur diffusion.
L’article conclut que, malgré ces tentatives de modernisation, le chariot traditionnel conserve une place centrale. Il demeure l’un des symboles les plus durables du système de consommation, et son remplacement massif paraît peu probable à court terme.
Washington Post, Chopping chives as competitive sport? Chefs are chasing a perfect score., 21/11/2025
L’article explore la manière dont la découpe de la ciboulette, geste culinaire simple en apparence, est devenue un phénomène viral et un marqueur de compétence pour de nombreux chefs professionnels et passionnés. Au cœur de cette tendance se trouve le compte Instagram « RateMyChives », créé par un chef britannique resté anonyme. Ce dernier raconte que l’idée lui est venue après un dîner décevant au cours duquel la mauvaise découpe des ciboulettes lui a révélé le manque de rigueur du restaurant. Estimant que ce détail pouvait refléter une négligence plus large, il a créé un compte dédié à l’évaluation de ces découpes, sans imaginer qu’il deviendrait un phénomène suivi par plus de 85 000 abonnés, dont plusieurs chefs mondialement reconnus.
L’article souligne que l’évaluation de ciboulette s’inscrit dans un mouvement plus large, où les internautes jugent en ligne des objets ou situations anodines — bâtons, styles de marche, chiens — transformant tout en compétition ludique. Sur Reddit, un utilisateur surnommé « Chivelord » publie quotidiennement une photo de ses ciboulettes hachées, invitant la communauté à en détecter les imperfections. Ce défi, à mi-chemin entre entraînement et performance collective, attire plusieurs millions de visiteurs et suscite une participation enthousiaste.
Du côté des professionnels, certains voient dans cet engouement une quête presque sisyphéenne de perfection. Kenji Hurlburt, professeur à l’Institut culinaire d’Amérique, note qu’il existe une beauté dans la tentative de maîtriser un produit naturellement irrégulier. La découpe de la ciboulette étant particulièrement délicate — en raison de sa fragilité, de ses diamètres variables et de sa texture changeante selon sa fraîcheur —, atteindre une coupe uniforme relève d’un défi technique réel. Hurlburt rappelle que même avec de bonnes techniques, il est difficile d’échapper totalement à la critique lorsque les photos sont exposées à des milliers d’internautes.
Pour le créateur de RateMyChives, le succès de la page tient à l’esprit de compétition qui anime les chefs : chacun souhaite prouver sa maîtrise, se comparer aux autres ou montrer ses progrès. Il affirme avoir vu des découpes médiocres provenant de restaurants étoilés, tout comme des réalisations impeccables faites dans des établissements modestes.
L’article conclut que, malgré l’aspect ludique ou dérisoire du phénomène, cette tendance révèle l’importance accordée aux détails dans la cuisine, tout en soulignant que la ciboulette, finalement, reste un ingrédient simple dont la découpe n’a de valeur que celle qu’on veut bien lui attribuer.
Wall Street Journal, Sauerkraut, Kimchi and…Gut Nuts? Fermented Foods Are Having a Moment, 11/11/2025
L’article décrit l’essor remarquable des aliments fermentés aux États-Unis, longtemps cantonnés à des usages marginaux — tels que la choucroute sur un hot-dog — mais aujourd’hui au centre d’un marché en forte croissance et d’une attention scientifique croissante. La fermentation, qui consiste à utiliser des micro-organismes bénéfiques pour transformer les aliments, gagne en popularité en raison de ses effets potentiels sur la santé, notamment l’amélioration du microbiote intestinal et la réduction de certains marqueurs d’inflammation.
Cette tendance s’appuie sur un marché estimé à plus de 61 milliards de dollars sur un an, en hausse de 27 % par rapport à quatre ans plus tôt, selon NielsenIQ. Elle est portée par un engouement croissant pour la « gut health » et pour des produits perçus comme moins transformés. De nombreux acteurs, des grandes entreprises aux start-up, multiplient les innovations : noix fermentées (« Gut Nuts »), crackers à base de chou fermenté, sauces piquantes fermentées ou encore boissons hybrides comme un mélange bleu de jus de cornichon fermenté et de limonade. Le Portland Fermentation Festival illustre cette dynamique : autrefois dominé par des amateurs, il est désormais largement investi par des entreprises professionnelles, et propose des animations pédagogiques telles qu’un « Bacterial Petting Zoo » destiné à sensibiliser le public.
Sur le plan scientifique, plusieurs travaux renforcent l’intérêt nutritionnel pour ces aliments. Des études d’observation associent la consommation régulière de yaourt à un risque réduit de diabète de type 2, d’obésité et de maladies cardiovasculaires. Une étude de Stanford menée en 2021 a montré qu’un régime riche en aliments fermentés — yaourt, kéfir, kimchi, etc. — pouvait diversifier le microbiote et abaisser certains marqueurs d’inflammation. D’autres recherches indiquent que les légumes fermentés, comme la choucroute, présentent des composés protecteurs absents dans le produit cru, et que le processus de fermentation peut augmenter la biodisponibilité de certains nutriments, notamment les vitamines du groupe B. Les scientifiques soulignent toutefois que de nombreuses questions demeurent, notamment sur les types de fermentation les plus bénéfiques ou les mécanismes précis en jeu.
Pour séduire les consommateurs réticents aux saveurs fortes, certaines entreprises proposent des versions adoucies, comme un kimchi sans sauce poisson ou une version « mild ». Les industriels innovent également en termes de praticité, en développant des produits fermentés plus transportables et adaptés à la consommation nomade. L’article conclut que ces initiatives visent à élargir l’accès aux aliments fermentés et à capitaliser sur une tendance durable, nourrie par l’intérêt pour la santé digestive.
Wall Street Journal, How America’s Hottest Chicken Chain Keeps Its Secret Sauce a Secret, 18/11/2025
L’article détaille la stratégie de Raising Cane’s pour protéger la recette de son célèbre « Cane’s Sauce », un élément devenu central dans l’identité et le succès de la chaîne. Fondée en 1996, l’enseigne compte aujourd’hui près de 1 000 restaurants et génère plus de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Le texte montre que, si le menu très réduit—cinq items seulement—contribue à la cohérence de l’offre, la sauce maison est perçue comme le véritable moteur de la fidélité des clients.
La recette, écrite à la main il y a environ 30 ans par l’un des cofondateurs, est conservée dans un coffre-fort à un emplacement tenu secret. Seules quelques personnes l’ont déjà vue. Raising Cane’s a mis en place un ensemble de protocoles pour préserver ce secret : accords de confidentialité pour les responsables, ingrédients livrés dans des sacs non identifiés, mélange pré-assaisonné pour les épices et fabrication quotidienne strictement réservée aux managers en restaurant. Même ces derniers ne connaissent pas les proportions exactes, ce qui limite les risques de fuite.
Cette culture du secret s’avère également un outil marketing puissant, comparable à la mystique entourant la formule de KFC. Malgré les théories selon lesquelles la sauce de Cane’s serait proche d’une variante de Thousand Island, les fans insistent sur son caractère plus poivré et plus relevé, une nuance que la société attribue à son mélange d’épices exclusif.
Le volume de consommation témoigne de l’enthousiasme du public : près de 800 millions de portions individuelles seraient écoulées chaque année. Les clients demandent fréquemment des suppléments, certains allant jusqu’à commander des gobelets de 22 onces remplis de sauce pour un usage domestique. Ce comportement s’est amplifié sous l’effet des réseaux sociaux. Raising Cane’s ne l’encourage pas officiellement, mais l’accepte tant que cela ne perturbe pas l’activité.
L’article souligne également que la sauce est devenue un sujet de fascination culturelle. Employés interrogés, influenceurs et chefs amateurs multiplient les tentatives d’imitation, sans parvenir à reproduire exactement le goût original. Quelques consommateurs pensent avoir trouvé un équivalent chez certaines marques de grande distribution, mais l’entreprise affirme que son mélange d’épices reste difficile à copier.
En conclusion, le texte montre que le secret autour du Cane’s Sauce fonctionne comme un atout commercial, renforçant l’image de la marque et contribuant largement à son statut de chaîne de poulet la plus dynamique du pays.
Forbes, From Fax Machines To AI: How Chipotle’s CTO Revolutionized Its Digital Business, 18/11/2025
L’article retrace la transformation numérique majeure menée par Curt Garner, aujourd’hui président et directeur de la stratégie et de la technologie chez Chipotle. Lorsque Garner rejoint l’entreprise en 2015 en tant que premier chief information officer, il découvre une organisation dont les commandes en ligne reposent encore en partie sur des formulaires faxés aux restaurants — une méthode archaïque, sans confirmation de réception et sans intégration au parcours client. Face à cette fragmentation, il engage une refonte complète des systèmes numériques afin d’accélérer la transition de la chaîne vers un modèle plus moderne et connecté.
En dix ans, les résultats sont spectaculaires : les ventes numériques passent de 225 millions de dollars (5 % des revenus) en 2015 à près de 4 milliards en 2024, représentant plus d’un tiers de l’activité. Chipotle compte désormais 20 millions de membres actifs dans son programme de fidélité et plus de 3 900 restaurants connectés. Malgré un contexte économique difficile pour le fast-casual, l’entreprise reste l’une des rares sociétés cotées sans dette, un signe de solidité budgétaire attribué en partie au succès du numérique.
L’article souligne que Curt Garner a également modernisé la conception des restaurants : plus de 1 100 établissements disposent d’un « Chipotlane », une voie dédiée au retrait des commandes digitales, qui améliore marges, volumes et rentabilité. La majorité des nouvelles implantations adopteront ce format. Parallèlement, Garner a rationalisé l’organisation interne, développant des outils adaptés aux équipes en cuisine pour synchroniser flux digitaux et service en salle, et optimisant la gestion des temps de préparation.
Le parcours professionnel de Curt Garner est également détaillé. Arrivé par hasard dans l’informatique lors d’un emploi temporaire chez Wendy’s, il gravit les échelons avant de rejoindre Starbucks, où il contribue à la modernisation du programme de cartes cadeaux et au lancement des commandes mobiles. Chez Chipotle, il intervient également à un moment critique, après les crises sanitaires de 2015 ayant fortement ébranlé la marque.
L’article met aussi en lumière l’implication de Curt Garner dans Cultivate Next, le fonds de capital-risque de Chipotle doté de 100 millions de dollars. Il y soutient des projets en robotique, intelligence artificielle, logistique alimentaire et agriculture durable. L’entreprise dépasse désormais ses objectifs annuels d’achats locaux.
Enfin, Curt Garner mise sur la gamification et l’intelligence artificielle pour renforcer la fidélité client. Le chatbot RH « Avo Cado » a déjà augmenté les candidatures et réduit le temps d’intégration. Pour Garner, la technologie doit avant tout améliorer le quotidien des clients et des équipes, plutôt que s’imposer comme une finalité.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey