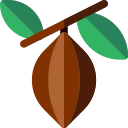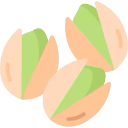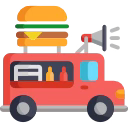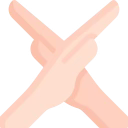🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-33
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la version audio :
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
La Tribune, Le succès des restaurants à concept pousse la restauration traditionnelle à se réinventer, 03/11/2025
Financial Times, Fried chicken wars shake up fast-food pecking order, 06/11/2025
Wall Street Journal, The Amazonification of Whole Foods Is Finally Here—Bring On the Doritos, 01/11/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Libération, «Oreiller de la belle Aurore», un engouement quoi qu’il en croûte, 07/11/2025
L’« oreiller de la belle Aurore », pâté en croûte emblématique de la tradition charcutière lyonnaise, connaît un renouveau spectaculaire. Longtemps tombée dans l’oubli, cette spécialité imposante – jusqu’à 32 kilos pour 60 cm de côté – conjugue raffinement et exubérance avec une farce composée de gibier, volaille, foie gras, ris de veau et truffes, le tout enveloppé dans une pâte bien dorée. Plébiscité par les amateurs de produits d’exception et les influenceurs food, ce mets d’apparat bénéficie d’un regain d’intérêt pour la cuisine traditionnelle française, jusqu’à justifier la création d’un championnat dédié par Joël Mauvigney, président de la Confédération des charcutiers traiteurs.
C’est Pierrick Bougerolle, charcutier de Saulieu, qui a remporté la première édition du concours, avec une version particulièrement élaborée mêlant huit viandes marinées séparément. Son oreiller, déjà commercialisé en boutique et sur les marchés, rencontre un franc succès malgré un prix élevé – jusqu’à 70 € le kilo. Difficile à réaliser en amateur, cette préparation demande savoir-faire, patience et maîtrise technique, tant la complexité des couches, jus, gelées et pâtes exige une exécution rigoureuse.
Derrière ce monument gastronomique se cache une histoire presque légendaire : selon Lucien Tendret, neveu de Brillat-Savarin, il aurait été conçu en hommage à la mère du célèbre gastronome. Reconstituée dans les années 1950 par Claudius Reynon, la recette est depuis perpétuée par sa famille. Très saisonnière, elle est disponible uniquement autour des fêtes de fin d’année, avec des réservations parfois effectuées un an à l’avance.
L’oreiller fascine aussi les chefs : Kei Kobayashi, trois étoiles Michelin, l’a récemment servi avec une sauce au champagne. Une confrérie lui est même consacrée, rassemblant charcutiers, restaurateurs et vignerons passionnés. Si chaque maison y apporte sa touche, tous s’accordent à dire que ce plat incarne l’excellence charcutière française. Chez Verot à Paris, par exemple, on y ajoute pistaches et morilles pour une version gourmande disponible seulement quatre fois par an. Ainsi, l’oreiller devient bien plus qu’un mets : un événement culinaire fédérateur, presque sacré, symbole vivant de notre patrimoine gastronomique.
Libération, «Il faut protéger et préserver les zones clés de production» : au Salon du chocolat, la fièvre de cacao, 02/11/2025
Lors de la 30ᵉ édition du Salon du chocolat à Paris, l’événement festif a laissé transparaître une réalité bien plus préoccupante : la forte tension autour du cacao. Avec un prix de la tonne dépassant les 6 000 dollars fin octobre 2025, les artisans chocolatiers oscillent entre inquiétude et espoir d’un commerce plus équitable. Cette envolée des prix, liée à des récoltes compromises en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana), à cause d’aléas climatiques (pluies, sécheresse, El Niño) et de maladies des plantations, a provoqué une flambée spéculative sur les marchés. Entre début 2023 et fin 2025, les cours ont presque été multipliés par cinq à New York.
Pour les producteurs, cette hausse spectaculaire ne s’est pourtant pas traduite en revenus supplémentaires. Le prix d’achat étant souvent fixé par les États en amont, les planteurs – dont plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté – n’ont pas bénéficié de cette manne financière. Cette injustice nourrit le malaise dans la filière et alimente des pratiques indignes : travail des enfants, déforestation, pauvreté chronique. Christophe Eberhart, cofondateur d’Ethiquable, rappelle que le prix trop bas payé aux coopératives est à la racine de ces dérives.
Pour pallier cette situation, certains acteurs plaident pour un changement structurel. Thierry Lalet, président de la Confédération des chocolatiers, appelle à une meilleure rémunération des planteurs et à la réduction du nombre d’intermédiaires. Des initiatives émergent : collectifs de producteurs, prix d’achat minimums garantis, traçabilité accrue. Christophe Bertrand, chocolatier francilien, défend l’idée d’un « score d’impact » pour mieux informer les consommateurs sur l’origine du cacao.
Face à l’inflation (+22 % en 2024 sur le prix des tablettes), les artisans refusent de voir le chocolat devenir un produit de luxe inaccessible. Selon eux, les consommateurs sont prêts à payer plus pour une qualité artisanale, pour peu que la transparence soit au rendez-vous. Loin du catastrophisme, c’est une prise de conscience collective que beaucoup appellent de leurs vœux. Produire mieux, payer plus équitablement, préserver les zones-clés de culture : telle est la voie défendue pour sauver une filière aussi gourmande que fragile.
Les Échos, Les industriels du chocolat ne profitent pas encore de la baisse des prix du cacao, 06/11/2025
Malgré un recul notable des cours du cacao entre fin 2024 et fin 2025, les industriels du chocolat ne parviennent pas encore à redresser la barre. Le géant Barry Callebaut, premier fournisseur mondial de cacao et chocolat, a annoncé une chute de 6,8 % de ses ventes en volume pour l’exercice 2024-2025. Le chiffre d’affaires, pourtant en hausse de 49 % en raison de la flambée des prix des matières premières, cache une réalité moins reluisante : le bénéfice net récurrent a, lui, chuté de près de 36 % en monnaies locales. La demande, trop volatile, n’a pas suivi la hausse des prix, laissant les industriels dans une situation tendue.
Les principaux groupes du secteur en subissent les conséquences. Mondelez (Milka, Côte d’Or) affiche un bénéfice trimestriel en baisse de 13 % malgré une hausse de chiffre d’affaires. Hershey, de son côté, a vu son bénéfice d’exploitation chuter de 29 % au troisième trimestre 2025, bien que ses ventes soient en hausse. Nestlé, quant à lui, reste également handicapé par la hausse passée des cours du cacao, même s’il s’efforce de réduire sa dépendance en développant des produits hybrides de type « chocobakery », qui utilisent moins de cacao, comme certains KitKat intégrant gaufrettes et autres éléments pâtissiers.
Pour répondre à cette pression sur les marges, les industriels cherchent désormais des alternatives. Barry Callebaut a signé un partenariat stratégique avec Planet A Foods, start-up allemande leader dans les substituts au chocolat sans cacao, avec sa solution ChoViva à base de graines de tournesol. Une stratégie visant à limiter la dépendance aux cours volatils et à diversifier l’offre dans un contexte toujours instable.
En effet, même divisés par deux en un an, les prix du cacao restent environ trois fois supérieurs à leur niveau d’avant-crise, fin 2022. L’impact de cette baisse récente ne se fait sentir qu’avec retard sur les coûts industriels, en raison des stocks et de la logistique. Le transfert partiel de la hausse passée sur les prix consommateur n’a pas suffi à absorber les pertes.
Néanmoins, un vent d’optimisme souffle. Les industriels espèrent un second semestre 2026 plus favorable, porté par des récoltes prometteuses et la stabilisation du marché. En attendant, ils s’adaptent, cherchent des alternatives et ajustent leur stratégie pour traverser une période économiquement incertaine.
Les Échos, « On va encore être les dindons de la farce » : les vins et spiritueux français redoutent le contrecoup de la taxe Gafam, 05/11/2025
La filière française des vins et spiritueux tire la sonnette d’alarme face au projet de doublement de la taxe GAFAM voté par l’Assemblée nationale. Les producteurs craignent une riposte commerciale des États-Unis, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour un secteur déjà fragilisé par les tensions économiques internationales. La filière – qui réalise 16 de ses 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’export – redoute particulièrement le retour de droits de douane punitifs. L’expérience de l’été 2025, où les exportations vers les États-Unis ont été divisées par deux après l’entrée en vigueur d’une taxe de 15 %, reste encore fraîche dans les mémoires.
Gabriel Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), reconnaît que la taxe sur les géants du numérique est légitime sur le fond, mais en dénonce les conséquences potentielles pour une filière sans lien direct avec le numérique. Il souligne l’absence de stratégie de repli en cas de représailles, ce qui reviendrait à « tuer la filière ». Même son de cloche chez Guillaume Girard-Reydet, président de la FFS et de Pernod Ricard France, qui déplore qu’une instabilité à peine résolue risque de basculer à nouveau en crise.
Les représentants de la profession dénoncent également un climat politique défavorable sur le plan intérieur. Les débats autour de nouvelles « taxes comportementales » sur l’alcool, discutées dans le cadre du PLFSS, fragilisent encore davantage le marché domestique. Or, comme le rappelle Géraud de La Noue (Campari France), on ne peut dissocier marché intérieur et export : une filière forte à l’international doit l’être d’abord chez elle.
Les chiffres sont inquiétants : au premier semestre, la filière a connu un recul de 5 % en valeur et de 3 % en volume. Des signaux faibles comme l’augmentation des procédures collectives ou les plans sociaux en préparation suscitent une vive inquiétude. La filière emploie 600 000 personnes directement ou indirectement, majoritairement dans des PME et exploitations viticoles.
La profession appelle à une politique économique plus stable et cohérente. Elle rejette les mesures fiscales prises sans concertation ni vision globale, qui risquent de pénaliser lourdement un secteur déjà sous pression. Au cœur de leurs revendications : le besoin d’un soutien actif et d’une meilleure prise en compte de la spécificité de leur activité dans les décisions publiques.
Les Échos, Viticulture : la stratégie des vins de Pays d’Oc pour résister à la tempête, 03/11/2025
Dans un contexte de crise viticole sans précédent, l’IGP Pays d’Oc tire son épingle du jeu grâce à une stratégie rigoureuse mêlant structuration de la filière, régulation innovante et marketing ciblé. Alors que la filière viticole française souffre d’un manque de coordination, le Sénat souligne dans un rapport récent l’exemplarité de deux régions : la Champagne et les vins de Pays d’Oc. Ces derniers ont su mettre en place des outils efficaces pour stabiliser leur production et préserver les débouchés, en France comme à l’export.
Depuis 2024, l’interprofession a lancé une stratégie de segmentation de l’offre, visant une meilleure adéquation entre production et consommation d’ici 2028. Elle repose sur un pilotage concerté entre viticulteurs (amont) et metteurs en marché (aval), chaque cave bénéficiant d’un « besoin individuel » de commercialisation. Ce système permet de limiter les volumes et d’éviter les excédents, tout en maintenant des prix stables.
Le positionnement commercial des vins de Pays d’Oc s’appuie sur la clarté des cépages (merlot, chardonnay…) bien plus compréhensibles pour les consommateurs que certaines appellations complexes. La gamme couvre tous les segments : du vin d’entrée de gamme à l’offre premium, adaptée à la grande distribution, aux cavistes, à la restauration traditionnelle ou gastronomique. La filière mise aussi sur les formats alternatifs très prisés à l’export, comme les Bag-in-Box ou les poches souples, et expérimente même des cocktails à base de vin pour séduire les jeunes générations.
Sur le plan réglementaire, l’IGP a obtenu une dérogation pour produire des vins à faible degré d’alcool (9 %) et a instauré une réserve climatique afin de faire face aux aléas, comme le gel de 2021. Elle a aussi validé un accord de durabilité avec Bruxelles, qui fixe un prix de référence pour les vins bio et HVE en vrac, incluant une marge bénéficiaire allant jusqu’à 20 %.
L’interprofession anime également un Club des Marques, mutualisant les budgets promotionnels à l’international à travers des plans triennaux ciblés. Enfin, elle ambitionne d’inclure les vins effervescents dans son cahier des charges pour renforcer sa présence sur les segments festifs et cocktails, un levier stratégique en lien avec le potentiel du vignoble blanc local.
Avec ses 120 000 hectares, 6 millions d’hectolitres produits par an et 1,9 million exportés, l’IGP Pays d’Oc montre qu’une gouvernance cohérente et une vision à long terme permettent de bâtir une filière résiliente, même en temps de crise.
Le Monde, En Provence, sur la piste de la pistache, 06/11/2025
Longtemps oubliée, la culture de la pistache connaît un retour remarquable en Provence, à la faveur du changement climatique et d’un nouvel engouement gastronomique pour ce fruit à coque aux notes subtiles. Sur le plateau de Valensole, l’agriculteur Aurélien Payan a été l’un des premiers à replanter des pistachiers, arbres résistants à la chaleur et à la sécheresse, parfaitement adaptés aux conditions extrêmes du sud de la France. S’il a fallu quatre ans pour obtenir une première récolte, les rendements restent modestes – à peine 100 kg sur 8 hectares – mais la promesse d’un produit d’exception à haute valeur ajoutée est bien réelle.
La pistache, très présente en Provence jusqu’au XXᵉ siècle, revient dans les vergers après des décennies d’abandon. Cette renaissance a été accélérée par l’entrepreneur Olivier Baussan, fondateur de marques iconiques (L’Occitane, Le Petit Marseillais), qui, frappé par l’absurdité d’importer des pistaches américaines très gourmandes en eau, a fédéré 130 agriculteurs autour du projet « Pistache en Provence ». Résultat : 500 hectares plantés et l’objectif ambitieux d’atteindre 1 000 tonnes de production annuelle à moyen terme, sur un marché français de 10 000 tonnes.
Côté consommation, la pistache vit un véritable boom depuis 2024, notamment grâce au succès viral du « chocolat Dubaï », une tablette garnie de crème de pistache. Elle séduit aussi les chefs et pâtissiers : Yann Couvreur, Philippe Conticini ou Pierre Hermé en font un ingrédient star de leurs créations. La Maison de la pistache, nouvelle enseigne d’Olivier Baussan, en valorise toutes les formes (huiles, thés, glaces, pestos). D’autres boutiques comme La Pistacherie à Paris ou Lyon surfent aussi sur la tendance.
Les restaurateurs provençaux s’approprient peu à peu ce produit local aux saveurs végétales fines. Certains, comme Anaïta Torkmani ou Manuel Barthélemy, explorent son potentiel en cuisine salée comme sucrée : soupe traditionnelle, gaufres, focaccia à la stracciatella, ou millefeuille à la crème de pistache. La diversité des variétés – Bronte (Italie), Antep (Turquie), Qazvin (Iran), Égine (Grèce) – enrichit encore l’éventail des saveurs.
Ce renouveau va de pair avec une exigence de durabilité : agriculture sèche, récolte manuelle, respect de la biodiversité. Le défi pour la filière française reste d’assurer la montée en puissance de la production tout en rééduquant les palais à la délicatesse d’un fruit souvent réduit à sa version salée et industrielle. Mais en Provence, la pistache s’impose déjà comme un symbole d’innovation agricole et gastronomique.
La Tribune, Le succès des restaurants à concept pousse la restauration traditionnelle à se réinventer, 03/11/2025
Alors que la restauration traditionnelle traverse une période critique, les établissements fondés sur un concept fort connaissent un essor fulgurant. En 2025, le secteur traditionnel souffre : hausse du coût des matières premières, baisse de fréquentation, explosion des charges, et un panier moyen en recul. Dans le Sud de la France, pourtant soutenu par le tourisme, l’activité a baissé de plus de 6 %, et les procédures collectives ont bondi de 21 % au deuxième trimestre.
À contre-courant, les restaurants à concept séduisent un public en quête d’expériences. Bars à cordons bleus, dîners dans le noir, cuisines centrées sur un aliment, ambiances immersives inspirées d’époques ou de cultures : ces établissements répondent à une demande contemporaine où le repas devient un prétexte à vivre un moment marquant, souvent photogénique et partageable sur les réseaux sociaux. Pour Laëtitia Faure, experte en tendances marketing, le visuel est devenu central : il faut que l’assiette soit aussi spectaculaire que bonne.
À Nice, Jean Valfort incarne ce renouveau avec son Panorama Group : rooftop méditerranéen, brasserie façon années 1920, dîner de plage… Il affirme que l’important n’est plus seulement ce qu’on mange, mais le décor, l’ambiance, la mise en scène. Son chiffre d’affaires a progressé de 35 % entre juillet et septembre, preuve que le modèle fonctionne.
Deux tendances dominent : d’un côté, les enseignes « mass market » comme Zara ou Ikea qui lancent leurs concepts food en imitant les codes du luxe ; de l’autre, les chefs et marques premium qui justifient des prix élevés par l’expérience offerte. Ce double mouvement met la restauration traditionnelle sous pression. Pour survivre, elle doit s’adapter, selon Thierry Marx et l’UMIH, en élargissant ses cartes à des cuisines du monde et en modernisant l’expérience client.
Mais la concurrence est rude : plats à emporter, livraison, restauration rapide, chaînes optimisées. Le ticket-restaurant élargi et les espaces micro-ondes de supermarchés comme Picard siphonnent la clientèle du midi. Face à ce bouleversement, les professionnels demandent des mesures fortes : formation obligatoire à la gestion pour les restaurateurs, taux de TVA réduit à 5,5 % pour la cuisine faite maison, ou encore un permis d’entreprendre pour éviter les faillites.
La restauration traditionnelle ne disparaîtra pas, mais elle ne peut plus ignorer les mutations d’un marché désormais guidé par l’expérience et l’émotion.
CNBC, America’s food trucks are nearing $3 billion business, but the road to success is getting rougher, 01/11/2025
Le secteur des food trucks aux États-Unis connaît une croissance impressionnante, frôlant les 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel avec plus de 92 000 camions en activité. Pourtant, derrière cette réussite apparente, les défis se multiplient. Si la croissance du nombre de food trucks est estimée à +17 % dans les prochaines années, leur croissance en chiffre d’affaires ralentit nettement (+0,2 % seulement en 2025 selon IBIS), signe d’un marché plus difficile.
Autrefois perçus comme une alternative abordable aux restaurants traditionnels, les food trucks doivent désormais faire face aux mêmes pressions économiques : inflation sur les ingrédients et les carburants, nouvelles taxes sur l’aluminium et l’acier (utilisés dans les équipements), et hausse des coûts de fonctionnement. Résultat : les prix au menu augmentent, parfois jusqu’à 30 % pour certains produits, comme l’indique Angel Ruiz, gérant du food truck new-yorkais Birria-Landia. Ce dernier, bien que très populaire, a dû ajuster ses prix de 12,5 % pour absorber les coûts, tout en veillant à ne pas perdre sa clientèle.
Contrairement à une idée reçue, un food truck n’est pas une « solution bon marché » : l’achat du véhicule équipé peut coûter jusqu’à 170 000 dollars, auxquels s’ajoutent les assurances, les permis sanitaires, les contraintes logistiques et réglementaires, sans oublier la gestion quotidienne, souvent assurée par une seule personne. La complexité administrative, la difficulté à obtenir un bon emplacement et la nécessité d’avoir un plan B en cas d’imprévu (chef absent, météo défavorable, etc.) font de l’activité un véritable défi opérationnel.
Face à ces enjeux, les food trucks évoluent. Beaucoup misent désormais sur des services de traiteur, des événements privés ou des partenariats avec des marques pour générer l’essentiel de leurs revenus. Le modèle hybride, entre cuisine mobile et restaurant fixe, tend aussi à se développer, à l’image de Birria-Landia qui prépare l’ouverture d’un point de vente physique à New York.
Plus que jamais, le succès passe par l’innovation culinaire, l’ancrage local, une forte identité de marque et une gestion rigoureuse. Les food trucks ne sont plus seulement une solution pratique : ils deviennent des acteurs à part entière de l’économie gastronomique urbaine, mais sur une route semée d’embûches.
Washington Post, At 89, she’s a top nutrition expert. Here’s what she eats in a day, 05/11/2025
À 89 ans, Marion Nestle demeure l’une des voix les plus influentes en matière de nutrition. Professeure émérite à l’université de New York, elle a marqué plusieurs générations par ses ouvrages critiques sur l’industrie agroalimentaire et ses conseils nutritionnels sans fard. Son livre majeur, Food Politics (2002), dénonçait déjà l’impact massif des industriels sur la santé publique, pointant leur rôle dans la diffusion des aliments ultra-transformés et leur lobbying actif contre toute régulation.
Nestle suit une philosophie alimentaire simple : « Manger de la vraie nourriture, pas trop, surtout des végétaux », inspirée du journaliste Michael Pollan. Elle prône une alimentation peu transformée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et produits laitiers simples. Elle ne diabolise ni les écarts ni les aliments plaisir, et reconnaît volontiers sa chance : un bon métabolisme, aucun problème de poids, un rapport serein à la nourriture.
Son quotidien alimentaire est ancré dans le réel : du café au lait au réveil, des céréales complètes ou du porridge avec des fruits en saison, des repas improvisés selon les produits disponibles sur sa terrasse ou au marché, et souvent des salades. Elle consomme peu mais varié : œufs, fromages, fruits, légumes croquants, pain, et parfois quelques aliments ultra-transformés, qu’elle choisit avec discernement. Elle évite ceux dont la liste d’ingrédients est longue ou incompréhensible.
Marion Nestle aime les glaces — en particulier au gingembre —, les bonbons See’s Candies, et les chips de maïs simples. Elle se montre méfiante envers les compléments alimentaires, estimant que leur contenu réel est souvent incertain et leur utilité discutable. Elle n’en prend pas, préférant s’en remettre à une alimentation équilibrée.
Son dernier ouvrage, What to Eat Now, est une mise à jour de son best-seller de 2006. Il ne s’agit pas d’un guide de régime, mais d’un outil pour comprendre les transformations de l’offre alimentaire : explosion des eaux fonctionnelles, multiplication des laits végétaux, développement des viandes végétales. Elle y rappelle l’importance de décrypter les étiquettes, de fuir les ingrédients artificiels et d’être lucide face à une industrie qui vend des produits de moins en moins sains sous couvert de marketing santé.
Marion Nestle continue de militer, par l’exemple et l’écriture, pour une alimentation informée, modérée, locale et joyeuse.
Forbes, Meet The Billionaires Behind A Food Empire Built On Dessert Topping, 02/11/2025
Fondé en 1945 par Robert E. Rich Sr., Rich Products est devenu un géant méconnu de l’agroalimentaire américain, avec 5,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et une présence dans plus de 100 pays. À l’origine de ce succès : une invention pionnière, la première crème fouettée non laitière, conçue comme une alternative bon marché, stable et facile à conserver à la crème traditionnelle. Malgré les poursuites du lobby laitier (plus de 40 procès), le produit devient un best-seller dans l’après-guerre.
Aujourd’hui, l’entreprise, valorisée à plus de 7 milliards de dollars, appartient toujours à 100 % à la famille Rich, qui entend la garder privée “pour l’éternité”, selon Bob Rich Jr., fils du fondateur et président honoraire. Son épouse, Mindy Rich, est présidente du conseil depuis 2021. Leur stratégie repose sur une gestion familiale rigoureuse, des décisions rapides, une croissance par étapes, et une culture d’entreprise résolument locale et éthique.
L’entreprise ne se limite plus à la chantilly : son portefeuille comprend pizzas, pâtisseries, pains surgelés, glaces Carvel, produits de la mer SeaPak, mousse de lait pour coffee shops et desserts industriels pour Walmart, Kroger ou Dunkin’. Rich’s compte désormais 60 marques acquises depuis les années 1970, et prévoit d’atteindre 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030, en misant sur des produits innovants, simplifiant la logistique des restaurateurs.
Le parcours de Bob Jr., ancien joueur de hockey et héritier initialement réticent, illustre l’esprit entrepreneurial de la famille. Il a dû apprendre par l’expérience, notamment lors de l’échec d’une première production au Canada. Il a ensuite piloté l’internationalisation du groupe et renforcé l’ancrage local, en rachetant par exemple le club de baseball des Buffalo Bisons pour le maintenir dans la ville.
Rich’s reste fermement implanté à Buffalo, malgré les nombreuses offres d’aide au déménagement vers d’autres États. La famille considère cette fidélité comme un engagement communautaire. Le nom “Rich Stadium”, premier accord de naming dans l’histoire de la NFL (1973), symbolise encore cette fierté régionale.
Les héritiers ne sont pas automatiquement promus : les enfants doivent d’abord réussir ailleurs. Ted Rich, actuel directeur de la croissance, est considéré comme un successeur possible, mais l’entreprise insiste davantage sur la notion de “stewardship” (gestion responsable) que sur la transmission dynastique.
Avec une philosophie résumée par “pas de bon business avec de mauvaises personnes”, Rich’s montre une rare cohérence entre croissance économique, valeurs humaines et enracinement local. Son histoire est celle d’une dynastie discrète mais puissante, qui continue de bâtir un empire à partir d’un simple nuage de chantilly végétale.
Wall Street Journal, Caviar on Everything—and Other Annoying Restaurant Trends, 30/10/2025
Entre présentations spectaculaires, ingrédients de luxe détournés et expériences calibrées pour Instagram, de nombreux professionnels de la restauration dénoncent des tendances devenues contre-productives, voire irritantes, pour les clients comme pour les équipes en salle. L’article compile leurs griefs et propose une remise en question salutaire du « trop-plein » dans la gastronomie contemporaine.
1. Le caviar à toutes les sauces
Longtemps symbole de luxe, le caviar est aujourd’hui utilisé à outrance, jusque sur des hamburgers, cheesecakes ou nuggets. Pour la consultante Leith Steel, cette débauche n’a souvent aucune logique gustative et relève plus de la démonstration de statut que du plaisir culinaire. Résultat : un ingrédient subtil perd sa noblesse, transformé en simple argument de prix.
2. Les carafes peu pratiques et l’absence d’eau du robinet
Les bouteilles vintage à bouchon mécanique séduisent visuellement, mais posent problème en salle : trop petites, elles nécessitent des recharges incessantes, au détriment du confort client. Autre irritant : certains établissements refusent de proposer de l’eau du robinet, ce qui est perçu comme exclusif et élitiste, surtout quand seules les options « pétillante ou plate » sont offertes.
3. Les décors pour réseaux sociaux
Vespas en salle, murs à néons, balançoires… Les installations conçues pour les selfies peuvent gêner la circulation, détourner l’attention du repas et faire douter de la qualité réelle de la cuisine, selon plusieurs restaurateurs. Une esthétique trop travaillée devient parfois un leurre.
4. Les limites de temps imposées aux clients
Héritées des mesures sanitaires, les restrictions de durée de repas subsistent dans certains restaurants, parfois imposées dès l’accueil. Pour Benjamin Berg, cela nuit à l’hospitalité et transforme l’expérience en acte purement commercial. Mieux vaut, selon lui, orienter discrètement les clients vers la sortie en fin de service plutôt que d’imposer une contrainte d’emblée.
5. Les fleurs et micro-pousses décoratives
Les éléments comestibles décoratifs – fleurs, herbes minuscules – sont rarement mangés car les clients doutent de leur comestibilité. En plus d’être coûteux et périssables, ils n’apportent pas toujours de valeur gustative. La cheffe Alejandra Espinoza leur préfère des herbes plus franches comme la coriandre.
6. Les discours trop formatés des serveurs
Des introductions longues et récitées sur le menu et l’histoire du restaurant lassent de plus en plus. Elles peuvent même déshumaniser l’échange avec les clients réguliers, selon Alexios Milioulis. Un accueil plus naturel, ouvert au dialogue, est préférable.
7. Les mocktails trop exubérants
Les cocktails sans alcool rivalisent parfois d’apparat, avec grands verres, pailles surdimensionnées et garnitures voyantes. Pour certains chefs comme Jason Hall, ces boissons manquent de subtilité et de sérieux. Il recommande plutôt des options sobres, plus cohérentes avec l’expérience gustative attendue.
Financial Times, Fried chicken wars shake up fast-food pecking order, 06/11/2025
Dans l’univers du fast-food américain, une nouvelle guerre fait rage, et elle ne se joue plus entre le Big Mac de McDonald’s et le Whopper de Burger King. Désormais, le poulet frit est au cœur de la bataille, redéfinissant les positions des grandes chaînes dans un marché devenu ultra-concurrentiel.
La consommation de volaille a explosé aux États-Unis : plus de 45 kg par personne en 2025, contre moitié moins en 1985, selon le département américain de l’agriculture. Ce boom profite surtout aux formats sans os, comme les tenders et les sandwiches croustillants, plébiscités par les consommateurs, notamment les jeunes adultes de la génération Z, sensibles au prix, à la commodité et au plaisir immédiat.
Paradoxalement, les enseignes historiques du poulet ont du mal à suivre. KFC a enchaîné huit trimestres sans croissance aux États-Unis avant d’enregistrer une légère reprise. Popeyes, autre acteur majeur, voit ses ventes chuter depuis trois trimestres consécutifs et a récemment remplacé son directeur général. Les nouveaux produits — sandwichs à bas prix et box économiques — visent à enrayer la tendance.
À l’inverse, des chaînes généralistes comme McDonald’s capitalisent sur l’engouement pour le poulet. Son Snack Wrap à 2,99 $ — des lamelles de poulet frit dans une tortilla — a contribué à une hausse de 2,4 % des ventes aux États-Unis au dernier trimestre. Le géant annonce désormais vendre autant de poulet que de bœuf, et mise fortement sur ce segment pour capter un marché porteur.
Des challengers comme Wendy’s, en perte de vitesse boursière, se repositionnent avec de nouvelles gammes (“Tendys”) pour séduire les jeunes. Mais la véritable menace vient de deux chaînes privées en forte croissance : Chick-fil-A, désormais troisième chaîne de restauration aux États-Unis derrière McDonald’s et Starbucks, et Raising Cane’s, spécialisée dans les chicken fingers, qui a surpassé KFC en chiffre d’affaires aux Etats-Unis l’an passé.
Cependant, l’opportunisme autour du poulet frit ne garantit pas le succès. Des enseignes comme Chipotle et Shake Shack peinent à fidéliser les jeunes, confrontés à des difficultés économiques : chômage, faibles hausses salariales, et pouvoir d’achat en berne.
Dans ce contexte, la taille devient un avantage stratégique. McDonald’s, avec des marges trois fois supérieures à celles de Wendy’s, peut soutenir des promotions agressives sans entamer sa rentabilité. Pourtant, tenir face à la crise ne suffit pas à relancer les actions des groupes de restauration rapide : tant que les consommateurs à faibles revenus resteront sous pression, le secteur restera sous tension.
La guerre du poulet frit ne fait que commencer, et pourrait profondément restructurer l’ordre établi du fast-food américain dans les années à venir.
Wall Street Journal, The Amazonification of Whole Foods Is Finally Here—Bring On the Doritos, 01/11/2025
Huit ans après son rachat par Amazon pour 13,7 milliards de dollars, Whole Foods connaît une transformation en profondeur qui marque une rupture avec l’ADN historique de l’enseigne, centrée sur les produits bio, naturels et locaux. Désormais, l’influence du géant de la tech s’affiche au grand jour avec l’arrivée de robots logistiques, de produits industriels comme Pepsi ou Doritos, et une réorganisation managériale visant à intégrer Whole Foods dans l’écosystème global d’Amazon.
À Philadelphie, des robots appelés ShopBots permettent de commander via l’application Amazon des produits absents des rayons traditionnels de Whole Foods, comme des lessives ou des sodas classiques. À Chicago, une boutique Amazon Grocery a remplacé un café au sein du magasin, offrant des produits ultra-transformés au sein même d’un espace auparavant réservé au bio. Cette stratégie vise à retenir les clients dans l’univers Amazon, en captant leurs dépenses « ordinaires » sans abandonner complètement le positionnement premium de Whole Foods.
Jason Buechel, actuel PDG de Whole Foods, a été promu à la tête de toute la division alimentaire d’Amazon (y compris Amazon Fresh et Amazon Go), et les employés du siège de Whole Foods deviendront officiellement des salariés Amazon dès décembre 2025. Ce transfert implique la perte de certains avantages historiques, comme les primes liées à la performance de Whole Foods, ou la remise de 20 % pour les employés en magasin.
Amazon affirme vouloir rationaliser ses activités alimentaires et accélérer son développement dans un secteur où sa part de marché plafonne à 4 %. Depuis l’acquisition, les ventes de Whole Foods ont certes progressé de 40 %, mais à un rythme annuel moyen décevant de 5 %, bien en deçà de l’âge d’or de la chaîne dans les années 2010. Certains analystes jugent l’opération peu rentable et estiment que Whole Foods reste marginal dans la stratégie d’Amazon.
En interne, les tensions montent. Les critères de performance d’Amazon s’imposent peu à peu, les rythmes de travail s’intensifient, et le personnel exprime son malaise face à une culture de la rentabilité perçue comme déshumanisante. Un mouvement de syndicalisation a même émergé dans certains magasins. Côté fournisseurs, des voix appellent à la prudence pour ne pas diluer l’image de marque de Whole Foods, précieuse mais fragile.
Face aux critiques sur la baisse de qualité de l’offre alimentaire et l’uniformisation des magasins, Amazon répond par une stratégie d’hybridation. Des projets comme “Project Fusion” prévoient que les équipes de Whole Foods contribuent à la gestion logistique d’Amazon Fresh, brouillant toujours plus la frontière entre les deux marques. Tandis que les clients fidèles regrettent l’esprit pionnier des débuts, d’autres saluent la diversification de l’offre, plus accessible. En vitrine, un panneau résume la posture ambiguë de la marque : « We’re Still Here! »
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey