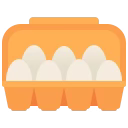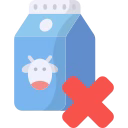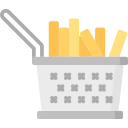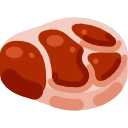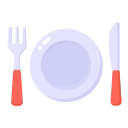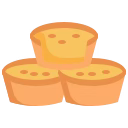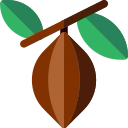🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-32
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la version audio :
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Dans les supermarchés, pourquoi le rayon oeufs est de plus en plus clairsemé, 29/10/2025
New York Times, Whole Foods, MAHA and the Battle Over Healthy Eating in America, 29/10/2025
New York Times, Going Down the Junk Food Rabbit Hole, 27/10/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Les Échos, Dans les supermarchés, pourquoi le rayon oeufs est de plus en plus clairsemé, 29/10/2025
Depuis plusieurs mois, les consommateurs français constatent des rayons œufs peu fournis dans les supermarchés. Pourtant, la filière affirme qu’il n’existe pas de pénurie à proprement parler. Le phénomène s’expliquerait davantage par une forte hausse de la demande que par un problème d’offre. D’après Nielsen IQ, les œufs connaissent le plus fort taux de rupture en grande distribution : 13,3 % depuis le début de l’année, contre 5,6 % l’an dernier. Pour David Lecomte, directeur des études chez Nielsen IQ, ce chiffre est alarmant puisque le seuil « normal » se situe autour de 2 %. Et cette situation dure : depuis juin, les taux de rupture dépassent les 15 %, illustrant une tension durable.
Cette hausse de la consommation est portée par les jeunes adultes, notamment les couples sans enfants de moins de 35 ans, avec une progression de +17 % dans cette catégorie. Produit peu cher, riche en protéines et facile à préparer, l’œuf coche toutes les cases des nouvelles tendances alimentaires axées sur la praticité, l’économie et la santé. Sur les dix premiers mois de 2025, les ventes ont progressé de 4,5 % en volume et de 8,3 % en valeur.
La filière avicole rappelle que les poules pondent quotidiennement et en abondance, mais la chaîne d’approvisionnement, très tendue, ne parvient pas à répondre aux pics de consommation. Selon le CNPO (l’interprofession des œufs), la demande peut varier jusqu’à 100 000 unités autour d’une moyenne mensuelle de 600 000 œufs, rendant la logistique difficile à stabiliser.
En parallèle, la production reste sous pression. Après les ravages de l’épizootie d’influenza aviaire en 2021, le secteur peine à retrouver ses capacités. La construction de nouveaux poulaillers a été stoppée et n’a pas encore repris son rythme. En 2024, l’auto-approvisionnement français en œufs était de 98,6 %, ce qui laisse un déficit structurel d’environ 300 poulaillers pour répondre à la demande actuelle.
Ce déséquilibre entre consommation croissante et production encore convalescente rend la filière vulnérable, malgré l’absence de réelle pénurie. Il interroge aussi sur la résilience du modèle d’approvisionnement et la nécessité de mieux anticiper les évolutions de la demande.
Les Échos, Les laits végétaux renforcent la croissance de Danone, 28/10/2025
Danone confirme son dynamisme dans un secteur agroalimentaire marqué par une croissance atone. Pour le quinzième trimestre consécutif, le groupe enregistre une hausse de son chiffre d’affaires (+4,8 % en données comparables), portée principalement par l’augmentation des volumes (+3,2 %). Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il contraste avec la tendance générale du marché, où la consommation ralentit.
L’Europe, avec +2,6 %, affiche une progression solide. La zone Chine, Asie du Nord et Océanie se distingue avec une hausse spectaculaire de +13,8 %, malgré un effet prix négatif. En revanche, les États-Unis restent en retrait (+1,5 %), notamment à cause d’une concurrence intense sur les produits à base de plantes et dans les crèmes à café. Pour renforcer sa position sur ce marché, Danone mise sur le rachat de Kate Farms, spécialisée dans la nutrition médicale végétale et bio.
Le segment des produits végétaux constitue aujourd’hui un levier stratégique majeur. La gamme Alpro (laits et yaourts végétaux) reprend des couleurs en Europe, après une période post-Covid difficile. Danone a revu sa stratégie en recentrant sa communication sur les bienfaits santé des produits, plutôt que sur leurs ingrédients, ce qui semble porter ses fruits. En particulier, les yaourts végétaux connaissent une croissance soutenue, dans un contexte où les consommateurs recherchent des produits riches en protéines et plus sains.
Parallèlement, d’autres piliers comme les yaourts riches en protéines (YoPro, Oikos) et la nutrition infantile continuent de soutenir la croissance, de même que la catégorie eaux, tirée par la marque Evian.
Danone confirme également sa volonté de se renforcer sur des marchés prioritaires comme les États-Unis, l’Inde, l’Asie et l’Afrique. Dans ce dernier cas, le groupe a récemment noué un partenariat avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour asseoir sa présence. L’entreprise reconnaît toutefois que sa couverture reste limitée dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc ou l’Algérie, où elle entend accélérer son développement.
Enfin, Danone réaffirme sa stratégie d’investissement axée sur la santé intestinale et la science, avec pour ambition de consolider son positionnement sur des segments à forte valeur ajoutée.
Les Échos, Protéines, beurre… pourquoi les industriels laitiers s’intéressent aux activités « ingrédients », 28/10/2025
Souvent méconnus du grand public, les ingrédients laitiers — comme le beurre industriel, les protéines ou les caséines — constituent une source de rentabilité stratégique pour les acteurs de la filière laitière. Ces produits, destinés au B2B (industrie agroalimentaire, nutrition spécialisée, pharmacie…), représentent un débouché de plus en plus valorisé, à la croisée des enjeux économiques, technologiques et environnementaux.
L’exemple de Fonterra, géant néo-zélandais du lait, illustre bien cette dynamique. Après avoir cédé son activité grand public à Lactalis, l’entreprise investit massivement dans la production d’ingrédients laitiers — un milliard de dollars néo-zélandais d’ici 3 à 4 ans — avec une orientation claire vers le beurre industriel, plébiscité pour son goût et sa naturalité. La stratégie de Fonterra vise à se recentrer sur son cœur de métier et à tirer parti de sa saisonnalité forte et de ses coûts de production bas.
En France, les grands groupes comme Bel, Lactalis, Savencia ou Sodiaal s’inscrivent eux aussi dans cette logique de valorisation des coproduits. Bel, par exemple, développe une production innovante de caséines à partir de petit-lait acide (issu de la fabrication des fromages frais) via un procédé de fermentation de précision. Ce procédé inédit permet de transformer un résidu jusqu’ici peu exploité en ingrédient stratégique, destiné à des produits comme La Vache qui Rit ou Kiri.
Les protéines laitières, notamment les caséines, rencontrent un fort engouement, en lien avec la tendance des produits enrichis en protéines. Selon Corentin Puvilland, économiste au Cniel, plus un ingrédient est concentré en protéines, plus sa valeur est élevée — une tendance renforcée ces trois dernières années.
Cette mutation de la chaîne de valeur modifie même l’économie de certains produits finis : dans le cas du cheddar industriel, les coproduits peuvent parfois valoir plus que le fromage lui-même. Le beurre ingrédient, quant à lui, est porté par la demande asiatique et moyen-orientale en viennoiseries.
Les performances financières des industriels confirment cette orientation : chez Savencia, les autres produits laitiers (dont les ingrédients) ont progressé de +5,6 % à fin septembre 2025, grâce à un effet prix favorable et à la performance des ingrédients de spécialités.
Les Échos, Fûts importés de France, capteurs high-tech : quand la Chine se met à faire du bon vin, 25/10/2025
Dans la province chinoise du Ningxia, aride et reculée, un véritable virage viticole est en cours. Le domaine Xige Estate, créé en 2017 par Zhang Yanzhi, symbolise cette montée en gamme spectaculaire. Doté d’un chai ultramoderne, équipé de 4 000 fûts de chêne français et capable de produire 3 000 bouteilles par heure, Xige ambitionne de produire du vin premium à grande échelle. L’entreprise investit chaque année près de 12 millions d’euros et cultive 2 000 hectares de vignes, avec des cépages variés allant du cabernet sauvignon au chardonnay.
Xige incarne la nouvelle stratégie du vin chinois : miser sur la qualité pour séduire une clientèle locale de plus en plus exigeante, mais aussi conquérir les marchés internationaux. Si la consommation de vin en Chine a chuté de 19 % en 2024 — divisée par trois depuis 2019 — les producteurs misent désormais sur la valeur plutôt que les volumes. Ce repositionnement intervient dans un contexte de ralentissement économique et de transformation des habitudes de consommation : le vin devient un produit de consommation personnelle, et non plus réservé aux affaires ou au prestige.
Malgré la baisse de la production (-17 % en 2024), les revenus des domaines du Ningxia ont progressé de 20 %, atteignant 5 milliards de dollars. Le succès s’illustre aussi par la reconnaissance internationale : les vins chinois ont remporté 181 médailles au Decanter World Wine Awards en 2025, dont deux « Best in Show », un record.
Cependant, le développement du vignoble chinois se heurte à plusieurs contraintes : des hivers très rigoureux qui imposent d’enterrer les vignes chaque année, un processus coûteux et très manuel (plus de 1 500 salariés chez Xige), et une dépendance forte aux équipements importés. Le chêne français est notamment plébiscité pour la fabrication des fûts, faute d’alternative locale.
En parallèle, des innovations émergent, comme le vin en canette lancé en 2023 par Xige, ou des gammes d’entrée de gamme à 150 yuans pour répondre à une clientèle plus large. Le haut de gamme n’est pas abandonné : la bouteille « 609 » vendue 96 € a été servie lors du dîner Macron-Xi Jinping.
Entre ambition nationale, technologies de pointe et logique commerciale, le vin chinois poursuit son ascension, même s’il reste encore peu compétitif à l’international.
Le Monde, La frite maison a (presque) tout bon, 30/10/2025
Si la frite est omniprésente dans l’alimentation française, elle traverse aujourd’hui une crise de saveur. Alors que la production de pommes de terre atteint des sommets – près de 200 000 hectares cultivés en 2025, selon le ministère de l’Agriculture – la majorité des tubercules est destinée à la fabrication industrielle de frites surgelées, souvent insipides. Produites par des géants comme McCain ou Clarebout, ces frites standardisées dominent le marché, mais laissent les gastronomes sur leur faim.
Face à cette uniformisation, une résistance s’organise dans les Hauts-de-France, berceau historique de la pomme de terre et de la frite. À Arras, le championnat du monde de la frite réunit chaque année près de 70 000 passionnés autour d’un événement festif et gourmand. Au-delà de la dimension populaire, ce rendez-vous permet de remettre à l’honneur les frites maison et les savoir-faire artisanaux. Des chefs comme Florent Ladeyn, ou des friteurs historiques comme Jean-Paul Dambrine, y proposent des frites dorées à la graisse de bœuf, accompagnées de sauces régionales.
Le concours, très structuré, comporte six catégories (frite créative, familiale, du monde, etc.), mais c’est la frite dite « authentique » qui suscite le plus de convoitise. À travers cette épreuve, les participants défendent une vision artisanale de la frite, fondée sur la qualité des produits et la précision des techniques.
La journaliste et militante culinaire Marie-Laure Fréchet, coorganisatrice du championnat et autrice de Ma frite adorée, rappelle les règles d’or de la frite parfaite : choisir une bonne variété (comme la bintje, l’agata ou la charlotte), respecter la saisonnalité, opter pour une coupe adaptée (cheveu, pont-neuf, bûche…), et maîtriser la cuisson en double bain. La matière grasse (animale ou végétale) joue un rôle crucial, tout comme l’assaisonnement, où les épices et vinaigres régionaux offrent de nombreuses possibilités.
Si les frites restent un plaisir calorique, elles peuvent, bien réalisées, retrouver leurs lettres de noblesse. Des innovations récentes, comme les frites infusées au romarin du chef Siem van Bruggen ou la mayonnaise au piment d’Urfa d’un kebab parisien, montrent qu’il est possible d’allier tradition, créativité et raffinement.
LSA, “Quel est l’avenir de la viande?” [tribune], 24/10/2025
Dans cette tribune engagée, le docteur Jean-Baptiste Bourgeois et l’entrepreneur David Nicolas plaident pour une refondation du modèle d’élevage français, articulée autour d’une alimentation plus durable, plus juste et plus respectueuse du vivant. À leurs yeux, l’opposition stérile entre viande et végétal masque les véritables enjeux de la transition alimentaire : non pas la nature des aliments, mais leur degré de transformation, leur origine et leur mode de production.
Le texte dénonce les deux impasses actuelles : d’un côté, un élevage intensif rentable mais néfaste pour l’environnement et la santé ; de l’autre, un élevage extensif, porteur de solutions mais encore marginal. La filière agroalimentaire, en quête de marges (plus de 42 %), favorise l’intermédiation et l’ultra-transformation, au détriment des éleveurs et de la qualité nutritionnelle. Résultat : la production nationale chute (-12 % en 30 ans), un tiers de la viande consommée est importée, et la crise des vocations s’aggrave.
Les auteurs battent en brèche deux idées reçues. D’abord, croire que l’avenir repose sur l’intensification. Ensuite, penser que consommer moins de viande est une solution universelle. En réalité, la diminution de la consommation est souvent une réaction au modèle industriel, alors que de nombreux Français (femmes, seniors, sportifs) souffrent de carences en fer ou en micronutriments, accentuées par une réduction non compensée de la viande.
Ils rappellent que la viande a joué un rôle fondamental dans l’évolution humaine, apportant protéines, graisses essentielles et nutriments. Ce socle biologique est aujourd’hui mis à mal par l’industrialisation, qui appauvrit le produit, le détourne de sa fonction originelle et le rend suspect dans les débats de société.
L’avenir de la viande passe, selon les auteurs, par une approche fondée sur la densité nutritionnelle, la transformation minimale et le respect des écosystèmes. Des éleveurs engagés montrent déjà la voie, via des pratiques régénératives, des bovins nourris à l’herbe et une valorisation des abats riches en micronutriments. Ces pratiques offrent des produits au bilan carbone quasi nul, surpassant même l’élevage bio intensif.
Ils concluent sur une note éthique : repenser l’alimentation, c’est assumer une responsabilité morale envers les générations futures. Il est temps que les livres de cuisine deviennent les livres d’histoire de demain.
Novethic, Gastronomie durable : Le guide Michelin enterre discrètement son Étoile verte, 31/10/2025
L’Étoile verte, distinction lancée en 2020 par le guide Michelin pour valoriser les restaurants engagés dans une démarche écologique, semble aujourd’hui reléguée au second plan. Le pictogramme vert a discrètement disparu des outils de recherche en ligne du site et de l’application Michelin, rendant les établissements concernés quasiment invisibles — sauf pour ceux cumulant déjà une Étoile rouge classique. Ce retrait numérique a été constaté par plusieurs acteurs du secteur, dont Fanny Giansetto, cofondatrice d’Ecotable, et suscite une incompréhension généralisée parmi les restaurateurs.
Officiellement, le guide Michelin affirme que l’Étoile verte « existe toujours », tout en précisant qu’elle n’est ni un label ni une certification, mais une simple reconnaissance complémentaire. Or, pour nombre d’observateurs, cette mise en retrait signe en réalité la disparition de la distinction. Selon Franck Pinay-Rabaroust, rédacteur en chef du média Bouillantes, l’initiative souffrait déjà d’un manque de cadrage : pas de cahier des charges clair, absence de moyens dédiés, peu de formation des inspecteurs. Face à l’essor rapide de la demande pour une gastronomie plus responsable, le Michelin semble dépassé.
Du côté des chefs, la déception est palpable. Pour Nicolas Conraux, restaurateur breton distingué à la fois par une Étoile rouge et une Étoile verte, cette disparition est un non-sens. Il rappelle que de nombreux clients choisissaient son établissement précisément pour ses engagements écologiques. La distinction servait de repère dans un secteur où la transparence reste rare.
Ce retrait envoie un signal préoccupant pour l’avenir de la gastronomie durable. Alors que 74 % des Français considèrent l’impact écologique comme un critère de choix lorsqu’ils sortent au restaurant (selon un sondage Ifop cité par Ecotable), le secteur de la restauration reste en retard : seuls 1 % des aliments proposés proviennent de l’agriculture biologique. Face à cette inertie, Ecotable appelle à des politiques publiques ambitieuses : formation des professionnels, affichage environnemental, soutien à la transition.
New York Times, Whole Foods, MAHA and the Battle Over Healthy Eating in America, 29/10/2025
Whole Foods, longtemps perçue comme l’emblème du « manger sain » aux États-Unis, se retrouve aujourd’hui au cœur d’un débat idéologique sur la nutrition. Alors que le mouvement « Make America Healthy Again » (MAHA) gagne du terrain, porté par une frange conservatrice dénonçant les additifs, les huiles de graines et les aliments ultra-transformés, la chaîne de supermarchés peine à clarifier sa position. Cela crée un paradoxe : l’entreprise qui a démocratisé l’alimentation bio et naturelle semble silencieuse face à un discours qui épouse pourtant certaines de ses valeurs historiques.
Depuis son rachat par Amazon en 2017, Whole Foods a changé de visage. Le sentiment d’exclusivité a baissé, les prix ont chuté, et la chaîne s’est rapprochée d’un modèle plus grand public. Toutefois, son influence reste forte : ses standards et son offre continuent de guider l’industrie. Mais face à MAHA, Whole Foods se montre prudente. Des figures conservatrices comme Alex Clark, animatrice d’un podcast influent, reprochent à la marque son manque d’engagement apparent envers les idées du mouvement, qu’elle juge pourtant alignées avec sa mission originelle.
D’autres, au contraire, estiment que Whole Foods nourrit la désinformation sanitaire en excluant certains ingrédients jugés sans danger par la communauté scientifique. Cette ambiguïté témoigne d’un repositionnement difficile dans un paysage polarisé, où le « manger sain » est devenu un marqueur politique autant que nutritionnel.
L’héritage de John Mackey, fondateur libertarien de Whole Foods, est encore perceptible : un mélange d’idéalisme communautaire, de capitalisme conscient et de rejet des institutions. Mais cette vision s’accorde mal avec la stratégie centralisée d’Amazon, axée sur la standardisation, la rentabilité et l’expansion.
Sur le plan commercial, Whole Foods continue d’innover, par exemple avec sa nouvelle campagne « It’s What’s Not in the Bag » (mettant en avant 562 ingrédients bannis). Elle cherche aussi à séduire les générations plus jeunes, via une offre élargie, des services numériques et une mise en avant des produits « fonctionnels ».
Néanmoins, la marque peine à retrouver l’aura qu’elle avait dans les années 2000, lorsque ses magasins incarnaient une utopie alimentaire. Coincée entre l’industrie conventionnelle qu’elle a autrefois défiée et les mouvements radicaux qu’elle a inspirés, Whole Foods doit redéfinir son rôle dans une Amérique où « bien manger » est désormais un champ de bataille culturel.
New York Times, Going Down the Junk Food Rabbit Hole, 27/10/2025
L’article explore les raisons de la domination des aliments ultratransformés dans l’alimentation américaine. Mère active et consciente des enjeux sanitaires, la journaliste admet recourir à ces produits pour leur praticité — une contradiction partagée par des millions d’Américains. Plus de 50 % des calories consommées chaque jour aux États-Unis proviennent de ces aliments, malgré les alertes croissantes sur leurs effets sur la santé (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires…).
Son enquête, menée sur plusieurs mois, retrace l’histoire des aliments ultratransformés, de leur essor dans les années 1950 à leur omniprésence actuelle. Elle montre comment la publicité télévisée, les innovations industrielles et le marketing ont ancré ces produits dans les foyers américains. Dès le départ, l’argument de la commodité — repas rapides, longue conservation, formats attrayants — a séduit des générations de consommateurs.
Fait notable : les premières alarmes scientifiques ne viennent pas des États-Unis mais du Brésil, où l’apparition rapide de l’obésité a suscité des recherches pionnières sur les effets spécifiques des aliments ultratransformés. Ces travaux ont nourri le concept de classification NOVA, aujourd’hui largement utilisé pour analyser le degré de transformation des produits alimentaires.
La journaliste s’appuie aussi sur des sources historiques originales : archives d’entreprises agroalimentaires, rapports internes de PepsiCo ou Kraft, et témoignages d’exécutifs de l’industrie. Ces documents révèlent les stratégies de segmentation des marchés, la multiplication des saveurs, ou encore le rôle des entreprises de tabac, autrefois propriétaires de grandes marques alimentaires, dans la diffusion de produits addictifs.
La journaliste revient également sur l’évolution du débat public, marqué par une prise de conscience croissante, mais aussi par un certain désarroi. Beaucoup de consommateurs souhaitent réduire leur consommation d’aliments transformés, mais peinent à identifier ce qui est réellement sain. L’absence de réglementation claire, l’influence des lobbies et le flou des labels compliquent la tâche.
Enfin, elle plaide pour une approche pragmatique : cuisiner davantage à partir d’aliments bruts, sans tomber dans la culpabilisation. Même elle, en tant que mère, reconnaît la difficulté de concilier alimentation idéale et contraintes du quotidien.
Food Dive, Out of the box: How food and beverage giants are making their packaging shine, 30/10/2025
Longtemps reléguée au second plan, l’emballage devient aujourd’hui une priorité stratégique pour les géants de l’agroalimentaire. Face à une concurrence accrue et à des consommateurs plus exigeants, les entreprises repensent leurs packagings pour séduire en rayon, renforcer leur image de marque et stimuler les ventes. Ce virage est porté par des données convaincantes : 80 % des consommateurs affirment avoir acheté un produit parce que l’emballage a attiré leur attention ; près de la moitié ont même changé de marque pour cette raison.
Des marques comme B&G Foods, Conagra ou Suja Life investissent désormais massivement dans le design, les tests consommateurs et les innovations structurelles. Chez Conagra, par exemple, le packaging du repas surgelé « Mega » a été entièrement repensé pour justifier un prix plus élevé. Résultat : un graphisme plus impactant, des mentions nutritionnelles (protéines) mises en avant, et un emballage noir valorisant la qualité perçue. Les ventes ont décollé, faisant de « Mega » un succès en grande distribution.
Le packaging ne se limite plus à l’esthétique : il doit informer, rassurer, refléter les valeurs de la marque (santé, naturalité, durabilité), tout en s’adaptant aux contraintes pratiques (ouverture facile, conservation, recyclabilité). Suja Life, marque de jus pressés à froid, a ainsi revu toute sa charte graphique pour mettre en avant les ingrédients, les bénéfices santé (« gut health », immunité) et même un « thermomètre de goût » pour guider les consommateurs.
L’article souligne aussi les risques liés aux changements d’emballage. Trop brutaux ou mal accueillis, ils peuvent provoquer une chute des ventes, comme l’a connu Tropicana en 2009 après un rebranding rejeté. Frito-Lay, de son côté, a dû abandonner un emballage biodégradable trop bruyant pour ses chips Sun Chips, malgré son ambition écologique.
Aujourd’hui, le packaging est perçu comme un levier de croissance, non plus un simple coût. Les entreprises s’entourent de spécialistes (designers, ingénieurs, psychologues du comportement) pour tester des prototypes en conditions réelles, parfois fabriqués en quelques heures grâce à des technologies internes comme celles de l’agence PV&COHO.
Food Dive, Food companies can now certify their products as free from ultraprocessed ingredients, 30/10/2025
Face à la méfiance croissante des consommateurs envers les aliments ultratransformés (UPF), un nouveau label fait son apparition aux États-Unis : le certificat « Non-UPF ». Porté par le nutritionniste Melissa Halas et soutenu par le Food Integrity Collective (également à l’origine du label Non-GMO), ce programme vise à identifier clairement les produits exempts de transformation excessive, d’additifs artificiels ou d’ingrédients jugés nocifs.
L’objectif est double : permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et inciter les marques à reformuler leurs produits pour répondre à la demande d’aliments plus sains. Le programme s’appuie sur la classification NOVA, un système reconnu qui distingue quatre niveaux de transformation. Les UPF, au sommet de cette échelle, incluent les produits industriels contenant des substances absentes des cuisines domestiques (colorants, arômes artificiels, édulcorants, émulsifiants…).
La démarche intervient dans un contexte où 70 % des Américains déclarent vouloir éviter les aliments ultratransformés, mais où seuls 37 % s’estiment réellement capables de les identifier. Le label « Non-UPF » pourrait donc combler ce déficit d’information. Il s’ajoute à d’autres initiatives similaires, comme celle du Non-GMO Project, qui a récemment lancé un label pilote sur le même sujet.
Cependant, l’absence de définition officielle des UPF pose problème. Ni la FDA ni le consensus scientifique n’ont encore tranché sur les critères précis de cette catégorie. Certains produits considérés comme ultratransformés (barres protéinées, yaourts aromatisés) peuvent néanmoins présenter un intérêt nutritionnel réel. Ce flou pourrait nuire à la lisibilité des nouveaux labels et semer davantage de confusion.
En Californie, un premier pas a été franchi avec une loi bannissant les UPF dans les cantines scolaires, intégrant une définition légale de ces aliments. Cette initiative pourrait inspirer d’autres États et accélérer la normalisation de ces certifications.
Si le succès du label « Non-UPF » dépendra de son adoption par les grandes marques, il marque déjà un tournant : la transformation industrielle devient un critère de choix aussi important que le sucre, les matières grasses ou le sel. En plaçant la transformation au cœur des débats sur la santé publique, cette nouvelle génération de labels redéfinit les contours de l’alimentation « saine ».
Eater, For Lisbon, the Pastel de Nata Is a Gift and a Curse, 27/10/2025
Symbole incontournable de la gastronomie portugaise, le pastel de nata est devenu l’emblème touristique de Lisbonne. Mais ce succès fulgurant, notamment depuis le boom touristique des années 2010, suscite aujourd’hui un malaise croissant chez les habitants. L’article explore la manière dont cette pâtisserie à base de crème d’œuf cristallise à la fois la réussite économique et la transformation controversée de la capitale.
Autrefois simple en-cas local, le pastel de nata est désormais omniprésent. De nouvelles chaînes comme Manteigaria, Nata Lisboa ou Fábrica da Nata ont ouvert des dizaines de points de vente dans le centre-ville. On en trouve dans les cafés, les hôtels, les aéroports, chez Starbucks ou même chez Zara, qui a ouvert un corner pâtisserie avec l’aide de Castro Atelier, une marque haut de gamme. Certains quartiers touristiques, comme la Rua Augusta, comptent jusqu’à huit boutiques spécialisées sur 100 mètres.
Si cette dynamique génère de l’emploi et attire les visiteurs, elle contribue aussi à l’uniformisation de l’offre, à l’exclusion des habitants (chassés par la hausse des loyers), et à la fermeture de commerces historiques. Le pastel de nata est devenu une « monoculture pâtissière », selon les critiques. Des pâtisseries artisanales proposant des douceurs régionales disparaissent, faute de rentabilité face à un produit hyper-standardisé, facilement instagrammable et optimisé pour le rendement.
Certaines marques, comme Castro, revendiquent une exigence de qualité, avec des recettes précises et des procédés de fabrication rigoureux. Mais cette sophistication masque parfois une déconnexion du contexte local : des cafés épurés, interchangeables, qui pourraient se trouver à Copenhague ou Paris, et non dans les ruelles lisboètes.
Le pastel de nata est également devenu un marqueur de la gentrification lisboète. L’article cite des chiffres alarmants : les prix immobiliers ont explosé de plus de 200 % dans le centre historique ; plus de 70 % des logements y sont aujourd’hui des locations touristiques. Les habitants fuient, les commerces ferment, et les protestations s’intensifient.
À travers ce dessert, Lisbonne illustre les contradictions d’un modèle économique basé sur le tourisme de masse : un produit culte devenu arme à double tranchant. Comme le résume un pâtissier : « Les rouages de l’économie lisboète sont graissés à la crème pâtissière. »
Financial Times, The rise of the eat-at-home economy, 24/10/2025
Le secteur de la restauration traverse une mutation profonde : de plus en plus de consommateurs préfèrent désormais manger chez eux, même lorsqu’ils recherchent une expérience « gastronomique ». Cette tendance, exacerbée par la pandémie et la pression inflationniste, favorise l’essor d’une « eat-at-home economy », où les plats premium s’invitent à domicile.
Des marques comme Charlie Bigham’s au Royaume-Uni incarnent ce phénomène. Le spécialiste des plats cuisinés haut de gamme vient de lancer une gamme Brasserie, comprenant des recettes sophistiquées comme le bœuf Wellington ou le coq au vin, vendues jusqu’à 30 £. Le message est clair : on peut vivre une expérience digne d’un restaurant sans quitter son salon. Cette stratégie cible une clientèle qui, auparavant, aurait fréquenté les établissements gastronomiques.
Les distributeurs suivent la même voie. Tesco a dévoilé sa collection Finest Chef’s Collection, aux prix allant jusqu’à 20 £. De son côté, Gousto, spécialiste des box-recettes, mise sur des options “Fine Dine In” pour séduire les gourmets. Tous capitalisent sur un même constat : le repas à domicile peut rivaliser avec celui du restaurant — en termes de goût, mais aussi de présentation et de rituel.
Cette mutation s’explique par plusieurs facteurs. L’inflation a fait bondir les prix dans les restaurants, y compris pour des offres accessibles comme les chaînes ou les gastropubs. Les clients cherchent donc des alternatives économiques, sans sacrifier la qualité. Par ailleurs, la pandémie a changé durablement les habitudes : les gens sont plus enclins à passer leurs soirées chez eux, parfois avec des amis, dans un cadre maîtrisé.
L’émergence de nouvelles technologies, de services de livraison performants et d’emballages plus soignés favorise aussi cette transformation. L’aspect esthétique des plats prêts à consommer à domicile s’est nettement amélioré, tout comme leur composition nutritionnelle.
Enfin, les professionnels de la restauration doivent s’adapter à cette nouvelle donne. Certains chefs investissent dans les plats en kit ou les recettes prêtes à emporter, tandis que d’autres cherchent à réinventer l’expérience sur place pour la rendre plus exceptionnelle et justifier le surcoût.
Ce « restaurant à la maison » n’est plus un pis-aller, mais une véritable alternative culturelle et économique. Il redéfinit la place du repas dans nos vies et bouscule les frontières entre cuisine domestique, industrie alimentaire et restauration professionnelle.
Wall Street Journal, Chocolate Makers Hopeful That 2026 Brings Cheaper Cocoa, 30/10/2024
L’industrie du chocolat traverse une période de forte turbulence, confrontée à une flambée historique des prix du cacao. Depuis 2023, les cours ont doublé, atteignant des niveaux records sur les marchés internationaux. Les causes sont multiples : mauvaises récoltes répétées en Côte d’Ivoire et au Ghana, maladies touchant les cacaoyers, vieillissement des plantations, mais aussi effets du changement climatique avec des sécheresses et inondations extrêmes.
À cela s’ajoutent des tensions structurelles. Les deux pays d’Afrique de l’Ouest qui assurent ensemble plus de 60 % de la production mondiale ont mis en place des réformes pour augmenter les revenus des producteurs, via des prix planchers et des taxes à l’exportation. Si ces mesures visent une meilleure répartition de la valeur, elles renchérissent le coût pour les transformateurs et industriels.
Résultat : les fabricants comme Hershey, Mondelez ou Barry Callebaut voient leurs marges fondre. Certains ont commencé à réduire le poids des tablettes, reformuler les recettes, ou encore augmenter les prix en rayon. D’autres réduisent leurs promotions, suspendent temporairement certains produits ou décalent des lancements.
Malgré cette pression, les industriels espèrent un retournement en 2026. Les signaux sont contrastés. D’un côté, de nouvelles plantations arrivent à maturité. De l’autre, la demande mondiale reste soutenue, notamment en Asie, où la consommation de chocolat continue de croître. L’incertitude reste donc forte.
Des analystes tablent sur un léger repli des prix si les récoltes 2025-2026 s’avèrent bonnes. Toutefois, la volatilité des marchés et les aléas climatiques rendent toute prévision fragile. Pour se prémunir, certains industriels investissent davantage dans des contrats à long terme, des alternatives au cacao traditionnel, ou des programmes de soutien direct aux producteurs afin de sécuriser leur approvisionnement.
En toile de fond, la pression monte aussi du côté des consommateurs, soucieux à la fois du prix et de la durabilité. La traçabilité, les labels éthiques et les pratiques agricoles deviennent des critères d’achat. Les fabricants doivent ainsi composer avec un double défi : maintenir une offre accessible tout en renforçant leurs engagements environnementaux et sociaux.
The Guardian, Inside the Republican network behind big soda’s bid to pit Maga against Maha, 19/10/2025
L’article dévoile les manœuvres politiques menées par les géants de l’industrie des sodas aux États-Unis pour contrer le mouvement MAHA, un courant conservateur prônant une alimentation plus saine, et souvent critique des produits ultra-transformés, dont les boissons sucrées. Ironiquement, MAHA, bien que proche de l’électorat MAGA (Make America Great Again), attaque frontalement des entreprises historiquement soutenues par les Républicains.
Face à cette menace, des groupes comme l’American Beverage Association (ABA), soutenus par Coca-Cola, PepsiCo ou Dr Pepper, ont activé un réseau d’influenceurs, de think tanks conservateurs et de figures politiques républicaines pour discréditer le mouvement MAHA auprès de la base électorale. L’objectif : faire passer la rhétorique anti-sodas pour une dérive liberticide ou élitiste, en l’opposant à la « liberté de choix » et à l’« Amérique populaire ».
Des campagnes médiatiques et numériques ont ainsi été lancées, souvent discrètement financées via des groupes de façade. Des vidéos et publications virales accusent MAHA de vouloir imposer un mode de vie rigide, d’interdire certains aliments ou de stigmatiser les consommateurs modestes. Le message clé : défendre le droit de boire un soda sans être jugé.
Ce retournement stratégique est d’autant plus frappant que le combat contre les boissons sucrées était jusqu’ici largement porté par les milieux progressistes, via des taxes soda ou des campagnes de santé publique. Désormais, certains conservateurs dénoncent MAHA comme un avatar puritain, voire autoritaire, détourné des valeurs américaines.
En coulisses, les industriels redoutent l’effet MAHA sur leurs ventes, déjà affectées par la montée des eaux plates, des boissons fonctionnelles ou des alternatives plus naturelles. Une adoption plus large de la philosophie MAHA — qui rejette notamment les édulcorants, les arômes artificiels et les additifs — pourrait accélérer le déclin des sodas classiques.
Le clivage entre MAGA et MAHA révèle une fracture au sein même de l’électorat conservateur : entre culture du plaisir et quête de santé. Et il souligne à quel point la nutrition est devenue un enjeu idéologique central aux États-Unis, dépassant les simples choix individuels.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey