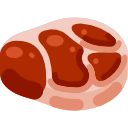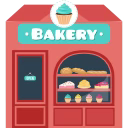🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-30
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la version audio :
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, De la start-up au rachat d’une chaîne de restaurants, les recettes du succès de Bao Family, 11/10/2025
L’Usine Nouvelle, Vérités et contre-vérités sur la consommation de viande : ce que disent les chiffres, 15/10/2025
Financial Times, Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss, 19/10/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Figaro, «Berceau de la gastronomie, la France doit redonner à ses enfants le goût du bien manger», 17/10/2025
Stéphane Layani, président du Marché international de Rungis, sonne l’alarme sur un paradoxe français : patrie de la haute cuisine et des terroirs, la France voit pourtant ses enfants s’éloigner du « bien manger », sur fond d’obésité croissante, de maladies chroniques liées à l’alimentation et de filières agricoles fragilisées. Pour lui, l’éducation alimentaire n’est pas un luxe mais un droit fondamental au même titre que lire, écrire ou compter, conditionnant la santé tout au long de la vie et la souveraineté alimentaire du pays . Former le goût revient à former le jugement : apprendre à résister aux sirènes de l’ultra-transformé, valoriser le travail agricole et retisser le lien entre ville et campagne. L’école est la première courroie de transmission, plus efficace qu’une énième campagne anti-malbouffe, à condition d’incarner cette éducation au quotidien, dans l’assiette et les pratiques des cantines .
Stéphane Layani avance trois leviers immédiats. D’abord, reconnaître officiellement les Marchés d’Intérêt National (MIN) comme relais stratégiques des achats publics alimentaires, afin de sécuriser qualité, traçabilité et sanitaire pour les cantines du territoire. Ensuite, flécher des financements pérennes vers des actions concrètes (formation des personnels de cantine, potagers pédagogiques, visites de fermes, retour des cours de cuisine en 6e), en affectant réellement le produit des taxes sur les boissons sucrées à la santé publique et à l’éducation alimentaire. Enfin, réconcilier les programmes scolaires et la restauration collective : aujourd’hui, le « coût matière » ne représente qu’environ 20 % du coût total d’un repas scolaire – soit près de 2 € pour un repas facturé 10 € –, ce qui bride la capacité à cuisiner frais et local. Sans moyens accrus, les objectifs Egalim resteront des injonctions sans effet .
Au-delà de la santé publique, Layani inscrit l’éducation alimentaire dans un projet de société : préserver le patrimoine gastronomique, soutenir les territoires ruraux, et redonner aux jeunes la joie transmissible du « bien manger », rappelée par la Semaine du Goût. L’ambition, dit-il, est de transformer chaque repas en leçon vivante de saisonnalité, de diversité et de lutte contre le gaspillage — une « révolution tranquille » à mener par l’école, les cantines et la puissance publique, de concert .
Le Figaro, «Aujourd’hui, le client au restaurant recherche l’effet waouh»: la mythique bande du Crillon se confie sur la cuisine contemporaine, 10/10/2025
Dans cet article trois figures emblématiques de la gastronomie française issues du célèbre Hôtel de Crillon (Christophe Hache, chef étoilé ; Boris Campanella, chef pâtissier ; et Xavier Thuizat, sommelier multi-récompensé) livrent une réflexion lucide et parfois critique sur l’évolution de la restauration française, entre quête d’émotion et diktat de l’« effet waouh ». Ce terme, devenu central dans les attentes des clients, symbolise à la fois l’exigence d’une expérience sensorielle totale et la dérive d’un certain spectacle culinaire.
Les trois anciens du Crillon constatent que la clientèle, de plus en plus connectée et habituée à partager ses repas sur les réseaux sociaux, cherche avant tout l’instant de surprise ou de stupéfaction : un plat photogénique, une mise en scène, un produit rare. La cuisine s’est ainsi transformée en performance, où l’émotion visuelle prend parfois le pas sur la cohérence gustative. Cette évolution, disent-ils, oblige les chefs à trouver un équilibre délicat entre créativité et sincérité : séduire sans trahir.
Christophe Hache plaide pour un retour à « l’émotion juste » : celle d’une cuisson maîtrisée, d’une sauce travaillée, d’un produit magnifié. Selon lui, la gastronomie française ne doit pas céder à l’effet de mode mais s’appuyer sur sa profondeur technique et sa culture du goût. Boris Campanella, lui, souligne que la pâtisserie contemporaine s’est transformée en art graphique, parfois au détriment du plaisir simple ; il défend la lisibilité du dessert et la vérité des saveurs. Xavier Thuizat, enfin, rappelle le rôle du vin comme fil conducteur du repas et comme partenaire du chef : un dialogue sensoriel plus qu’une juxtaposition d’effets.
Tous trois s’accordent sur un constat : la jeune génération de chefs est brillante, mais trop souvent sous pression — économique, médiatique, ou liée aux guides. L’avenir de la haute gastronomie passera selon eux par un réenracinement dans l’émotion sincère, la saisonnalité, et la transmission. La vraie modernité n’est pas dans l’« effet waouh », conclut l’article, mais dans la justesse et la simplicité retrouvées du goût.
Libération, De la start-up au rachat d’une chaîne de restaurants, les recettes du succès de Bao Family, 11/10/2025
L’article retrace l’ascension fulgurante de la Bao Family, un groupe de restaurants chinois parisiens fondé par Céline Chung et Billy Pham. En quelques années, ce duo franco-chinois a réussi à dépoussiérer l’image figée de la cuisine chinoise en France, longtemps cantonnée aux buffets standardisés et aux clichés. Leur réussite repose sur un savant mélange d’authenticité, de design, et de storytelling, qui a su séduire une clientèle jeune, curieuse et connectée.
Tout commence en 2018 avec Petit Bao, un premier restaurant dans le 2e arrondissement de Paris, conçu comme un hommage à la cuisine de Shanghai et aux dim sums familiaux. Puis viennent Gros Bao, Bao Express, Bao Kitchen et plus récemment Bao Family Studio, un laboratoire créatif dédié à la R&D culinaire et au design. La clé de leur succès ? Une approche globale qui combine excellence du produit, architecture intérieure inspirée des « cha chaan teng » hongkongais et communication léchée sur les réseaux sociaux. Chaque établissement raconte une histoire, entre nostalgie et modernité, et fait de la cuisine chinoise un univers esthétique et émotionnel.
L’article souligne que cette réussite s’inscrit dans une tendance plus large : la montée en puissance des restaurateurs issus de la diaspora asiatique, porteurs d’une double culture et décidés à réhabiliter leur patrimoine culinaire. Chez Bao Family, la Chine n’est pas réduite à une identité uniforme : les recettes proviennent de multiples régions, de Canton à Sichuan, mais sont réinterprétées avec rigueur et sensibilité, loin du folklore. L’approvisionnement est également travaillé : légumes frais, bouillons maison, viandes françaises, et sauces artisanales.
Sur le plan entrepreneurial, la Bao Family a bâti un modèle de croissance maîtrisée, sans franchise, en misant sur la formation interne et la culture d’entreprise. Le collectif compte aujourd’hui plus de 250 employés et prévoit des ouvertures à l’étranger. Céline Chung revendique une ambition claire : « faire pour la cuisine chinoise ce que Big Mamma a fait pour l’italienne » — démocratiser sans dénaturer, élever sans exclure.
Ainsi, l’article décrit la Bao Family comme un symbole de la nouvelle restauration identitaire : consciente, exigeante, ancrée dans le réel et fière de ses racines. Une success story qui, au-delà de la mode, redonne à la cuisine chinoise ses lettres de noblesse dans le paysage gastronomique français.
L’Usine Nouvelle, La Mère Poulard a cédé sa biscuiterie bretonne pour se concentrer sur ses activités touristiques, 16/10/2025
L’article revient sur un tournant majeur pour l’une des marques emblématiques du patrimoine gastronomique français : La Mère Poulard, célèbre pour ses biscuits et son auberge au Mont-Saint-Michel. L’entreprise, fondée en 1888 par la cuisinière légendaire Annette Poulard, a annoncé la cession de sa biscuiterie bretonne à un groupe agroalimentaire français. L’article analyse les raisons économiques et stratégiques de cette vente, ainsi que les perspectives pour la marque et la filière régionale.
Depuis sa reprise dans les années 2000 par le groupe japonais Akiyama, La Mère Poulard avait cherché à moderniser sa production et à conquérir les marchés asiatiques. Si la notoriété internationale s’est renforcée, notamment au Japon et en Chine, la marque a souffert en revanche d’une érosion de ses ventes en France et d’un positionnement ambigu : entre produit premium artisanal et biscuit industriel de grande distribution. La hausse du coût des matières premières (beurre, œufs, farine) et de l’énergie, combinée à la baisse du pouvoir d’achat, a fragilisé la rentabilité de la biscuiterie installée à Saint-Étienne-en-Coglès, en Ille-et-Vilaine.
Selon l’article, la vente de la biscuiterie à un acteur français s’inscrit dans une logique de recentrage sur l’hôtellerie et la restauration autour du Mont-Saint-Michel, cœur historique de la marque. L’usine, qui emploie environ 80 salariés, poursuivra la production sous licence, garantissant une continuité industrielle et des emplois maintenus à court terme. Cependant, cette cession soulève des interrogations : l’identité artisanale et régionale de La Mère Poulard peut-elle survivre à la logique industrielle d’un nouveau propriétaire ?
L’article évoque aussi un enjeu plus large : la fragilisation du patrimoine agroalimentaire français face aux restructurations de marché. Les marques historiques, souvent perçues comme “authentiques”, peinent à concilier tradition, compétitivité et innovation dans un contexte de concentration croissante. La Mère Poulard n’échappe pas à ce dilemme. Pour certains observateurs, la cession pourrait néanmoins offrir une seconde vie à la marque, si le repreneur investit réellement dans la qualité, la communication et le rayonnement du “made in Bretagne”.
L’Usine Nouvelle, Vérités et contre-vérités sur la consommation de viande : ce que disent les chiffres, 15/10/2025
Un article qui démonte les idées reçues qui entourent la consommation de viande en France, à travers une analyse statistique précise et des données issues de FranceAgriMer, de l’INSEE et de l’Ifop. Alors que le débat sur l’alimentation durable et les impacts environnementaux du bétail occupe le devant de la scène, le magazine s’efforce de replacer les tendances dans leur contexte socio-économique et nutritionnel, loin des caricatures.
Première vérité : les Français mangent de moins en moins de viande, mais pas aussi drastiquement qu’on le croit. Depuis vingt ans, la consommation annuelle est passée d’environ 90 kg par personne dans les années 2000 à près de 82 kg en 2024, soit une baisse de 9 %. Ce recul est particulièrement marqué pour le bœuf, en raison de son prix élevé et de sa mauvaise image climatique, alors que la volaille poursuit sa progression constante (+15 % sur la même période). Le porc reste stable, ancré dans la culture charcutière nationale.
Deuxième vérité : la motivation écologique des consommateurs est réelle, mais souvent secondaire face aux contraintes économiques. L’article montre que le prix est le premier facteur de réduction de la viande, devant les considérations éthiques ou sanitaires. Les jeunes générations, plus sensibles aux discours végans et climatiques, sont surreprésentées parmi les flexitariens, mais continuent de consommer de la viande lors d’occasions conviviales.
Troisième vérité : le secteur de l’élevage s’adapte, en misant sur la qualité, le local et le label. Les filières Label Rouge, Bio ou “Bleu-Blanc-Cœur” connaissent une croissance continue, compensant partiellement la baisse des volumes. Les industriels investissent aussi dans la traçabilité et la réduction de l’empreinte carbone, sous pression de la grande distribution et des réglementations européennes.
Enfin, l’article démonte deux “contre-vérités” répandues : non, la France ne se “végétalise” pas à grande vitesse (la part des végans reste inférieure à 1 %), et non, les alternatives végétales ne remplacent pas la viande, mais s’y ajoutent dans les pratiques hybrides des consommateurs. En revanche, l’image sociale de la viande évolue profondément : elle n’est plus un symbole de réussite ou de virilité, mais un plaisir ponctuel, raisonné, voire coupable.
En conclusion, l’article plaide pour un débat apaisé et informé, fondé sur les données plutôt que sur les postures idéologiques. La viande reste un pilier culturel et économique majeur, mais son avenir passe par une transformation durable du modèle d’élevage et par la réconciliation entre goût, éthique et environnement.
Les Échos, « On ne veut pas d’aides, on veut des vaches » : le recul de l’élevage en France déstabilise le marché européen de la viande de boeuf, 17/10/2025
L’article explore la crise structurelle de l’élevage bovin en France, un secteur en déclin rapide malgré son rôle clé dans l’économie rurale et l’équilibre alimentaire européen. Le titre, emprunté à la colère d’un éleveur du Cantal, résume la situation : les producteurs ne réclament plus de subventions, mais des animaux — autrement dit, la pérennité de leur métier et le renouvellement des cheptels.
Depuis vingt ans, le nombre d’éleveurs bovins français a chuté de plus de 40 %, et le cheptel national a perdu près d’un million de vaches depuis 2016. Cette érosion tient à plusieurs facteurs : faible rentabilité, poids administratif, vieillissement des exploitants, mais aussi désaffection des jeunes pour un métier jugé trop dur et peu valorisé. Les départs à la retraite ne sont plus compensés, et les installations ne suivent pas. Résultat : la France, longtemps premier producteur de viande bovine en Europe, devient importatrice nette, notamment depuis l’Irlande et la Pologne.
L’article souligne que cette évolution fragilise tout le marché européen. La baisse de la production française crée des tensions sur les prix et déséquilibre la filière, alors que la demande reste stable, portée par la restauration hors domicile et l’exportation vers le Maghreb. Bruxelles redoute un effet domino : si le déclin s’accélère, l’autosuffisance européenne en viande rouge pourrait reculer de 10 % d’ici à 2030.
Face à cette situation, les éleveurs dénoncent l’inefficacité des aides de la PAC, trop centrées sur les surfaces plutôt que sur l’activité. Ils réclament un soutien à la production, un plan de revalorisation du métier, et une politique publique qui redonne sens à la transmission des exploitations. Certains syndicats agricoles prônent même un plan Marshall pour l’élevage bovin, incluant des primes à la vache allaitante, la simplification des normes et la relocalisation des abattoirs.
Mais au-delà des chiffres, l’article met en lumière un enjeu humain et culturel : la disparition progressive d’un pan du paysage français. Dans les zones rurales, l’élevage structure encore la vie économique, sociale et paysagère. Sa disparition risquerait d’entraîner friches, désertification et perte d’un savoir-faire séculaire.
L’article se conclut sur une note alarmante mais lucide : sans renouvellement générationnel rapide, la France pourrait devenir dépendante des importations pour une viande autrefois symbole de son excellence agricole. Un basculement historique, qui interroge la souveraineté alimentaire et l’avenir du modèle agricole européen.
Les Échos, Kamel Saci, champion de judo et maître boulanger, 16/10/2025
L’article dresse le parcours atypique de Kamel Saci, un homme qui incarne la réussite par le travail, la passion et la transmission. Ancien champion de judo, devenu artisan boulanger reconnu à New York, Kamel Saci symbolise la nouvelle génération d’entrepreneurs du goût : cosmopolites, créatifs et profondément attachés à la qualité artisanale.
Né à Lyon de parents algériens, Kamel Saci grandit dans un environnement modeste où l’effort est une valeur cardinale. Le sport, puis la boulangerie, deviennent pour lui deux écoles de rigueur et de discipline. Après avoir décroché un brevet de maîtrise et travaillé dans plusieurs maisons réputées, il quitte la France au début des années 2000 pour tenter l’aventure américaine. À New York, il fonde Le District et collabore avec plusieurs concepts de boulangerie haut de gamme, avant de devenir consultant pour de grandes enseignes de la restauration.
Ce qui distingue Kamel Saci, selon l’article, c’est sa vision de l’artisanat comme acte culturel et éducatif. Dans un pays où la baguette vient tout juste d’être inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, il s’impose comme ambassadeur du savoir-faire français. Ses pains, brioches et croissants, produits avec des farines bio et levains naturels, incarnent une exigence qui séduit les chefs new-yorkais autant que les consommateurs en quête d’authenticité.
Mais au-delà du succès professionnel, Kamel Saci met son expérience au service des jeunes. Il a créé des programmes de formation pour adolescents défavorisés, convaincu que l’artisanat peut être une voie d’émancipation. Son message : “La main, le geste et le goût sont des outils de liberté.” Pour lui, la boulangerie, comme le judo, apprend la patience, le respect et la persévérance.
L’article souligne aussi sa réflexion sur le statut social de l’artisan en France. Kamel Saci regrette que les métiers de bouche soient encore trop souvent perçus comme des choix par défaut, alors qu’ils exigent une technicité, une endurance et une créativité comparables à celles des grands métiers d’art. En exportant son savoir-faire, il veut changer cette perception et rendre à la boulangerie son prestige.
Le Monde, Fraîche, frite ou fumée : la « mozzarella di bufala » dans tous ses états, 09/10/2025
Un article riche et documenté qui explore le monde fascinant de la mozzarella di bufala campana, emblème de l’Italie du Sud et symbole d’une gastronomie à la fois simple et sophistiquée. L’article retrace l’histoire, les méthodes de fabrication, les enjeux économiques et les débats identitaires autour de ce fromage désormais mondialement connu, mais souvent mal compris.
La mozzarella di bufala est produite à partir du lait de bufflonne, principalement en Campanie, autour de Caserte et de Salerne. Elle bénéficie d’une appellation d’origine protégée (AOP) depuis 1996, garantissant son authenticité et sa traçabilité. L’article rappelle que cette AOP représente à la fois une fierté et un défi : si la demande explose — plus de 50 000 tonnes produites chaque année —, le marché est aussi saturé de contrefaçons et de copies industrielles. Hors Italie, plus de 70 % des fromages vendus sous le nom de “mozzarella di bufala” ne respecteraient pas les cahiers des charges européens.
L’article détaille le processus artisanal qui fait la singularité du produit : lait frais caillé le jour même, filage à la main dans de l’eau chaude, façonnage rapide pour préserver la texture crémeuse et l’acidité légère. Cette maîtrise exigeante est menacée par la mécanisation croissante et la pression de la grande distribution. Certains producteurs tentent d’y résister, comme les maisons historiques Il Casolare ou Tenuta Vannulo, qui misent sur le bio, le circuit court et la transparence.
Au-delà de la technique, l’article s’intéresse au renouveau gastronomique autour de la mozzarella. Longtemps reléguée à la simple salade tomate-basilic, elle connaît aujourd’hui une revalorisation dans les restaurants haut de gamme : servie tiède, fondante, accompagnée d’anchois, d’huile d’olive millésimée ou de zestes d’agrumes. Des chefs comme Massimo Bottura ou Simone Tondo en font une matière première noble, à la croisée du terroir et de la créativité contemporaine.
Mais la mozzarella di bufala porte aussi des enjeux sociaux et environnementaux. Les élevages de bufflonnes posent la question du bien-être animal et de la durabilité, notamment sur la gestion des déchets laitiers et des pâturages. Face à cela, le Consorzio di Tutela multiplie les contrôles et prône une production plus éthique.
Modern Retail, AI has changed how Kellanova thinks about its customers, 06/10/2025
L’article explore comment Kellanova utilise l’IA pour transformer sa compréhension des consommateurs et repenser sa stratégie marketing. L’entreprise, désormais centrée sur les snacks et céréales à forte valeur ajoutée (Pringles, Pop-Tarts, Cheez-It…), fait de la donnée et des algorithmes un levier majeur pour adapter son offre dans un marché alimentaire en mutation rapide.
Depuis sa séparation d’avec WK Kellogg Co (focalisée sur les céréales de petit-déjeuner traditionnelles), Kellanova s’est repositionnée comme une entreprise d’alimentation “intelligente”, fondée sur l’analyse comportementale et la personnalisation de l’expérience client. Selon son Chief Growth Officer, l’IA est devenue un moteur de décision stratégique, capable de détecter des signaux faibles dans les habitudes de consommation, de prévoir les tendances gustatives et d’optimiser le lancement de nouveaux produits.
Concrètement, l’IA intervient à plusieurs niveaux :
• Analyse prédictive des ventes à partir de millions de données de points de vente, pour ajuster les volumes de production.
• Optimisation marketing : grâce au machine learning, les campagnes publicitaires sont adaptées en temps réel selon les profils de consommateurs et les canaux les plus performants.
• Innovation produit : des algorithmes analysent les avis clients, les publications sur les réseaux sociaux et les comportements d’achat afin de concevoir de nouvelles recettes (par exemple, des versions épicées ou “protein boostées” de snacks populaires).
Parton note que cette révolution technologique s’accompagne d’un changement culturel chez Kellanova : les équipes marketing, R&D et supply chain travaillent désormais de façon intégrée autour de la donnée. L’entreprise forme ses collaborateurs à l’interprétation des modèles d’IA, tout en veillant à éviter le piège de la “décision déshumanisée”. L’objectif n’est pas de remplacer l’intuition marketing, mais de la nourrir.
L’article souligne aussi l’impact de l’IA sur la relation client : Kellanova a mis en place des outils de segmentation avancée permettant de mieux comprendre les attentes émotionnelles liées à la consommation de snacks — plaisir, réconfort, partage. Ces insights servent à développer une communication plus personnalisée, centrée sur l’expérience plutôt que sur le produit.
Enfin, l’article rappelle les enjeux éthiques de cette transformation : respect des données personnelles, transparence algorithmique et lutte contre les biais marketing. Kellanova affirme adopter une approche “responsible AI”, avec audits internes et chartes de bonne pratique.
Financial Times, Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss, 19/10/2025
Dans cet entretien, Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, estime que l’industrie agroalimentaire mondiale est arrivée à un point de bascule historique, sous l’effet conjugué des mutations démographiques, de la révolution scientifique et de l’évolution des attentes des consommateurs. L’alimentation, longtemps perçue comme un secteur mature, se réinvente désormais comme un levier de santé publique.
Le dirigeant français, à la tête du groupe depuis 2021 après la mise à l’écart d’Emmanuel Faber, met en avant une conviction : la prochaine frontière du “manger mieux” passe par la nutrition de précision et la science du microbiome intestinal. Danone, déjà propriétaire de marques comme Activia et Evian, a investi près de 500 millions d’euros en recherche et innovation en 2024, soit une hausse de 10 % en un an. Ces investissements ciblent la microbiologie, la nutrition médicale et la réduction des sucres et additifs dans les produits grand public.
Selon Antoine de Saint-Affrique, de nombreuses maladies chroniques trouvent leur origine dans un déséquilibre du microbiote — conséquence d’une alimentation industrielle appauvrie et d’une surconsommation d’antibiotiques. Danone souhaite donc “reconstruire le lien entre alimentation et santé”, en concevant des produits capables d’avoir un impact physiologique positif, une logique que le groupe “défend depuis toujours”. Cette approche fait écho à la nouvelle politique de santé publique américaine, impulsée par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., qui milite pour une lutte renforcée contre l’obésité et les additifs alimentaires — une orientation que le patron de Danone juge “parfaitement alignée” avec sa stratégie.
Sur le plan financier, le groupe affiche un redressement spectaculaire : ventes en hausse de 4,2 % sur les six premiers mois de l’année, croissance portée par les volumes plutôt que les prix, et performance boursière supérieure à celle de ses concurrents Nestlé ou Unilever (+20 % depuis janvier). Danone a profondément remanié son portefeuille, cédant les activités non stratégiques comme Horizon Organic, réduisant les effectifs de 1 600 personnes et réorientant la gouvernance vers le long terme.
Enfin, la transformation culturelle est centrale : chaque membre du comité exécutif doit rencontrer directement les jeunes salariés sur le terrain. Pour Antoine de Saint-Affrique, ces échanges informels permettent de “comprendre la réalité de l’entreprise en cinq minutes”. Danone, désormais recentré et solvable, prépare de nouvelles acquisitions ciblées — à l’image de Kate Farms (nutrition médicale bio) et de la biotech belge Akkermansia Company, pionnière du microbiome.
Food Dive, Inside Ferrero’s push to become America’s next packaged food giant, 09/10/2025
L’article analyse la stratégie ambitieuse du groupe Ferrero pour s’imposer comme un géant de l’agroalimentaire aux États-Unis, au-delà de ses emblématiques Nutella, Ferrero Rocher et Tic Tac. Longtemps perçue comme une marque européenne de confiserie haut de gamme, l’entreprise familiale luxembourgeoise entend désormais rivaliser directement avec Hershey et Mars, en devenant le principal acteur du marché américain des produits sucrés emballés.
Depuis 2018, Ferrero a mené une série d’acquisitions spectaculaires : Butterfinger, Keebler, Power Crunch, Halo Top, et plus récemment WK Kellogg pour 3,1 milliards de dollars. Cette dernière opération, finalisée en septembre 2025, ouvre à Ferrero les portes du petit-déjeuner américain, grâce à des marques phares comme Frosted Flakes ou Rice Krispies. À contre-courant des grandes entreprises qui se scindent (Kraft Heinz, Keurig Dr Pepper), Ferrero adopte une stratégie d’intégration et de diversification, combinant croissance externe et expansion organique.
Cette approche porte ses fruits : le chiffre d’affaires américain du groupe a atteint 3 milliards de dollars en 2025, soit quatre fois plus qu’en 2018, avec une croissance annuelle moyenne de 7,9 % — un rythme supérieur à celui de ses concurrents. Michael Lindsey, président de Ferrero North America, souligne que peu d’entreprises réussissent à “faire du big M&A et de la forte croissance organique simultanément”. L’objectif affiché est clair : devenir le premier groupe sucré-packagé des États-Unis.
Mais si Ferrero a bâti un empire discret, sa notoriété auprès des consommateurs américains reste limitée. Pour y remédier, la société prépare la plus grande campagne marketing de son histoire : plus de 100 millions de dollars investis en 2026, autour du Super Bowl et de la Coupe du monde de football. Cette offensive vise à repositionner Ferrero comme une marque globale, présente dans toutes les catégories — du chocolat à la glace, du biscuit au petit-déjeuner.
L’innovation est au cœur de cette stratégie : nouveaux formats pour Ferrero Rocher, lancement du Butterfinger au caramel salé, introduction du Tic Tac Chewy, et arrivée de Nutella Ice Cream et Kinder Bueno Frozen Desserts aux États-Unis. En parallèle, Ferrero poursuit une expansion industrielle massive, avec 5 milliards de dollars investis en Amérique du Nord depuis 2019 pour renforcer sa production et ouvrir son premier centre d’innovation hors d’Europe, à Chicago.
Pour Michael Lindsey, cette audace s’explique par le statut privé de Ferrero : “Nous sommes l’un des rares groupes capables d’investir massivement, même en période d’incertitude.” L’entreprise, forte de son indépendance et de son héritage familial, entend bien démontrer que la qualité artisanale et la puissance industrielle peuvent coexister — et que l’avenir du goût s’écrira aussi en Amérique.
Wired, The Bourbon Industry Is in Turmoil. Could Tech Provide the Shot It Needs?, 17/10/2025
L’article propose une enquête approfondie sur la crise actuelle du bourbon américain et sur la réponse inattendue d’une nouvelle distillerie high-tech du Kentucky : Whiskey House, symbole d’une possible renaissance du secteur par la technologie.
Après une décennie d’euphorie, le marché du whiskey s’effondre. Des marques réputées comme Bulleit et Wild Turkey voient leurs ventes chuter (–7 à –8 % au premier semestre 2025), tandis que Kentucky Owl et Garrard County Distilling ont déposé le bilan. Même Uncle Nearest, star montante de la diversité dans le bourbon, est passé en redressement judiciaire. Dans ce climat morose, le lancement de Whiskey House à Elizabethtown (Kentucky) pourrait sembler suicidaire. Pourtant, ses fondateurs David Mandell et John Hargrove, anciens dirigeants de Bardstown Bourbon Company, y voient une opportunité : réinventer la distillation à l’ère des données et de l’automatisation.
Leur pari : une distillerie sans visiteurs, sans marque grand public, 100 % dédiée à la production sous contrat pour d’autres labels, de Calumet Farms à Clyde May’s. L’édifice de 110 000 m² ressemble davantage à un data center qu’à une distillerie traditionnelle. Plus de 1 500 capteurs surveillent en continu chaque étape du processus — fermentation, distillation, température, reflux — tandis que les opérateurs, peu nombreux (7 par équipe), travaillent via des interfaces de contrôle prédictif. L’objectif : éradiquer l’aléatoire humain et garantir une constance de qualité inédite dans l’histoire du bourbon.
Whiskey House produit déjà 120 000 barils par an, avec la possibilité de personnaliser chaque recette. Chaque fût est étiqueté d’un QR code résistant à la chaleur, intégré à une base de données qui permet aux clients de suivre vieillissement, humidité et “angel’s share” (évaporation naturelle). Une IA en cours de développement analysera bientôt les données des chais pour repérer les conditions idéales d’affinage et optimiser la sélection des meilleurs fûts.
Dans un marché saturé où la surproduction menace, David Mandell reste confiant : “Notre avenir, c’est la précision et la flexibilité.” Pour les experts comme Jeff Hopmayer, ancien magnat du bourbon, ce modèle pourrait annoncer la mutation inévitable de l’industrie. L’intégration de l’intelligence artificielle, affirme-t-il, “rend la fermentation et les arômes d’une régularité stupéfiante.”
Financial Times, Are weight loss drugs killing off the business lunch?, 15/10/2025
L’article une mutation inattendue des pratiques professionnelles et gastronomiques: la montée en puissance des médicaments anti-obésité, comme Ozempic et Mounjaro, bouleverse les habitudes de table — notamment le rituel historique du “business lunch” dans les milieux d’affaires britanniques et américains.
Selon les données citées par l’article, près de 12 % des Américains et 1,4 million de Britanniques ont déjà eu recours à ces injections coupe-faim, qui agissent en réduisant la sensation d’appétit. Or, cette révolution silencieuse commence à se faire sentir dans les restaurants : assiettes à moitié pleines, plats sautés, couverts moins souvent dressés. Pour les restaurateurs déjà confrontés à l’inflation et à la pénurie de main-d’œuvre, ce nouveau facteur inquiète.
Dans la City de Londres, plusieurs dirigeants et restaurateurs confient observer un changement net : les repas d’affaires se raccourcissent, les clients commandent moins, souvent une simple entrée ou une salade, et l’ambiance conviviale cède la place à une sobriété nouvelle. Pour Julie McKeen (Odgers), ces déjeuners étaient des moments privilégiés de négociation et de lien humain : “Quand une personne se contente de picorer une salade, l’équilibre relationnel se rompt.”
Certaines figures du monde des affaires, comme l’avocat Sir Nigel Boardman, assument publiquement leur usage de Mounjaro, qu’il compare à un “coach personnel” pour la santé. D’autres préfèrent rester discrets, craignant le stigmate social lié à ces médicaments — perçus comme des raccourcis plutôt que des choix de discipline.
Face à ce phénomène, les restaurateurs s’adaptent. Le chef étoilé Heston Blumenthal propose un “Mindful Experience” au Fat Duck, menu réduit en portions et en prix, fondé sur le plaisir plutôt que la satiété. Tom Brown, au Capital Hotel, ajuste aussi sa carte, tandis que des enseignes comme Hawksmoor ou les établissements du Inception Group testent des offres “small plates” et des menus allégés.
L’industrie reste cependant partagée. Certains y voient une menace durable pour la dépense par client ; d’autres rappellent que la gastronomie a survécu à toutes les modes alimentaires — d’Atkins au 5:2. Comme le résume Kate Nicholls, présidente de UK Hospitality : “Ce n’est pas la fin du business lunch, seulement son évolution.”
L’article conclut sur une note ironique : avant de débuter son traitement, un cadre londonien prévoit un dernier festin — une “Ozempic party” — pour savourer une ultime côte de bœuf. Symbole d’une époque où le plaisir de manger devient aussi un acte mesuré, même dans le monde des affaires.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey