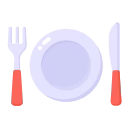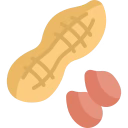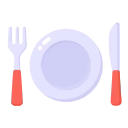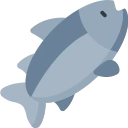🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-29
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la version audio (à laquelle j’ai apporté quelques améliorations) :
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, Restauration : face à l’excès d’adresses, comment le secteur veut renverser la table, 10/10/2025
Les Échos, Ce géant de l’apéro qui veut lancer la production de cacahuètes en France, 06/10/2025
Financial Times, How high-end restaurants went global, 11/10/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Le succès des médicaments coupe-faim aux Etats-Unis oblige les groupes spécialisés dans les produits hypercaloriques à revoir leur stratégie, 10/10/2025
L’essor spectaculaire des traitements antiobésité aux États-Unis, tels que l’Ozempic et le Wegovy, agit comme un véritable électrochoc pour l’industrie agroalimentaire. En réduisant l’appétit et les volumes consommés, ces médicaments bouleversent la demande et menacent le cœur du modèle économique des géants du “snacking” et des produits dits indulgents. L’article explique que la consommation de confiseries, de sodas et de plats préparés recule déjà dans les zones où ces traitements se diffusent le plus rapidement. Mars, Mondelez, PepsiCo ou Kraft Heinz, bâtis sur des produits de la gratification immédiate, voient poindre un risque structurel : un consommateur moins compulsif, plus rationnel et plus attentif à la satiété. Selon Morgan Stanley, une baisse de 3 % de la consommation calorique nationale pourrait effacer plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les segments sucrés et gras.
Cette mutation ouvre, à l’inverse, une fenêtre d’opportunité pour les spécialistes du végétal, du frais et de la nutrition fonctionnelle. Bonduelle, Danone ou General Mills enregistrent une demande accrue pour les légumes prêts à consommer, les plats équilibrés et les protéines végétales. Les start-up américaines Freshly, Factor ou Daily Harvest surfent sur ce “healthy convenience”, proposant des repas portionnés et riches en fibres, compatibles avec une alimentation médicalisée. Les observateurs y voient un basculement historique : l’alimentation devient un prolongement du soin, et le “bien-manger” une forme de thérapie quotidienne. Pour les investisseurs, la frontière entre foodtech et biotech s’efface peu à peu.
Les analystes du secteur évoquent plusieurs scénarios : certains tablent sur un rééquilibrage partiel, d’autres sur une transformation durable comparable à celle qu’a connue le tabac avec la cigarette électronique. Tous s’accordent à dire que les groupes agroalimentaires devront se repositionner vers la santé, la satiété et la fonctionnalité nutritionnelle. L’article conclut que cette révolution du métabolisme signe le début d’une recomposition mondiale : les industriels du plaisir immédiat devront apprendre à séduire un consommateur devenu métaboliquement raisonnable.
Le Monde, Tout comprendre aux aliments ultratransformés, nouvel enjeu de santé publique, 05/10/2025
Les aliments ultratransformés (AUT) s’imposent comme un enjeu majeur de santé publique, au croisement de la science, de la régulation et des pratiques industrielles. L’article rappelle qu’ils regroupent des produits issus de procédés complexes combinant ingrédients raffinés, additifs technologiques, arômes, colorants, émulsifiants et agents de texture qui reconstituent des matrices éloignées de l’aliment d’origine. Plusieurs grandes études observationnelles associent une consommation élevée d’AUT à une hausse du risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de dépression et d’obésité, même à qualité nutritionnelle équivalente. Ce paradoxe nourrit le débat sur le rôle de la « matrice » alimentaire et sur l’hypothèse que le degré de transformation, au-delà des macronutriments, influence la santé.
En France, les AUT représentent près de 60 % de l’apport énergétique, avec des écarts sociaux marqués : ils sont davantage consommés par les ménages jeunes et modestes, attirés par le prix, la praticité et la conservation. Le système de classification NOVA, popularisé par le chercheur brésilien Carlos Monteiro, structure désormais la discussion, tout en restant contesté par une partie des scientifiques et des industriels qui dénoncent une définition jugée floue et hétérogène. Les autorités sanitaires européennes réfléchissent à des outils d’information complémentaires au Nutri-Score, à un encadrement renforcé de la publicité destinée aux enfants et à des objectifs de réduction d’AUT dans la restauration collective. De grands groupes testent des reformulations : raccourcir les listes d’ingrédients, substituer certains additifs, réintégrer des matrices plus simples, réévaluer les procédés de texturation et de chauffage. Mais l’arbitrage est délicat : la sécurité microbiologique, la disponibilité et le prix restent des contraintes lourdes, tandis que l’acceptabilité sensorielle ne peut être sacrifiée.
Au-delà des produits, l’article pose la question politique de la dépendance des systèmes alimentaires à des chaînes industrielles longues, celle de la transparence et de la souveraineté. Il en ressort que la lutte contre l’ultratransformation ne se résume pas à retirer quelques additifs : elle suppose de revaloriser les aliments bruts, les cuisines du quotidien, les circuits courts et l’éducation au goût. À court terme, les acteurs de l’agroalimentaire devront composer avec une demande croissante de simplicité lisible, tandis que les pouvoirs publics arbitreront entre protection des consommateurs, compétitivité industrielle et équité sociale.
Le Monde, Picnic, le rescapé de la bulle du « quick commerce », 07/10/2025
Dans un secteur du quick commerce durement corrigé après l’euphorie de 2021, Picnic fait figure d’exception en poursuivant sa croissance grâce à un modèle logistique frugal et planifié. Au lieu de la promesse ruineuse de la livraison en dix minutes, l’enseigne néerlandaise s’appuie sur des tournées à heure fixe, opérées par de petites camionnettes électriques qui desservent des quartiers entiers selon des itinéraires optimisés. Cette organisation, proche d’un « supermarché ambulant », réduit les kilomètres à vide, diminue le besoin en dark stores et limite fortement le gaspillage, puisque la préparation suit des commandes consolidées la veille. Le panier moyen, familial, se prête bien à ce rythme : l’assortiment volontairement resserré, les prix compétitifs et l’expérience simple fidélisent des clients moins sensibles au besoin d’immédiateté que les urbains pressés ciblés par les concurrents défaits.
Financièrement, le modèle offre une trajectoire plus saine : coûts de livraison maîtrisés, densité de tournées, productivité par chauffeur et automatisation croissante des entrepôts. Picnic revendique des positions solides aux Pays-Bas, en Allemagne et une montée en puissance dans le nord de la France, avec un discours environnemental crédible fondé sur l’électrification complète de la flotte et la réduction du gaspillage. Le contraste est marqué avec des acteurs comme Gorillas, Getir ou Flink, dont la course à la vitesse a fait exploser les coûts fixes et la promotion, avant d’aboutir à des fermetures ou consolidations.
L’article souligne que Picnic s’inscrit dans une « deuxième génération » du commerce alimentaire en ligne : plus lent mais plus efficace, orienté vers la rentabilité unitaire et la durabilité opérationnelle. Les perspectives tiennent à la capacité d’augmenter la densité géographique, d’élargir l’assortiment sans diluer l’efficacité, et d’intégrer davantage de données pour affiner la planification des tournées. Au plan concurrentiel, les distributeurs traditionnels observent ce modèle avec attention, y voyant une inspiration possible pour des services de livraison maîtrisant le dernier kilomètre sans subvention massive. Reste une inconnue : la concurrence de la livraison de drives et des places de marché pourrait relancer la pression promotionnelle ; mais la discipline opérationnelle et l’ancrage local de Picnic constituent, pour l’heure, un avantage défendable.
La Tribune, Menacés de disparition, les producteurs de lait de montagne tirent la sonnette d’alarme, 10/10/2025
Dans les zones de montagne françaises, la filière laitière vit une lente érosion. L’article donne la parole aux éleveurs du Massif central, des Alpes et des Pyrénées, qui alertent sur la disparition progressive d’exploitations familiales isolées. Leurs coûts de production ont bondi de 20 % en deux ans, sous l’effet des hausses d’énergie, d’alimentation animale et de transport. Les laiteries préfèrent collecter en plaine, plus rentable, laissant les producteurs de montagne dans une impasse économique. Beaucoup n’ont pas de successeurs : la pénibilité, le manque d’attractivité du métier et la faiblesse des revenus dissuadent les jeunes.
Les volumes livrés chutent, entraînant la fermeture de petits ateliers de transformation et une perte d’activité dans les vallées. Les filières sous appellation (Beaufort, Comté, Cantal) résistent grâce à leur valorisation, mais les productions hors AOP s’effondrent. Les éleveurs réclament un plan de sauvegarde spécifique : prix plancher, contrats pluriannuels, aides à la modernisation et compensation des surcoûts logistiques. Au-delà des aspects économiques, le lait de montagne joue un rôle écologique essentiel : il entretient les pâturages, prévient l’enfrichement et limite les risques d’incendie. Son recul menace les paysages et l’équilibre environnemental. Les élus locaux plaident pour une politique agricole différenciée, intégrant le coût réel du maintien des zones d’altitude. Les coopératives explorent des solutions : mutualisation de la collecte, micro-fromageries, diversification vers le lait cru et le bio. Mais les marges restent fragiles et les investissements lourds.
L’article conclut que la survie du lait de montagne dépasse le cadre agricole : elle concerne l’aménagement du territoire, la vitalité rurale et la transmission d’un patrimoine collectif. Sans soutien rapide, c’est tout un pan de la France fromagère qui risque de s’éteindre, emportant avec lui un savoir-faire séculaire et un lien unique entre paysage, terroir et identité.
Libération, Restauration : face à l’excès d’adresses, comment le secteur veut renverser la table, 10/10/2025
La restauration française traverse une crise de surcapacité inédite. L’article décrit un secteur à la fois bouillonnant de créativité et étranglé par ses propres excès. Jamais la France n’a compté autant d’établissements – plus de 180 000 selon l’Insee – mais jamais autant n’ont eu du mal à survivre. Après le rebond spectaculaire de 2022-2023, qui avait fait suite à la pandémie, le marché se normalise brutalement : la clientèle se raréfie, les coûts flambent et les marges s’effondrent. Les restaurateurs se retrouvent pris en étau entre la hausse du Smic, l’explosion du prix des matières premières et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. Les repas en semaine, longtemps cœur du chiffre d’affaires, reculent fortement. Les clients sortent moins, dépensent moins et privilégient les repas à domicile, dopés par la livraison et le “batch cooking”.
Les acteurs du secteur parlent désormais d’un “trop-plein d’adresses” : une multiplication anarchique de concepts – néo-bistrots, cuisines fusion, street food, coffee shops – qui a saturé la demande, notamment dans les grandes villes. Le consommateur, sollicité de toutes parts, devient volatil. Face à cette situation, beaucoup d’établissements cherchent à se réinventer. Les indépendants réduisent leurs cartes, valorisent la saisonnalité, raccourcissent les circuits d’approvisionnement et explorent la restauration durable. Les chefs misent sur la transparence, la sobriété gastronomique et la convivialité. En parallèle, les chaînes rationalisent leur modèle : robotisation, menus standardisés, digitalisation de la commande et fidélisation par application mobile. La restauration se professionnalise, mais perd de sa spontanéité artisanale.
L’article souligne aussi une crise du travail : difficultés de recrutement, turnover massif et conditions jugées pénibles. Les écoles hôtelières peinent à attirer les jeunes générations. Des initiatives émergent pour redonner du sens au métier : salaires revalorisés, semaines de quatre jours, partage des bénéfices. Certains professionnels appellent à une refondation collective du secteur, articulée autour de la formation, de la durabilité et du lien humain. L’article conclut que la restauration française doit désormais “renverser la table” au sens propre : moins de quantité, plus de qualité, et une redéfinition du plaisir culinaire qui réconcilie rentabilité, responsabilité et art de vivre.
Libération, «Folie matcha» : victimes de leur succès, les producteurs de thé japonais voient le vert à moitié vide, 04/10/2025
La « folie matcha » portée par les réseaux sociaux et la quête de bien-être met sous tension la filière japonaise de ce thé vert en poudre emblématique. L’article montre comment la demande mondiale, multipliée en quelques années, dépasse la capacité d’une production fondée sur des gestes lents et un savoir-faire très localisé. Dans les régions d’Uji, Kyoto et Shizuoka, produire un matcha d’excellence exige culture sous ombrage, récolte minutieuse, étuvage doux, séchage précis et broyage à la meule de pierre, étapes difficiles à industrialiser sans perte aromatique. Or, la main-d’œuvre vieillit, la transmission ralentit et la pression foncière réduit les surfaces disponibles.
Résultat : les prix s’envolent, les volumes exportables stagnent, et les intermédiaires se multiplient, avec à la clé des risques de contrefaçons ou de mélanges opportunistes importés de Chine ou de Taïwan. Les maisons historiques, soucieuses de préserver réputation et qualité, arbitrent entre rareté organisée et ouverture de nouveaux marchés ; certaines limitent volontairement les ventes pour maintenir un niveau d’exigence et protéger les appellations. Le gouvernement soutient l’identification des origines, des labels et des démarches bio, mais les certifications peinent à suivre l’ampleur de la demande internationale, tandis que les critères de qualité restent mal compris hors du Japon.
Le boom occidental se traduit par une consommation souvent éloignée du rituel : latte sucré, pâtisseries, glaces et préparations où le matcha est davantage une couleur, un storytelling et une promesse santé qu’un terroir. L’article met en lumière un paradoxe : le produit devient icône mondiale précisément au moment où les conditions de sa production artisanale sont les plus fragiles. Pour les producteurs, l’équation économique est instable : coûts de main-d’œuvre, investissements en ombrières, aléas climatiques, conversion bio et exigences d’exportation pèsent sur des marges déjà ténues. À moyen terme, la filière devra choisir entre croissance et intégrité : mécaniser certaines étapes, segmenter davantage les qualités, ou assumer la rareté avec des prix élevés et une pédagogie renforcée. Elle pose aussi la question du renouvellement des producteurs : attirer des jeunes vers un métier exigeant, mieux rémunérer la qualité et sécuriser l’aval pour que la tradition survive à la mode.
Les Échos, La « poulet mania » fait les affaires du géant français de la volaille LDC, 07/10/2025
Le groupe LDC, propriétaire de marques emblématiques comme Loué, Le Gaulois et Maître Coq, profite pleinement d’un phénomène structurel : la montée en puissance du poulet dans les habitudes alimentaires françaises et européennes. Dans un contexte d’inflation persistante, cette viande blanche s’impose comme la plus accessible, la plus polyvalente et la plus en phase avec les nouvelles attentes de santé et de praticité.
L’article décrit une croissance continue de la consommation de volaille, tirée par la restauration rapide, les découpes prêtes à cuire et les plats cuisinés. En 2024, le marché français a progressé de près de 4 %, alors que la consommation de bœuf et de porc reculait. LDC, qui contrôle près de 40 % de la production nationale, a vu son chiffre d’affaires bondir de 12 %, dopé par la demande intérieure et les exportations vers l’Afrique et le Moyen-Orient. Le groupe mise sur son modèle intégré – de l’élevage à la distribution – pour sécuriser l’approvisionnement et amortir les hausses de coûts. Il investit dans la modernisation de ses abattoirs, la robotisation, la réduction des densités d’élevage et l’alimentation sans OGM. Cette stratégie permet à LDC de répondre à la demande croissante pour des produits locaux, certifiés et traçables, tout en soutenant la compétitivité de la filière française.
Mais cette “poulet mania” n’est pas sans défis. Le modèle reste dépendant des importations de soja et de maïs, et la filière doit affronter les critiques environnementales liées à la concentration d’élevages et aux émissions d’ammoniac. LDC doit aussi composer avec la concurrence des volailles brésiliennes et ukrainiennes, souvent moins chères. Pour y faire face, le groupe accélère sur la montée en gamme – Label Rouge, bio, filières plein air – et expérimente des produits hybrides mêlant protéines animales et végétales. L’article conclut que cette dynamique illustre une mutation durable : le poulet est devenu la protéine de référence des Français, symbole d’un compromis entre prix, santé et responsabilité. LDC, en s’adaptant rapidement, incarne cette nouvelle équation alimentaire.
Les Échos, Café : une demande mondiale en plein essor malgré les tensions sur la production, 07/10/2025
La consommation mondiale de café atteint des niveaux records, tandis que la production se trouve fragilisée par le changement climatique et la volatilité des marchés agricoles. L’article souligne un paradoxe : la planète n’a jamais autant bu de café, mais n’a jamais eu autant de mal à en produire. Depuis 2020, la demande progresse d’environ 2,5 % par an, portée par la reprise post-Covid, la montée en gamme des cafés de spécialité et le succès du “coffee to go”. Les grands torréfacteurs mondiaux – Nestlé (Nescafé, Nespresso), JDE Peet’s ou Lavazza – enregistrent des ventes en hausse, tout en affrontant une flambée des coûts. Les récoltes brésiliennes ont souffert de sécheresses prolongées et de gelées, tandis que le Vietnam, premier producteur de robusta, subit des épisodes de chaleur extrême. Résultat : les cours du robusta ont bondi de 40 % depuis janvier 2025. La production ne suit plus le rythme d’une demande dopée par la croissance des classes moyennes asiatiques et africaines.
Face à cette tension, les acteurs de la filière tentent de sécuriser leurs approvisionnements : développement de nouvelles variétés résistantes, programmes de replantation et diversification géographique. Les grandes marques misent aussi sur la durabilité : investissements dans les certifications (Rainforest Alliance, Fairtrade), soutien à la transition agroforestière et réduction de l’empreinte carbone des chaînes d’approvisionnement. Mais les petits producteurs restent vulnérables : leurs coûts explosent plus vite que les prix garantis, et beaucoup se détournent du café au profit de cultures vivrières plus rentables. En Europe, le marché s’oriente vers le premium et les capsules réutilisables, mais les consommateurs subissent des hausses de prix. L’article souligne que cette tension mondiale redéfinit la valeur du café : d’un produit banal, il devient un bien semi-luxueux, reflet d’enjeux environnementaux, climatiques et géopolitiques. À moyen terme, la filière devra réconcilier rentabilité, équité et résilience pour éviter une crise structurelle. Le café, symbole de convivialité, s’impose désormais comme un baromètre des équilibres agricoles planétaires.
Les Échos, Ce géant de l’apéro qui veut lancer la production de cacahuètes en France, 06/10/2025
Menguy’s, propriété de la coopérative Océalia et spécialiste de l’apéritif, veut relancer une culture oubliée : celle de la cacahuète française. L’article détaille un projet inédit de relocalisation agricole, mené en partenariat avec l’institut technique Terres Inovia et plusieurs exploitations du Sud-Ouest. Aujourd’hui, la France importe 99 % de sa consommation – principalement d’Afrique de l’Ouest, d’Argentine et des États-Unis. Les coûts logistiques, la volatilité des cours mondiaux et les enjeux de souveraineté alimentaire incitent Menguy’s à tester la faisabilité d’une production locale. Les premières expérimentations, conduites dans le Gers et les Landes, montrent des rendements prometteurs, proches de 3 tonnes à l’hectare, avec une qualité jugée satisfaisante pour la transformation.
Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large : sécuriser l’approvisionnement, réduire l’empreinte carbone et valoriser le “made in France”. L’entreprise ambitionne de cultiver 500 hectares d’ici 2030, couvrant environ 5 % de la demande nationale. Elle mise sur une communication valorisant la traçabilité et la durabilité, deux arguments de poids sur un marché de l’apéritif en pleine mutation. Le segment des fruits secs progresse de 6 % par an, porté par les nouvelles habitudes de grignotage sain et la recherche de produits naturels. Menguy’s, qui réalise 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, veut associer les agriculteurs à la réussite du projet par des contrats pluriannuels et un accompagnement technique.
Les défis demeurent : mécanisation, séchage, stockage et adaptation au climat français. Mais les partenaires agricoles y voient une opportunité de diversification et une réponse concrète à la demande de relocalisation. L’article conclut que cette initiative illustre la transition d’un modèle agroalimentaire vers une logique circulaire, plus territoriale et moins dépendante des marchés mondiaux. Si la cacahuète française reste marginale, elle symbolise une nouvelle ambition : faire rimer convivialité, souveraineté et innovation.
Financial Times, How high-end restaurants went global, 11/10/2025
L’article analyse la mondialisation accélérée des restaurants haut de gamme, devenus un pilier de l’économie du luxe post-Covid. Dans un reportage mené entre Londres, Dubaï et New York, Jay Rayner décrit comment des enseignes naguère singulières — Nobu, Zuma, Cipriani, LPM ou Hakkasan — ont bâti des réseaux internationaux, transformant le dîner raffiné en produit global. Le cœur du phénomène : la fusion entre gastronomie premium, design standardisé et stratégie d’expansion typique des marques de mode. À Dubaï, vitrine de cette mondialisation, les quartiers du DIFC ou de Marina concentrent désormais les mêmes concepts qu’à Londres, Hong Kong ou Mykonos : thon cru, Wagyu, caviar et service calibré pour une clientèle cosmopolite dépensant 150 dollars par repas.
La pandémie a joué un rôle déterminant. Alors que le commerce de détail de luxe s’est digitalisé, la restauration haut de gamme a pris le relais comme expérience physique et statutaire. « Vous ne pouvez pas acheter ce que nous faisons sur Amazon », résume Noah Tepperberg du groupe Tao, propriétaire d’Hakkasan et Lavo. Pour les promoteurs immobiliers, ces enseignes deviennent des vecteurs d’attractivité : intégrer un Zuma ou un Nobu à un complexe résidentiel garantit une image premium et fait grimper la valeur du foncier. Les investisseurs encouragent donc cette présence mondialisée, de Dubaï à Singapour, de Los Angeles à Mykonos.
Les restaurateurs, eux, arbitrent entre croissance et authenticité. François O’Neill (Maison François) ou le groupe JKS (Gymkhana) voient dans l’international une échappatoire à la morosité du marché britannique, mais redoutent la dilution du “savoir-faire maison”. Certains, comme Barrafina, exportent sous franchise contrôlée ; d’autres cèdent leurs licences à des opérateurs locaux, au risque d’un affadissement du concept. Les observateurs soulignent un paradoxe : ces établissements promettent l’unicité, mais finissent par se ressembler, reproduisant la standardisation des chaînes de milieu de gamme des années 2000. L’article y voit le symptôme d’une “luxe globalisation” où le repas devient un signe de statut interchangeable.
Reste un risque majeur : celui du déclassement symbolique. Si le raffinement se copie, il se banalise. Le défi des restaurateurs mondialisés sera de maintenir la magie du lieu dans un monde où l’expérience gastronomique tend à devenir un produit de marque comme un autre.
Financial Times, Dark chocolate is being rebranded – but is bitter really better?, 06/10/2025
L’article analyse la nouvelle offensive marketing de Cadbury autour de sa marque historique Bournville, relancée après un demi-siècle d’absence publicitaire. L’entreprise veut redéfinir le chocolat noir pour le rendre plus accessible, plus joyeux et moins intimidant. Avec le slogan « Nothing fancy. Or schmancy », Cadbury parodie l’univers souvent prétentieux du chocolat noir haut de gamme. La marque mise sur la convivialité et la nostalgie plutôt que sur la sophistication, et revendique un positionnement “plaisir” face à la rigidité perçue du segment premium.
La campagne, conçue avec le scénariste Simon Blackwell (Peep Show), met en scène deux dégustateurs caricaturant les discours excessifs sur l’amertume et les “notes de terroir”. L’objectif est clair : désacraliser le chocolat noir pour conquérir un public large, habitué au lait mais curieux de saveurs plus intenses. Le pari repose sur un constat : le segment du chocolat noir reste minoritaire au Royaume-Uni (7,2 % du marché, soit 6,4 milliards de livres), mais il croît deux fois plus vite que le reste du secteur (+21,5 % en un an).
Pour autant, Bournville s’éloigne des standards du “bean-to-bar” artisanal. Son profil gustatif reste très sucré : 58 g de sucre pour 100 g, davantage qu’une tablette de 75 % de cacao, et une teneur en lait non négligeable. L’article souligne le paradoxe d’un produit présenté comme “noir” mais conçu pour les amateurs de douceur. Les experts interrogés, dont la juge et formatrice Jennifer Earle, rappellent que “beaucoup de barres premium n’utilisent pas de bon cacao” et que Cadbury “capitalise sur le halo santé du chocolat noir sans en proposer les véritables bénéfices”. L’ambition de la marque est néanmoins claire : séduire les consommateurs “matures”, aux goûts évoluant vers l’intensité mais rebutés par la dureté des produits artisanaux.
Ce repositionnement s’inscrit dans une tendance plus large : la démocratisation du goût “amer” et l’adoucissement des produits perçus comme sophistiqués. Bournville veut ainsi devenir le “chocolat noir du quotidien”, opposé à Green & Black’s ou L’Esterre, en misant sur la familiarité et le prix. Mais, conclut le journaliste, si le ton est léger, la recette l’est tout autant : plus sucrée que noire, la nouvelle Bournville s’adresse aux papilles rassurées, pas aux puristes du cacao.
Financial Times, England’s wine industry is growing dangerously fast, 04/10/2025
L’article alerte sur la croissance “dangereusement rapide” de l’industrie viticole anglaise, devenue en quelques années un secteur d’investissement massif. Longtemps considéré comme une activité d’amateurs, le vignoble britannique – qui englobe l’Angleterre et le Pays de Galles – vit aujourd’hui une expansion sans précédent, portée par le réchauffement climatique, la spéculation foncière et l’attrait pour les vins effervescents de style champagne.
Les chiffres donnent la mesure du phénomène : 4 841 hectares de vignes recensés, dont plus de 1 000 encore trop jeunes pour produire, et une récolte record de 21,6 millions de bouteilles en 2023, contre 13,1 millions en 2018. Trois quarts de cette production sont consacrés aux vins effervescents, dominés par les cépages champenois – Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Depuis le succès pionnier de Nyetimber dans les années 1990, ces “English sparklings” rivalisent en prestige avec les champagnes français. Mais cette spécialisation rend le modèle fragile : les vins de méthode traditionnelle nécessitent un long vieillissement en bouteille, immobilisant le capital et retardant les retours financiers.
La chroniqueuse Jancis Robinson souligne les limites économiques d’une telle frénésie. Les investisseurs, souvent attirés par le prestige plus que par la rentabilité, découvrent que les cycles de production, la variabilité climatique et la lenteur du vieillissement pèsent lourdement sur la trésorerie. Malgré une vendange 2025 plus modeste, un surplus de raisins se profile, provoquant une baisse des prix du fruit et des opportunités pour les producteurs artisanaux. Le vigneron Dermot Sugrue, figure respectée du Sussex, confie avoir pu acheter du raisin de très haute qualité à prix bradé.
L’évolution climatique transforme aussi la nature des vins : des étés plus chauds permettent désormais de produire des rouges et blancs tranquilles, notamment à partir du Pinot Noir et du Bacchus. Lors de la dégustation annuelle de WineGB, plus de la moitié des 300 vins présentés étaient désormais des “still wines”, reflet du potentiel croissant du sud de l’Angleterre, notamment de l’Essex et du Crouch Valley.
Pour Jancis Robinson, cette explosion viticole mêle promesse et excès. L’Angleterre s’impose comme une nouvelle frontière œnologique européenne, mais la surproduction, la dépendance climatique et la spéculation foncière pourraient rapidement transformer cet âge d’or en crise de maturité. L’industrie doit apprendre à croître moins vite – et à vieillir mieux.
The Guardian, Enjoying international cuisines makes people more tolerant, UK study finds, 07/10/2025
Selon une étude conjointe des universités de Birmingham et de Munich, les Britanniques qui consomment fréquemment des cuisines étrangères manifestent des attitudes plus ouvertes et moins hostiles envers les immigrés. Publiée sous le titre Breaking Bread: Investigating the Role of Ethnic Food in Potentiating Outgroup Tolerance, la recherche démontre qu’un rapport régulier à la diversité culinaire réduit d’environ 10 % la probabilité de percevoir les immigrés comme une menace culturelle ou économique.
L’étude, menée auprès de plus de 1 000 adultes blancs britanniques, corrèle la fréquence et la variété des repas internationaux (indien, turc, chinois, thaïlandais, caribéen, espagnol) avec les opinions sur l’immigration africaine, asiatique et européenne. Les résultats sont clairs : plus les participants apprécient et consomment ces cuisines, moins ils sont enclins à voter pour des partis ou des candidats prônant des politiques anti-immigration. Les chercheurs précisent que cette corrélation n’est pas simplement liée à une prédisposition initiale à l’ouverture d’esprit : elle s’explique surtout par le contact positif et la dimension émotionnelle liée à la nourriture.
Le Dr Rodolfo Leyva, auteur principal, souligne que les restaurants et stands de rue créent des espaces d’interaction naturelle entre populations locales et communautés immigrées. “Tout le monde mange, et la nourriture est l’une des façons les plus accessibles d’expérimenter la diversité culturelle”, explique-t-il. Contrairement à d’autres formes d’exposition culturelle – musées, concerts ou voyages –, la gastronomie permet une immersion directe et plaisante dans l’altérité.
L’étude replace ce phénomène dans l’histoire longue de la cuisine britannique, profondément marquée par les influences étrangères : le kedgeree anglo-indien, les glaces italiennes du XIXᵉ siècle ou les plats caribéens de la génération Windrush. Ces apports successifs ont bâti un patrimoine culinaire multiculturel aujourd’hui considéré comme un moteur d’inclusion.
Les chercheurs proposent d’intégrer ces enseignements aux politiques publiques de cohésion sociale. Parmi leurs recommandations : organiser des dégustations multiculturelles dans les écoles, soutenir les restaurateurs issus de l’immigration et promouvoir la diversité culinaire dans les campagnes touristiques. Pour le Guardian, cette étude confirme que le goût peut être un vecteur de tolérance : en partageant la table, on apprend à partager le monde.
New York Times, This TikTok Food Trend Is More Than 10,000 Years Old, 07/10/2025
Sous ses airs de nouveauté virale, la tendance TikTok du “smoked salmon girlies” plonge en réalité ses racines dans des traditions millénaires. Genevieve Ko montre comment une pratique culinaire ancestrale des peuples autochtones d’Amérique du Nord, celle du saumon fumé à froid, a été réinventée et détournée sur les réseaux sociaux. L’été 2025 a vu se multiplier les vidéos d’influenceurs exhibant des filets de saumon brillants, laqués d’érable, déchirés à pleines mains sous les projecteurs. Derrière le spectaculaire, une entreprise américaine, Solovey Kitchen, d’origine slave, a su transformer le produit en phénomène marketing.
Mais cette appropriation masque une histoire longue de plus de dix millénaires. Bien avant les “food trends”, les communautés autochtones du nord du continent – notamment les peuples Tlingit et Muckleshoot en Alaska et dans le nord-ouest pacifique – pratiquaient le fumage du saumon pour le conserver et assurer leur autonomie alimentaire. Les filets, d’abord saumûrés, étaient suspendus dans des fumoirs à faible température, alimentés par du bois d’aulne. Le processus, sans cuisson, permettait de sécher le poisson, de le préserver pour l’hiver et de transmettre des savoir-faire collectifs.
Pour Kate Nelson (Tlingit), autrice de Turtle Island: Foods and Traditions of the Indigenous Peoples of North America, l’intérêt du public pour ces recettes ancestrales est positif, à condition de les replacer dans leur contexte culturel. “Le problème, dit-elle, c’est quand les gens les présentent comme une nouveauté, sans savoir d’où cela vient.” Valerie Segrest, nutritionniste autochtone et animatrice du podcast The Old Growth Table, rappelle que des preuves archéologiques attestent d’activités de pêche et de fumage vieilles de 12 000 ans dans la région de Seattle. Pour elle, le saumon est une ressource sacrée, un lien spirituel entre nature, communauté et transmission.
L’article donne la parole à Heather Douville, présentatrice du programme Our Way of Life, qui perpétue ces pratiques en Alaska malgré la disparition des fumoirs collectifs, détruits par les autorités fédérales au XXᵉ siècle. Elle insiste sur la valeur d’interdépendance qui sous-tend ces savoirs : “La force vient du collectif, pas de l’individu.” Pour les communautés autochtones, préserver le saumon, c’est préserver un mode de vie. Les tendances virales peuvent en populariser l’image, mais la tradition, elle, reste affaire de mémoire et de transmission partagée.
Wall Street Journal, Startups Are Eating Big Food’s Lunch, 05/10/2025
L’industrie agroalimentaire américaine vit une révolution silencieuse : les start-up de produits de grande consommation captent désormais l’essentiel de la croissance du marché, au détriment des géants historiques comme Kraft Heinz, General Mills ou Campbell’s. Alors que les volumes globaux stagnent, la croissance vient quasi exclusivement des “insurgent brands”, petites marques innovantes qui incarnent l’agilité, la transparence et la différenciation recherchées par les consommateurs.
Selon Bain & Company, ces acteurs représentent moins de 2 % du marché des produits alimentaires, boissons et biens de consommation, mais génèrent près de 39 % de la croissance sectorielle en 2024, soit deux fois plus qu’en 2023. Les géants du “Big Food” se retrouvent pris en étau : les foyers modestes migrent vers les marques distributeurs pour des raisons de prix, tandis que les classes moyennes et aisées se tournent vers ces jeunes marques perçues comme plus saines, authentiques ou durables.
L’exemple le plus frappant est celui de Chomps, fabricant de snacks protéinés à base de viande. En quatre ans, l’entreprise est passée de 70 à 660 millions de dollars de chiffre d’affaires, grâce à une stratégie ciblant un public féminin et soucieux de nutrition. Ce dynamisme se retrouve dans d’autres segments – chips, glaces, yaourts, chocolat, plats surgelés – où les petits acteurs s’imposent par leur rapidité de décision, leur communication numérique directe et leur capacité à lancer des produits en quelques jours.
La transformation est amplifiée par la dématérialisation des canaux de distribution. Amazon et le e-commerce offrent aux jeunes marques une visibilité sans contrainte d’espace en rayon, tandis que TikTok et Instagram permettent un storytelling fondateur à faible coût. Comme le résume Charlotte Apps (Bain), “une décision promotionnelle qui prend six semaines chez un grand groupe peut être exécutée en dix minutes par une start-up”.
Les analystes soulignent que les grands groupes doivent sortir de la défensive. Les précédents historiques montrent que la reconquête passe par la réinvention, non par la réduction des coûts. TD Cowen rappelle que l’innovation et le réinvestissement dans la marque restent les leviers les plus efficaces, même au prix d’une baisse de marge à court terme. D’autres misent sur les acquisitions ciblées : PepsiCo avec Poppi, Hershey avec LesserEvil, ou Campbell’s avec la maison mère de Rao’s. Mais ces rachats n’assurent pas toujours le succès : selon Bain, les marques acquises voient leur croissance divisée par deux une fois intégrées.
Whole Foods Market, The Next Big Things: Our Top Food Trend Predictions for 2026
Comme chaque année à cette époque, le Trends Council de Whole Foods Market publie son panorama prospectif des tendances qui influenceront les goûts, les rayons et les assiettes. Pour 2026, les experts identifient huit évolutions majeures articulant naturalité, bien-être et créativité, traduisant la convergence entre nutrition fonctionnelle, héritage culinaire et plaisir visuel.
1️⃣ Tallow Takeover – le retour du suif : le gras de bœuf (beef tallow), autrefois délaissé, revient en force. Apprécié pour son goût riche et son haut point de fumée, il symbolise le retour aux graisses “ancestrales” et au nose-to-tail, principe de valorisation intégrale de l’animal. Son image “vintage” cartonne sur les réseaux sociaux, et les restaurants redécouvrent ses vertus pour fritures et pâtisseries.
2️⃣ Focus on Fiber – la revanche des fibres : après l’ère des protéines, place aux fibres. L’intérêt pour la santé intestinale et le microbiote se traduit par une explosion de produits “prébiotiques” à base d’avoine, de chicorée, de konjac ou de cassava. Les marques revendiquent désormais la teneur en fibres comme argument central de bien-être digestif.
3️⃣ Les femmes au cœur de l’agriculture : proclamée “Année internationale de la femme agricultrice” par la FAO, 2026 met à l’honneur les femmes dans les filières agricoles. De Lotus Foods à True Moringa, les marques soutiennent entrepreneuriat féminin, formation et accès aux ressources, dans une logique d’équité et de durabilité.
4️⃣ Kitchen Couture – l’emballage devient décor : la tendance du dopamine décor s’invite en cuisine. Les emballages deviennent des objets esthétiques, colorés et affichables : huiles d’olive, conserves ou chocolat se transforment en accessoires décoratifs, mêlant luxe accessible et plaisir visuel.
5️⃣ Freezer Fine Dining – la gastronomie surgelée : la montée en gamme du surgelé se poursuit. Inspirés des cuisines du monde, des plats comme arancini, dumplings ou birria visent le confort et la qualité restaurant à domicile.
6️⃣ Les vinaigres vivants et les douceurs raisonnées : le vinaigre, “vin aigre” millénaire, vit une renaissance. Ses déclinaisons vivantes, fruitées ou fermentées séduisent pour leurs bénéfices digestifs et leur versatilité en cuisine et mixologie.
7️⃣ Sweet, But Make It Mindful – la douceur consciente : les marques réduisent le sucre ajouté, misant sur le miel, le sirop d’érable ou le fruit entier. Le plaisir devient maîtrisé et transparent.
8️⃣ Instant Reimagined – l’instant gourmet : les repas express montent en gamme : cafés filtrés premium, ramens enrichis, repas en cup nutritifs. L’instantanéité retrouve sa noblesse grâce à la qualité.
Pour ceux qui veulent encore plus d’infos sur le matcha (mais en anglais)
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey