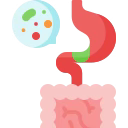🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-28
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la version audio :
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Skyr, whey, barres : pourquoi les Français sont devenus gagas de protéines, 02/10/2025
Les Échos, Les débuts prometteurs de la culture de la vanille made in Bretagne, 01/10/2025
Modern Retail, TikTok is talking to brands like it’s a grocer now, 01/10/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, « De la Russie au Kazakhstan, le blé dur s’élève à l’Est, alors qu’en France les surfaces plantées s’étiolent », 28/09/2025
La production mondiale de blé dur, essentielle pour l’industrie des pâtes, connaît une redistribution géographique majeure. Longtemps dominée par le Canada, la France et quelques pays méditerranéens, elle se déplace aujourd’hui vers l’Est, notamment en Russie et au Kazakhstan. Ces deux puissances agricoles, déjà parmi les leaders pour le blé tendre, investissent massivement dans le blé dur. Avec des conditions climatiques adaptées, de vastes surfaces disponibles et des coûts de production compétitifs, elles deviennent des acteurs incontournables, au détriment des pays européens traditionnels.
En France, la situation est préoccupante. Les surfaces plantées en blé dur ont fortement diminué au cours des dernières années. Les agriculteurs français, confrontés à une rentabilité moindre que pour d’autres cultures, se détournent de cette céréale. Les aléas climatiques accentuent la tendance : sécheresses, maladies et instabilité des rendements rendent la culture du blé dur risquée. Résultat : la production française ne couvre plus la demande nationale en semoule et pâtes, obligeant à importer, y compris de pays tiers.
Cette évolution bouleverse la filière agroalimentaire. L’Italie, championne des pâtes, doit désormais diversifier ses approvisionnements, notamment auprès de la Russie et du Kazakhstan, au risque de dépendre davantage de pays extérieurs à l’Union européenne. Les industriels français, eux aussi, adaptent leurs chaînes d’approvisionnement. Cette dépendance accrue interroge la souveraineté alimentaire de l’Europe, qui perd progressivement le contrôle d’une ressource stratégique.
Le dynamisme russe et kazakh repose aussi sur une stratégie géopolitique : accroître leur influence sur les marchés agricoles mondiaux, comme ils l’ont déjà fait avec le blé tendre. En s’imposant dans le blé dur, ils renforcent leur rôle de fournisseurs incontournables, capables de peser sur les prix internationaux et de sécuriser des devises précieuses. Les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine ne semblent pas freiner ce mouvement, au contraire : elles incitent ces pays à diversifier leurs débouchés vers l’Asie et le Moyen-Orient, où la consommation de pâtes explose.
Pour les producteurs français et européens, l’enjeu est clair : sans une stratégie volontariste de soutien à la filière, l’Europe pourrait perdre définitivement sa place dans la production mondiale de blé dur. Cela passerait par une meilleure rémunération des agriculteurs, des investissements en recherche variétale et des politiques agricoles plus incitatives. Le contraste est saisissant : alors que le blé dur décline en France, il devient une arme économique et politique à l’Est.
Les Échos, Skyr, whey, barres : pourquoi les Français sont devenus gagas de protéines, 02/10/2025
En quelques années, les protéines se sont imposées comme l’un des segments les plus dynamiques du marché alimentaire français. Longtemps cantonnées aux salles de sport et aux adeptes de musculation, elles séduisent désormais un public beaucoup plus large, allant des jeunes actifs aux seniors en quête de vitalité. Les Échos Week-End décrypte les raisons de cet engouement pour les produits riches en protéines – yaourts Skyr, poudres de whey, barres énergétiques ou encore boissons enrichies.
Cette tendance répond à plusieurs évolutions sociétales. D’abord, la recherche d’une alimentation plus fonctionnelle, c’est-à-dire capable de répondre à des besoins précis : énergie, satiété, récupération musculaire ou contrôle du poids. Les protéines, souvent associées à la force et à la performance, trouvent naturellement leur place dans ce contexte. Ensuite, le succès des régimes hyperprotéinés, popularisés par certaines stars du fitness, a largement contribué à démocratiser leur consommation au-delà du cercle des sportifs.
Les industriels de l’agroalimentaire ont saisi cette opportunité. Danone, Nestlé et Lactalis, mais aussi des start-up spécialisées, multiplient les lancements de produits enrichis en protéines. Le Skyr, yaourt islandais naturellement riche en protéines et faible en matières grasses, est devenu un symbole de cette tendance. De même, les rayons regorgent de barres protéinées aux saveurs variées, présentées comme des snacks sains et rassasiants. Ces innovations visent à intégrer la protéine dans le quotidien alimentaire, en dehors des seuls contextes sportifs.
L’article souligne que le marché est porté par une double promesse : santé et praticité. Pour les consommateurs pressés, avaler une barre protéinée ou un shaker de whey constitue une solution rapide et perçue comme bénéfique. Les seniors y voient aussi un allié pour préserver leur masse musculaire et lutter contre la sarcopénie. Ainsi, la protéine n’est plus seulement un outil de performance, mais un ingrédient de bien-être au sens large.
Toutefois, des voix critiques s’élèvent. Certains nutritionnistes rappellent que la population française n’est pas carencée en protéines, et qu’une alimentation équilibrée suffit généralement à couvrir les besoins. Ils dénoncent un effet de mode exploité par le marketing, qui pousse à la surconsommation de produits transformés. Par ailleurs, l’impact environnemental de la whey (sous-produit laitier) ou de certaines protéines animales pose question, à l’heure où la transition écologique devient incontournable.
Malgré ces réserves, le succès des protéines illustre une mutation durable des habitudes alimentaires : les Français recherchent désormais des produits qui combinent plaisir, santé et efficacité. L’alimentation devient un outil de performance quotidienne, et la protéine son symbole phare.
Libération, Violences en cuisine : avec Christopher Coutanceau, l’ancien monde toujours aux fourneaux, 30/09/2025
Le débat sur les violences en cuisine, longtemps resté tabou, s’impose de plus en plus dans l’actualité gastronomique française. L’article s’intéresse au cas du chef triplement étoilé Christopher Coutanceau, figure emblématique de La Rochelle. S’il incarne une génération reconnue pour son excellence culinaire, il illustre également les résistances persistantes d’un certain « ancien monde » face aux évolutions sociétales qui remettent en cause les pratiques traditionnelles des brigades.
Dans ses déclarations, Coutanceau défend une vision exigeante et parfois dure du métier de cuisinier. Selon lui, la discipline militaire, la rigueur et une hiérarchie stricte restent des conditions nécessaires à la performance gastronomique. Mais cette position est vivement critiquée par de jeunes cuisiniers et anciens apprentis qui dénoncent des pratiques violentes, allant des humiliations verbales aux gestes brutaux, voire au harcèlement moral. Pour ces derniers, la passion culinaire ne peut justifier des comportements qui relèvent de la maltraitance.
Ce débat prend place dans un contexte plus large : depuis quelques années, les témoignages d’abus dans la restauration se multiplient, à la faveur de mouvements sociaux comme #MeToo qui ont libéré la parole dans différents secteurs. De grands noms de la gastronomie, longtemps intouchables, se retrouvent ainsi mis en cause. Cette prise de conscience interroge le modèle historique de la haute cuisine française, héritée d’Auguste Escoffier et popularisée par les grands chefs du XXe siècle, où l’autorité se voulait sans partage.
Cependant, Coutanceau n’est pas isolé dans sa défense d’une cuisine « à l’ancienne ». Certains collègues estiment que la transmission du savoir-faire nécessite une certaine dureté, arguant que la pression des services et l’exigence du résultat justifient ces méthodes. À l’inverse, une nouvelle génération de chefs prône un management plus bienveillant, où la créativité et l’épanouissement des équipes remplacent la peur et la soumission. L’article souligne que la fracture est générationnelle : les jeunes recrues, moins enclines à accepter des conditions de travail rudes, fuient massivement les cuisines, aggravant la crise de recrutement du secteur.
Cette polémique reflète donc un enjeu crucial pour l’avenir de la restauration française : comment maintenir l’excellence culinaire sans reproduire des violences systémiques ? L’article suggère que la clé réside dans un rééquilibrage : préserver la discipline nécessaire tout en construisant un environnement de travail respectueux. Car à l’heure où les cuisines se veulent plus inclusives et attentives au bien-être, la brutalité du « vieux monde » risque de sonner le glas d’une certaine idée de la gastronomie.
Les Échos, Pourquoi Danone se passionne pour le microbiote intestinal, 29/09/2025
Le microbiote intestinal, souvent qualifié de « deuxième cerveau », fascine autant les chercheurs que les industriels de l’agroalimentaire. L’article s’intéresse à la stratégie de Danone, qui investit massivement dans ce champ de recherche pour y trouver un relais de croissance. Conscient de l’importance croissante de la santé digestive et du bien-être intestinal dans les attentes des consommateurs, le groupe français veut se positionner comme un leader de l’alimentation « santé ».
Depuis plusieurs années, les scientifiques ont mis en évidence le rôle déterminant du microbiote – l’ensemble des milliards de bactéries qui peuplent nos intestins – dans la digestion, le système immunitaire et même la régulation de l’humeur. Cette découverte ouvre un vaste champ d’innovations, où l’alimentation fonctionnelle occupe une place centrale. Pour Danone, déjà connu pour ses produits laitiers fermentés comme Activia, il s’agit d’une continuité stratégique : utiliser les ferments et probiotiques pour développer de nouvelles gammes à forte valeur ajoutée.
Le groupe mise sur deux leviers. D’un côté, la recherche scientifique : Danone collabore avec des laboratoires universitaires, finance des études cliniques et investit dans des start-up spécialisées dans les biotechnologies. De l’autre, le marketing : en vulgarisant les bénéfices du microbiote, il cherche à convaincre le grand public que prendre soin de son ventre, c’est aussi améliorer son bien-être global. Cette double approche doit permettre de légitimer des produits vendus plus chers, dans un marché où la valeur prime désormais sur le volume.
La tendance est mondiale : le marché des probiotiques et produits « gut health » explose, porté par une demande croissante en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Les consommateurs, soucieux de prévention, veulent des solutions naturelles pour améliorer leur santé. Cela pousse des géants comme Nestlé, Yakult ou PepsiCo à investir également dans ce créneau. Danone doit donc se différencier en s’appuyant sur son expertise historique et sur la confiance dont bénéficie la marque en matière de produits fermentés.
Mais des obstacles demeurent. Le lien entre microbiote et santé n’est pas encore totalement élucidé scientifiquement, et certaines allégations sont difficiles à prouver. Le risque de « surpromesse » est réel : si les bénéfices ne sont pas clairement démontrés, la crédibilité des marques pourrait être entamée. Par ailleurs, la réglementation européenne est stricte concernant les allégations de santé.
Libération, Black and White Burger, Starsmash, la Kazdalerie... Quand les influenceurs se lancent dans le fast-food, 29/09/2025
L’article explore la relation grandissante entre les influenceurs et les grandes chaînes de restauration rapide, en particulier McDonald’s, Burger King ou encore KFC. Ces enseignes investissent massivement dans des campagnes de communication ciblant les jeunes générations, en utilisant les codes des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube. Objectif : séduire un public toujours plus connecté, qui consomme autant des images et des vidéos virales que des hamburgers ou nuggets.
Le fast-food n’a jamais eu besoin d’autant d’alliés pour séduire la jeunesse. Jadis, la publicité traditionnelle suffisait à créer un imaginaire collectif autour du « burger américain ». Aujourd’hui, ce sont les influenceurs qui façonnent les goûts et les tendances, grâce à leur proximité perçue avec les abonnés. Ils participent à des challenges sponsorisés, testent des menus en direct ou s’associent à des lancements exclusifs. En France comme ailleurs, certains influenceurs cumulent des millions de vues avec de simples dégustations filmées, transformant un produit banal en objet de désir.
Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue et de mutation des habitudes alimentaires. Alors que les consommateurs déclarent vouloir manger plus sainement, la réalité des ventes montre la persistance de l’attrait pour les menus rapides et bon marché. Les enseignes de fast-food exploitent cette ambivalence en créant un univers « cool », décomplexé, qui s’accorde parfaitement avec la culture internet et l’économie de l’attention. Le partenariat avec des créateurs de contenu est donc une manière de réinventer la publicité, en la rendant plus subtile et virale.
Mais ce modèle soulève des critiques. Les nutritionnistes alertent sur la banalisation de la junk food auprès d’un public jeune et vulnérable. La mise en avant festive et humoristique de repas hypercaloriques masque les enjeux de santé publique, notamment l’obésité infantile. Certains observateurs dénoncent aussi une forme de manipulation : les influenceurs, en se présentant comme des « amis » ou des « pairs », brouillent la frontière entre recommandation sincère et publicité rémunérée.
Par ailleurs, cette tendance traduit une évolution du marketing alimentaire : les grandes marques ne parlent plus directement à leurs clients, elles passent par des intermédiaires incarnés. Cela modifie profondément la façon dont se construit la confiance : elle ne repose plus sur la marque elle-même, mais sur des figures médiatiques souvent jeunes, parfois peu transparentes sur leurs liens financiers. Face à ces critiques, certaines plateformes commencent à exiger une mention plus claire des partenariats sponsorisés.
Le Figaro, Pourquoi les Français continuent-ils à préférer la vraie viande aux alternatives végétales industrielles ?, 01/10/2025
Alors que de nombreux pays voient une progression sensible des substituts végétaux à la viande, la France fait figure d’exception. L’article analyse cette résistance culturelle et gastronomique : malgré les campagnes médiatiques et les innovations industrielles, la majorité des Français restent attachés à la viande traditionnelle, considérée comme un pilier de leur identité culinaire et sociale.
Les produits d’origine végétale imitant la viande (steaks de soja, nuggets de pois, burgers à base de protéines de pois ou de blé) suscitent encore beaucoup de méfiance. Les consommateurs les jugent trop transformés, éloignés du goût authentique, et souvent associés à une alimentation ultra-industrialisée, paradoxalement à rebours des attentes actuelles en matière de naturalité. De plus, leur prix reste souvent élevé comparé aux viandes de premier prix, ce qui freine leur adoption au-delà d’un cercle restreint de consommateurs urbains et sensibilisés aux enjeux environnementaux.
La dimension culturelle est centrale : la viande en France n’est pas seulement un aliment, mais un symbole de convivialité et de tradition. Du bœuf bourguignon au poulet rôti dominical, les repas structurés autour de la viande incarnent une forme de patrimoine culinaire. Les substituts végétaux, souvent perçus comme importés du modèle anglo-saxon, peinent à s’intégrer dans cet imaginaire collectif. Les Français préfèrent généralement réduire leur consommation de viande ou privilégier une viande de meilleure qualité plutôt que de basculer vers des alternatives industrielles.
Sur le plan économique, la filière viande reste également un poids lourd de l’agriculture nationale. Éleveurs, bouchers et restaurateurs défendent activement leur modèle, parfois avec le soutien des pouvoirs publics. La loi française encadre même l’usage de termes comme « steak » ou « saucisse » pour les produits végétaux, afin d’éviter toute confusion. Cette régulation illustre la volonté de protéger une filière déjà fragilisée par les débats environnementaux et les critiques liées au bien-être animal.
Pour autant, les alternatives végétales ne sont pas absentes : elles trouvent leur public chez les jeunes, les flexitariens et une partie des urbains soucieux de limiter leur impact écologique. Mais leur croissance reste limitée par rapport à des marchés comme les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Le défi des industriels sera donc d’innover en matière de goût, de naturalité et de prix, tout en s’adaptant au terroir culturel français.
L’article conclut que, pour l’heure, la viande conserve un avantage symbolique et sensoriel décisif. En France, elle reste synonyme de plaisir et de tradition, alors que les alternatives végétales doivent encore faire leurs preuves pour convaincre au-delà d’une niche militante.
Les Échos, Anti-gaspi : comment le « déstockage alimentaire » fait son trou en France, 29/09/2025
Le déstockage alimentaire, longtemps perçu comme une niche marginale, connaît aujourd’hui un véritable essor en France. Selon Les Échos, cette pratique qui consiste à vendre à prix réduits des produits proches de leur date limite de consommation, ou dont l’emballage présente des défauts mineurs, s’impose comme un levier efficace contre le gaspillage alimentaire. Elle séduit à la fois les consommateurs en quête de bonnes affaires et les entreprises soucieuses de valoriser des invendus.
Des plateformes spécialisées comme Too Good To Go, Phenix ou encore Nous anti-gaspi se développent rapidement, s’appuyant sur la digitalisation et l’économie circulaire. Elles offrent aux distributeurs et aux industriels un canal alternatif pour écouler leurs stocks, tout en donnant aux particuliers l’opportunité d’accéder à des produits de qualité à prix réduits, parfois jusqu’à -50 % ou -70 %. L’essor de ces acteurs traduit une double tendance : une sensibilité accrue aux enjeux environnementaux et un contexte inflationniste qui pousse les ménages à rechercher des solutions économiques.
Les enseignes de grande distribution se sont elles aussi emparées du phénomène. Carrefour, Intermarché ou Système U intègrent désormais des rayons ou des espaces dédiés au déstockage, parfois sous des marques spécifiques. Cette intégration renforce la légitimité de la pratique et permet de toucher un public plus large, au-delà des consommateurs militants. Les industriels alimentaires, eux, voient dans cette solution un moyen de réduire leurs pertes et de valoriser des produits qui, autrement, auraient été détruits.
Cependant, le secteur doit relever plusieurs défis. La logistique, notamment la gestion des dates de péremption et la rotation rapide des stocks, reste complexe. L’image du déstockage doit aussi évoluer : il ne s’agit plus de produits de « seconde zone », mais de denrées parfaitement consommables, écartées pour des raisons souvent purement commerciales. La pédagogie auprès du grand public est donc essentielle pour rassurer et élargir l’audience.
L’article rappelle également que la France s’est dotée d’une législation pionnière avec la loi Garot (2016), qui interdit la destruction des invendus alimentaires par les grandes surfaces et encourage leur redistribution. Le déstockage s’inscrit dans cette dynamique, aux côtés du don aux associations caritatives. Il illustre un changement de paradigme : les déchets alimentaires deviennent une ressource, porteuse de valeur économique et écologique.
Les Échos, La revanche inattendue du livre de cuisine, 01/10/2025
À l’ère des tutoriels YouTube, des blogs culinaires et des applications de recettes, on aurait pu croire le livre de cuisine condamné à disparaître. Pourtant, comme le souligne l’article, il connaît un surprenant regain d’intérêt. Les ventes se maintiennent à un niveau élevé, et certains titres s’imposent même comme de véritables best-sellers. Ce phénomène illustre la capacité du livre de cuisine à se réinventer et à conserver une valeur unique face à la dématérialisation.
Les lecteurs ne recherchent plus seulement un recueil de recettes fonctionnelles. Le livre de cuisine est devenu un objet culturel, esthétique et identitaire. Il conjugue la transmission d’un savoir-faire avec une mise en scène soignée, jouant sur la photographie, le design et parfois même le récit personnel de l’auteur. Certains ouvrages se positionnent comme des « beaux livres » que l’on expose dans son salon autant qu’on les utilise dans sa cuisine. Le succès de chefs médiatiques comme Cyril Lignac ou Yotam Ottolenghi illustre cette hybridation entre gastronomie, lifestyle et narration.
L’article souligne également que ce retour en grâce est porté par une quête d’authenticité et de tangibilité. Dans un monde saturé d’écrans, posséder un livre imprimé procure une expérience plus intime et plus durable. Le geste de feuilleter, d’annoter ou de transmettre un ouvrage à ses proches participe d’une ritualisation qui échappe au numérique. De plus, les livres offrent une garantie de fiabilité : là où internet regorge de recettes approximatives ou mal adaptées, l’édition culinaire conserve une image d’expertise validée.
Le marché se diversifie. On observe une explosion de thématiques ciblées : cuisine végétarienne ou vegan, fermentation, pâtisserie créative, street food maison, ou encore ouvrages centrés sur la nutrition et le bien-être. Certains éditeurs misent sur des niches très précises, répondant à des communautés engagées. D’autres surfent sur l’actualité gastronomique ou la notoriété d’émissions télévisées comme Top Chef.
Cette vitalité s’explique aussi par le rôle du livre dans la construction identitaire. Offrir ou s’offrir un livre de cuisine, c’est affirmer un rapport particulier à l’alimentation, que ce soit le goût de la convivialité, le désir d’innovation ou la recherche de santé. Le livre devient ainsi un marqueur social, à mi-chemin entre l’outil pratique et l’objet de distinction culturelle.
Les Échos, Les débuts prometteurs de la culture de la vanille made in Bretagne, 01/10/2025
La vanille, épice rare et précieuse, est traditionnellement associée à Madagascar, à la Réunion ou encore à l’Indonésie. Pourtant, comme le révèle l’article, une expérimentation audacieuse est en cours en Bretagne : la culture de vanille en serre, sous climat tempéré, commence à donner des résultats encourageants. Cette initiative illustre la volonté d’adapter certaines productions exotiques au territoire français, dans une logique d’innovation agricole et de souveraineté alimentaire.
À l’origine du projet, des horticulteurs et entrepreneurs bretons qui ont décidé de se lancer dans la production de cette orchidée tropicale. Grâce à des serres chauffées et à un savoir-faire inspiré des méthodes réunionnaises, ils parviennent à reproduire les conditions nécessaires à la croissance et à la floraison de la vanille. Le processus reste long et complexe : il faut trois ans pour obtenir des gousses exploitables, qui doivent ensuite être récoltées à la main et subir un affinage minutieux. Mais les premiers essais montrent que la Bretagne est capable de produire une vanille de qualité, aux arômes comparables à ceux des origines traditionnelles.
Cette innovation répond à plusieurs enjeux. D’abord, l’instabilité du marché mondial de la vanille, marqué par des fluctuations extrêmes des prix et par des problèmes de fraude ou de contrefaçon. Produire localement permettrait de sécuriser une partie des approvisionnements, notamment pour la haute gastronomie française, très demandeuse d’une épice premium et traçable. Ensuite, la culture bretonne se veut plus durable : en réduisant les importations lointaines et en maîtrisant les conditions de production, elle limite l’empreinte carbone et garantit une meilleure transparence.
Les perspectives économiques sont prometteuses. Si la production reste encore marginale, son positionnement haut de gamme, destiné aux chefs, pâtissiers et artisans chocolatiers, assure une valorisation intéressante. La vanille bretonne ne cherche pas à concurrencer les volumes de Madagascar, mais à s’imposer comme un produit d’exception, incarnant une nouvelle forme de terroir. Elle pourrait à terme rejoindre les circuits courts et les filières labellisées, renforçant l’attractivité de la Bretagne comme région d’innovation gastronomique.
Cependant, des défis subsistent. Le coût énergétique des serres chauffées reste élevé, et la rentabilité dépendra de la capacité à maintenir une qualité constante. Par ailleurs, la culture reste fragile et exige un savoir-faire précis. Les producteurs devront aussi convaincre un marché habitué aux origines traditionnelles.
The Guardian, ‘Planetary health diet’ could save 40,000 deaths a day, landmark report finds, 03/10/2025
Un rapport majeur publié dans The Lancet par 70 experts issus de 35 pays affirme que l’adoption mondiale du « planetary health diet » (PHD) pourrait prévenir 15 millions de décès prématurés par an, soit environ 40 000 par jour, tout en réduisant de moitié les émissions alimentaires liées au climat d’ici 2050. À l’heure où le système alimentaire génère un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et constitue la principale cause de déforestation, de perte de biodiversité et de pollution, les chercheurs jugent impossible de contenir la crise climatique sans transformer profondément nos habitudes alimentaires.
Le régime proposé reste flexible : il privilégie les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et noix, mais tolère une consommation modérée de produits animaux. Les recommandations incluent une portion hebdomadaire de viande rouge, deux portions de poulet et de poisson, trois à quatre œufs, ainsi qu’une ration quotidienne de produits laitiers. Le PHD peut être décliné en version omnivore, végétarienne ou végane, et adapté aux cultures locales. L’objectif est de corriger des régimes actuels jugés déséquilibrés : excès de viande et de produits laitiers en Amérique du Nord, Europe et Amérique latine, mais aussi surconsommation de féculents dans certaines régions d’Afrique subsaharienne.
Le rapport souligne également les inégalités structurelles : les 30 % les plus riches de la planète génèrent plus de 70 % des impacts environnementaux liés à l’alimentation, tandis que 2,8 milliards de personnes n’ont pas les moyens d’accéder à une alimentation saine et qu’1 milliard souffre encore de sous-nutrition. À l’opposé, un autre milliard d’individus est en situation d’obésité, révélant un système alimentaire doublement défaillant.
Pour inverser la tendance, les experts recommandent de réorienter les subventions agricoles vers des productions durables, d’imposer des taxes sur les aliments néfastes pour la santé, de rendre les produits sains plus abordables et de réglementer la publicité. Ils estiment que la transformation du système coûterait 200 à 500 milliards de dollars par an, mais permettrait d’économiser 5.000 milliards en frais liés aux maladies et aux dégâts environnementaux.
Les bénéfices du PHD dépassent la prévention des maladies cardiovasculaires : il réduit aussi les risques de diabète, cancers et maladies neurodégénératives, tout en améliorant l’apport en fibres, acides gras essentiels et micronutriments comme le magnésium et le zinc. Seule la vitamine B12 et le fer nécessitent une vigilance particulière pour les régimes sans produits animaux.
Financial Times, Moving beyond ‘plant bait for the vegans’: can meat substitutes convince consumers?, 29/09/2025
L’élevage représente environ 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, principalement sous forme de méthane et d’oxyde nitreux. Face à cet enjeu, les substituts de viande apparaissent comme une piste prometteuse : produire des alternatives végétales génère deux fois moins d’émissions que la viande, tout en réduisant l’usage des terres et de l’eau. Mais la question centrale demeure : les consommateurs, surtout dans les cultures très attachées à la viande, accepteront-ils d’adapter leurs assiettes ?
L’article décrit les trois approches majeures de l’industrie. La première repose sur les protéines végétales (soja, pois, blé), transformées en textures fibreuses imitant le muscle animal, utilisées dans les burgers, nuggets ou même « faux thon ». La deuxième est la fermentation : champignons cultivés pour produire des filaments riches en protéines, ou microbes programmés pour fabriquer des protéines animales comme la caséine, permettant des laits ou fromages quasi identiques aux originaux. Enfin, la troisième est l’option hybride, où viande et végétaux sont combinés. Ces solutions visent à préserver le goût et la texture familiers, essentiels pour convaincre les carnivores.
Les avantages sont multiples : réduction potentielle massive des émissions, amélioration de la santé publique par la baisse des graisses saturées, et transition plus douce politiquement que des mesures coercitives. Mais les obstacles sont sérieux. Beaucoup de substituts restent hautement transformés, nécessitant additifs et arômes, ce qui suscite des doutes sur leur valeur nutritionnelle. Ils peuvent aussi coûter plus cher que la viande, surtout pour les produits issus de la fermentation de précision, encore onéreuse. Le goût reste un frein décisif : certains produits imitent bien la viande, d’autres déçoivent, ce qui limite leur adoption durable.
Sur le plan climatique, remplacer le bœuf (60 kg de CO₂/kg produit) par des légumineuses (<1 kg) aurait un impact colossal. Mais la demande mondiale de protéines animales continue de croître, notamment en Asie et en Afrique, où la viande reste symbole de statut. Dès lors, les substituts ne compenseront sans doute pas assez vite cette tendance. Leur succès dépendra de politiques publiques actives : fonds publics (comme les 190 M€ du Danemark pour soutenir les protéines végétales), incitations fiscales, encadrement publicitaire et accompagnement des producteurs.
Les gagnants potentiels sont les start-up foodtech et les grands groupes agroalimentaires qui investissent dans ces technologies (Tyson, Cargill, JBS). Les perdants, en revanche, pourraient être les éleveurs traditionnels, surtout les petits exploitants incapables de s’adapter. Les tensions politiques s’annoncent vives, entre soutiens aux substituts et pressions des lobbies de la viande, qui cherchent déjà à restreindre l’usage de termes comme « burger » ou « lait ».
Modern Retail, TikTok is talking to brands like it’s a grocer now, 01/10/2025
TikTok, autrefois perçu avant tout comme une plateforme de divertissement et de créativité virale, s’impose désormais comme un acteur incontournable du commerce alimentaire et des boissons. Comme l’explique Amanda Parker, responsable de l’alimentaire pour TikTok Shop, la plateforme ne se contente plus d’attirer de petits entrepreneurs : de grandes marques comme Mars ou Coca-Cola s’en servent aujourd’hui pour tester des nouveautés, lancer des éditions limitées ou mener des recherches produit. Là où les innovations passaient auparavant par un partenariat avec les distributeurs traditionnels, TikTok Shop devient un canal expérimental et stratégique.
La comparaison avec la grande distribution n’est pas fortuite. Amanda Parker souligne que TikTok reprend certains codes du merchandising des enseignes physiques – comme les mises en avant saisonnières ou les tests de produits – mais en version numérique, grâce à la combinaison unique de contenu et de commerce. La croissance est impressionnante : TikTok Shop a progressé de 120 % en un an, et la catégorie alimentaire et boissons a plus que doublé depuis 2024. Le nombre de grandes marques (plus de 30 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel) présentes sur la plateforme a bondi de 95 % au premier semestre 2025.
Au-delà des ventes, TikTok est devenu un laboratoire de tendances. Les marques peuvent détecter très tôt ce qui séduit les consommateurs en suivant les hashtags et les contenus émergents. C’est ainsi que Mars a lancé ses Skittles POP’d, directement inspirés d’une tendance TikTok de bonbons lyophilisés, ou que la marque familiale EZ Bombs a conquis plus de 1.000 points de vente physiques aux États-Unis après avoir explosé sur TikTok Shop. La viralité devient un tremplin vers la distribution traditionnelle.
La plateforme mise aussi sur les méga-livestreams, où influenceurs et marques cuisinent, goûtent ou organisent des ventes flash en direct, renforçant l’aspect communautaire et interactif. Ce format, encore émergent, illustre la spécificité de TikTok : chaque opération doit être visuellement percutante et adaptée aux codes de l’ASMR ou de la transformation culinaire.
TikTok se positionne ainsi comme un nouvel acteur du retail media, capable de rivaliser avec Amazon ou Walmart en matière de données consommateurs et de publicité ciblée. Si des incertitudes demeurent autour de sa gouvernance et de son avenir aux États-Unis, la plateforme s’impose déjà comme un levier omnicanal incontournable pour les marques alimentaires, qui y voient à la fois un outil de test, de communication et de vente directe.
Modern Retail, Why ChatGPT checkout isn’t a threat to Amazon’s dominance — yet, 02/10/2025
OpenAI accélère son incursion dans le e-commerce avec le lancement d’Instant Checkout, une fonctionnalité intégrée à ChatGPT qui permet aux utilisateurs américains d’acheter directement des produits sans quitter l’application. Pour l’heure, le service concerne des vendeurs Etsy et sera bientôt élargi à plus d’un million de marchands Shopify (Glossier, Skims, Spanx, Vuori…). Les paiements sont opérés via Stripe, et les marchands paient une commission encore non précisée. Cette initiative marque l’entrée officielle de ChatGPT dans ce que l’entreprise appelle « l’agentic commerce » — une vision où des agents d’IA pourraient un jour acheter automatiquement au nom des consommateurs.
Pour l’instant, l’expérience reste limitée : l’utilisateur doit rechercher un produit, le sélectionner et finaliser l’achat, comme sur n’importe quelle plateforme. La différence tient au fait que tout se passe dans l’interface ChatGPT, sans redirection vers un site marchand. Le système ne supporte que les achats unitaires, mais OpenAI promet l’ajout de paniers multi-produits et une extension à d’autres régions.
Si cette nouveauté semble concurrencer Amazon, le géant de Seattle conserve un avantage considérable grâce à son infrastructure logistique bâtie sur deux décennies et à la fidélité des abonnés Prime habitués à la livraison ultra-rapide. Acheter via ChatGPT, en passant par de petits marchands Etsy ou Shopify, reste « un pari » sur les délais de livraison. Par ailleurs, Amazon pourrait malgré tout capter une partie de cette activité : son service logistique tiers vient d’annoncer qu’il prendra aussi en charge des commandes issues de Walmart, Shein et Shopify. En clair, Amazon gagne dans tous les cas une part des revenus du commerce en ligne américain.
Là où la menace pour Amazon pourrait être plus sérieuse, c’est dans la publicité. Le cœur de la rentabilité du groupe n’est pas la vente directe mais son unité publicitaire de 56 milliards de dollars, alimentée par la recherche produit interne. Si de plus en plus de consommateurs passent par ChatGPT pour découvrir des produits, cela pourrait siphonner une partie du trafic et fragiliser le modèle publicitaire d’Amazon. Pour l’instant, OpenAI n’a pas intégré de placements sponsorisés : les résultats sont présentés comme « purement organiques », mais des pistes de monétisation sont à l’étude.
Pour les marchands, ChatGPT représente un nouveau canal de vente attractif. Beaucoup de vendeurs Amazon peinent à générer du trafic sur leurs sites direct-to-consumer, et la publicité sur Google ou Meta reste coûteuse. Le partenariat OpenAI-Shopify incite déjà certains d’entre eux à envisager une migration vers Shopify afin de profiter du canal ChatGPT.
CNBC, From PepsiCo to Taco Bell, dirty soda is taking over, 27/09/2025
Née en 2010 dans l’Utah avec la chaîne Swig, la tendance du dirty soda — sodas mélangés à des sirops, de la crème ou du lait — s’est imposée comme une nouvelle dynamique dans l’univers des boissons gazeuses, longtemps en perte de vitesse. Popularisée par TikTok et l’émission The Secret Lives of Mormon Wives, elle s’étend désormais des soda shops régionaux aux géants de l’agroalimentaire comme PepsiCo, Taco Bell ou McDonald’s, donnant un second souffle à une catégorie jugée vieillissante.
PepsiCo est en première ligne avec le lancement de nouvelles boissons inspirées du dirty soda : après le succès de Pepsi Wild Cherry & Cream, deux produits prêts-à-boire, Dirty Dew et Mug Floats Vanilla Howler, seront dévoilés en 2026. L’entreprise compare l’engouement actuel à la nostalgie des « root beer floats » ou des bars à soda du milieu du XXᵉ siècle. Pour Mark Kirkham, directeur marketing de Pepsi Beverages North America, il s’agit de revisiter le soda de manière ludique et créative.
Le succès ne se limite pas aux supermarchés. Des chaînes comme TGI Fridays ont ajouté le dirty soda à leur carte, parfois en version alcoolisée, tandis que McDonald’s teste de nouvelles recettes de sodas aromatisés dans plus de 500 restaurants. Taco Bell a également surfé sur la vague avec des déclinaisons exclusives de son Baja Blast. Côté indépendants, Swig a dépassé les 140 établissements aux États-Unis et affiche une croissance de 8,2 % de ses ventes à magasins comparables en 2025, inspirant des rivaux comme Sodalicious ou Fiiz. Pour son PDG, Alex Dunn, Swig est au soda « ce que Starbucks a été pour le café ».
Le dirty soda attire un public jeune, notamment les femmes de 18 à 35 ans. Plus accessible et moins caféiné que le café, il peut être consommé tout au long de la journée et séduit par son côté personnalisable et visuellement attractif, parfait pour les réseaux sociaux. Cette tendance joue aussi le rôle de « porte d’entrée » vers les marques traditionnelles : Keurig Dr Pepper observe par exemple que ses innovations “creamy” ou fruitées fidélisent durablement de nouveaux consommateurs.
Plus largement, cette mode contribue à renverser la courbe de déclin des sodas aux États-Unis. Après deux décennies de baisse, la consommation de boissons gazeuses s’est stabilisée autour de 11,9 milliards de gallons (environ 54 milliards de litres) en 2024-2025, portée par l’essor du dirty soda et des sodas prébiotiques. Pour l’industrie, c’est une opportunité stratégique : recruter une nouvelle génération de buveurs, stimuler la créativité et diversifier les canaux, du service rapide aux rayons de supermarchés.
New York Times, The $400 Million Restaurant Man, 30/09/2025
À 70 ans, Stephen Starr s’impose comme l’un des restaurateurs les plus influents des États-Unis, à la tête d’un empire de 43 établissements dans six villes, générant environ 400 millions de dollars de revenus annuels et employant 5.000 personnes. De Philadelphie à New York en passant par Miami, Washington ou Nashville, ses restaurants attirent présidents, célébrités et touristes, tout en séduisant un public plus populaire. Sa force : une capacité unique à créer des lieux immersifs où gastronomie, design, musique et atmosphère s’entrelacent comme un spectacle savamment orchestré.
Stephen Starr est décrit comme un créateur. Son obsession pour les détails — de la sélection des playlists à l’intensité des lumières — traduit son passé dans la musique, où il a débuté avant de se lancer dans la restauration. Son premier succès fut The Continental (1995), un bar à martinis qui lança la révolution culinaire de Philadelphie, suivi du spectaculaire Buddakan (1998). Sa vision audacieuse, conjuguant design théâtral et restauration grand public, fit de lui un pionnier, mais aussi un entrepreneur parfois critiqué pour ses « méga-restaurants » clinquants.
Sa carrière s’est déployée en trois actes. D’abord, plaire au plus grand nombre grâce à des concepts séduisants et accessibles. Ensuite, gagner en crédibilité auprès des élites culinaires, avec des projets plus exigeants comme Le Coucou à New York, salué par la critique et récompensé par un James Beard Award et une étoile Michelin. Enfin, un troisième acte où Stephen Starr assume ses propres envies : ressusciter des institutions déchues (comme Babbo ou bientôt Lupa) ou développer des marques iconiques telles que Pastis, en multipliant les déclinaisons dans plusieurs villes.
Stephen Starr est comparé à un Rick Rubin (un producteur de disques américain, principalement connu pour son travail dans le milieu du rap et du heavy metal) de la restauration : il ne cuisine pas, mais sait détecter les talents (chefs comme Nancy Silverton, Mark Ladner ou Daniel Rose) et transformer une idée en concept pérenne et lucratif. Cette stratégie lui permet de bâtir une « bibliothèque » de marques restauratrices qu’il adapte et exporte. Son flair est souvent confirmé par le public : ainsi, ses intuitions sur un plat ou une ambiance s’imposent face aux hésitations de ses partenaires.
Toujours en quête de nouveaux projets, Starr prépare actuellement plusieurs ouvertures, dont un Mission Chinese revisité avec Danny Bowien et un projet avec le réalisateur M. Night Shyamalan. S’il admet que ses choix ne sont pas toujours rationnels financièrement — investir dans une fresque à 90 000 $ ou remplacer des miroirs pour 20 000 $ — il revendique une logique artistique : créer des lieux uniques, quitte à sacrifier des marges.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey