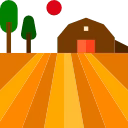🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-27
Bonjour à toutes et à tous, Eat’s Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Cette semaine j’ai décidé d’innover. Cela fait plusieurs fois que certains d’entre vous me disent que le podcast Eat’s Business leur manque. Comme mon ancien compère Daniel est désormais bien occupé par son poste de CEO et que je suis toujours bien pris par mon poste de CEO de moi-même, j’ai décidé de faire appel à une amie : la technologie. Je vous propose donc un épisode entièrement généré par l’IA de NotebookLM qui reprend les différents articles présents dans la newsletter de la semaine sous forme de conversation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce procédé je vous laisse découvrir le rendu, c’est assez bluffant.
Si ce format complémentaire vous plaît, n’hésitez pas à me le dire et je ferai en sorte de publier les deux en même temps et d’améliorer le rendu audio pour les prochaines fois.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Le Figaro, «On n’a pas envie de mettre ce prix pour ressortir déçu» : comment les Français ont déserté les restaurants, 26/09/2025
Les Échos, Agriculture : pour faire face à la concurrence mondiale, les coopératives dans une course à la taille, 22/09/2025
Wall Street Journal, The Extravagant (and Loud) Candies Adults Can’t Stop Eating in 2025, 26/09/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Figaro, «On n’a pas envie de mettre ce prix pour ressortir déçu» : comment les Français ont déserté les restaurants, 26/09/2025
La fréquentation des restaurants traditionnels en France est en net recul, frappée par un cocktail de facteurs économiques et culturels. À l’inflation, au télétravail et à la transformation des modes de vie s’ajoute une défiance croissante des consommateurs vis-à-vis de l’expérience proposée. Beaucoup dénoncent une déconnexion entre le prix payé et la qualité du service ou des plats reçus. Certains estiment qu’ils mangeraient mieux, pour moins cher, chez eux. Des plats tièdes, des produits industriels, un service impersonnel : autant d’éléments qui nourrissent la frustration des clients.
Sur les réseaux sociaux, la fronde s’organise : témoignages indignés, additions détaillées, critiques sur la hausse des prix se multiplient. La perception d’un abus tarifaire devient un sujet sensible. Le vin cristallise les critiques : revendu jusqu’à 3 à 6 fois son prix d’achat, il est vu comme un symbole d’un rapport qualité-prix déséquilibré. Résultat : de nombreux consommateurs désertent les restaurants moyenne gamme, qu’ils estiment surfacturés et peu authentiques.
Face à cette désaffection, d’autres modes de consommation prennent le relais. Les fast-foods, plus accessibles, connaissent une hausse de fréquentation. Les chaînes traditionnelles à petits prix (comme les Bouillons à Paris) sont pleines, alors que les établissements classiques peinent à remplir leurs salles. La livraison de repas s’est installée durablement, poursuivant son essor post-Covid. Près d’un quart des Français y ont recours régulièrement. Les box repas comme Hello Fresh ou Quitoque séduisent ceux qui veulent bien manger à domicile, à moindre coût.
Le secteur des épiceries fines progresse aussi. Des produits de qualité, autrefois réservés aux restaurants, sont désormais disponibles en grande distribution. Les clients préfèrent parfois un plat cuisiné premium ou des produits frais en boutique spécialisée à un repas moyen au restaurant.
Ce recentrage domestique se traduit aussi par des comportements d’austérité : plats partagés, suppression des desserts ou de l’alcool au restaurant. Les chiffres confirment la tendance : jusqu’à 25 fermetures de restaurants par jour, et une baisse globale de fréquentation de 20 à 30 %.
Pour les professionnels, l’enjeu est clair : retrouver l’équilibre entre prix, qualité et expérience client. Faute d’adaptation, le « milieu de gamme » pourrait disparaître, au profit d’une restauration soit très haut de gamme, soit très standardisée.
Le Monde, Gaufres, donuts, cookies : en ville ou dans les centres commerciaux, l’heure de gloire du fast-food sucré, 23/09/2025
Le fast-food sucré connaît une véritable explosion en France, marquée par la prolifération d’enseignes spécialisées dans les cookies, donuts, gaufres et autres gourmandises américanisées. Des enseignes telles que Puffy, Dreams Donuts ou encore Krispy Kreme se multiplient dans les centres-villes, les gares et les centres commerciaux. En 2024, ce segment a enregistré une croissance de 13 %, bien supérieure à celle de la fast-food en général (5 %), selon la revue France Snacking. Cette dynamique est alimentée par un contexte post-inflation où le besoin de réconfort et la recherche de petits plaisirs accessibles priment sur les préoccupations de santé. Le paradoxe est saisissant : alors que près d’un Français sur deux est en surpoids et que l’obésité progresse, notamment chez les jeunes, les produits très sucrés et gras attirent toujours plus.
Ce succès repose sur des modèles économiques efficaces : fabrication simple, faibles coûts des matières premières et marges élevées, à quoi s’ajoute une rentabilité renforcée par la vente de boissons chaudes. Les coffee-shops jouent un rôle clé, combinant cookies et lattes dans des décors travaillés. La cible principale reste la génération Z, avide d’expériences visuelles et partageables sur les réseaux sociaux. Dreams Donuts, par exemple, conçoit ses produits pour leur esthétique Instagram, avec des toppings spectaculaires (Kinder, Schtroumpfs, Spéculoos). Les stratégies marketing s’appuient fortement sur les influenceurs, les opérations virales et le bouche-à-oreille digital.
Mais cette course au sucré n’est pas sans limites. Plusieurs enseignes ferment déjà des points de vente. Si l’investissement initial reste modeste, la concurrence est rude et le marché pourrait atteindre un point de saturation. Les ouvertures en franchise se poursuivent à un rythme soutenu, mais la pérennité repose sur la capacité à fidéliser une clientèle changeante. Le modèle, bien que très rentable, interroge aussi sur la transformation des centres urbains où ces enseignes remplacent des commerces traditionnels affaiblis. Le développement rapide, la simplicité d’installation (pas besoin de hotte ou de cuisson grasse) et la portée symbolique du “goûter d’adulte” en font un phénomène sociétal autant qu’économique.
Les Échos, Agriculture : pour faire face à la concurrence mondiale, les coopératives dans une course à la taille, 22/09/2025
Le projet de fusion entre Agrial et Terrena s’inscrit dans un mouvement plus global de concentration du secteur coopératif agricole français. Face à une compétition internationale accrue et à la pression exercée par la grande distribution, les coopératives multiplient les alliances pour gagner en taille critique. Le futur ensemble, issu de la fusion annoncée, afficherait un chiffre d’affaires de près de 13 milliards d’euros et regrouperait 35 000 salariés, se positionnant comme un acteur majeur dans des filières variées : lait, viande, volaille, céréales ou encore salades prêtes à l’emploi.
Cette dynamique de consolidation touche aussi d’autres acteurs : Terres du Sud et Vivadour dans le Sud-Ouest, ou encore Euralis et Maïsadour, qui ont relancé un projet de fusion globale de leurs activités. Objectif : réaliser des économies d’échelle pour affronter les géants européens du secteur. L’exemple d’Arla Foods, coopérative danoise en voie de fusion avec un partenaire allemand, est significatif : son chiffre d’affaires atteindrait 15 milliards d’euros, soit trois fois plus que Sodiaal.
Les coopératives doivent aussi composer avec l’évolution des canaux de négociation, aujourd’hui dominés par les centrales d’achat européennes. Ces dernières imposent des baisses de prix régulières, ce qui suscite un fort mécontentement chez les agriculteurs coopérateurs. Pour conserver leur rentabilité, les coopératives doivent investir massivement : selon Dominique Chargé, président de la Coopération agricole, un plan d’investissements de 10 milliards d’euros est prévu sur trois ans, notamment pour moderniser les outils industriels et accompagner la transition agroécologique.
Les effets du changement climatique poussent aussi les structures à se réorganiser. Des petites coopératives viticoles du Tarn se sont regroupées après une chute de production due au mildiou. De plus, la baisse du nombre d’agriculteurs accentue la nécessité de sécuriser les approvisionnements. Moins d’éleveurs, c’est moins de lait, de fromage, de viande. Enfin, la gouvernance reste un enjeu crucial : les fusions peuvent entraîner des tensions internes, comme l’avait montré la crise de gouvernance chez Tereos en 2021. Le défi est donc double : rester compétitif tout en préservant l’âme coopérative.
Le Monde, Fusion géante en vue dans les coopératives agricoles françaises, 22/09/2025
L’article revient sur la fusion mentionnée dans l’article précédent. C’est, en effet, une transformation majeure qui se profile dans le paysage agricole français avec ce projet de fusion entre deux coopératives régionales de premier plan : Agrial (Normandie) et Terrena (Pays de la Loire). Cette opération, si elle est validée par les adhérents et l’Autorité de la concurrence, donnerait naissance à un acteur coopératif de premier plan, pesant plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires et regroupant près de 30 000 salariés. Elle marquerait une étape importante dans la réorganisation du secteur agroalimentaire coopératif, confronté à des défis économiques, environnementaux et concurrentiels sans précédent.
Agrial, née en 2000, s’est imposée dans des domaines variés (salades, lait, cidre) et s’est déployée à l’international via des acquisitions comme celle de Manzana, fabricant californien de jus et compotes. En 2024, elle affichait 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Terrena, plus “modeste” (5,6 milliards), est très présente sur les viandes, les oeufs, les céréales, et détient une part dans Laïta (Paysan Breton, Mamie Nova). Leur fusion permettrait une mutualisation des compétences, une meilleure maîtrise des filières et un renforcement de leur position sur les marchés européens et internationaux.
Ce rapprochement s’inscrit dans une vague plus large de consolidation, comme en témoignent les discussions entre Euralis et Maïsadour dans le Sud-Ouest. Ces fusions visent à offrir aux coopératives les moyens d’investir dans la modernisation, de s’adapter au changement climatique et de répondre aux nouvelles attentes sociétales. Pour les producteurs, il s’agit aussi de mieux valoriser leur production dans un contexte où la pression des distributeurs s’intensifie.
La décision finale reviendra aux adhérents et aux salariés des deux coopératives, à travers une série de votes et de consultations prévues courant 2026. L’objectif est de finaliser la fusion d’ici début 2027. L’opération pourrait servir de modèle à d’autres regroupements dans un secteur en pleine mutation, désireux de peser plus lourd sur la scène européenne tout en conservant son ancrage territorial et coopératif.
Les Échos, Les légumes sans pesticides peinent à séduire les consommateurs, 25/09/2025
Face à la pression sociétale croissante pour réduire l’usage des pesticides, une voie intermédiaire entre agriculture conventionnelle et bio gagne du terrain : le label « zéro résidu de pesticides » (ZRP). Portée notamment par le collectif Nouveaux Champs depuis 2018, cette certification ambitionne de proposer une alternative crédible, plus accessible que le bio, tout en réduisant significativement l’usage des produits phytosanitaires. En sept ans, 35 entreprises représentant environ 400 agriculteurs ont rejoint la démarche, et 28 espèces de légumes et fruits sont désormais labellisées ZRP, dont les tomates, les carottes, les pommes ou les abricots.
Le cahier des charges impose un seuil maximal de 0,01 milligramme de résidus par kilo à la sortie des champs, sans pour autant interdire les traitements phytosanitaires durant la culture. Ce compromis permet une meilleure maîtrise des risques pour les producteurs, qui peuvent vendre leurs récoltes en filière conventionnelle en cas de non-conformité. En moyenne, l’usage de pesticides est réduit de moitié, bien que cette performance varie en fonction des aléas climatiques. La certification repose sur des analyses strictes menées par des laboratoires indépendants à chaque étape, jusqu’aux stations de conditionnement.
Si le ZRP reste marginal dans les rayons (moins de 1 % du marché), il représente une part significative du chiffre d’affaires de certaines entreprises, jusqu’à 15 % chez Paysans de Rougeline. Les distributeurs y voient une offre plus abordable que le bio, surtout depuis que l’inflation a freiné l’élan des consommateurs vers les produits certifiés AB. Pour les producteurs, c’est un moyen de se différencier, malgré une rentabilité encore incertaine en raison des faibles volumes et des coûts d’analyses.
Certaines coopératives vont plus loin encore. Prince de Bretagne a supprimé tout traitement sur ses tomates, qui sont désormais à 100 % en sans pesticides (SP). Avec ses partenaires Saveol et Solarenn, ce sont 200 000 tonnes produites annuellement par 176 producteurs. Pourtant, le paradoxe demeure : certains légumes comme le potimarron ou le chou-fleur cultivés sans pesticides ne trouvent pas preneurs, faute de valorisation en magasin. Sans affichage clair ni demande explicite du consommateur, l’effort agricole reste invisible, poussant certains producteurs à abandonner la démarche.
Malgré ces obstacles, le sans pesticides stimule la recherche agronomique. Prince de Bretagne a récemment développé une variété d’échalote SP résistante au mildiou, avec 170 tonnes déjà commercialisées. Le responsable de la coopérative insiste : cette voie offre une solution pragmatique pour transformer les pratiques sans basculer totalement vers le bio. Elle permet de sécuriser les récoltes tout en répondant à une exigence croissante de durabilité. À condition toutefois que le marché suive, par la pédagogie et une meilleure mise en avant en rayon.
Les Échos, « Il y a un vrai risque de casse » : le rapport qui alerte sur la faiblesse des marges de l’industrie laitière, 25/09/2025
Une étude inédite de la Banque de France, commandée par la Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL), met en lumière l’extrême fragilité économique du secteur laitier privé en France. Le rapport, qui analyse les comptes de 149 entreprises (dont Lactalis, Savencia, Danone ou Bel), révèle que leur taux de marge net moyen a chuté à 1,1 % en 2024, contre 1,8 % en 2020. Un seuil jugé critique, plaçant ces entreprises « à la limite de la ligne de flottaison » et exposées au moindre choc économique, géopolitique ou d’approvisionnement.
Pris en étau entre les producteurs, qui réclament des hausses de prix pour compenser l’explosion des coûts de production, et la grande distribution, engagée dans une nouvelle guerre des prix, les industriels alertent : « On est à la merci de la moindre crise », avertit François-Xavier Huard, directeur général de la FNIL. Alors que le prix du lait payé aux éleveurs est passé de 340,50 €/1000L en 2020 à 467,10 € en juin 2025, les industriels dénoncent l’incapacité à répercuter ces hausses, en dépit des mécanismes prévus par la loi Egalim.
La pression de la grande distribution s’intensifie, notamment via la constitution de centrales d’achat européennes (Carrefour, Système U et partenaires allemands), qui amplifient les logiques de baisse des prix et contournent partiellement la législation française. D’ici 2027, 100 % des produits de grande consommation devraient être négociés via ces plateformes, réduisant la marge de manœuvre des industriels français.
En parallèle, la dépendance à l’exportation fragilise également le secteur : 75 % des entreprises adhérentes de la FNIL exportent, et pour 10 % d’entre elles, l’international représente plus de 40 % du chiffre d’affaires. Or, les tensions géopolitiques, les barrières douanières et la concurrence mondiale compliquent les débouchés extérieurs.
Sur le partage de la valeur, l’étude réfute certaines critiques : 64 % de la valeur ajoutée des industriels laitiers est allouée à la rémunération des salariés (contre 59 % dans le reste de l’agroalimentaire), et seulement 14 % aux actionnaires (contre 18 % ailleurs), illustrant une gestion resserrée.
Enfin, le secteur doit continuer d’investir dans la modernisation de ses outils de production pour rester compétitif et répondre aux attentes de durabilité et d’évolution des modes de consommation. Mais pour la FNIL, maintenir cette dynamique sous la pression actuelle devient de plus en plus difficile. Le message est clair : sans meilleure reconnaissance de la réalité économique du secteur, la filière court un « vrai risque de casse ».
La Tribune, Les vins de Bordeaux au bord de la catastrophe économique, 24/09/2025
Le vignoble bordelais traverse une crise d’une gravité inédite, marquée par une surproduction chronique, une trésorerie exsangue et un effondrement des prix. En dépit d’un millésime 2025 de qualité, les viticulteurs bordelais peinent à vendre leur production, et ce à des tarifs très inférieurs aux coûts de revient. La crise, qui couve depuis plusieurs années, a été amplifiée par la chute des exportations vers la Chine et les États-Unis, la baisse continue de la consommation de vin rouge, ainsi que le dysfonctionnement du système des ventes en primeurs.
La situation est critique : de nombreuses exploitations, y compris des domaines réputés, se retrouvent en procédure collective ou en redressement judiciaire. Un milliard d’euros de trésorerie a disparu du circuit en deux ans, selon le collectif Viti33. Les chais, les entrepôts des négociants et même les rayons des grandes surfaces sont saturés de vin invendu, et les prix de vente chutent dangereusement. Des tonneaux de Bordeaux se négocient aujourd’hui à 700 ou 800 euros, pour un coût de production de 1 500 euros minimum.
Cette spirale déflationniste alimente un climat de désespoir. Les producteurs bradent, arrachent les vignes, ou partent à la retraite en espérant écouler les stocks. Les crus classés, eux-mêmes, peinent à écouler leurs seconds vins. À cela s’ajoute le paradoxe du millésime 2025 : d’excellente qualité mais à faible rendement, ce qui renchérit mécaniquement les coûts de production par litre, aggravant encore la situation économique.
Le Crédit Agricole, premier partenaire bancaire du secteur, fait face à un taux de défaut très élevé, sans pour autant évoquer de risque systémique. Les négociants, pour l’instant, tiennent bon, mais les bilans 2025 s’annoncent alarmants. La crise menace plus de 5 000 exploitations et jusqu’à 50 000 emplois directs et indirects en Gironde. Elle entraîne une recomposition du paysage viticole, déjà marquée par l’arrachage de 18 000 hectares, et potentiellement 15 000 à 30 000 hectares supplémentaires.
Ce que dénoncent les acteurs locaux, c’est le silence des pouvoirs publics et l’absence de plan d’envergure pour gérer ce qui s’apparente à un effondrement programmé. La viticulture bordelaise vit, selon plusieurs experts, la pire crise depuis un demi-siècle.
Le Monde, Valérie de Sutter, l’esprit libre du sans-alcool, 24/09/2025
Valérie de Sutter, fondatrice de la marque JNPR, incarne une révolution discrète mais puissante : celle des spiritueux sans alcool. Ancienne communicante politique, elle se reconvertit en 2019 alors qu’elle s’installe à Milan. Inspirée par les « functional drinks » new-yorkais et déçue par l’offre existante en boissons sans alcool, elle décide de créer une alternative raffinée, sans sucre ni alcool, avec un profil de dégustation digne des meilleurs cocktails.
Avec l’aide du bartender italien Flavio Angiolillo et une distillerie corrézienne spécialisée dans le gin, elle met au point JNPR no 1, puis d’autres références aux arômes plus marqués comme JNPR no 2 (gingembre) ou JNPR no 3 (verveine). Elle développe également une gamme de spiritueux inspirés du bitter, du vermouth ou du rhum, toujours à 0 % d’alcool. L’ambition est claire : offrir une véritable alternative au plaisir de l’apéritif, sans compromis sur le goût ou l’expérience sensorielle.
Le succès est rapide. Dès la première année, elle réalise 200 000 euros de chiffre d’affaires via une vente exclusivement en ligne. En 2024, la marque vend 150 000 bouteilles, dont 90 % en France et 55 % sur son propre site. Son slogan « Sans sucre, sans alcool, réinventons l’apéritif » trouve un écho dans une société en quête de sobriété, de mieux-vivre et de cohérence alimentaire.
Valérie de Sutter ne se positionne pas comme une militante de l’abstinence, mais comme une entrepreneuse convaincue qu’on peut réinventer les codes de la convivialité sans passer par l’alcool. En janvier 2025, elle publie un ouvrage de recettes de cocktails sans alcool, renforçant son statut d’experte dans ce nouveau segment. L’arrivée de Rémy Cointreau au capital de JNPR en juillet 2025, via son fonds corporate, valide définitivement la crédibilité de son projet à l’échelle internationale.
Avec une stratégie tournée vers l’export et une vision claire du marché, Valérie de Sutter souhaite désormais faire de JNPR un leader européen, voire mondial. Elle croit au potentiel énorme de ce marché encore émergent, à condition de maintenir un haut niveau d’exigence en matière de goût et d’image. Un pari audacieux qui s’inscrit dans une mutation plus large des comportements de consommation.
Le Monde, Au restaurant, l’horizon grisant du sans-alcool, 21/09/2025
Face à la baisse continue de la consommation d’alcool en France, notamment lors des repas, les restaurants, y compris gastronomiques, élargissent leur offre de boissons sans alcool. Sommeliers, chefs et mixologues collaborent désormais pour créer des accords mets-boissons aussi subtils qu’avec le vin. Cette tendance s’impose comme une réponse aux nouvelles attentes d’une clientèle plus soucieuse de sa santé, de son mode de vie ou de convictions personnelles, tout en restant attachée au plaisir gustatif.
À L’Écrin, le restaurant étoilé de l’Hôtel de Crillon, plus de 30 % des clients choisissent désormais une option sans alcool pour accompagner leur dîner. Xavier Thuizat, chef sommelier, y voit l’occasion de créer de nouvelles expériences gustatives et émotionnelles, tout en générant un chiffre d’affaires additionnel. Thé d’exception, café de spécialité, infusions aux épices, décoctions végétales, jus fermentés ou encore cocktails sans alcool font désormais partie de l’arsenal du sommelier moderne.
Des chefs de renom comme David Toutain ou Anne-Sophie Pic vont plus loin en intégrant des boissons créées sur mesure dans leur menu. Leurs boissons sans alcool fonctionnent comme une extension de l’assiette, reprenant les arômes, les textures et les associations de saveurs. Chez Toutain, par exemple, une eau de courgette fermentée peut être associée à un plat de légumes du même registre, offrant une continuité sensorielle.
La créativité est également portée par une nouvelle génération de professionnels, à l’image de Benoît d’Onofrio, autoproclamé “sobrelier”, ou de Victor Delpierre, mixologue spécialisé dans les “120”, des boissons à base de raisin qui imitent l’expérience du vin sans passer par la fermentation. Ces experts développent des recettes à la fois complexes et cohérentes avec les cuisines des grands restaurants.
Cette dynamique transforme la sommellerie : elle n’est plus seulement l’affaire du vin, mais devient une discipline transversale où se croisent mixologie, gastronomie et création liquide. Elle soulève également des enjeux pédagogiques, car les écoles hôtelières tardent encore à intégrer cette approche dans leurs formations.
En somme, la montée du sans-alcool en restauration haut de gamme traduit une transformation profonde de la culture gastronomique, où le plaisir et la responsabilité ne sont plus antagonistes, mais complémentaires.
Le Monde, Le kombucha sort de sa bulle, 20/09/2025
Longtemps cantonné aux rayons bio et aux marchés confidentiels, le kombucha connaît en France un tournant décisif. Cette boisson fermentée à base de thé sucré, enrichie de levures et de bactéries, séduit désormais une clientèle plus large, urbaine, jeune et soucieuse de son bien-être. Boosté par la tendance du “better-for-you” et du “low & no alcohol”, le kombucha entre dans une phase d’industrialisation maîtrisée, sans renier son image artisanale.
La filière se structure rapidement. Des marques comme Jubiles, Karma ou Lökki développent leurs capacités de production tout en cherchant à rester fidèles à l’esprit originel du produit : vivant, non pasteurisé, peu sucré et naturellement pétillant. Les entrepreneurs du secteur insistent sur la nécessité d’un équilibre entre standardisation et respect des cycles biologiques. La fermentation doit rester contrôlée, mais naturelle, et les levures indigènes doivent être préservées.
Les grandes surfaces et les cafés-restaurants s’ouvrent progressivement à ces boissons alternatives. En parallèle, les brasseurs traditionnels, touchés par la baisse de la consommation de bière et d’alcool, commencent à s’y intéresser. Certaines microbrasseries diversifient ainsi leur activité en intégrant le kombucha dans leur gamme de produits. Des chefs l’intègrent aussi dans leurs menus comme boisson d’accompagnement.
Mais le marché reste fragile. La durée de vie limitée du kombucha non pasteurisé, les contraintes logistiques de la chaîne du froid et la méconnaissance du grand public freinent encore son adoption à grande échelle. Les prix, souvent élevés (jusqu’à 3 à 5 euros la bouteille), constituent également un frein, surtout en période d’inflation.
Malgré cela, les perspectives sont prometteuses. Le kombucha s’inscrit dans une mouvance de fond qui dépasse la simple tendance. Il correspond à une évolution des comportements : consommer moins, mieux, de manière plus responsable. Son profil santé, son originalité aromatique et son image naturelle en font un concurrent sérieux aux sodas classiques, aux eaux aromatisées industrielles, voire aux bières sans alcool.
Les acteurs du secteur misent sur l’éducation des consommateurs, la démocratisation du produit et une meilleure compréhension des bienfaits du microbiote pour ancrer durablement le kombucha dans les habitudes. Un défi de taille, mais qui pourrait, à terme, faire de cette boisson vivante une référence de la consommation responsable.
Inc, This Founder Turned Cooking Dinner for His Customers Into a Multimillion-Dollar Business, 22/09/2025
Jon Urbana, fondateur de Kow Steaks, une entreprise spécialisée dans le bœuf Wagyu américain en vente directe aux consommateurs (DTC), a su transformer une simple initiative marketing en un modèle économique à part entière. Fondée en 2017 à Omaha, dans le Nebraska, Kow Steaks proposait des pièces de viande haut de gamme, avec des prix allant de 30 à plus de 1 600 dollars. Si la marque avait su fidéliser une clientèle passionnée, la croissance stagnait après trois ans d’activité, avec une hausse annuelle des ventes limitée à 5-10 %.
Face à cette impasse, Jon Urbana a lancé en 2020 une stratégie inédite : se rendre chez ses meilleurs clients pour leur cuisiner lui-même les steaks Kow, gratuitement, à condition qu’ils achètent la viande. Armé d’un billet d’avion, d’une glacière Yeti et de ses meilleures pièces, il leur offrait une expérience steakhouse « cowboy » directement à domicile. L’objectif était clair : séduire leurs invités et ainsi étendre sa base de clientèle. Ces dîners privés, perçus comme une dépense marketing, ont rapidement suscité un engouement croissant.
Devant le succès de ces événements, Urbana a décidé de les facturer. À sa grande surprise, la transition vers une offre payante n’a suscité aucune opposition. Ce pivot stratégique a donné naissance à une division événementielle dédiée, aujourd’hui dotée de six employés internes et d’un réseau de prestataires locaux. Kow Steaks organise désormais des événements allant de dîners intimes à des réceptions de grande envergure (jusqu’à 5 000 personnes), avec des tarifs oscillant entre 10 000 et 15 000 dollars par événement.
En quelques années, cette nouvelle activité s’est imposée comme un pilier de la croissance de l’entreprise, avec une progression de 500 % d’une année sur l’autre. Parmi les clients figurent des entreprises prestigieuses telles que Chevron, American Express, la NFL (Super Bowl), la PGA Tour, ainsi que des célébrités comme le chanteur country Blake Shelton.
Pour Jon Urbana, cette stratégie a permis non seulement de contourner la dépendance aux ventes DTC, mais aussi de valoriser l’excellence de ses produits par l’expérience directe. « Quand des gens habitués aux meilleurs restaurants du monde s’arrêtent de parler pour savourer votre viande, vous savez que vous tenez quelque chose », confie-t-il. L’histoire de Kow Steaks illustre ainsi comment l’incarnation du produit par son fondateur peut devenir un moteur puissant de différenciation et de croissance.
IFT, Can Food Really Heal?, 03/09/2025
Le concept de « Food as Medicine » (ou « Food is Medicine ») connaît un regain d’intérêt majeur, soutenu par des études cliniques récentes et des initiatives politiques ambitieuses. L’idée, loin d’être nouvelle, puise ses racines dans les traditions médicales anciennes, de la Grèce antique à l’Ayurveda. Elle repose sur une conviction simple : une alimentation adaptée peut non seulement prévenir certaines maladies, mais aussi en atténuer les symptômes, voire les traiter. Cette approche a récemment été intégrée dans la stratégie nationale sur la faim, la nutrition et la santé lancée par l’administration Biden-Harris en 2022, visant à promouvoir un accès élargi aux fruits et légumes frais.
Les preuves scientifiques en faveur de cette approche s’accumulent : des études montrent qu’une alimentation équilibrée peut améliorer la santé métabolique, cardiovasculaire, voire mentale. Des essais comme SMILES ont mis en lumière l’effet bénéfique d’un régime alimentaire adapté sur la dépression. Toutefois, les résultats restent hétérogènes selon les pathologies et les populations. Certaines études n’ont pas obtenu d’amélioration significative, par exemple dans la gestion du diabète de type 2, ce qui soulève la nécessité de recherches plus ciblées pour identifier les interventions alimentaires les plus efficaces, en fonction des profils individuels (génétique, microbiote, etc.).
Sur le terrain, plusieurs initiatives locales émergent, comme les “prescriptions de fruits et légumes”, soutenues dans certains États via des dérogations Medicaid. Ces programmes, menés par des associations comme DC Greens ou en partenariat avec des distributeurs comme Kroger ou H-E-B, visent à intégrer l’alimentation dans le parcours de soins. Toutefois, ces dispositifs restent souvent à l’état de projet pilote, freinés par des incertitudes politiques, le manque de financements stables et des coupes budgétaires affectant Medicaid ou la recherche publique.
Face à ces défis, les acteurs de la chaîne alimentaire sont appelés à jouer un rôle plus actif. Le secteur agroalimentaire est invité à développer des produits plus nutritifs, à moindre coût, et à collaborer étroitement avec les professionnels de santé. L’industrie dispose d’un levier puissant pour influencer l’accès à une alimentation saine et contribuer à l’évolution des politiques publiques. Pour Tambra Raye Stevenson, fondatrice de Women Advancing Nutrition, Dietetics, and Agriculture, l’avenir repose sur une approche transversale, mêlant santé publique, justice alimentaire, éducation nutritionnelle et durabilité.
Le mouvement Food as Medicine n’est plus une tendance mais un changement systémique en cours, soutenu par une demande croissante des consommateurs pour des solutions de santé intégrant l’alimentation comme pilier central. Pour réussir, il doit cependant sortir du cadre expérimental et s’institutionnaliser, en s’appuyant sur des politiques volontaristes et des partenariats public-privé solides.
New York Times, Sushi Is Bigger Than Ever in America. There’s One Main Reason., 22/09/2025
Autrefois perçu comme un produit rare et exotique aux États-Unis, le sushi est devenu une composante incontournable du paysage alimentaire américain. Ce phénomène de démocratisation s’est accéléré depuis la pandémie , période durant laquelle les consommateurs, lassés de la cuisine maison et du fast-food classique, ont intégré le sushi comme une alternative pratique, perçue comme saine et qualitative.
D’après le National Fisheries Institute, les ventes de sushi ont bondi de 50 % chez Kroger, le plus grand distributeur américain, atteignant désormais un million de rouleaux vendus par jour. Chez Blue Ribbon Sushi, la vente à emporter représente aujourd’hui 30 % de l’activité, contre 6 % avant la pandémie. Cette évolution touche tous les segments : des restaurants gastronomiques aux stations-service, en passant par les supermarchés, les campus universitaires et même les parcs d’attractions.
Le sushi vendu en grande surface – surnommé “retail sushi” ou “deli sushi” – est désormais l’un des segments les plus dynamiques du marché. En 2024, il pesait 2,8 milliards de dollars (+7 % par rapport à 2023), avec une croissance portée par quelques grandes entreprises (Bento, Fuji Foods, AFC) qui industrialisent la production. Les produits sont souvent à base de poisson cuit ou de poisson cru décongelé après avoir été congelé à -40 °C, garantissant sécurité sanitaire et conservation.
La montée en gamme est aussi perceptible : des chaînes comme Sugarfish investissent dans des solutions de packaging haut de gamme qui conservent l’équilibre subtil entre riz tiède et poisson froid, défi logistique majeur pour respecter les standards des chefs traditionnels.
Le succès du sushi repose sur plusieurs facteurs : son profil santé (riche en protéines, sans gluten ni produits laitiers, peu transformé), sa praticité et son attractivité auprès de toutes les catégories démographiques. Selon Circana, il s’agit d’un « produit licorne » du grab-and-go, apprécié des jeunes, des seniors, des urbains comme des suburbains.
Sur les campus comme à l’université du Massachusetts Amherst, la consommation progresse de 30 % par an. Des chefs comme Alexander Ong rapportent que les étudiants en mangent du matin au soir, confirmant que le sushi s’est imposé comme une collation quotidienne.
Cependant, cette popularité pose aussi question. Des voix s’inquiètent de la durabilité des poissons utilisés (qu’ils soient d’élevage ou sauvages) et de l’américanisation croissante du sushi, incarnée par l’explosion des rolls fusion aux ingrédients éloignés de la tradition japonaise. Chez Kamehachi, le plus vieux bar à sushi de Chicago, la propriétaire déplore une perte d’authenticité.
Malgré ces réserves, la tendance semble irréversible : aux États-Unis, le sushi est passé en une génération du statut de curiosité gastronomique à celui de produit de grande consommation.
Eater, The Life and Death of the American Foodie, 24/09/2025
L’article explore avec acuité l’évolution du terme « foodie » aux États-Unis, de sa naissance exaltée dans les années 2000 à sa désuétude actuelle. À travers une analyse mêlant souvenirs personnels, histoire culinaire, culture populaire et transformations numériques, l’autrice retrace comment le goût pour la nourriture est passé d’une pratique élitiste à un élément structurant de la culture de masse.
Dans les années 2000, être « foodie » signifiait cultiver une curiosité gourmande assumée : chercher l’authenticité, connaître les chefs, voyager pour un plat, et surtout partager ses découvertes sur des blogs ou forums comme Chowhound. La quête culinaire était alors un signe de distinction culturelle, mais aussi un nouveau langage commun, alimenté par la télévision (Food Network, Top Chef, No Reservations) et Internet. La gastronomie s’est ainsi muée en “fandom” : une passion communautaire, nourrie par le savoir, les émotions et le partage.
Cette démocratisation a eu ses effets bénéfiques : elle a fait émerger des cuisines souvent marginalisées, valorisé les restaurants familiaux, et encouragé des générations entières à cuisiner ou explorer les cultures par l’assiette. Mais elle a aussi montré ses limites : idéalisation d’une « authenticité » figée, appropriation culturelle, glorification toxique de chefs masculins « rock stars », et inégalités de représentation dans les médias gastronomiques.
Aujourd’hui, le terme « foodie » est ringardisé, assimilé à une caricature : celle d’un amateur suffisant, obsédé par la nouveauté et coupé de l’expérience collective. Le film The Menu incarne cette critique, en présentant un personnage dont la prétention culinaire l’isole et l’humilie. À l’ère des influenceurs et des superlatifs viraux, l’expérience gastronomique est souvent réduite à une course à l’image ou à l’algorithme.
Et pourtant, l’esprit du foodie n’a pas disparu. Il s’est fondu dans le tissu culturel américain. Savoir ce qu’est un poke, un al pastor ou un beurre blanc fait désormais partie du langage courant. Des séries comme The Bear, des blockbusters comme Ratatouille ou des tendances comme les “tomato girls” témoignent d’une société où la nourriture reste centrale, même sans mot pour la désigner.
Jaya Saxena conclut avec une pointe de nostalgie : si tout le monde est désormais un foodie sans le dire, cela ne doit pas faire oublier l’importance du travail de terrain — se déplacer, goûter, comprendre, raconter. Car la gastronomie reste un vecteur d’émotion, de culture et de lien. Et même si le mot est mort, l’élan, lui, perdure.
Wall Street Journal, Smartphone App or Pen and Paper? Two Gen Zers Debate the Best Way to Meal-Plan, 12/09/2025
Cet article propose un débat léger mais révélateur entre deux jeunes professionnelles de la génération Z autour de leur manière de planifier leurs repas hebdomadaires. Nora Knoepflmacher, éditrice adjointe, mise sur la technologie avec l’application Umami, tandis qu’Amanda Lauro, éditrice photo, privilégie une approche plus traditionnelle avec un carnet de planification papier.
L’application Umami, disponible gratuitement sur iOS et Android, permet à Nora d’importer facilement des recettes repérées sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Elle peut ensuite les planifier sur un calendrier intégré, générer automatiquement une liste de courses et même ajuster les portions. Pour elle, cette organisation numérique lui permet non seulement de mieux structurer ses repas, mais aussi de gagner du temps et de limiter le gaspillage. Elle apprécie notamment de pouvoir cuisiner en suivant les étapes directement depuis l’application, qui centralise tous les éléments nécessaires : image, vidéo, liste d’ingrédients, étapes de la recette et même minuteur intégré.
De son côté, Amanda Lauro défend le plaisir d’un retour à l’analogique. Avec son carnet Papier Meal Planner, elle note ses menus semaine par semaine, avec des sections pour chaque repas de la journée et une colonne dédiée aux courses. Pour elle, écrire à la main est une activité apaisante, un moment de déconnexion. Elle apprécie aussi la lisibilité globale qu’offre une page de carnet, où elle visualise toute une semaine d’un coup. Amanda puise ses recettes dans les réseaux sociaux mais aussi, et surtout, dans des livres de cuisine papier, qu’elle considère comme un moyen de se reconnecter à une forme de rituel culinaire.
Leurs préférences reflètent une tension générationnelle bien connue mais ici réinterprétée : loin de rejeter les outils numériques, Amanda choisit simplement de réserver la cuisine comme un espace déconnecté. De son côté, Nora incarne une forme d’hybridation moderne, où la technologie facilite l’accès à la cuisine sans l’aseptiser. Toutes deux soulignent l’importance de la préparation des repas dans leur quotidien de jeunes actives, notamment pour des raisons de budget et de santé.
Wall Street Journal, The Extravagant (and Loud) Candies Adults Can’t Stop Eating in 2025, 26/09/2025
L’année 2025 voit l’essor inattendu d’une nouvelle tendance gourmande : les bonbons extravagants, bruyants et très prisés par les adultes. Contrairement aux confiseries traditionnelles destinées aux enfants, ces sucreries contemporaines sont conçues pour séduire un public adulte avide d’expériences sensorielles audacieuses. Croquants, moelleux, intensément parfumés et colorés, ces bonbons ne passent pas inaperçus — ni visuellement, ni auditivement.
Le phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, en particulier TikTok, où des créateurs comme @jazzy.tingles accumulent des millions de vues avec des vidéos de dégustation de bonbons atypiques : cristaux comestibles, bonbons lyophilisés au goût acidulé, jellies croustillantes... Ces vidéos, souvent classées dans la catégorie ASMR/mukbang, jouent sur les textures sonores du croquant ou du masticable, créant une nouvelle forme de consommation ostentatoire du sucre.
Cette tendance a également donné naissance à une vague de boutiques haut de gamme aux États-Unis — comme BonBon (New York), Candycopia (Chicago), Lil Sweet Treat (côte Est), Kändi (Los Angeles), ou Scandy Candy (Miami). Contrairement à Dylan’s Candy Bar, qui s’adresse aux enfants, ces enseignes ciblent les adultes désireux de composer leur propre assortiment premium pour moins de 10 dollars. Parmi les marques les plus prisées figure BUBS, entreprise suédoise rendue célèbre sur TikTok en 2024, connue pour ses bonbons bicolores et mousseux comme le Lemon Raspberry Skull.
L’engouement pour ces confiseries résulte en partie d’un retour nostalgique pour les snacks d’enfance des Millennials, combiné à une envie de « ressentir quelque chose » chez les Gen Z, souvent attirés par les sensations extrêmes (acidité, épices, textures intenses). Cette tendance va à l’encontre des décennies de culpabilisation autour du sucre. Aujourd’hui, les adultes s’approprient pleinement ce plaisir gustatif sans culpabilité.
Certaines figures de la culture alimentaire comme Abi Balingit et Frankie Gaw expriment leur attachement à des bonbons d’enfance comme les White Rabbit, Botan Rice Candy ou Percy Pigs, autant pour leurs textures que pour leur esthétique ou leur charge émotionnelle. Le fondateur de BonBon, Leo Schaltz, évoque quant à lui le concept suédois de « lördagsgodis » : une tradition familiale de dégustation de bonbons le samedi, désormais revisitée à travers des boutiques modernes.
Finalement, dans un monde post-pandémique où le stress est omniprésent, le bonbon devient un refuge. Il incarne à la fois un retour à l’enfance, une forme de réconfort, et une expérience sociale et sensorielle moderne. Bruyants, acidulés, esthétiques, ces bonbons de luxe remplissent un double rôle : combler une envie sucrée et affirmer une identité culturelle et générationnelle. Plus qu’une simple gourmandise, le bonbon devient un phénomène de société en 2025.
New Climate, Food and Agriculture Sector Deep Dive : Assessing The Transparency, Integrity and Progress of Corporate Climate Strategies, June 2025
L’étude analyse la transparence, l’intégrité et la progression des stratégies climat de 5 grandes entreprises du secteur agroalimentaire (Danone, JBS, Mars, Nestlé, PepsiCo). Elle s’appuie sur un cadre d’évaluation sectoriel pour identifier les bonnes pratiques, déterminer les insuffisances et guider les améliorations nécessaires du secteur en matière de décarbonation. Le rapport étudie la pertinence des objectifs de réduction d’émissions, la clarté des engagements et les leviers de transition critiques pour transformer le secteur à court et long terme.
5 points clés à retenir :
Rôle critique des transitions structurelles : Les mesures les plus impactantes pour la réduction durable des émissions dans l’agroalimentaire sont : l’augmentation de la part des protéines végétales, l’arrêt de la déforestation, la réduction de l’utilisation de fertilisants chimiques et la lutte contre les pertes/gaspillages alimentaires. Ces leviers exigent une mise en place urgente et systémique pour transformer le secteur sur le long terme.
Faiblesse et ambiguïté des objectifs climatiques : Les objectifs affichés par les entreprises sont souvent invalidés ou fragilisés par leur dépendance à des « absorptions » de carbone (land-based CDR) dont la quantification et la durabilité sont mal définies. L’agrégation de ces absorptions avec les réductions réelles fausse la réalité des progrès et détourne l’attention de mesures structurantes comme la réduction du méthane.
Intégrité insuffisante des stratégies : La plupart des entreprises du panel présentent une intégrité faible à très faible sur l’ensemble des dimensions analysées (objectifs, actions pour les transitions-clés, transparence des reporting…). L’intégrité des trajectoires de réduction est jugée faible dès que le rôle des absorptions n’est pas explicitement séparé des réductions.
Manque d’engagement sur les leviers principaux : Peu d’entreprises prennent des engagements forts sur l’accélération de la transition vers les protéines végétales et sur la réduction de l’utilisation de fertilisants. La réduction des émissions de méthane demeure une ambition marginale, tandis que la couverture des objectifs anti-déforestation reste partielle et peu détaillée.
Recommandations pour rehausser l’intégrité : Les standards sectoriels (notamment la Science Based Targets initiative – SBTi – FLAG Guidance) devraient imposer des objectifs séparés pour réduction et absorption, clarifier la part des objectifs pouvant être atteinte par chaque modalité, et réclamer des objectifs spécifiques pour le méthane et le protoxyde d’azote. Les entreprises doivent être encouragées à prioriser les actions structurelles sur les émissions et ne pas s’appuyer excessivement sur les absorptions.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey