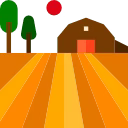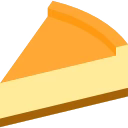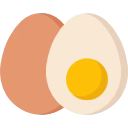🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-25
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Le Monde, Levure ou levain ? Un débat gastronomique difficile à trancher, 11/09/2025
Les Échos, « C'est la protéine animale la moins chère et l'habitude s'est installée » : la filière oeuf se mobilise pour rassasier les Français, 08/09/2025
The Washington Post, Why climate change could ramp up our sugar intake, 09/09/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Halles gourmandes : le succès incertain des usines à restaurants de centre-ville, 05/09/2025
Les halles gourmandes connaissent une multiplication rapide dans les centres-villes français. Ces espaces de restauration collective accueillent sous un même toit une diversité de stands culinaires allant de la cuisine asiatique aux spécialités locales, comme au Beau Marché de Bourg-en-Bresse. Pensées comme des lieux de convivialité et de dynamisme urbain, elles sont devenues des outils de revitalisation pour les maires souhaitant redonner vie à des quartiers commerçants en déclin. L’idée : attirer une clientèle jeune, urbaine, et friande d’expériences gastronomiques hybrides.
Le modèle semble séduisant, mais les réalités économiques sont plus nuancées. Si certains visiteurs saluent la diversité de l’offre, d’autres pointent une hausse des prix et une ambiance plus proche d’un centre commercial que d’un marché traditionnel. Les commerçants, eux, doivent faire face à des loyers élevés, à des charges importantes, et à l’obligation d’ouvrir six jours sur sept. Cette pression économique pousse certains à abandonner leur stand dès les premiers mois. Des entreprises comme Biltoki, spécialisées dans ces structures, ont dû fermer plusieurs établissements, à Mont-de-Marsan ou Saint-Étienne, faute de rentabilité.
Pourtant, les halles bénéficient encore d’un soutien politique. Leur format clé-en-main – bâtiment rénové, gestion centralisée, bar commun – rassure les municipalités. À Bourg-en-Bresse, le maire socialiste y voit un levier d’aménagement urbain autour du marché du samedi. Mais les commerçants traditionnels restent parfois sceptiques, craignant une banalisation de l’offre alimentaire et une perte d’identité locale.
Les difficultés rencontrées amènent certains opérateurs à réviser leur copie. Biltoki, par exemple, préfère désormais favoriser les stands de cuisine prête à consommer plutôt que les poissonneries ou boucheries traditionnelles, moins rentables. Le consultant Pascal Madry rappelle que ces halles, encore instables, pourraient ne pas s’imposer durablement. Leur succès repose sur un équilibre complexe entre attractivité commerciale, viabilité économique et intégration urbaine. Pour l’instant, elles restent à la croisée des chemins : véritable innovation ou effet de mode passager ?
Le Figaro, Cachou Lajaunie, une disparition qui reste en travers de la gorge des Français, 12/09/2025
Le célèbre bonbon à la réglisse Cachou Lajaunie, reconnaissable à sa petite boîte jaune et noire, ne sera plus produit. Cette décision du groupe Perfetti Van Melle, annoncée cette année, marque la fin d’une longue histoire commencée à Toulouse à la fin du XIXᵉ siècle. Créé par le pharmacien Léon Lajaunie, ce petit carré noir, à base de cachou, de réglisse et de résine, était à l’origine conçu pour soulager les troubles digestifs et rafraîchir l’haleine. Peu sucré, fort en goût, il a rapidement séduit au-delà du monde médical.
Pendant plus d’un siècle, le Cachou est devenu un symbole de la culture populaire française. Son format unique, son goût intense et ses campagnes publicitaires marquantes – notamment le spot culte des années 1980 – l’ont élevé au rang d’icône. Sa fabrication artisanale, qui nécessitait neuf jours, restait inchangée malgré les évolutions industrielles. Toutefois, la marque a connu une série de rachats successifs : de Kraft à Mondelez, puis à Perfetti Van Melle. Malgré des tentatives de relance post-Covid visant un public plus jeune, les ventes ont chuté, passant de 10 millions d’unités dans les années 1980 à 3 millions en 2021.
La fin annoncée du Cachou Lajaunie a déclenché une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, révélant son importance affective pour de nombreux Français. Certains y voient la perte d’un pan de patrimoine gustatif, d’autres dénoncent le désintérêt croissant des multinationales pour les marques historiques à faible rentabilité. Des tentatives de sauvetage émergent, comme celle d’un entrepreneur héraultais prêt à reprendre la production. Mais l’opération s’annonce complexe, tant au niveau juridique qu’industriel.
Au-delà du cas Lajaunie, c’est toute la question de la pérennité des produits emblématiques qui est posée. Dans un marché dominé par l’innovation permanente, les bonbons « d’antan » peinent à survivre. Pourtant, la disparition de ce petit carré noir révèle un besoin de mémoire et d’enracinement culturel. Le Cachou n’était pas un simple bonbon : il incarnait un goût, une époque, et un lien entre générations.
Libération, Vin : les cépages hybrides, à la croisée des chais, 09/09/2025
Longtemps dénigrés dans le monde du vin, les cépages hybrides suscitent aujourd’hui un regain d’intérêt parmi les vignerons soucieux de durabilité. Ces variétés, issues de croisements entre différentes espèces de vignes (Vitis vinifera et autres), présentent une résistance naturelle aux maladies cryptogamiques comme l’oïdium ou le mildiou. Dans un contexte de réchauffement climatique, de pressions réglementaires sur les pesticides et de quête de sobriété, ils apparaissent comme une alternative sérieuse aux cépages traditionnels, plus vulnérables.
Des vignerons pionniers, comme Didier Grappe dans le Jura ou Valentin Morel, ont fait de ces cépages un levier d’expérimentation. Leur approche est autant agronomique que politique : produire un vin vivant, sans intrants chimiques, dans un esprit de liberté créative. Ils cultivent des variétés parfois inconnues du grand public – Seyval, Vidoc, Souvignier gris, Solaris – capables de produire des vins originaux avec une forte identité aromatique. Pour eux, les hybrides ne sont pas un pis-aller, mais un outil pour réinventer le goût du vin.
En France, ces cépages ne représentent que 1 à 2 % du vignoble, contre 6 % dans d’autres pays comme les États-Unis ou l’Allemagne. Leur reconnaissance officielle reste difficile. La législation européenne n’autorise que certains hybrides pour la vinification en AOP, ce qui freine leur développement commercial. Des associations militantes comme Vitis Batardus Liberata plaident pour une reconnaissance élargie et une liberté de plantation plus grande. Pour les tenants des vins nature, le refus de l’uniformité passe aussi par l’exploration de ces variétés souvent oubliées ou interdites.
Leur utilisation reste cependant controversée. Certains œnologues leur reprochent un profil aromatique parfois « rustique », ou un manque de complexité. D’autres mettent en garde contre une standardisation génétique. Mais ces critiques sont nuancées par l’expérience des vignerons eux-mêmes : bien vinifiés, les hybrides offrent une palette aromatique originale et permettent de réduire drastiquement le nombre de traitements, jusqu’à 90 % dans certains cas.
Alors que le climat bouscule les équilibres de la viticulture, les cépages hybrides s’imposent comme un champ d’exploration fertile, entre nécessité agronomique et audace stylistique. Encore marginaux, ils pourraient bien devenir les piliers d’un vin résilient et visionnaire.
Libération, Vin en vrac, qu’importe le flacon, 09/09/2025
Dans les grandes villes françaises, une ancienne pratique revient en force : la vente de vin en vrac. Loin de l’image poussiéreuse des cubitainers de supermarché, ce mode de consommation séduit une nouvelle génération de cavistes et de consommateurs à la recherche de qualité, d’écoresponsabilité et d’accessibilité. À Marseille, la cave Château Pompette propose des vins nature à la tireuse, que l’on peut goûter avant d’emplir sa propre bouteille consignée. Le client paie le vin au litre et peut revenir avec son contenant pour le recharger. Un geste simple, économique, et désormais branché.
Ce retour du vin en vrac correspond à une triple aspiration : réduction des déchets, transparence dans la production, et démocratisation du bon vin. Des enseignes comme En Vrac à Paris, Soif à Pigalle ou encore Le Zinc à Toulouse participent à cette dynamique. Certains vont jusqu’à proposer des verres à la pompe, dans un esprit proche du bar à bières artisanales. La notion d’origine et de traçabilité est centrale : les bouteilles sont étiquetées avec le nom du domaine, du cépage, du millésime, et souvent une brève histoire du vigneron.
Pour les producteurs, ce canal de distribution représente un débouché direct, libéré des contraintes liées à l’embouteillage : étiquetage, bouchons, cartons, logistique… Des vignerons engagés dans le bio ou les vins nature y voient un moyen de garder la main sur leurs prix, tout en favorisant une relation directe avec les consommateurs urbains. Le vrac leur permet aussi d’écouler des volumes plus importants sans rogner sur la qualité.
Longtemps perçu comme un produit de moindre valeur, le vin en vrac change donc de statut. Il devient synonyme de sobriété élégante, de militantisme discret et de plaisir immédiat. Pour certains clients, c’est aussi une manière de consommer moins mais mieux, dans un rituel plus flexible et décomplexé. Le flacon importe peu, tant que le contenu respecte des critères de goût, d’éthique et de transparence.
Reste une difficulté : convaincre les plus traditionnels que le vin ne perd pas son âme en sortant de sa bouteille. Mais à l’heure des crises climatiques, du retour des consignes et de la quête de lien producteur-consommateur, le vin en vrac semble avoir trouvé une nouvelle jeunesse.
Challenges, Pourquoi les agriculteurs français ne veulent toujours pas du Mercosur, 04/09/2025
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) continue de susciter une vive opposition en France. Validé fin août 2025 par la Commission européenne, ce texte vise à faciliter les échanges entre les deux blocs, notamment en réduisant les droits de douane sur des produits agricoles. Mais pour les agriculteurs français, il s’agit d’un coup dur porté à leur compétitivité, à leurs efforts environnementaux et à la souveraineté alimentaire européenne.
La FNSEA, principal syndicat agricole, évoque un « tournant dramatique », tandis que la Coordination rurale parle de « trahison programmée ». En cause : l’arrivée massive attendue de viande bovine, de volaille, de sucre, de riz, d’éthanol ou encore de miel, produits à bas coût dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales bien moins strictes qu’en Europe. Le secteur céréalier, bien que moins concerné, partage également les craintes d’un nivellement par le bas.
L’accord prévoit une clause de sauvegarde en cas de déséquilibres majeurs sur le marché, ainsi qu’une enveloppe de 7 milliards d’euros pour soutenir les filières en difficulté. Mais ces garanties sont jugées très insuffisantes par les professionnels, qui y voient des compensations a posteriori plutôt qu’un vrai mécanisme de protection. Le rapport de force géopolitique ne joue pas non plus en faveur de la France : une majorité qualifiée d’États membres de l’UE suffira pour valider définitivement le traité, ce qui limite les possibilités de blocage par un seul pays.
Au-delà de la concurrence, les agriculteurs redoutent un affaiblissement du modèle agricole européen, fondé sur des normes strictes, une rémunération équitable et une transition écologique engagée. Ils s’inquiètent aussi de voir ce traité devenir un précédent pour d’autres accords commerciaux en discussion, notamment avec l’Inde, la Thaïlande ou la Malaisie. Pour faire front, certaines organisations paysannes envisagent des alliances avec les ONG écologistes, elles aussi opposées à l’accord pour des raisons de déforestation et d’impact climatique.
Ce rejet du Mercosur traduit un malaise plus large du monde agricole face à la globalisation. Il questionne le rôle de l’Europe : veut-elle défendre un modèle agricole durable ou céder aux logiques du commerce international au détriment de ses producteurs ? La réponse reste, pour l’instant, suspendue aux équilibres politiques bruxellois.
L’Express, Régime "IG bas", "glucose révolution"… Ces modes alimentaires qui inquiètent les scientifiques, 07/08/2025
La nutrition est devenue un terrain d’influence majeure sur les réseaux sociaux, où se multiplient conseils, programmes et compléments alimentaires sans validation scientifique. L’une des dernières tendances en date, popularisée par l’influenceuse française Jessie Inchauspé, alias « Glucose Goddess », repose sur la théorie selon laquelle contrôler les pics de glycémie permettrait d’améliorer santé, énergie et poids. Son livre à succès et ses publications Instagram (plus d’1,5 million d’abonnés) ont séduit un large public, principalement féminin, en quête de solutions simples et naturelles.
Le concept est séduisant : il s’agirait de lisser la courbe glycémique en adaptant l’ordre des aliments, en prenant du vinaigre avant les repas, ou encore en évitant les glucides à jeun. Jessie Inchauspé a même lancé sa propre gamme de compléments alimentaires censés « bloquer » les hausses de glucose. Mais les scientifiques s’inquiètent de la diffusion de ces méthodes, souvent présentées comme révolutionnaires, sans fondement clinique sérieux. Aucun essai randomisé n’a été mené pour valider l’efficacité des recommandations de la « glucose révolution ».
Pour les endocrinologues, ces pics de glycémie postprandiaux sont physiologiques chez les personnes non diabétiques. Les régimes IG bas (index glycémique) ne sont pas nouveaux, mais leur efficacité est variable selon les individus. De plus, l’index glycémique d’un aliment isolé ne reflète pas celui d’un repas complet. L’obsession actuelle autour du glucose risque donc de favoriser des comportements restrictifs, voire orthorexiques, notamment chez les adolescents et jeunes adultes.
Les nutritionnistes appellent à la prudence : s’il est utile de limiter les sucres rapides, le discours simpliste de Jessie Inchauspé occulte les fondements d’une alimentation équilibrée. Les recommandations officielles (PNNS) restent claires : manger varié, limiter les produits ultra-transformés, privilégier les fibres, bouger. Le succès du « glucose marketing » souligne surtout le besoin d’une éducation nutritionnelle plus accessible, dans un monde saturé d’informations contradictoires.
Au-delà de la mode, ce phénomène révèle une tension croissante entre science, bien-être et économie de l’attention. Il questionne aussi la responsabilité des influenceurs dans la diffusion de pratiques aux effets encore méconnus. Entre fascination pour les solutions miracles et méfiance vis-à-vis des experts, la santé alimentaire devient un champ de bataille culturel autant que médical.
Le Monde, Levure ou levain ? Un débat gastronomique difficile à trancher, 11/09/2025
Le débat entre levure et levain divise boulangers, pizzaiolos et amateurs de pain. D’un côté, les partisans de la levure valorisent sa rapidité, sa simplicité d’utilisation et sa capacité à produire une pâte légère et bien aérée. De l’autre, les défenseurs du levain – mélange naturel de farine et d’eau – mettent en avant ses bénéfices gustatifs, nutritionnels et digestifs. Ce débat va bien au-delà de la technique, car il cristallise des visions opposées du métier et de la consommation alimentaire.
Le levain permet une fermentation longue, qui libère des arômes complexes et confère aux produits une meilleure conservation. Il facilite aussi la digestion grâce à l’action des bactéries lactiques, qui prédigèrent une partie des amidons. Des artisans comme Adriano Farano, fondateur de Pane Vivo et Pizza Viva à Paris, en ont fait leur marque de fabrique, au nom d’une boulangerie plus naturelle et respectueuse du corps. D’autres, comme Bartolo Calderone, vont jusqu’à ouvrir des écoles dédiées à la fermentation naturelle. Cette approche séduit une nouvelle génération de professionnels, souvent en reconversion, attirés par une alimentation plus vertueuse.
Mais cette méthode requiert une technicité poussée, une attention constante et une plus grande sensibilité aux variations de température, d’hydratation ou de farine. Guillaume Grasso, pizzaiolo napolitain traditionnel, rappelle qu’un produit réussi demande une stabilité difficile à atteindre avec le levain. Il défend la levure comme outil de précision, fidèle aux recettes familiales héritées de Naples. Certains, comme Benoît Castel, optent pour une solution hybride : un usage maîtrisé du levain combiné à une faible dose de levure, pour gagner en souplesse sans sacrifier la qualité.
Le débat dépasse aussi la sphère artisanale : il touche à la question du goût du consommateur, de la transmission des savoir-faire et du rôle nutritionnel du pain. Si le levain apporte plus de complexité et de satiété, il reste moins consensuel. Les deux mondes peuvent coexister, chacun répondant à des attentes spécifiques. L’essor du levain marque en tout cas un retour à une approche plus artisanale, mais aussi plus exigeante, du métier de boulanger.
Le Monde, A Paris, des glaces à en perdre la boule, 12/09/2025
À Paris, la scène des glaciers connaît une révolution sensorielle. L’offre s’est en effet considérablement diversifiée, portée par des artisans créatifs et des influences venues des quatre coins du monde. Désormais, l’ube (igname violette d’Asie), le pandan, le matcha ou encore le Comté s’invitent dans des glaces au design audacieux et aux textures inattendues. Cette explosion de créativité s’inscrit dans une redéfinition plus large du dessert glacé, devenu une expérience à part entière.
Les adresses comme Kapé (Paris 11e), La Glacerie (Paris 4e) ou JJ Hings (Paris 10e) proposent des créations qui brouillent les frontières entre pâtisserie, street food et gastronomie. Chez Café Isaka, par exemple, la glace est frite à la minute dans une chapelure panko, une idée importée du Japon. Le duo Philippine Jaillet et Charles Neyers (Boréal,Paris 18e) ose quant à lui une crème glacée au mont d’or pour accompagner une tarte au vin jaune. À la Glacerie, les glaces sont enrichies de morceaux de pâte à cookie crue ou de coulis fondants, pour une expérience ultra-gourmande.
Cette nouvelle génération de glaciers privilégie aussi une approche artisanale, avec des ingrédients bruts, peu sucrés, et parfois bio ou en circuit court. La texture est retravaillée grâce à des techniques inspirées de la haute pâtisserie, tandis que le visuel devient un outil de communication essentiel, largement diffusé sur Instagram et TikTok. En plus des boutiques, les glaciers investissent les restaurants gastronomiques ou les cafés tendance, comme au Boréal (Paris 18e), où la glace au fromage accompagne un dessert sucré-salé.
Ce renouvellement s’inscrit dans une évolution des attentes des consommateurs, plus ouverts aux nouvelles saveurs et attentifs à l’origine des produits. Les glaces deviennent un terrain d’expérimentation culinaire, où se croisent héritages culturels, souvenirs d’enfance et innovations techniques. Elles racontent aussi une histoire plus intime : celle de glaciers cosmopolites qui revisitent leurs racines. Plus qu’une tendance, cette mutation de la glace traduit un changement de regard sur le dessert, désormais légitime sur les meilleures tables.
Le Figaro, «Tout le monde en veut ! » : quel est ce nouveau dessert qui fait saliver Madrid ?, 13/09/2025
À Madrid, la « tarta de queso », un gâteau au fromage fondant et crémeux, est devenue bien plus qu’un dessert : un phénomène culturel. Héritée du Pays basque, cette version revisitée du cheesecake connaît un engouement sans précédent dans la capitale espagnole. Chaque jour, des dizaines de clients patientent devant des enseignes devenues cultes, comme celle du pâtissier Alex Cordobés. Loin du gâteau dense et sucré à l’américaine, la tarta de queso madrilène séduit par sa texture légèrement coulante au centre, son goût prononcé de fromage, et l’absence de croûte, offrant une dégustation onctueuse et intense.
Le phénomène dépasse la seule sphère gastronomique : il s’impose comme un rituel social. À chaque repas entre amis ou en famille, la question du dessert est tranchée d’avance – ce sera une tarta de queso. Partagée, photographiée, commentée sur les réseaux sociaux, elle est devenue un emblème gourmand, au même titre que la tortilla ou les churros. Sa viralité s’explique aussi par son esthétique minimaliste mais appétissante, idéale pour les formats courts de TikTok ou Instagram.
Les pâtissiers madrilènes rivalisent de créativité pour réinventer ce dessert tout en respectant ses fondamentaux : des fromages locaux comme le manchego, une cuisson précise qui laisse le cœur à peine pris, et des portions généreuses. Certains proposent des versions parfumées (citron, vanille, chocolat), d’autres misent sur la simplicité et la qualité des produits. À l’international, la tarta de queso s’exporte avec succès : on la retrouve désormais à Paris, Londres ou Tokyo, souvent dans des cafés branchés ou des restaurants espagnols.
Cette popularité soulève aussi des questions stratégiques pour les pâtissiers madrilènes : comment maintenir la qualité artisanale tout en répondant à une demande massive ? Certains misent sur la distribution en ligne, d’autres ouvrent des franchises, tandis que quelques puristes préfèrent conserver un modèle de vente locale et exclusive. Quoi qu’il en soit, ce succès démontre l’attachement des consommateurs à des desserts qui racontent une histoire, expriment un territoire, et procurent un plaisir immédiat. La tarta de queso est ainsi devenue le symbole d’une gastronomie populaire, généreuse et en perpétuelle réinvention.
Les Échos, « C'est la protéine animale la moins chère et l'habitude s'est installée » : la filière oeuf se mobilise pour rassasier les Français, 08/09/2025
Face à une demande en constante augmentation (+4 à 5 % par an), la filière française de l’œuf se mobilise pour renforcer sa souveraineté alimentaire. En 2025, 15 milliards d’œufs ont été produits en France, assurant 97 % d’autosuffisance. Pourtant, pour maintenir cet équilibre, il faudra produire 350 millions d’œufs supplémentaires chaque année d’ici 2027, selon les professionnels du secteur. Cela représente l'équivalent d’1,5 million de poules pondeuses en plus, ce qui suppose des investissements lourds dans les élevages, l’outil industriel et la logistique.
L'œuf s’impose comme un produit refuge en période d’inflation : économique, riche en protéines, adaptable à tous les régimes alimentaires. Ce retour en grâce s’observe aussi chez les jeunes consommateurs, séduits par sa praticité et sa naturalité. La profession mise donc sur cette dynamique pour asseoir une croissance durable, tout en poursuivant sa transition vers des élevages plus respectueux du bien-être animal. En 2025, plus de 68 % des œufs coquille vendus en grande distribution provenaient déjà d’élevages hors cages, un chiffre que la filière espère porter à 80 % dans les deux ans.
Outre la production de coquilles, le segment de l’œuf transformé (utilisé dans les industries agroalimentaires ou la restauration collective) représente un enjeu stratégique. Les producteurs investissent dans l’innovation : pasteurisation, ovoproduits en poudre, emballages écoresponsables ou encore blockchain pour la traçabilité. Ces efforts doivent permettre de se différencier face à la concurrence européenne, voire mondiale, dans un contexte d’ouverture des marchés.
Mais des incertitudes demeurent. Les crises sanitaires récurrentes (grippe aviaire), la volatilité des prix des matières premières (alimentation animale, énergie) et la pression environnementale obligent la filière à s’adapter en permanence. Des aides publiques et une meilleure concertation entre éleveurs, industriels et distributeurs sont jugées indispensables pour sécuriser l’avenir. Enfin, la communication auprès des consommateurs reste un levier essentiel : pour faire de l’œuf un produit d’avenir, il faut aussi lui redonner du sens et une valeur perçue à la hauteur de ses atouts nutritionnels et économiques.
New York Times, Why 7-Eleven and Other Convenience Stores in Japan Are So Special, 09/09/2025
Au Japon, les konbini – ces supérettes de quartier ouvertes 24h/24 – sont bien plus que des commerces de proximité. Véritables piliers du quotidien, ils offrent une gamme de services très étendue : restauration rapide, paiement de factures, envoi de colis, billetterie pour concerts, impressions de documents ou encore guichets automatiques bancaires. Avec plus de 55 000 établissements répartis sur tout le territoire, ces magasins incarnent un modèle de service de proximité unique au monde.
Parmi les nombreuses enseignes (FamilyMart, Lawson), 7-Eleven est la plus emblématique, avec près de 22 000 points de vente sur l’archipel. Son implantation japonaise remonte à 1974, avec une première ouverture à Tokyo. Dès 1975, le concept de magasin ouvert 24h/24 est lancé et s’est rapidement généralisé. Par la suite, en 1991, l’entreprise japonaise Ito-Yokado devient majoritaire dans le capital de la maison-mère américaine, et depuis 2005, 7-Eleven est entièrement japonaise via le groupe Seven & i Holdings. Aujourd’hui, 7-Eleven exploite plus de 83 000 magasins dans 19 pays, dont 13 000 en Amérique du Nord, où l’entreprise prévoit d’investir 13,6 milliards de dollars pour renforcer sa présence.
Ce qui distingue les konbini japonais, c’est leur polyvalence et leur rôle dans la vie sociale. Dans les zones rurales touchées par le vieillissement démographique, ces commerces sont parfois les derniers points de service disponibles. Lors de catastrophes naturelles, ils deviennent des lieux de refuge, de ravitaillement et d’échange d’informations. Ils sont également des lieux de socialisation informels, où il est accepté d’entrer sans consommer.
Les magasins sont réputés pour leur propreté, leur organisation minutieuse et la qualité de leur offre alimentaire. Bento frais, onigiri, plats chauds (curry, croquettes, poulet frit), machines à café ou smoothies, glaces, desserts saisonniers… tout y est. Certains établissements disposent même de tables, de micro-ondes et de fontaines d’eau chaude pour consommer sur place. L’offre évolue au gré des saisons et des régions, avec par exemple des spécialités comme les Okinawa Soba dans les konbini d’Okinawa.
The Washington Post, Why climate change could ramp up our sugar intake, 09/09/2025
Alors que les canicules deviennent plus fréquentes, une nouvelle étude révèle un effet inattendu du changement climatique sur l’alimentation des américains : les températures élevées augmenteraient la consommation de produits sucrés, notamment les boissons gazeuses et les desserts glacés comme les glaces. Cette tendance pourrait, à long terme, aggraver les problèmes de santé publique liés à une alimentation trop riche en sucres ajoutés.
Menée par des chercheurs en économie, climatologie et nutrition, l’étude s’appuie sur 16 années de données recueillies auprès de consommateurs américains (2004–2019), croisées avec les températures locales. Selon Pengfei Liu, économiste à l’Université de Rhode Island et co-auteur de l’étude publiée dans Nature Climate Change, les individus augmentent spontanément leur consommation de produits sucrés pour se rafraîchir, sans avoir conscience de l’impact nutritionnel.
Les résultats montrent que les achats de sodas, jus sucrés et glaces augmentent significativement entre 12 et 30°C. Au-delà de 32°C, l’effet diminue, car l’appétit est alors naturellement réduit. Le pic de consommation concerne notamment les personnes à faibles revenus ou peu diplômées, souvent plus vulnérables à la chaleur et à la désinformation nutritionnelle. Ces populations vivent aussi dans des régions où l’eau potable est parfois contaminée, ce qui pousse à consommer des boissons industrielles comme substitut hydratant.
À terme, sous un scénario pessimiste de réchauffement climatique, les chercheurs estiment que chaque Américain pourrait consommer en moyenne 3 grammes de sucre en plus par jour d’ici 2095, uniquement en raison de la hausse des températures. Si cette quantité peut sembler faible, son effet cumulatif sur des décennies est préoccupant : diabète, obésité, maladies cardiovasculaires ou encore cancer sont en ligne de mire.
Pour lutter contre ce phénomène, les auteurs de l’étude recommandent des programmes d’éducation nutritionnelle, voire des taxes sur les produits sucrés, afin de sensibiliser les consommateurs à leur comportement alimentaire, surtout en période de forte chaleur. L’équipe de recherche entend désormais élargir son étude à d’autres pays, notamment en Asie, pour analyser l’impact du climat sur des produits locaux comme le bubble tea.
Food Dive, 4 food trends that could define the rest of 2025, 27/08/2025
L’année 2025 est particulièrement rude pour les grands groupes agroalimentaires américains. L’inflation persistante, la baisse de la consommation, l’augmentation des coûts de production et les pressions réglementaires poussent l’industrie dans ses retranchements. Si les ventes ralentissent, les consommateurs attendent paradoxalement davantage de qualité nutritionnelle et d’innovation de la part des marques, les obligeant à investir massivement dans des ingrédients fonctionnels premium.
Des acteurs comme Kraft Heinz ou Conagra Brands anticipent des baisses de chiffre d’affaires malgré une éventuelle reprise au second semestre. En parallèle, les tarifs douaniers – notamment sur l’aluminium et l’acier – imposés par l’administration Trump alourdissent la facture (jusqu’à 200 millions de dollars supplémentaires pour Conagra), et les coûts des matières premières (œufs, cacao…) continuent de grimper. Résultat : licenciements en chaîne (General Mills, Post Holdings, Brown-Forman) et restructurations deviennent monnaie courante pour préserver les marges.
Côté croissance, les groupes misent désormais sur des acquisitions ciblées plutôt que sur des méga-fusions risquées. Des opérations comme le rachat de Poppi (soda prébiotique) par PepsiCo ou de LesserEvil (snacking sain) par Hershey témoignent d’un recentrage sur des segments porteurs, notamment les boissons fonctionnelles et les snacks sains. L’accent est mis sur des marques à forte identité capables de répondre aux attentes des consommateurs en matière de santé, bien-être et naturalité.
Le marché est aussi dynamisé par une nouvelle vague d’ingrédients fonctionnels. Si la protéine reste plébiscitée (surtout dans le contexte de l’essor des traitements GLP-1), les attentes évoluent vers des produits aidant à réguler l’humeur, le sommeil, la santé intestinale ou la peau. Des acteurs comme ADM ou Darling investissent dans les postbiotiques et le collagène, tandis que Coca-Cola lance des sodas fonctionnels sous sa marque Simply.
Enfin, le mouvement MAHA (Make America Healthy Again), soutenu par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., amorce un tournant. Après l’élimination des colorants artificiels, les regards se tournent vers les additifs chimiques et les aliments ultratransformés. Les nouvelles lignes directrices alimentaires américaines, attendues pour fin 2025, pourraient refléter les convictions controversées de Kennedy, suscitant l’inquiétude des nutritionnistes. Une réforme du système alimentaire américain semble en cours, mais son orientation reste incertaine.
BBC, Whey to go: Is cheese the new reason to travel?, 08/09/2025
Le fromage ne se contente plus de séduire les papilles : il devient une véritable clé de lecture du territoire français. À travers musées, caves d’affinage, routes fromagères et rencontres avec les producteurs, de plus en plus de voyageurs – français comme étrangers – explorent l’Hexagone en suivant la piste de ses fromages. Le phénomène s’inscrit dans une tendance plus large du tourisme culinaire, en forte croissance selon les projections de Future Market Insights.
À Paris, le Musée Vivant du Fromage, ouvert près de Notre-Dame, incarne cette volonté de démocratiser la culture fromagère. Il offre une immersion ludique et pédagogique dans les savoir-faire, les terroirs et les traditions, avec une scénographie immersive et un large comptoir de dégustation. Pour Guillaume Gaubert, responsable du musée, cet engouement s’explique par un retour des Français à leurs racines rurales et culinaires. Chaque région revendique fièrement son fromage emblématique : le Munster en Alsace, le Camembert en Normandie, l’Ossau-Iraty au Pays basque ou encore le Beaufort en Savoie.
Hors de la capitale, le Jura attire les amateurs de Comté avec des sites emblématiques comme La Maison du Comté à Poligny et le Fort Saint-Antoine, où 100 000 meules sont affinées dans d’anciennes casernes militaires. Ici, les affineurs évaluent chaque meule à l’oreille, révélant l’art ancestral de l’affinage. Le tourisme fromager y a bondi de 23 000 visiteurs en 2019 à 35 000 en 2024. Même la Vache Qui Rit possède son propre musée à Lons-le-Saunier, retraçant son histoire depuis les fruitières jurassiennes jusqu’à sa transformation en icône mondiale.
La diversité des terroirs s’étend jusque dans le Massif Central, où les caves naturelles de Roquefort profitent de failles géologiques pour affiner ce fromage au goût puissant, ou en Corse, où la Route des Sens Authentiques relie éleveurs, vignerons et producteurs de brocciu. Ces itinéraires offrent bien plus qu’une dégustation : une rencontre avec des familles qui perpétuent des traditions parfois millénaires.
Des agences spécialisées, comme Cheese Journeys, proposent des voyages immersifs autour du fromage, mêlant culture, nature et histoire. Pour sa fondatrice, Anna Juhl, le fromage permet de « comprendre la France par ses terroirs et ses hommes ». Une promesse de voyage authentique, sensoriel et profondément humain.
The Magnum Ice Cream Company (TMICC) Presentation
Cette présentation réalisé par Unilever pour expliquer la cotation en bourse de son segment glaces est bourrée d’informations sur ce secteur. En voici une synthèse.
Taille et dynamique du marché
Marché mondial de la glace :
En 2024, il pèse environ 75 milliards d’euros.
Fait partie du marché élargi du snacking (~470 milliards €).
Période 2014-2029 : croissance constante prévue, à un rythme annuel de +3-4 % (CAGR).
Résilience exceptionnelle : la pandémie Covid a peu affecté la croissance, comparaison favorable avec d’autres segments snacking.
Occasions de consommation :
La glace se consomme lors de nombreux moments de la journée — rafraîchissement, indulgence, partage.
Les innovations créent des “occasions” supplémentaires (formats snacking, etc.), élargissant la base de consommation.
Tendances structurelles
Premiumisation
Dans les pays développés (PIB/hab. >35 000 $, ex : Europe de l’Ouest, US…), la gamme “premium” croît plus vite que la moyenne.
En 2024, le premium représente 41 % de la valeur du marché (vs 37 % en 2016).
Cette montée en gamme s’appuie sur la recherche de produits plus innovants, gourmands et/ou plus sains.
Emphase sur la disponibilité et la distribution
La densité des points de vente (ou “outlet penetration”) reste le déterminant clé de la consommation, notamment dans les pays émergents.
Les pays émergents offrent un potentiel de croissance de +50 % par simple extension des réseaux de distribution et d’armoires réfrigérées.
E-commerce
Le digital explose sur le segment (e-commerce, quick-commerce…).
Prévision : croissance annuelle de +9 % sur 2024-2029, nettement au-dessus du marché global.
Structure concurrentielle
Marché concentré
Deux groupes “pure players” de la glace à échelle mondiale : The Magnum Ice Cream Company (ex-Unilever) – 21% de part de marché, et Froneri – 11%.
Suivent des acteurs multi-catégories : General Mills, Yili, Nestlé, Ferrero, Mars…
Segmentation géographique et canaux
Développés vs émergents
Marché mature en Occident : fort en valeur, croissance tirée par l’innovation et le premium.
Forte marge de progression sur les marchés émergents (Chine, Inde, Mexique, Indonésie…), où la distribution et la pénétration par habitant restent faibles.
Environ 30 % du revenu de “TMICC” en 2024 provient des pays émergents, avec une anticipation de croissance deux fois plus rapide qu’en marchés développés.
Canal At-Home / Away-from-Home / e-commerce
La totalité du marché se répartit sur
consommation “at-home” (via grande distribution : ~retail)
consommation “away-from-home” (hors-foyer, via des frigos)
digital commerce (vente en ligne et livraison rapide).
TMICC détient la plus grande flotte mondiale d’armoires réfrigérées : ~3 millions.
Tendances consommateurs et produits
Nouvelles attentes : contrôle des portions, nutrition…
Influence modérée à court terme des médicaments type GLP-1 (régulateurs d’appétit), limitées géographiquement aux USA.
Apur, L’alimentation à Paris, Edition 2025
Outre les 2,11 millions de résidents, 3,6 millions de personnes, incluant les travailleurs, les étudiants et les touristes vivent à Paris au quotidien. L’analyse de leurs comportements alimentaires met en lumière tant des pratiques diverses que des situations spécifiques à Paris et parfois variables selon les quartiers.
Elle permet aussi de relier la diversité des profils socio-économiques avec leurs attentes alimentaires. Un accent particulier est mis notamment sur l’analyse du développement de la restauration hors domicile, sur l’évolution des consommations de produits biologiques, durables, carnés et de fruits et légumes ainsi que sur la progression des situations de précarité, notamment chez les jeunes et les étudiants.
Shake Up Factory a quelques places disponibles cet automne dans ses bureaux de Station F à Paris pour des startups agroalimentaires. Pour celles et ceux qui sont intéressés vous trouverez toutes les informations nécessaires ici.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey