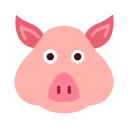🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-24
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Aujourd’hui la newsletter est un peu plus longue que d’habitude car j’ai sélectionné quelques articles sortis pendant le mois d’août. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, La face cachée des bières d'abbaye, 27/08/2025
Les Échos, Les kiwis obtiennent une allégation santé autorisée, un label rare et inédit pour un fruit, 21/08/2025
Wall Street Journal, Scientists Have Unlocked the Secret That Gives Fine Chocolate Its Great Taste, 27/08/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Fusion Kraft-Heinz : « Pourquoi la mayonnaise n’a-t-elle pas pris ? », 03/09/2025
Dix ans après la fusion emblématique entre Kraft et Heinz, orchestrée par le fonds 3G Capital et Warren Buffett, le géant américain de l’agroalimentaire annonce sa scission en deux entités distinctes. Cette décision met en lumière l’échec d’un modèle capitalistique centré sur la réduction drastique des coûts au détriment de l’innovation. D’un côté, une entreprise de 15,4 milliards de dollars regroupera les condiments et produits à tartiner (Heinz, Philadelphia), de l’autre, une structure de 10,4 milliards gérera les snacks et charcuteries (Oscar Mayer, Lunchables, Capri-Sun). La fusion initiale avait été saluée comme un coup de génie financier, mais s’est rapidement heurtée à une désaffection croissante des consommateurs pour les produits ultra-transformés, alors que la demande évolue vers des aliments plus sains. Les réductions de coûts opérées par 3G Capital ont paralysé la capacité d’innovation du groupe, piégé entre le discount des marques distributeurs et l’attrait croissant des produits premium.
Ce changement de paradigme est aussi renforcé par l’essor des médicaments anti-obésité qui freinent les comportements d’achats impulsifs, et par une politique publique plus hostile à la malbouffe. Le président Robert F. Kennedy, soutenu par Donald Trump, mène une campagne contre les sucres, enjoignant même Coca-Cola à changer ses formulations. Dans ce contexte, les grands groupes revoient leurs stratégies : Ferrero rachète les céréales Kellogg, Keurig Dr Pepper s’empare du néerlandais JDE Peet’s, et prévoit lui aussi une scission. Cette recomposition montre que l’agroalimentaire, à l’instar d’autres industries, entre dans une phase de réajustement face aux nouvelles attentes sociétales et réglementaires. En toile de fond, c’est la logique même des fusions géantes et des logiques financières à courte vue qui est remise en question. Ce retour à des structures plus agiles s’accompagne d’une redéfinition des portefeuilles de marques autour de valeurs mieux alignées avec les évolutions de consommation et les préoccupations de santé publique.
L’Usine Nouvelle, Cette étude démontre que la consommation d'aliments ultra-transformés est mauvaise pour la santé, 30/08/2025
Une étude publiée dans la revue Cell Metabolism vient confirmer les soupçons pesant depuis des années sur les aliments ultra-transformés (UPF, pour “ultra-processed foods”). Conduite sur une période de 18 semaines auprès de 43 hommes, elle démontre que la consommation régulière de ces aliments nuit à la santé humaine, même en l’absence d’excès calorique. L’expérience repose sur un protocole scientifique rigoureux, avec un système de rotation entre deux régimes : l’un basé sur des aliments bruts, l’autre sur des produits ultra-transformés, avec un apport calorique identique dans chaque groupe.
Les chercheurs précisent que les UPF sont riches en graisses saturées, sucres raffinés et autres composants industriels synthétiques. Ces aliments représentent déjà plus de 50 % de l’apport calorique quotidien aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Les résultats de l’étude sont sans appel : les participants suivant un régime ultra-transformé ont connu une prise de poids significative, une augmentation de la masse grasse et, fait nouveau, une dégradation marquée de la qualité de leur sperme.
Ce dernier point est particulièrement préoccupant, car il établit un lien direct entre alimentation industrielle et fertilité masculine. Les auteurs insistent : les effets nocifs observés ne s’expliquent pas uniquement par une surconsommation de calories, mais bien par la nature même des aliments ultra-transformés. Le design expérimental permet d’exclure l’hypothèse que les conséquences sont dues au simple excès énergétique.
Les implications de cette étude sont majeures pour les politiques de santé publique et pour l’industrie agroalimentaire. Elle renforce les arguments en faveur d’une alimentation plus naturelle, moins transformée, et appelle à revoir les normes de formulation des produits vendus en grande surface. Le message est clair : pour préserver sa santé, mieux vaut se détourner des produits industriels aux listes d’ingrédients interminables, même si leur profil nutritionnel semble conforme.
Le Monde, Les clubs œnologiques, acteurs discrets de la culture du vin, 05/09/2025
En dépit de la baisse de la consommation de vin en France, notamment chez les jeunes générations, les clubs œnologiques connaissent un réel engouement. Souvent informels et discrets, ils rassemblent des amateurs de tous horizons autour de dégustations thématiques, organisées à domicile, dans des bars ou des locaux associatifs. Ces clubs cultivent des valeurs de partage, de transmission et de découverte, sans élitisme, mais avec rigueur.
Il est difficile d’en quantifier le nombre exact, car beaucoup fonctionnent en dehors de tout cadre officiel. Toutefois, une structure fédératrice existe : la Fédération culturelle des vins de France (FCVF), créée en 1997 à Illzach. Elle regroupe une cinquantaine de clubs, contre soixante avant la pandémie. En échange d’une cotisation annuelle, elle fournit aux clubs membres des bouteilles de qualité pour neuf dégustations par an, ainsi que le matériel et les supports pédagogiques. Les séances, très codifiées, incitent les participants à se documenter pour commenter chaque vin.
Les profils des membres varient selon les clubs. À Mulhouse, le club La Quille attire des jeunes de 25 à 30 ans, tandis qu’à L’Aigle (Orne), le club Bacchus rassemble des quinquagénaires issus de professions diverses. Certains clubs sont même genrés, comme les Bacchantes, pendant féminin du club Bacchus. Le but est autant de découvrir des crus méconnus que de confronter les goûts, dans une ambiance conviviale.
Parallèlement, des cercles informels se multiplient, souvent connectés via des forums comme La Passion du vin, qui compte aujourd’hui 25 000 inscrits. Ces groupes organisent leurs propres dégustations et partagent leurs comptes rendus en ligne, contribuant à diffuser la culture du vin au-delà des circuits traditionnels.
D’autres initiatives existent, comme celle d’Isabelle Roberty, œnologue et fondatrice de l’école Muscadelle, qui anime des ateliers de dégustation dans le sud-ouest pour des entreprises ou des associations. À travers toutes ces formes, les clubs œnologiques permettent d’explorer la diversité des terroirs, cépages et vinifications, tout en renforçant les liens sociaux. Ils apparaissent comme des acteurs essentiels de la culture viticole française contemporaine.
Libération, Le chef Jean Imbert accusé de violences conjugales : enquête sur le grand silence de ses prestigieux partenaires, 05/09/2025
L’image du chef Jean Imbert s’effondre sous le poids d’accusations de violences conjugales. Après une enquête révélée par le magazine Elle en avril 2025, dans laquelle plusieurs ex-compagnes, dont Lila Salet, dénoncent des faits de violences physiques et psychologiques, une procédure judiciaire a été ouverte. Jean Imbert, qui a depuis annoncé publiquement sa mise en retrait de ses établissements, nie les faits par l’intermédiaire de ses avocates, mettant en avant l’absence de preuves et la prescription d’une partie des accusations.
Malgré la gravité des faits allégués, la majorité des marques et établissements associés au chef adoptent une stratégie du silence. Ni le Plaza Athénée, ni LVMH, ni Disney, ni The Brando, ni même Michelin n’ont rompu leurs liens ou pris publiquement leurs distances, se contentant de mentions évasives ou d’ajustements discrets. Seule exception, Nespresso a déclaré ne plus avoir de partenariat en cours avec Jean Imbert et a rappelé son attachement à des valeurs incompatibles avec de tels faits. L’attentisme du monde de la restauration de luxe et de ses partenaires témoigne d’un malaise : le chef continue d’incarner la “marque” Jean Imbert, et son nom reste valorisé malgré les accusations.
L’article interroge la complaisance des entreprises face à une figure médiatique devenue symbole de “food-entertainment” : chef starisé à travers les réseaux sociaux, il a bâti un empire sur son image plus que sur sa cuisine. Selon plusieurs experts, Jean Imbert a misé sur une stratégie de notoriété calquée sur le modèle des influenceurs, capitalisant sur des collaborations prestigieuses et une visibilité omniprésente. Ce branding efficace, appuyé par des partenariats de luxe et des projets événementiels (comme au Mont-Saint-Michel ou à Disneyland Paris), rend difficile pour les marques de se désolidariser sans impact économique ou réputationnel.
Pour les plaignantes, ce silence équivaut à un soutien implicite. Elles dénoncent l’hypocrisie d’entreprises qui revendiquent des valeurs d’éthique et d’égalité tout en évitant de trancher face à des accusations graves. L’affaire souligne la difficulté persistante pour les industries, y compris gastronomiques, à assumer leurs responsabilités sociétales, particulièrement sur les questions de violences faites aux femmes.
Libération, Vendanges : une baisse continue de la production sur fond d’évolution de la consommation, 25/08/2025
Le secteur viticole est confronté à une baisse structurelle et durable de la production, accentuée par l’évolution des habitudes de consommation. Selon l’Organisation internationale du vin, la consommation de vin en France a encore diminué de 3,6 % en 2024. Cette tendance s’explique par une conjoncture économique défavorable, une prise de conscience accrue des effets de l’alcool sur la santé, et un changement des préférences en faveur de produits plus légers, plus digestes ou désalcoolisés.
Face à cette crise, l’arrachage des vignes devient un outil de régulation incontournable. Il touche presque toutes les grandes régions viticoles : Bordeaux, Sud-Ouest, Rhône, Val-de-Loire et Languedoc-Roussillon. Seule la Champagne est épargnée grâce à une régulation stricte par l’interprofession. À cela s’ajoute l’impact du dérèglement climatique (sécheresse, mildiou, gel) qui perturbe lourdement les récoltes, notamment en agriculture biologique, où les rendements sont naturellement plus fragiles.
Le Beaujolais est présenté comme un exemple de reconversion réussie. Confrontée depuis vingt ans à une baisse de la demande, la région a arraché 40 % de ses vignes et recentré sa stratégie sur le cépage gamay, très apprécié pour sa légèreté et sa buvabilité. Cette adaptation au goût du marché a permis un renouveau partiel, avec des campagnes de promotion ciblées. Par ailleurs, la production de vins blancs, effervescents et sans alcool connaît un net essor, traduisant une reconfiguration de l’offre pour répondre à une demande plus modérée et diversifiée.
Pour l’économiste Jean-Marie Cardebat, il ne s’agit pas seulement de réduire l’offre mais d’accompagner l’évolution des usages. Certaines caves qui ont pris le virage du sans alcool s’en sortent mieux. Dans le Beaujolais, l’encépagement en chardonnay progresse également, et l’approche agroécologique – réduction des désherbants, retour au labour – devient la norme, au prix de rendements plus faibles.
Le secteur viticole français est ainsi en pleine mutation, tiraillé entre traditions, exigences écologiques, instabilité climatique et transformation des usages. Une recomposition en profondeur est en cours, dans l’objectif de renouer avec la demande tout en garantissant la viabilité économique et environnementale des exploitations.
Libération, Dégoûts alimentaires : «Tout ce que nous aimons manger, nous l’avons appris», 18/08/2025
À travers une interview de la chercheuse Sandrine Monnery-Patris, spécialiste en sciences cognitives au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CSGA, Inrae), l’article explore les mécanismes de formation de nos préférences et aversions alimentaires. La chercheuse y démontre que nos goûts ne sont pas innés mais largement acquis, principalement dans les toutes premières années de vie. Selon elle, l’exposition précoce à une grande variété de saveurs est déterminante : elle crée une familiarité sensorielle qui favorise l’acceptation de nouveaux aliments.
Les premières influences apparaissent dès la période utérine, à travers le liquide amniotique, puis lors de l’allaitement. En grandissant, le mimétisme social et les habitudes familiales jouent un rôle clé. Ainsi, voir un adulte apprécier un aliment augmente la probabilité qu’un enfant le goûte et l’aime à son tour. À l’inverse, les pratiques éducatives autoritaires (forcer à finir l’assiette) ou trop permissives (ne proposer que ce que l’enfant aime déjà) ont tendance à refermer le répertoire alimentaire.
Sandrine Monnery-Patris insiste également sur l’existence d’une « néophobie alimentaire » vers 2-4 ans, phase naturelle de rejet des nouveautés gustatives, qu’il convient d’accompagner avec patience. Elle souligne qu’il faut souvent huit à dix essais pour qu’un aliment soit accepté. L’absence de familiarisation dans cette période peut créer des dégoûts durables à l’âge adulte. Toutefois, rien n’est figé : comme pour le langage, nos goûts peuvent évoluer tout au long de la vie, même s’ils sont plus malléables dans l’enfance.
L’article évoque aussi les facteurs physiologiques : si l’homme naît avec une appétence pour le sucré (comme le lait), d’autres saveurs, notamment l’amertume ou les notes soufrées (choux, abats), nécessitent un apprentissage plus long. Le rejet de certaines saveurs est aussi lié à des mécanismes de protection de l’espèce (amertume = poison). La néophobie est donc un réflexe évolutif, qui n’empêche pas l’apprentissage si celui-ci est bien accompagné.
Enfin, la chercheuse alerte sur la tendance à la « nutritionnalisation » de l’alimentation, qui fait passer au second plan le plaisir de manger. Elle encourage la diversité, la curiosité et la réappropriation de la cuisine (par exemple, impliquer les enfants dans la préparation) comme leviers pour surmonter les dégoûts et enrichir l’alimentation. L’enjeu n’est pas de tout aimer, mais d’avoir un répertoire gustatif suffisamment large pour couvrir les besoins nutritionnels et s’ouvrir au plaisir de manger.
Libération, Pourboires : commerçants, arrêtez de nous culpabiliser (et payez mieux vos salariés), 13/08/2025
L’article dénonce une pratique commerciale de plus en plus répandue à Paris (et dans d’autres villes de province également) : la sollicitation automatique d’un pourboire au moment du paiement par carte, même dans des commerces où cela n’est traditionnellement pas d’usage. Ce phénomène, hérité des habitudes américaines, fait son chemin en France sous une forme algorithmique et culpabilisante : les terminaux de paiement suggèrent mécaniquement des pourboires, souvent élevés, sans que le client n’ait explicitement manifesté son intention d’en laisser un.
L’auteure, Kim Hullot-Guiot, illustre cette dérive avec des cas concrets : un cookie à 3,50 € auquel un terminal propose d’ajouter jusqu’à 1 € de pourboire, soit près de 30 % du prix. Elle critique non pas le principe du pourboire — qu’elle juge légitime dans certains contextes (livreurs, serveurs, coiffeurs, etc.) — mais la manière intrusive, quasi-automatisée, de le demander. Ce système place les clients dans une situation inconfortable et les salariés dans une position ambiguë, contraints de détourner les yeux pendant que le client décide, dans un climat de pression implicite.
Au-delà de l’aspect désagréable, l’autrice pointe un problème plus profond : cette nouvelle norme tend à faire glisser la responsabilité de la rémunération des salariés vers les consommateurs. Elle dénonce une logique où les employeurs, au lieu d’augmenter les salaires ou de garantir des conditions dignes, espèrent compenser par la générosité des clients. Or, en France, contrairement aux États-Unis, le salaire de base doit couvrir les besoins essentiels sans dépendre des pourboires.
L’article met aussi en garde contre la normalisation d’un « micro-rajout » systématique à chaque achat, qui pourrait s’installer insidieusement dans tous les types de commerce. Ce mécanisme, s’il se généralise, pourrait freiner la juste revalorisation des salaires dans les métiers de services. Elle appelle donc les commerçants à ne pas faire peser cette charge sur le consommateur et à assumer leurs responsabilités d’employeurs.
Les Échos, Quand la Chine sème le trouble dans la filière française du porc, 05/09/2025
La Chine a annoncé l’imposition, dès le 10 septembre 2025, de droits antidumping provisoires sur les importations de porc européen, avec un taux de 20 % pour la France. Cette décision, prise dans le contexte de tensions commerciales croissantes entre Pékin et Bruxelles, est perçue comme une mesure de rétorsion après les sanctions européennes sur les véhicules électriques chinois.
La France, troisième producteur porcin européen derrière l’Espagne et l’Allemagne, voit sa filière fragilisée par cette mesure, la Chine étant son principal client. En 2024, elle avait importé 115.000 tonnes de produits porcins français, soit 16 % des exportations françaises du secteur. Même si les volumes sont restés stables, les prix ont chuté de 10 %, réduisant la valeur globale des ventes.
La décision chinoise inquiète fortement la filière française, non seulement pour la perte d’un débouché clé — notamment pour des morceaux peu consommés en Europe comme les oreilles ou les pieds — mais surtout pour le risque d’engorgement du marché européen. Les volumes destinés à la Chine devront être redirigés, notamment depuis l’Espagne, ce qui pourrait faire chuter les prix en Europe. Les éleveurs français, qui commençaient à se relever après des années de crise, redoutent un nouveau recul de leur rentabilité alors que les prix à la production ont déjà commencé à baisser cet été.
Les Échos, Pommes de terre : derrière une récolte historique, le risque d'un effondrement des prix, 02/09/2025
Alors que la France s’apprête à battre un record de production de pommes de terre de conservation avec une récolte estimée à 8,5 millions de tonnes, le secteur s’inquiète d’une possible chute des prix, voire d’un effondrement du marché libre. Ce paradoxe entre abondance et crise tient à un déséquilibre structurel : une hausse de la production sans augmentation équivalente des capacités industrielles pour l’absorber.
Selon l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT), cette récolte exceptionnelle est le fruit d’une hausse des surfaces cultivées de plus de 10 % en un an, et de 25 % depuis 2023. Ce boom s’explique par la désaffection des agriculteurs pour d’autres cultures peu rentables (blé, maïs, colza, betterave) et par l’attrait relatif de la pomme de terre, jusque-là perçue comme un refuge rentable. Toutefois, la demande industrielle (chips, frites) n’a pas suivi au même rythme, les nouvelles usines nécessaires à l’absorption de cette hausse n’étant pas encore opérationnelles.
En conséquence, une part importante de la production, non contractualisée, se retrouve sur le marché libre, avec des prix oscillant entre 0 et 15 euros la tonne, contre environ 115 euros à la même période en 2024. À l’opposé, les lots sous contrat, qui représentent habituellement 80 à 90 % des volumes industriels, ne couvrent cette année que 70 à 80 %, laissant un surplus vulnérable aux aléas du marché. Pour les producteurs non couverts par ces contrats, notamment les nouveaux entrants, la situation est critique : sans capacité de stockage et sans acheteur garanti, ils risquent de devoir vendre à perte.
Les producteurs historiques, mieux équipés, peuvent temporiser en stockant, mais cette crise révèle une fragilité structurelle du modèle : un excès d’offre face à une chaîne de transformation rigide, et une dépendance à une contractualisation qui s’effrite. Du côté des industriels, cette situation est vue d’un bon œil : elle leur garantit un approvisionnement abondant à bas prix, renforçant leur pouvoir de négociation.
Ce déséquilibre met en lumière les limites de la régulation actuelle et pose la question d’une meilleure planification entre amont agricole et aval industriel. L’épisode pourrait aussi entraîner une reconfiguration du secteur, avec une sélection économique impitoyable parmi les producteurs, à commencer par les plus vulnérables.
Les Échos, La face cachée des bières d'abbaye, 27/08/2025
Derrière l’image traditionnelle et monastique véhiculée par des marques comme Leffe, Grimbergen ou Affligem, l’article dévoile une réalité industrielle bien éloignée des abbayes. En France, une seule véritable bière est encore brassée dans un monastère : celle de l’abbaye de Saint-Wandrille, en Normandie, où le moine Frère Matthieu perpétue cette tradition. En revanche, les grandes marques d’abbaye sont désormais produites par des multinationales : AB InBev (Leffe), Carlsberg (Grimbergen) et Heineken (Affligem), dans des usines industrielles souvent situées loin des abbayes dont elles revendiquent l’héritage.
Ces bières s’appuient sur un marketing puissamment évocateur : blasons religieux, dates de fondation médiévales, mise en scène de recettes ancestrales… En réalité, la plupart n’ont plus aucun lien organique avec les moines, même si des contrats commerciaux prévoient des royalties et un droit de regard pour les abbayes concernées. Par exemple, Grimbergen est brassée à Strasbourg dans une usine Kronenbourg, alors que son abbaye est en Belgique. Seuls des volumes très limités y sont encore produits à des fins symboliques.
En France, aucun encadrement officiel ne définit ce qu’est une « bière d’abbaye ». Contrairement à la Belgique, où un label existe, le flou réglementaire permet une large liberté marketing. Des plaintes de consommateurs ont déjà émergé aux États-Unis, dénonçant des pratiques trompeuses. En 2020, une avancée législative française a toutefois imposé la mention claire du lieu de production sur les étiquettes, sous l’impulsion du Syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI). Celui-ci milite pour plus de transparence face à la domination des industriels, qui captent l’essentiel du marché des bières artisanales via l’imaginaire de l’abbaye.
Malgré une légère baisse des ventes depuis 2021, les bières d’abbaye représentent toujours 20 % du volume vendu en grande distribution. Elles se vendent plus cher que les blondes classiques (type pils), renforçant l’attrait pour ce positionnement semi-premium. Toutefois, seule la certification trappiste garantit encore une production réellement monastique, conditionnée à une implication directe des moines et à une finalité sociale des bénéfices. Seules neuf marques dans le monde, dont Chimay, respectent ce cahier des charges strict.
Face à la montée des attentes en matière d’authenticité et de transparence, cet article interroge la légitimité des stratégies marketing autour de l’abbaye. Il oppose un storytelling industriel bien rodé à la pratique sincère, mais marginale, d’acteurs comme Saint-Wandrille, derniers gardiens d’une tradition désormais instrumentalisée.
Les Échos, Les kiwis obtiennent une allégation santé autorisée, un label rare et inédit pour un fruit, 21/08/2025
Le kiwi vert entre dans une nouvelle ère grâce à une reconnaissance officielle de ses bienfaits par la Commission européenne. Une allégation santé vient d’être validée, affirmant que la consommation quotidienne de deux kiwis verts (minimum 200 grammes de pulpe) contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles. C’est la première fois qu’un fruit frais obtient un tel label de santé sur le territoire européen, offrant ainsi à l’ensemble de la filière une opportunité de repositionnement stratégique.
Ce tournant s’inscrit dans la dynamique de l’« alimentation fonctionnelle », où les consommateurs recherchent des aliments aux bénéfices prouvés pour la santé, au-delà de leurs simples qualités nutritionnelles. Le pruneau, jusqu’ici seul à bénéficier d’une réputation digestive, trouve désormais un concurrent crédible et moderne dans le kiwi, notamment la variété Hayward. L’entreprise néo-zélandaise Zespri, leader mondial de la distribution de kiwi, se félicite de cette avancée, fruit de plus de quinze ans de recherches et de lobbying. Le dossier validé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) repose sur 18 études scientifiques, dont six jugées suffisamment solides pour appuyer l’allégation.
Ce label santé est un outil précieux pour différencier le kiwi dans les linéaires et justifier une montée en gamme. Zespri entend s’en servir pour valoriser ses produits, mais l’ensemble des producteurs européens pourra en bénéficier. En France, où le kiwi est principalement cultivé dans le Sud-Ouest, plus de 1 500 producteurs sont concernés. Le pays, sixième producteur mondial et troisième européen, pourrait voir dans cette reconnaissance un levier pour relancer la consommation de fruits frais.
Cette décision intervient dans un contexte où la notion de « santé par l’alimentation » prend une place centrale dans les politiques publiques et les attentes des consommateurs. Elle offre aussi un contrepoint aux stratégies de certains industriels transformant les aliments pour y injecter artificiellement des bénéfices santé. Le kiwi, lui, joue la carte du naturel.
Par ailleurs, cette reconnaissance officielle pourrait inciter d’autres filières de fruits et légumes à documenter scientifiquement leurs effets bénéfiques, afin d’obtenir des labels similaires. C’est aussi une manière de réconcilier agriculture, nutrition et marketing en ancrant les produits frais dans les dynamiques d’innovation et de différenciation. L’allégation santé devient ainsi un nouvel outil concurrentiel dans un secteur à la recherche de valeur ajoutée face à la volatilité des marchés agricoles.
CNBC, Matcha mania turns the green powder into gold, 31/08/2025
Le matcha est aujourd’hui au cœur d’un engouement mondial sans précédent. Devenu un incontournable des réseaux sociaux pour ses bienfaits antioxydants et ses vertus santé supposées, il est également victime de son succès. La demande, portée par les marchés internationaux et le regain de tourisme post-Covid au Japon, a fait bondir les prix à des niveaux records. Le tencha, feuille de thé utilisée pour produire le matcha, a vu son prix augmenter de 170 % lors des dernières enchères à Kyoto, atteignant 8 235 yens le kilo. Les détaillants, confrontés à une pénurie, rationnent désormais les ventes tandis que les consommateurs se ruent sur les stocks disponibles, aussi bien dans les boutiques japonaises qu’en ligne.
Ce phénomène ne vient pas sans tensions structurelles. La culture du tencha est particulièrement exigeante : les feuilles doivent être ombragées, récoltées à la main, puis rapidement traitées pour en préserver les arômes délicats. Dans un pays où la main-d’œuvre agricole se raréfie, et après un été caniculaire qui a fragilisé les récoltes, la filière peine à suivre. Des entreprises comme Ito En, leader mondial du thé prêt-à-boire, créent même des divisions entières dédiées au matcha pour tenter de sécuriser leurs approvisionnements. L’entreprise prévoit d’augmenter de 50 % à 100 % le prix de ses produits dès septembre. Malgré des contrats exclusifs avec des producteurs, la société ne parvient à obtenir qu’environ 600 tonnes de tencha par an, contre 7 000 tonnes de thé vert standard.
Face à l’ampleur de la demande, le gouvernement japonais envisage de subventionner les producteurs pour encourager la culture du tencha. Mais les agriculteurs restent prudents, craignant que cette tendance ne s’essouffle. Pour certains acteurs, l’enjeu est aussi éducatif. Chitose Nagao, fondatrice des cafés Atelier Matcha, milite pour un usage différencié des qualités de matcha : inutile d’utiliser de la poudre haut de gamme pour un latte ou un smoothie. Grâce à son partenariat avec un producteur artisanal de Kyoto, elle continue de croître à l’international, avec des ouvertures prévues au Vietnam et aux Philippines. En tant que passionnée de la voie du thé (sado), elle garde un œil sur la prochaine vague : le hojicha, thé torréfié aux notes plus douces et pauvre en caféine.
CNBC, A world on weight loss drugs: How GLP-1s are reshaping the economy, 26/08/2025
Les médicaments contre l’obésité de type GLP-1, tels que Wegovy et Zepbound, connaissent une ascension fulgurante depuis leur autorisation aux États-Unis en 2021 et 2023. Originellement développés pour traiter le diabète de type 2, ces agonistes des récepteurs du GLP-1 agissent en imitant des hormones intestinales afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie. Leur adoption massive transforme non seulement les comportements alimentaires mais redéfinit des pans entiers de l’économie mondiale.
L’impact de ces traitements est double : médical et économique. Alors que l’obésité reste un facteur de risque majeur pour de nombreuses pathologies chroniques, ces médicaments promettent une amélioration notable de la santé publique. Leurs applications thérapeutiques s’élargissent également à des affections comme le psoriasis, l’apnée du sommeil ou même des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Sur le plan économique, Goldman Sachs estime qu’une adoption généralisée aux États-Unis pourrait accroître le PIB de 0,4 % via une productivité accrue et des économies de santé. Cependant, le coût reste élevé : entre 1 000 et 1 300 dollars par mois, et une couverture généralisée par Medicare pourrait alourdir les dépenses publiques de près de 48 milliards de dollars sur dix ans.
Les effets de ces médicaments dépassent largement le domaine médical. Une étude de l’université Cornell révèle que les foyers ayant un utilisateur de GLP-1 réduisent leurs dépenses alimentaires de 5,3 % en six mois, jusqu’à 8,2 % pour les foyers à hauts revenus. Ce changement de comportement affecte particulièrement les produits ultra-transformés comme les chips ou les pâtisseries, mais aussi certains produits de base. Contrairement aux attentes, les consommateurs ne remplacent pas ces aliments par des alternatives plus saines, ils consomment simplement moins. Ces évolutions représentent un défi de taille pour les acteurs de l’agroalimentaire, poussant des géants comme Nestlé ou Danone à repenser leurs gammes avec des produits plus protéinés ou en plus petites portions.
Le secteur alimentaire n’est pas le seul touché. Les GLP-1 influencent également les achats d’alcool, de vêtements, les habitudes de voyage ou encore la fréquentation des salles de sport. En modulant le circuit de la récompense dans le cerveau, ces médicaments pourraient réduire certaines addictions, y compris à l’alcool et aux jeux. Certains analystes évoquent même une baisse de la consommation de carburant aérien grâce à une réduction du poids moyen des passagers.
Cependant, cette révolution médicamenteuse pose aussi des questions d’équité. L’accès à ces traitements reste limité, surtout pour les populations les plus vulnérables, souvent les plus touchées par l’obésité. Le risque d’une société à deux vitesses se profile, où seuls les plus aisés pourraient bénéficier de ces médicaments aux effets visibles. Malgré des efforts pour baisser les prix et l’arrivée de concurrents comme AstraZeneca ou Pfizer, la fracture sociale pourrait s’aggraver si l’accès reste inégal.
The Guardian, ‘No place in children’s hands’: under-16s in England to be banned from buying energy drinks, 02/09/2025
Le gouvernement britannique s’apprête à interdire la vente de boissons énergisantes contenant plus de 150 mg de caféine par litre aux mineurs de moins de 16 ans en Angleterre. Cette décision, attendue de longue date, s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le Parti travailliste lors des élections générales de 2024, et répond à des inquiétudes croissantes sur les effets néfastes de ces boissons sur la santé physique, mentale et scolaire des jeunes.
Les boissons visées par cette mesure incluent notamment Red Bull, Monster, Prime Energy ou Relentless. Leur teneur en caféine équivaut parfois à celle d’un double expresso dans une seule canette, provoquant des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et une agitation en classe. Des enseignants signalent que certains élèves, ayant consommé ces boissons sur le chemin de l’école, deviennent hyperactifs et incapables de se concentrer. Une étude du syndicat NASUWT montre que plus de 70 % des enseignants s’inquiètent de la consommation de ces boissons pendant et en dehors du cadre scolaire.
Les établissements concernés – commerces, cafés, restaurants, plateformes en ligne et distributeurs automatiques – seront tenus de respecter cette interdiction, sans qu’une date d’application précise ne soit encore annoncée. La mesure sera introduite par voie de règlement secondaire dans le cadre du Food Safety Act de 1990.
Si la grande distribution a déjà adopté une interdiction volontaire depuis 2018, de nombreuses petites enseignes continuent de vendre ces boissons aux mineurs. Les autorités sanitaires et pédagogiques, ainsi que les dentistes, saluent cette décision, tout en appelant à des restrictions plus larges, incluant les versions sans sucre, afin de lutter contre les caries dentaires. Certains produits énergétiques contiendraient en effet jusqu’à 20 cuillères à café de sucre par portion, en plus d’un effet potentiellement addictif.
Des voix critiques, notamment du secteur industriel représenté par la British Soft Drinks Association, rappellent que les entreprises concernées respectent déjà un code d’autorégulation, avec des étiquetages spécifiques et des interdictions de ciblage marketing envers les moins de 16 ans. Elles appellent à une régulation fondée sur des preuves rigoureuses.
Pour les autorités, cette mesure de santé publique, comparable à celles déjà appliquées pour le tabac ou l’alcool, vise à protéger une population vulnérable contre des produits inadaptés et à améliorer leur bien-être général, tant physique que scolaire.
Wall Street Journal, My Family Went Off Ultra-Processed Foods for a Month. The Results Surprised Us., 29/08/2025
Dans cet article à la fois personnel et documenté, la journaliste scientifique Michaeleen Doucleff raconte l’expérience qu’elle a menée avec sa fille de 8 ans : éliminer totalement les aliments ultra-transformés (AUT) de leur alimentation pendant un mois. Ce défi, initié comme une simple expérimentation familiale, s’est rapidement transformé en un changement de mode de vie durable.
Doucleff s’appuie sur des recherches solides pour rappeler que les AUT sont associés à l’obésité, au diabète, aux maladies cardiovasculaires et potentiellement à des troubles mentaux comme la dépression. Pourtant, ils représentent environ 60 % des apports caloriques des enfants américains. Le flou scientifique autour de ce qui, précisément, rend ces aliments nocifs, n’empêche pas les experts d’en recommander la réduction, voire l’élimination.
En famille, Doucleff adopte une règle simple : si un ingrédient est imprononçable ou absent de leur cuisine habituelle, ils ne l’achètent pas. Cette règle bannit une multitude d’aliments courants (crackers, pains industriels, barres de céréales, chocolats aromatisés), mais permet aussi de redécouvrir une alimentation faite de produits bruts : yaourt nature, légumes frais, poisson en conserve, fruits secs, etc.
Les résultats se font rapidement sentir : moins de fringales, disparition du “bruit alimentaire” mental, regain d’appétit pour les repas maison. En trois semaines, sa fille, auparavant « difficile », se met à manger avec appétit des plats équilibrés. Selon des experts interrogés, les AUT perturbent la faim naturelle, augmentent les fringales et détournent les enfants des aliments nourrissants.
Des études récentes viennent confirmer ces observations : l’une publiée dans Nature Medicine montre que les personnes suivant un régime peu transformé perdent du poids tout en réduisant leurs envies de grignotage. Une autre, axée sur la santé mentale, souligne une amélioration significative des symptômes dépressifs chez les adultes ayant suivi un régime riche en aliments naturels.
Cependant, dans un monde saturé de produits transformés, l’évitement des AUT s’avère complexe, notamment pour les enfants. La journaliste met alors en place des « contextes sans AUT », comme la maison et la voiture, et adopte une approche plus souple : ces aliments sont permis seulement lors d’occasions spéciales. Elle insiste aussi sur l’importance d’enseigner la cuisine aux enfants, un levier d’autonomie et de plaisir.
Enfin, elle conclut que cette transformation a été rendue possible non par la discipline, mais par une évolution naturelle du goût et du rapport à l’alimentation. En réduisant les AUT, les aliments simples deviennent plus savoureux et satisfaisants. Cette prise de conscience, partagée par toute la famille, a profondément modifié leur manière de se nourrir.
Wall Street Journal, Scientists Have Unlocked the Secret That Gives Fine Chocolate Its Great Taste, 27/08/2025
Des chercheurs de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni) ont percé l’un des mystères les plus convoités de la gastronomie : les microbes responsables du goût exceptionnel du chocolat de qualité supérieure. Pour la première fois, ils ont isolé et reproduit en laboratoire une culture microbienne capable de fermenter des fèves de cacao en leur conférant les arômes complexes recherchés dans les chocolats haut de gamme.
La fabrication du chocolat commence par la fermentation : les producteurs laissent les fèves fraîches, entourées de leur pulpe blanche, dans des caisses en bois recouvertes de feuilles, où des levures et des bactéries naturellement présentes déclenchent la transformation. Ce processus est crucial : il convertit la pulpe en composés aromatiques qui donnent au chocolat ses caractéristiques gustatives.
Les chercheurs ont collaboré avec trois fermes colombiennes, un pays reconnu pour son cacao dit “fine flavor”. Grâce à des analyses génétiques effectuées à différentes étapes de la fermentation, ils ont identifié des centaines de microbes impliqués, avant de sélectionner neuf espèces clés responsables de la production des composés aromatiques recherchés. Ils ont ensuite utilisé cette “culture starter” pour fermenter des fèves en laboratoire.
Résultat : les fèves ainsi fermentées ont produit un chocolat au profil aromatique similaire aux meilleures variétés, selon une dégustation menée par un panel d’experts du Cocoa Research Center à Trinité-et-Tobago. Le chocolat obtenu présentait des notes florales et fruitées comparables à celles du cacao malgache, réputé pour sa finesse.
Ce travail est une première mondiale. Si d’autres recherches avaient déjà montré que le terroir – notamment les microbes présents dans le sol – influence le goût du chocolat, aucune étude n’avait jusqu’ici réussi à isoler les microbes et à reproduire l’ensemble du processus avec succès. Selon Pablo Cruz-Morales, biochimiste au Danemark (non impliqué dans l’étude), c’est une avancée majeure : « Personne n’avait encore “rétro-conçu” une culture microbienne fonctionnelle. »
Cette découverte, publiée dans la revue Nature Microbiology, ouvre des perspectives prometteuses pour les producteurs de cacao. Elle pourrait permettre de standardiser la fermentation naturelle, aujourd’hui encore très variable, et d’assurer une qualité constante pour les chocolats haut de gamme. Cela profiterait aussi bien aux artisans chocolatiers qu’aux agriculteurs, en particulier dans des régions comme la Colombie, où la production de cacao fin est en plein essor.
Reste une frustration pour les scientifiques et les amateurs : le chocolat issu de cette fermentation de laboratoire n’est pas encore commercialisé. « J’aurais aimé qu’on m’en envoie un échantillon », regrette Cruz-Morales.
Wall Street Journal, Meet the Parents Raising ‘Carnivore Babies,’ Swapping Puréed Fruit for Rib-Eye, 12/08/2025
Une nouvelle tendance alimentaire controversée fait son apparition chez certains jeunes parents nord-américains : les “carnivore babies”, des bébés nourris presque exclusivement de viande et de produits d’origine animale, au détriment des purées de fruits, légumes ou céréales habituellement recommandées.
Cette pratique, popularisée sur les réseaux sociaux par des influenceurs et médecins adeptes du régime carnivore, consiste à donner dès la diversification alimentaire des aliments comme foie de poulet mixé, sardines, jaune d’œuf cru, beurre, bouillon d’os ou viande rouge. Des communautés en ligne comme Carnivore Motherhood partagent recettes, conseils et témoignages.
Les motivations des parents sont multiples : rejet des aliments ultra-transformés, influence d’idéologies nutritionnelles extrêmes, et foi dans les bienfaits des produits animaux pour la santé, la fertilité ou le comportement des enfants. Dariya Quenneville (Canada) ou Lorraine Bonkowski (Michigan), toutes deux évoquées dans l’article, affirment que ces régimes ont rendu leurs enfants plus calmes, plus robustes ou plus éveillés.
Cependant, les pédiatres expriment de sérieuses inquiétudes. Le Dr Mark Corkins (Université du Tennessee) rappelle que les bébés ont besoin de vitamine C, de fibres, d’antioxydants et de polyphénols, nutriments absents ou très peu présents dans une alimentation centrée sur la viande. Les régimes déséquilibrés à un si jeune âge risquent de compromettre le développement du microbiote intestinal, du système immunitaire et des préférences alimentaires futures.
Des figures comme le professeur Steven Abrams (Texas) admettent que la viande est utile pour son apport en fer et en protéines de qualité, mais insistent sur la nécessité d’une diversité alimentaire dès le plus jeune âge, conformément aux recommandations nutritionnelles américaines. Celles-ci préconisent pour les enfants de 12 à 23 mois une alimentation variée incluant fruits, légumes, céréales complètes, produits laitiers et protéines.
Certains parents, comme Neisha Salas-Berry, vont jusqu’à exclure totalement les snacks classiques (« baby junk food ») au profit de collations carnées comme des barres de viande séchée, surnommées « meat candy » par ses enfants. Son mari, médecin et YouTubeur influent, contribue à populariser ce régime extrême, notamment à travers une communauté payante dédiée à la santé et à la nutrition carnivore.
Cette tendance, bien qu’encore marginale, interroge profondément les normes alimentaires pour les tout-petits et soulève des débats de société sur l’influence des réseaux sociaux, le rejet des recommandations médicales traditionnelles, et les nouvelles formes de radicalisation nutritionnelle.
Financial Times, Renewable food is on the horizon, 28/08/2025
Dans cet article de réflexion prospectiviste, Paul Gilding, chercheur à l’Université de Cambridge en leadership durable, alerte sur l’effondrement prévisible du modèle agricole industriel actuel, tout en dessinant les contours d’une révolution alimentaire imminente portée par l’innovation technologique : l’avènement de la “nourriture renouvelable”.
Selon lui, l’agriculture industrielle est structurellement insoutenable : entre changement climatique, épuisement des sols, pénurie d’eau et conflits géopolitiques, elle ne pourra répondre à l’augmentation prévue de 50 % de la demande alimentaire mondiale d’ici quelques décennies. Cette crise systémique n’est pas hypothétique : les pénuries alimentaires globales ou régionales deviennent une probabilité sérieuse, avec des conséquences économiques et sociales potentiellement dévastatrices.
Face à cette impasse, l’auteur identifie un levier majeur de transformation : le marché, guidé non par la morale mais par l’efficacité économique et technologique. Il met en lumière des solutions innovantes déjà en cours de déploiement, issues de la fermentation, des biotechnologies et de l’intelligence artificielle. Ces technologies permettent de produire des protéines et ingrédients alimentaires sans agriculture traditionnelle, réduisant l’usage des terres, de l’eau et les émissions de gaz à effet de serre de plus de 90 %.
Parmi les exemples marquants, Solar Foods, entreprise finlandaise, fabrique une protéine à base d’air, d’eau et d’électricité, sans impact climatique ni besoin en terres agricoles. De son côté, Veramaris produit des oméga-3 à partir de microalgues, supprimant les aléas liés à la pêche tout en assurant une qualité constante.
Ces innovations représentent une menace directe pour les acteurs traditionnels de l’agroalimentaire, car elles sont plus compétitives, plus stables et plus propres. L’auteur insiste : ce basculement ne viendra pas d’un changement de conscience éthique chez les consommateurs, mais d’un effet d’entraînement économique similaire à celui observé dans les secteurs des énergies renouvelables ou des véhicules électriques.
Des géants comme Unilever, Nestlé ou Danone investissent déjà massivement dans ces filières alternatives, non par conviction environnementale, mais pour préserver leur compétitivité face à l’instabilité croissante des chaînes d’approvisionnement globales.
Enfin, Gilding appelle à une prise de position politique ambitieuse, soulignant que des pays comme la Chine et Singapour prennent de l’avance, tandis que les États-Unis et l’Europe risquent de rester à la traîne, comme ce fut le cas dans d’autres transitions industrielles récentes.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey