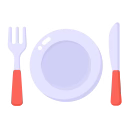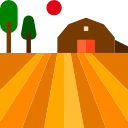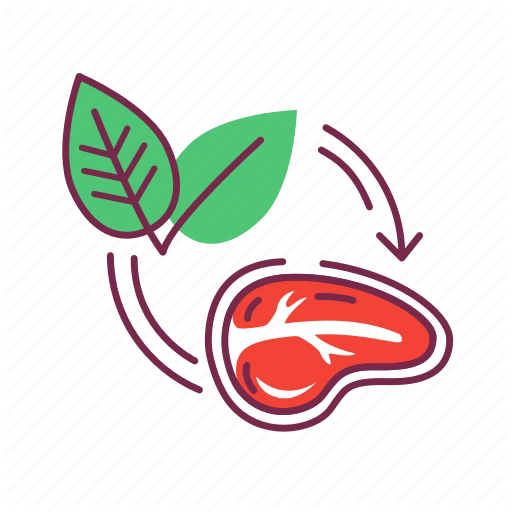🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-22
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
A partir de ce week-end Eat’s Business passe en mode été. Il y aura une revue de presse fin juillet et une autre fin août. En attendant je vous souhaite à toutes et tous de passer de très bonnes vacances.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, L’origine du logo Döner Kebab (enfin) révélée, 01/07/2025
L’Usine Nouvelle, Le spécialiste des aspirateurs Dyson entend désormais révolutionner… la culture des fraises, 03/07/2025
The Spoon, The Grocery Store is the Food System, 23/06/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Parisien, Titre-restaurant : les restaurateurs fous furieux après les annonces du gouvernement, 26/06/2025
L’article retrace la vive déception des restaurateurs, boulangers et commerçants de bouche après l’annonce des arbitrages du gouvernement sur la réforme des titres-restaurant. Réunis autour de Véronique Louwagie, ministre déléguée au Commerce, les représentants des professionnels ont découvert que leur principale revendication — l’instauration d’un double plafond — avait été rejetée. Le dispositif qu’ils proposaient visait à limiter l’utilisation des titres à 10 € par jour dans la grande distribution, contre 25 € dans les restaurants, boulangeries et commerces de bouche, afin de rééquilibrer la concurrence et soutenir les petits commerces. Une variante prévoyait un plafond modulé selon le taux de TVA appliqué : 10 % pour la restauration (25 €) et 5,5 % pour les produits de première nécessité (10 €). Le gouvernement a rejeté ces propositions, invoquant des raisons de simplicité pour le consommateur et le risque d’une censure par le Conseil d’État au nom du principe d’égalité devant la loi commerciale. Autre point de discorde : le refus d’encadrer les commissions prélevées sur les transactions en titres-restaurant. Alors qu’elles dépassent 4 % du montant pour ces titres (contre moins de 1 % pour les paiements par carte bancaire), le gouvernement se limite à promettre une plus grande transparence, sans imposer de plafonnement. Les professionnels dénoncent des arbitrages favorisant la grande distribution, déjà avantagée depuis que les titres peuvent servir à l’achat de produits non immédiatement consommables. Romain Vidal (GHR) et Franck Chaumes (Umih) fustigent une réforme jugée incohérente avec les discours sur la revitalisation des centres-villes. Les annonces destinées à « compenser » — comme l’élargissement de l’usage des titres le dimanche ou la réduction de leur durée de validité — sont vues comme profitant davantage aux supermarchés qu’aux commerces de proximité. Les représentants des métiers de bouche appellent désormais à mobiliser les parlementaires pour amender le projet avant son entrée en vigueur en 2027. Pour eux, l’avenir des petits commerces est en jeu dans ce dossier.
Libération, La folle épopée du cacio e pepe, coqueluche des restos italiens, 21/06/2025
L’article propose une immersion dans le phénomène culinaire du cacio e pepe, plat romain devenu un emblème des trattorias parisiennes. À base de pâtes, pecorino romano et poivre noir, ce plat cache derrière son apparente simplicité un vrai défi technique : obtenir une sauce crémeuse et homogène sans que le fromage ne coagule ou ne forme des grumeaux exige un tour de main précis et un contrôle minutieux des températures. Des chefs comme Giovanni Passerini, Lorenzo Sciabica ou Fabrizio Ferrara (Osteria Ferrara) se sont distingués par leur maîtrise de ce plat. L’article détaille les secrets d’exécution : choix des pâtes (spaghettonis, tonnarellis, fusillonis) pour libérer l’amidon nécessaire, pecorino affiné pour une meilleure fonte, poivre noir sélectionné (le Sarawak pour ses notes florales et chaudes). Fabrizio Ferrara ajoute une touche personnelle avec du pecorino sicilien au poivre. L’enquête montre que le cacio e pepe fascine jusqu’aux scientifiques : le chimiste Dario Bressanini a analysé la structure de la sauce et ses propriétés d’émulsion, tandis que le Max-Planck Institute a démontré que le mélange était métastable et tendait naturellement à se déstructurer en formant des gouttelettes d’huile. L’article retrace aussi les origines pastorales du plat, issu de la cucina povera, et son évolution au XIXe siècle en parallèle du développement des routes commerciales du poivre. Aujourd’hui, ce plat représente un symbole de la gastronomie italienne, incarnant le raffinement derrière la simplicité. L’article conseille enfin des adresses à Rome où le cacio e pepe atteint des sommets, comme Trattoria da Danilo où il est préparé dans des meules de pecorino devant le client, mêlant spectacle et saveurs authentiques.
L’Usine Nouvelle, Pourquoi il est possible de fabriquer du "Dubaï Chocolate" ailleurs qu'aux Emirats arabes unis, 26/06/2025
L’article décrypte les enjeux juridiques et économiques qui entourent le phénomène du « Dubaï Chocolate », ce chocolat au lait fourré à la crème de pistache devenu viral sur les réseaux sociaux avant de se retrouver dans les rayons des supermarchés européens. Le produit, imaginé par Sarah Hamouda à Dubaï, a rapidement été repris par de grandes marques, dont Lindt qui fabrique des tablettes « Dubaï Style Chocolate » en Allemagne. Cette appropriation a suscité un litige : un importateur de la recette originale a saisi la justice allemande, estimant que l’usage du nom par des industriels turcs était trompeur. Les tribunaux ont jugé que le nom « Dubaï Chocolate » est devenu générique du fait de son succès mondial. Il ne bénéficie donc d’aucune protection géographique spécifique, contrairement à des appellations comme le roquefort ou le champagne. L’article souligne que cette décision ouvre la porte à la fabrication du produit dans n’importe quel pays, y compris en France, à condition de ne pas induire le consommateur en erreur sur l’origine. L’avocate Marie-Avril Roux Steinkuehler explique qu’un recours fondé sur le parasitisme économique (copie d’un concept pour profiter de sa notoriété) serait possible mais difficile à faire aboutir sans action engagée par l’inventrice. Au-delà de l’aspect juridique, l’article rappelle que, même produit en France, ce chocolat continuerait de dépendre d’ingrédients importés, notamment des pistaches provenant principalement des États-Unis, de Turquie et d’Iran. Les Émirats arabes unis ne figurent pas parmi les producteurs majeurs de pistaches. Ce cas illustre les limites du droit face aux phénomènes alimentaires mondialisés et aux modes virales : une idée peut devenir un produit générique en quelques mois, rendant sa protection complexe. L’article conclut sur la difficulté de défendre l’originalité d’une recette ou d’un concept culinaire dans un monde où les réseaux sociaux accélèrent la diffusion et la standardisation des innovations.
Les Échos, Le brocoli séduit, pas l'artichaut… La méthode Prince de Bretagne pour s'adapter au marché, 25/06/2025
L’article met en lumière la stratégie d’adaptation de Prince de Bretagne face aux évolutions des goûts des consommateurs et aux défis structurels du maraîchage breton. Longtemps roi des champs, l’artichaut breton décline : ses ventes ont chuté de 40 % en dix ans, et les surfaces plantées ont été réduites de moitié. En cause : une image vieillissante et une préparation jugée trop longue par les jeunes générations. À l’inverse, le brocoli séduit de plus en plus : ses surfaces ont progressé de 15 % en un an, porté par la demande des ménages, de la restauration collective et des exportations. La courge suit la même dynamique (+10 %). Prince de Bretagne mise sur l’innovation pour sauver l’artichaut : lancement du Végécook (artichaut prêt à cuire au micro-ondes), surgélation des petits calibres invendus, et nouveaux partenariats avec la grande distribution pour proposer des formats plus pratiques. Le groupement parie aussi sur la diversification : la myrtille, par exemple, dont la production pourrait passer de 20 à 130 tonnes d’ici 2028. L’article souligne que ces ajustements sont rendus plus difficiles par des facteurs structurels : baisse continue des surfaces maraîchères (-15 % en 7 ans), départs à la retraite non remplacés, manque de main-d’œuvre, en particulier pour les cultures manuelles comme le chou-fleur. Face à ces défis, la coopérative cherche à renforcer la valeur ajoutée de ses productions et à reconquérir le consommateur en misant sur la praticité, la qualité et l’image du légume breton. L’enjeu est de taille : maintenir un modèle agricole familial et compétitif, tout en répondant aux attentes d’un marché de plus en plus sensible au prix et à la facilité d’usage. L’article conclut que la réussite passera par la capacité à moderniser les pratiques sans trahir l’identité du terroir.
Le Monde, Mehdi Favri, chef de Maslow Group : « Notre mission est d’aider le plus de gens possible à végétaliser leur alimentation », 26/06/2025
Dans cet entretien, les trois fondateurs du Maslow Group — Mehdi Favri, Julia Chican Vernin et Marine Ricklin — partagent leur ambition de démocratiser une cuisine végétale à la fois gourmande, accessible et rentable. Créé en 2021, le groupe a déjà ouvert trois établissements à Paris : Maslow, Fellows et Maslow Temple. Ensemble, ces restaurants attirent 40 000 clients par mois, dont 80 % ne sont pas végétariens. Leur objectif : séduire un large public au-delà des seuls convaincus, en proposant une offre ludique et inclusive. Les plats s’inspirent de la street food et de la cuisine du monde : chou-fleur façon poulet frit coréen, champignons panés à tremper dans une sauce soja-sésame, nachos aux lentilles ou encore tacos végétariens. Le succès du groupe repose sur un modèle économique précis : les fondateurs, passés par FoodChéri, ont mis en place des fiches techniques rigoureuses pour limiter les pertes et standardiser les gestes en cuisine. La maîtrise des coûts permet de proposer un ticket moyen autour de 30 €, jugé juste par rapport à la qualité des produits et au cadre. Le Maslow Group se distingue aussi par son engagement écologique : lutte contre le gaspillage (pain transformé en chapelure, parures valorisées en sauces ou huiles aromatisées), choix de fournisseurs responsables (le local privilégié si les pratiques sont vertueuses), et attention portée à l’empreinte carbone des ingrédients. Loin du dogmatisme, le trio revendique une approche pragmatique : mieux vaut un produit « propre » qu’un produit simplement local. Le groupe prévoit l’ouverture de deux nouvelles adresses à moyen terme, tout en restant prudent pour ne pas compromettre l’exigence de qualité qui fait sa réputation. Les fondateurs insistent sur la nécessité de repenser le modèle économique de la restauration : entre inflation des coûts, exigences environnementales et évolutions des attentes des consommateurs, la restauration végétale doit prouver qu’elle peut être à la fois désirable, rentable et responsable. L’article souligne ainsi la réussite d’un modèle qui conjugue plaisir gustatif, rigueur entrepreneuriale et engagement durable.
Libération, L’origine du logo Döner Kebab (enfin) révélée, 01/07/2025
Dans cet article, Libération nous plonge dans les coulisses d’une enquête originale qui a permis de lever le voile sur l’origine du célèbre logo du Döner Kebab, devenu un symbole visuel incontournable dans de nombreux établissements en Allemagne et en France. Ce logo représente un cuisinier moustachu en tenue blanche, armé d’un grand couteau, debout devant une broche à viande. Depuis les années 1980, ce dessin s’est imposé sur les emballages des kebabs et dans l’imaginaire collectif, sans que l’on sache vraiment qui en était l’auteur. L’enquête a mobilisé journalistes, podcasteurs et youtubeurs passionnés. Elle s’appuie notamment sur les recherches d’Aylin Dogan (créatrice du podcast Döner Papers) et de Kannemilsch, un vidéaste spécialisé dans les objets populaires. Ensemble, ils ont retrouvé Mehmet Unay, un ancien designer commercial de Düsseldorf aujourd’hui retraité. C’est lui qui a réalisé ce dessin en une heure à peine, dans les années 1980, sans imaginer qu’il deviendrait iconique. Le lettrage « Döner Kebab » a été ajouté par son jeune collègue de l’époque, Orhan Tançgil. Anecdote amusante : Mehmet Unay a reconnu que son cuisinier tenait le couteau… à l’envers. Ce logo, devenu culte, a même été décliné sur des tee-shirts et autres objets dérivés. L’article conclut en rappelant que, si le logo est désormais identifié, le débat sur les véritables origines du kebab reste ouvert. Le sandwich est-il allemand, turc ou un hybride des deux cultures ? En France, on l’appelle souvent un « grec », un clin d’œil aux habitudes des consommateurs plus qu’à une origine précise. L’enquête illustre ainsi la force des symboles populaires et la manière dont certains dessins, conçus modestement, deviennent des icônes culturelles transnationales, échappant largement à leurs créateurs initiaux.
Les Échos, Magnum, Ben & Jerry's, Carte d'Or… Unilever prêt à se délester de ses marques de glaces, 01/07/2025
L’article décrypte la décision stratégique d’Unilever de se séparer de sa division glaces, une activité regroupée sous la nouvelle entité The Magnum Ice Cream Company (TMICC). Cette scission, qui doit aboutir à une cotation à la Bourse d’Amsterdam avant fin 2025, marque un tournant pour le géant anglo-néerlandais. Avec des marques phares comme Magnum, Ben & Jerry’s, Carte d’Or, Cornetto ou Viennetta, Unilever reste l’un des poids lourds du secteur. Pourtant, cette activité, qui génère 8,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit 14 % des revenus du groupe), est jugée trop coûteuse et peu synergique. La logistique de la chaîne du froid, la saisonnalité des ventes et la pression sur les marges (accentuée par l’inflation des matières premières comme le cacao et le lait) ont conduit Unilever à ce choix radical. L’article souligne aussi les tensions internes, notamment avec Ben & Jerry’s, connu pour ses positions politiques affirmées. Le récent limogeage de son patron, Dave Stever, après des prises de position pro-palestiniennes, illustre les frictions entre la maison mère et sa filiale engagée. Deux plaintes ont été déposées contre Unilever dans ce cadre. Si cette division des glaces pourrait séduire de nouveaux investisseurs (grâce à un marché concentré et des opportunités dans les pays émergents), elle traduit aussi une évolution du portefeuille d’Unilever, qui privilégie désormais les produits de soins et d’hygiène au détriment de l’alimentaire, dont le poids passera sous la barre des 25 % du chiffre d’affaires global. La scission s’inscrit dans une tendance déjà observée chez d’autres grands groupes, comme Nestlé, qui avait cédé son activité glaces aux États-Unis à Froneri.
Les Échos, « L'agroalimentaire n'est pas assez concentré en Europe », selon le PDG de Lactalis, 01/07/2025
Dans cet entretien, Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis, livre une analyse lucide de l’état de l’agroalimentaire européen et des défis de son groupe. Après 25 ans à la tête de Lactalis, Besnier a accompagné la croissance et l’internationalisation du groupe : le chiffre d’affaires est passé de 5 à plus de 30 milliards d’euros, et 80 % des résultats sont désormais réalisés hors de France. Lactalis est présent industriellement dans 50 pays et ses produits sont vendus dans 180. Besnier plaide pour une plus grande concentration de l’agroalimentaire en Europe afin de rééquilibrer les rapports avec une grande distribution très puissante : un fournisseur pèse rarement plus de 1-2 % des ventes d’un distributeur, alors que ce dernier représente 20 % des ventes du fournisseur. L’article revient aussi sur la stratégie du groupe, toujours centré sur les produits laitiers (lait, fromage, ultra-frais) qu’il considère comme les plus performants en goût et en apport nutritionnel. Si Lactalis intègre prudemment des alternatives végétales, c’est sans volonté de diversification majeure. L’entreprise continue de prospecter des acquisitions, notamment en Inde, en Océanie, au Portugal et en Europe du Nord et de l’Est, tout en restant attentive aux opportunités en France. Besnier alerte enfin sur les prix alimentaires trop bas, qui pénalisent les producteurs et freinent les efforts de décarbonation et de réduction du plastique.
L’Usine Nouvelle, Le spécialiste des aspirateurs Dyson entend désormais révolutionner… la culture des fraises, 03/07/2025
L’article détaille l’incursion inattendue de Dyson, le géant britannique des aspirateurs et sèche-mains, dans le monde de l’agriculture, et plus précisément dans la culture des fraises. Connue pour ses innovations technologiques dans l’électroménager, l’entreprise dirigée par James Dyson a investi plus de 9 millions d’euros dans un projet d’agriculture sous serre high-tech au sein de son immense site agricole de 6 000 hectares à Hullavington, au Royaume-Uni. L’objectif : concevoir un modèle de production de fraises plus durable, efficace et technologiquement avancé.
Les serres développées par Dyson intègrent un ensemble de solutions technologiques inspirées de son expertise industrielle : contrôle climatique automatisé, capteurs en réseau pour surveiller en temps réel la température, l’humidité et les besoins en eau des plants, éclairage LED optimisé pour la photosynthèse. L’ambition est de produire des fraises hors-sol avec un minimum d’intrants, de limiter les pertes et d’obtenir des récoltes plus régulières et prévisibles, indépendamment des aléas climatiques. Dyson met également en avant la réduction des émissions de carbone liées au transport, les fraises pouvant ainsi être cultivées localement et approvisionner le marché britannique sans recourir à des importations.
L’article souligne que ce projet s’inscrit dans une tendance plus large : celle de la high-tech appliquée à l’agriculture (ou agri-tech). Dyson rejoint ainsi d’autres acteurs qui parient sur la culture verticale, les fermes urbaines ou les serres intelligentes pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de durabilité. Le groupe expérimente aussi la culture d’autres fruits et légumes sous serre, et pourrait à terme commercialiser ses technologies auprès des agriculteurs.
Cependant, l’article interroge les limites de ce modèle : le coût élevé des infrastructures, la consommation énergétique des serres, et la difficulté d’atteindre un prix de vente compétitif face aux fraises importées de pays à moindre coût de production. L’initiative de Dyson apparaît donc à la fois comme une vitrine de son savoir-faire technologique et comme un pari sur l’avenir de l’agriculture locale en Europe, à l’heure des défis climatiques et des tensions sur les chaînes logistiques.
Inc, Beyond Meat’s Next Dish Won’t Imitate Beef, Pork, or Chicken, 26/06/2025
L’article s’intéresse à la nouvelle stratégie de Beyond Meat, pionnier des substituts végétaux, qui tente de relancer sa croissance après une spectaculaire chute de sa valorisation boursière. L’entreprise, qui valait 235 dollars l’action lors de son apogée, est retombée à moins de 3 dollars en 2025. En réponse, son PDG Ethan Brown parie sur un nouveau produit baptisé provisoirement « Beyond Ground » : un haché végétal qui ne cherche plus à imiter une viande précise (bœuf, porc, poulet), mais à s’imposer comme une alternative protéinée à part entière.
Le produit se compose d’ingrédients simples : eau, protéines de fève, protéines de pomme de terre et psyllium, sans huile ajoutée, pour un apport de 27 g de protéines par portion. L’idée est de répondre aux critiques sur les substituts jugés trop complexes et ultra-transformés, tout en réduisant les coûts de production afin de proposer un prix plus accessible au grand public. Le lancement se veut progressif : d’abord auprès des chefs, influenceurs et créateurs de contenus culinaires, avant un déploiement plus large en supermarché à l’automne 2025.
L’article rappelle que Beyond Meat, emblème des alternatives végétales lors de son entrée en Bourse, a vu ses ventes stagner, alors que l’engouement pour les viandes végétales s’essouffle. La concurrence s’est intensifiée, les consommateurs devenant plus exigeants sur le goût, le prix et la qualité nutritionnelle. Beyond Meat mise donc sur un positionnement différent : proposer une base protéinée polyvalente qui trouve sa place dans toutes sortes de recettes, sans chercher à reproduire la texture ou le goût d’une viande précise. Ethan Brown estime que ce choix peut relancer la dynamique de la marque, en s’éloignant des comparaisons systématiques avec les viandes animales et en valorisant une approche plus authentique et nutritive. L’article conclut en soulignant que le défi reste de taille : convaincre un public plus large tout en améliorant les marges et en se démarquant dans un marché devenu extrêmement concurrentiel.
The Washington Post, Jalapeños in sauvignon blanc? We tried the trend — and then some., 11/06/2025
L’article s’amuse à tester un phénomène culinaire devenu viral sur TikTok : le « spicy sauvy B », une boisson qui associe sauvignon blanc et tranches de piment jalapeño congelées. L’autrice se penche sur cette tendance qui illustre notre époque : un goût marqué pour l’expérimentation culinaire, des modes éphémères, et un attrait pour les sensations fortes. Elle raconte ses essais, souvent ratés au départ : en ajoutant trop de jalapeño, le vin devient imbuvable, la brûlure prenant le dessus sur les arômes. En ajustant la dose, elle parvient à un équilibre où les notes végétales et poivrées du piment se marient avec les caractéristiques herbacées du sauvignon blanc. L’article met en parallèle cette mode avec d’autres tendances récentes : chips ultra-épicées, miel pimenté, cocktails relevés.
Ne s’arrêtant pas là, l’autrice tente des variantes : zeste de citron pour accentuer l’acidité, olives pour un clin d’œil au dirty martini, framboises pour une touche fruitée. Certaines expériences sont convaincantes, d’autres franchement ratées : l’ajout de bacon, par exemple, apporte une texture grasse et une saveur fumée qui déséquilibrent complètement le vin. L’autrice souligne l’intérêt de cette tendance pour bousculer les codes d’un univers souvent perçu comme rigide : celui du vin. Le spicy sauvy B permettrait d’ouvrir la porte à des consommateurs jeunes, moins sensibles aux conventions œnologiques traditionnelles.
L’article interroge aussi l’effet des réseaux sociaux : ils transforment des gestes anecdotiques en phénomènes mondiaux, amplifiant des tendances parfois éphémères. Enfin, il invite chacun à oser l’expérimentation, tout en reconnaissant les limites de ces mélanges : ce n’est pas toujours une bonne idée de sacrifier l’équilibre d’un vin pour suivre une mode. L’expérience du spicy sauvy B révèle ainsi nos envies de nouveauté, mais aussi les pièges de l’instantanéité et du buzz dans nos choix alimentaires.
The Spoon, The Grocery Store is the Food System, 23/06/2025
Dans cet essai, l’auteur défend l’idée que le supermarché n’est pas seulement un maillon du système alimentaire : il en est l’incarnation la plus visible et la plus concrète pour la majorité des consommateurs. Loin des fermes ou des centres de distribution, c’est au supermarché que l’ensemble des choix agricoles, industriels, commerciaux et politiques converge et se matérialise. Chaque produit en rayon reflète une chaîne complexe de décisions : choix des cultures par les agriculteurs, formulations des industriels, réglementations des autorités. Et chaque acte d’achat envoie un signal qui remonte cette chaîne.
L’article met en lumière le paradoxe de l’abondance : en apparence, les supermarchés offrent une variété infinie – des centaines de céréales, des dizaines de yaourts, une profusion de barres nutritionnelles. Mais derrière cette diversité de marques se cache une uniformité inquiétante : la majorité des produits reposent sur quelques cultures industrielles (maïs, soja, blé). Cette homogénéité résulte d’un système agricole optimisé pour l’échelle et la rentabilité, bien plus que pour la nutrition ou la biodiversité. De même, la diversité apparente des marques masque une forte concentration de la distribution entre les mains de quelques géants de la grande distribution, qui décident des produits mis en avant et des fournisseurs qui survivent.
L’article souligne aussi les effets pervers du marketing. Dans un environnement saturé de messages visuels, les emballages doivent capter l’attention en deux secondes. Le storytelling des marques se réduit souvent à des slogans simplistes (« ancient grains », « naturel »), écrasant la complexité des pratiques agricoles réelles. Le consommateur, pris par le rythme des courses, n’a ni le temps ni la capacité de décrypter les engagements réels des marques.
L’auteur insiste enfin sur les inégalités d’accès : les quartiers riches ont des supermarchés offrant des produits variés et sains, tandis que les zones pauvres sont souvent reléguées aux food deserts. Pourtant, il existe des alternatives : coopératives, marchés mobiles, politiques publiques incitatives. L’article invite à repenser notre rôle : en tant que « citoyens alimentaires », nos choix collectifs peuvent façonner un système plus juste et durable. Le supermarché est à la fois miroir et moteur de ce système : il reflète nos priorités actuelles et détermine nos futurs possibles.
Food Dive, Food tech investments slow as AI grabs venture capital attention, 10/06/2025
L’article analyse la nette inflexion des investissements dans la food tech en 2025, un secteur désormais en perte de vitesse face à l’irrésistible attrait des technologies d’intelligence artificielle. Selon des données de Pitchbook relayées par l’article, les startups de la food tech n’ont levé que 1,4 milliard de dollars au premier trimestre 2025, un chiffre en chute de 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre de transactions a lui aussi diminué de 15 %. Cette désaffection s’explique en grande partie par le basculement massif des capitaux vers les entreprises développant des solutions d’IA, qui ont capté près de 70 % des investissements en capital-risque sur la période.
L’article souligne que ce recentrage des investisseurs ne signifie pas que la food tech manque d’innovations, mais plutôt que le secteur pâtit d’un effet de mode et d’une exigence accrue de rentabilité. Les projets jugés trop éloignés d’une mise sur le marché rapide ou d’un retour sur investissement tangible peinent désormais à séduire. Les startups en phase d’amorçage sont les plus touchées : elles peinent à convaincre face à un environnement où les valorisations ont également été revues à la baisse. Pourtant, quelques niches tirent leur épingle du jeu. Liberation Bioindustries, qui mise sur la fermentation de précision pour produire des alternatives protéiques, a levé 52 millions de dollars. Vivici, positionnée sur les produits laitiers alternatifs, a pour sa part levé 33,8 millions de dollars. Ces exceptions confirment que l’innovation reste possible, à condition de répondre à des attentes précises : durabilité, santé, efficacité des processus, résilience des chaînes d’approvisionnement.
L’article met aussi en garde contre une vision à court terme des investisseurs. Le ralentissement des financements pourrait freiner des projets essentiels pour rendre l’alimentation plus durable ou mieux adaptée aux défis environnementaux. Les experts interrogés insistent sur la nécessité de trouver un équilibre : continuer à financer la food tech, indispensable pour transformer le système alimentaire, tout en capitalisant sur les apports de l’IA pour accélérer cette transformation. Le texte conclut sur l’idée que l’IA et la food tech ne sont pas des univers opposés, mais des alliés potentiels pour bâtir l’alimentation de demain.
Wall Street Journal, Mars’s $30 Billion Takeover of Kellanova Comes Under In-Depth EU Investigation, 25/06/2025
L’article analyse l’ouverture d’une enquête approfondie par la Commission européenne sur le rachat de Kellanova (Pringles, Pop-Tarts et Cheez-Its) par Mars, géant de la confiserie (M&M’s, Twix, Skittles). Cette opération, d’un montant de 30 milliards de dollars, suscite des inquiétudes sur ses conséquences pour la concurrence et les consommateurs en Europe. Selon la Commission, ce rachat pourrait renforcer la position dominante de Mars sur plusieurs segments, notamment les snacks salés et sucrés, en donnant au groupe un pouvoir excessif face aux distributeurs. Les craintes portent sur la capacité de Mars-Kellanova à imposer des hausses de prix en raison de son poids dans les rayons des grandes surfaces. Le risque est d’exclure des marques plus petites ou locales, qui peinent déjà à obtenir des contrats et de la visibilité dans les linéaires.
L’article rappelle que l’accord devait initialement être finalisé au premier semestre 2025, mais l’enquête repousse cette échéance. La décision définitive de la Commission européenne est attendue pour le 31 octobre 2025. Mars s’est dit déçu de la prolongation de la procédure mais prêt à coopérer pleinement. La Commission souligne que ce type de méga-fusion pourrait aggraver la hausse des prix alimentaires, déjà alimentée par l’inflation, les tensions géopolitiques et les coûts énergétiques élevés.
Ce dossier illustre les tensions entre la logique industrielle (qui cherche des économies d’échelle et une meilleure efficacité des chaînes logistiques) et les impératifs de régulation visant à préserver la diversité de l’offre et à protéger les consommateurs. Il s’inscrit dans un contexte où les autorités européennes surveillent de près les mouvements de consolidation dans l’agroalimentaire, un secteur jugé stratégique pour la souveraineté économique et la stabilité sociale. L’enquête devra déterminer si des engagements de Mars (par exemple, cessions d’actifs ou garanties d’accès au marché pour des tiers) peuvent suffire à lever les doutes sur la concurrence. Le rachat de Kellanova par Mars pourrait ainsi devenir un cas d’école sur la manière dont l’UE entend encadrer les géants de l’agroalimentaire.
New York Times, War, Inflation and Now Drought Are Hitting Global Food Supplies, 21/06/2025
L’article dresse un état des lieux alarmant des menaces qui pèsent sur les approvisionnements alimentaires mondiaux. Après les chocs causés par la pandémie, la guerre en Ukraine et l’inflation galopante, une nouvelle crise s’ajoute : la sécheresse, qui frappe plusieurs régions-clés de production. Le Brésil, premier exportateur mondial de café, voit ses récoltes affectées, ce qui entraîne une envolée des prix. Aux États-Unis, le cheptel bovin a atteint son plus bas niveau depuis 70 ans, conséquence de pâturages asséchés qui forcent les éleveurs à abattre prématurément leurs animaux. La production de blé est également fragilisée en Russie, en Ukraine et en Inde, ce qui limite les exportations et contribue à la volatilité des cours mondiaux.
L’article souligne que cette succession de crises met en évidence la vulnérabilité des chaînes alimentaires mondiales. La concentration de la production sur quelques zones géographiques et sur un nombre réduit de cultures majeures (blé, maïs, soja, riz) accroît les risques en cas de chocs climatiques. L’Europe n’est pas épargnée : une étude de la Banque centrale européenne citée dans l’article prévoit un recul potentiel de 15 % du PIB agricole du continent si les sécheresses s’intensifient. Le sud de l’Europe (Espagne, Italie, Grèce) est particulièrement concerné, ses cultures étant déjà soumises à un stress hydrique important.
L’article met aussi en avant les réponses possibles : diversification des cultures, amélioration des infrastructures d’irrigation, constitution de stocks stratégiques et réforme des politiques agricoles pour les rendre plus résilientes. Mais il alerte sur la lenteur des actions face à l’urgence des crises. Les tensions géopolitiques compliquent encore la situation : la guerre au Proche-Orient perturbe des routes commerciales, la guerre en Ukraine limite les exportations depuis la mer Noire, et les restrictions à l’exportation décidées par certains États accentuent la pénurie. L’auteur conclut que la sécurité alimentaire mondiale, longtemps considérée comme acquise, doit redevenir une priorité stratégique.
Fast Company, How will AI change the restaurant business?, 03/07/2025
L’article explore l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le secteur de la restauration, un domaine en pleine transformation numérique. Selon un sondage cité par l’article, 98 % des dirigeants du secteur estiment que l’IA jouera un rôle clé dans l’expérience client d’ici trois ans. Aujourd’hui, l’IA intervient déjà dans plusieurs domaines : prise de commande automatisée dans les drive, réponses aux appels téléphoniques, gestion des réservations et fidélisation, campagnes marketing ciblées. Les grandes chaînes sont les premières à s’équiper de ces technologies, mais l’article souligne que les restaurants indépendants pourraient eux aussi tirer parti de ces outils.
L’IA conversationnelle, bien que prometteuse, reste encore marginale : moins de 20 % des établissements l’utilisent pour dialoguer avec leurs clients. Des exemples concrets sont donnés, comme Flour + Water à San Francisco, où un assistant téléphonique basé sur l’IA permet de réduire les appels manqués et d’améliorer la satisfaction des clients. Les outils de gestion relationnelle comme SevenRooms aident à identifier les clients les plus susceptibles de revenir et à personnaliser les offres. L’article met en lumière un paradoxe : alors que le potentiel de l’IA est immense, beaucoup de restaurateurs peinent à l’adopter faute de préparation technique, de formation des équipes ou de moyens financiers. À ce stade, moins d’un tiers des entreprises se disent réellement prêtes pour un déploiement à grande échelle.
L’article insiste sur les défis que soulève cette révolution : risque de déshumanisation du service, protection des données clients, nécessité d’un équilibre entre technologie et convivialité. L’IA pourrait permettre aux restaurateurs de mieux gérer leurs opérations et d’affiner leurs décisions stratégiques (par exemple, ajuster les horaires d’ouverture ou optimiser les stocks). Mais elle pourrait aussi creuser les écarts entre grandes chaînes, mieux équipées, et petits acteurs. L’article conclut en rappelant que, si l’IA n’est pas la solution à tous les maux du secteur, elle offre une opportunité majeure de réinventer la relation client et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des restaurants, à condition d’être adoptée avec discernement.
New York Times, The Map Rating Restaurants Based on How Hot the Customers Are, 01/07/2025
L’article décrit le phénomène viral d’une carte interactive baptisée LooksMapping, qui évalue les restaurants de New York, Los Angeles et San Francisco… en fonction de l’« attractivité » de leur clientèle. Ce projet, imaginé par Riley Walz, repose sur un algorithme d’intelligence artificielle qui a analysé près de 600 000 photos issues des avis Google pour attribuer à chaque établissement une note de 1 à 10. L’outil, conçu sur un mode satirique, prétend indiquer les lieux où les clients seraient les plus « hot » selon des critères esthétiques identifiés par la machine.
L’article souligne les biais et les dérives d’un tel dispositif : les quartiers riches et majoritairement blancs sont systématiquement mieux notés, tandis que les zones populaires obtiennent des scores plus faibles. Le système attribue des points pour des éléments absurdes (par exemple, une robe de mariée augmente la note) et en retire pour des détails aléatoires (photo floue, angle peu flatteur). L’article met en lumière les biais raciaux, sociaux et culturels d’un tel outil, reflet des imperfections de l’IA lorsqu’elle s’appuie sur des bases de données biaisées. L’article questionne aussi notre obsession pour l’apparence dans la sphère publique et privée : en valorisant l’esthétique des clients plutôt que la qualité des plats ou du service, LooksMapping pousse à l’extrême les logiques superficielles déjà à l’œuvre dans les réseaux sociaux et certains sites d’avis.
Au-delà de l’anecdote, l’article ouvre un débat sur la façon dont les algorithmes façonnent notre perception des lieux, en imposant des critères souvent arbitraires. Il interroge les impacts de ces outils sur l’image des restaurants, notamment ceux qui se trouvent dans des quartiers défavorisés et qui pourraient pâtir de notes injustement basses. L’auteur rappelle que ce type de projet, bien que ludique en apparence, reflète des mécanismes plus profonds : la reproduction des inégalités par la technologie, et la difficulté à créer des outils d’IA vraiment équitables. L’article se termine sur une note critique : sous couvert d’humour, ce genre d’initiative interroge notre rapport aux autres et à nous-mêmes dans l’espace public.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey