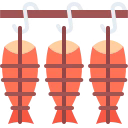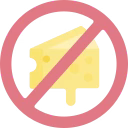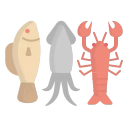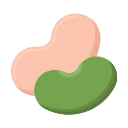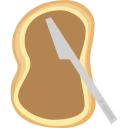🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-20
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Le Monde, La gastronomie s’enflamme pour le fumé, 12/06/2025
New York Times, You’ve Heard of Fine Wine. Now Meet Fine Water., 09/06/2025
New York Times, A.I. Is Getting Smarter Every Day. But Can It Cook?, 02/06/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Libération, Alimentation saine : ouvrir le champ des possibles, 07/06/2025
Dans un contexte marqué par l’inflation et la crise économique, l’accès à une alimentation saine et durable demeure complexe pour beaucoup de Français. Frédéric Faure, vice-président de Biocoop, souligne que le coût élevé des produits de qualité constitue le principal obstacle à leur adoption généralisée. Il dénonce une situation paradoxale où ceux qui produisent la nourriture ne peuvent parfois pas s'alimenter correctement eux-mêmes. Selon lui, l'alimentation saine devrait être un droit fondamental au-delà de simples recommandations nutritionnelles.
Le modèle actuel, axé sur la production de masse et l'utilisation intensive de pesticides pour satisfaire une demande mondialisée, est critiqué pour ses conséquences environnementales et sociales néfastes. L'importation massive d'aliments venant de l'autre bout du monde, malgré son coût environnemental considérable, continue d'affaiblir les filières locales. Par ailleurs, le logo Origin’Info, qui pourrait renforcer la transparence sur l’origine des produits alimentaires, n'est toujours pas obligatoire.
Le vice-président de Biocoop pointe également du doigt la prépondérance de produits ultra-transformés, peu coûteux mais néfastes pour la santé, bénéficiant d’une promotion disproportionnée par rapport aux aliments de qualité. Il appelle à la généralisation du Nutri-Score obligatoire et à l'interdiction de la publicité pour les produits les plus mal notés. De plus, il critique les pratiques commerciales agressives de la grande distribution qui tirent les prix vers le bas au détriment de la rémunération juste des producteurs.
Frédéric Faure affirme que promouvoir une alimentation locale, bio et équilibrée ne doit pas être réservé aux privilégiés, évoquant des solutions comme le vrac, les produits locaux et le fait maison. Il insiste sur l’importance d’une transformation culturelle collective et regrette la réduction du budget de communication de l’Agence Bio, qui nuit à la promotion des produits bio. Enfin, il met en avant des initiatives telles que la Sécurité Sociale de l’Alimentation qui visent à garantir un droit universel à une alimentation de qualité, considérant ces démarches comme essentielles pour enclencher une transition vers une société plus responsable, solidaire et équitable.
L’Usine Nouvelle, Les tensions commerciales avec la Chine et les Etats-Unis affectent la filière française des spiritueux, 13/06/2025
La filière française des spiritueux subit un recul marqué de ses exportations en raison des tensions commerciales avec la Chine et les États-Unis. En 2024, les ventes à l’international ont chuté de 6% en valeur, après une baisse déjà importante de 12% en 2023. Ce contexte fragilise une industrie stratégique qui pèse 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 151 000 emplois en France, avec 50% de ses ventes réalisées à l’étranger.
La Chine, en particulier, constitue une zone de difficultés majeures suite à l'ouverture d'une enquête antidumping sur les spiritueux européens, entraînant une baisse drastique des exportations françaises vers ce marché et vers Singapour. Les surtaxes potentielles prévues pour juillet 2025 risquent d'augmenter les prix de vente de 12% à 16%. Gabriel Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, regrette notamment le retrait progressif du cognac et de l’armagnac des repas officiels chinois.
Aux États-Unis, les spiritueux français affrontent également des difficultés dues aux politiques douanières restrictives mises en place par Donald Trump. Les ventes de cognac, produit phare représentant près de 67% des exportations françaises vers les États-Unis, ont baissé de 10,9% en 2024. Le rhum et les liqueurs ont également enregistré des diminutions notables.
Par ailleurs, les rejets politiques des accords commerciaux, tels que le CETA avec le Canada et l'accord Mercosur avec le Brésil, entravent le développement potentiel des exportations françaises sur ces marchés importants. La Fédération des exportateurs souhaite cependant des accords sectoriels spécifiques dédiés aux spiritueux pour contourner ces blocages.
En France, les ventes domestiques pâtissent aussi de la baisse de la consommation d'alcool. La grande distribution enregistre une diminution de 3,8% des volumes vendus et une réduction de 3,6% des ventes en valeur. Le secteur des cafés-hôtels-restaurants connaît également une baisse des ventes, tant en volume qu’en valeur.
L’Usine Nouvelle, Labeyrie détaille sa stratégie pour faire bondir son chiffre d’affaires de 30% en quatre ans, 13/06/2025
Labeyrie Fine Foods ambitionne une forte croissance en visant un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros d’ici 2028, soit une progression de 30% par rapport à 2024. L’entreprise française, spécialisée notamment dans le foie gras, le saumon fumé et les produits apéritifs, prévoit d’importants investissements industriels afin d’accompagner cette dynamique. Le président de Labeyrie, Jacques Trottier, affirme que la compétitivité en France n’est pas entravée par les charges sociales si les marques proposées sont attractives et innovantes.
En 2024, Labeyrie a déjà réalisé une croissance de 7% de son chiffre d’affaires qui atteignait alors 867 millions d’euros. Cette performance a été favorisée par l’absence de grippe aviaire, ce qui a permis une augmentation des volumes en foie gras, ainsi que par de solides ventes de saumon fumé pendant les fêtes et un accueil favorable réservé à ses innovations, notamment des plats préparés à base de poisson.
Pour réaliser son objectif, Labeyrie compte augmenter ses ventes de 290 à 400 millions de produits d'ici 2028. La moitié de cette croissance devrait provenir des segments où l’entreprise excelle déjà, tels que le saumon, le foie gras et les produits apéritifs. À cet effet, l'entreprise prévoit d'investir 120 millions d’euros dans ses douze usines, dont neuf en France, après avoir déjà investi 100 millions d’euros depuis 2020. Ces fonds seront notamment consacrés à l'amélioration des outils de découpe de saumon sur le site de Saint-Geours de Maremne.
Par ailleurs, Labeyrie souhaite renforcer sa présence sur de nouveaux marchés, comme celui de la truite, en sécurisant ses approvisionnements et en augmentant ses capacités industrielles dédiées à ce produit. L’entreprise entend également se développer sur le segment des produits végétaux, comme le houmous, avec pour objectif que cette catégorie représente 25% de son chiffre d'affaires d'ici 2028.
Jacques Trottier reste optimiste quant à la capacité de Labeyrie à atteindre ses objectifs, soulignant que les restructurations nécessaires ont été réalisées durant le cycle inflationniste récent, permettant à l’entreprise d’être parfaitement positionnée pour tirer profit des segments en reprise après la crise.
Les Échos, La France, planche de salut du distributeur allemand Metro, 10/06/2025
Le groupe allemand Metro, spécialisé dans la distribution alimentaire à destination des professionnels, a fait de sa filiale française un axe stratégique majeur dans sa quête de redressement et de croissance. En 2024, Metro France a généré un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros, en hausse de 4 %, et représente aujourd’hui 11 % des effectifs mondiaux du groupe. Avec 99 halles réparties sur l’ensemble du territoire, l’enseigne s’est imposée comme un acteur incontournable auprès des restaurateurs indépendants, avec plus de 16 % de parts de marché dans la restauration commerciale.
Cette réussite repose sur un recentrage clair de l’activité vers une clientèle exclusivement professionnelle, abandonnant le modèle de grande distribution grand public. Metro France a également misé sur l’omnicanalité en déployant une stratégie combinant vente physique, livraison et marketplace numérique. Deux entrepôts logistiques ont été récemment ouverts à Savigny-le-Temple et La Brède, renforçant la capacité de livraison de l’enseigne. Une plateforme e-commerce de 18 000 m², située dans la Somme, soutient ce virage digital.
L’accompagnement des restaurateurs constitue un autre pilier de la stratégie de Metro France. L’entreprise propose des services allant de l’aménagement de cuisine à l’aide au calcul de rentabilité, en passant par la livraison de produits ultra-frais. Cette offre de proximité, doublée d’une expertise logistique, permet à l’enseigne de se distinguer sur un marché particulièrement concurrentiel. Metro France domine désormais le cash and carry avec 80 % de parts de marché, loin devant Promocash (Carrefour).
L’acquisition de Pro à Pro en 2017, orientée vers la restauration collective, s’est avérée payante : le chiffre d’affaires de cette entité a doublé pour atteindre 1,2 milliard d’euros en 2023. Metro entend poursuivre cette diversification afin d’élargir son spectre d’intervention.
Dans un contexte marqué par une consommation alimentaire globalement atone, y compris en restauration hors domicile, Metro France parvient à maintenir une dynamique positive. Cette performance est saluée comme un modèle de transformation réussie, qui repose sur l’agilité stratégique, la digitalisation, et une compréhension fine des attentes des professionnels de la restauration. Face aux nouveaux entrants et aux évolutions des modes de consommation, Metro France démontre sa capacité à anticiper et à s’adapter, consolidant ainsi sa position de leader du secteur.
Le Monde, La gastronomie s’enflamme pour le fumé, 12/06/2025
La gastronomie française connaît un engouement notable pour les saveurs fumées, une tendance qui dépasse le simple effet de mode pour devenir un véritable courant culinaire. Que ce soit dans les cuisines de chefs étoilés, les restaurants spécialisés ou les épiceries fines, le goût fumé est partout. Cette redécouverte s’inscrit dans une quête d’authenticité et d’émotions gustatives, souvent associée à des souvenirs d’enfance ou à des pratiques artisanales ancestrales.
Dans ce contexte, les méthodes traditionnelles de fumage à froid ou à chaud sont remises au goût du jour. Des établissements comme The Smoked Meat ou Melt, à Paris, mettent en avant des viandes longuement fumées au bois de hêtre, tandis que d’autres, tels que L’Atelier Dürüm, optent pour un fumage subtil et maîtrisé. La tendance touche aussi les produits de la mer : thon fumé, sardines artisanales ou saumon de prestige s’invitent dans les assiettes des amateurs éclairés. Le végétal n’est pas en reste avec des alternatives comme le tofu, les huiles ou les sels fumés.
De grandes maisons françaises comme Petrossian ou Barthouil proposent désormais des gammes premium intégrant le fumé, à l’image de ventrèche de thon fumée ou d’œufs de truite délicatement travaillés. L’univers des boissons suit cette dynamique avec des cocktails intégrant des éléments fumés, ou encore des thés comme le lapsang souchong et le hojicha, prisés pour leurs arômes profonds.
Cette tendance séduit particulièrement une jeune génération de chefs, souvent trentenaires, qui expérimentent avec les essences de bois, les temps de fumage et les associations audacieuses. Dans leurs établissements comme Aldéhyde ou Ardent, le fumé devient un langage culinaire, une signature sensorielle à part entière. Il permet de jouer sur la texture, le goût, la température, et d’enrichir l’expérience gustative.
Parallèlement, l’Union européenne prévoit d’interdire les arômes artificiels de fumé d’ici 2029, ce qui pousse les professionnels à revenir à des techniques artisanales, plus respectueuses de la matière première. Le fumé n’est plus seulement un goût, c’est désormais un marqueur de qualité, un vecteur d’histoire et de créativité dans une cuisine en perpétuelle redéfinition.
LSA, Fromage végétal : pourquoi Bel (Kiri, Babybel...) a raté son pari avec Nurishh, 09/06/2025
Le groupe Bel, connu pour ses marques emblématiques comme La Vache qui Rit ou Babybel, a annoncé la fin de sa marque végétale Nurishh, lancée en 2021, ainsi que la fermeture de l’usine de Saint-Nazaire d’ici fin 2025. Cette décision met en lumière l’échec de la stratégie de Bel sur le segment encore émergent du fromage végétal. Malgré une part de marché prometteuse à ses débuts (jusqu’à 44 % en valeur), Nurishh n’a pas réussi à s’imposer durablement auprès des consommateurs.
L’entreprise avait pourtant engagé d’importants investissements pour faire de Nurishh un acteur majeur de la transition alimentaire. Elle s’était notamment associée à la start-up américaine Perfect Day pour développer des produits à base de protéines issues de fermentation, et à Climax Foods pour recourir à l’intelligence artificielle dans la simulation des textures et arômes des fromages affinés. Un projet baptisé “Cocagne” avait mobilisé plus de 9 millions d’euros.
Pourtant, ces innovations n’ont pas suffi à convaincre. Les critiques portent principalement sur l’absence de différenciation gustative, un manque de storytelling fort, une identité visuelle jugée peu attractive et une image trop industrielle. Nurishh a pâti de l’image d’un produit ultra-transformé, peu appétissant et bon marché, en décalage avec les attentes d’un public flexitarien et exigeant.
En parallèle, Bel entend recentrer ses efforts sur des versions végétales de ses marques phares, plus connues et mieux perçues. Boursin, Babybel ou encore La Vache qui Rit disposeront ainsi de déclinaisons végétales, destinées prioritairement au marché nord-américain, où l’acceptation des substituts alimentaires est plus avancée.
Le marché des alternatives végétales au fromage reste en phase de construction : il représente à peine 12 millions d’euros en France, pour seulement 3,5 % des consommateurs. La croissance est pourtant bien réelle (+9,9 % en 2024) et des marques comme Violife (40 % de parts de marché), Tartare Végétal ou Jay & Joy misent sur la qualité artisanale, la fermentation naturelle et des profils organoleptiques différenciants.
L’échec de Nurishh reflète les défis d’un secteur encore jeune, où la réussite repose autant sur l’innovation produit que sur la capacité à construire un imaginaire culinaire crédible et séduisant.
Inc, An Air-to-Butter Startup Gave Chefs a Taste. They Had Notes, 07/06/2025
La start-up californienne Savor ambitionne de révolutionner la production de matières grasses alimentaires avec un concept novateur : créer du beurre à partir de l’air et de l’eau. Fondée par la biologiste Kathleen Alexander, l’entreprise utilise un procédé thermochimique inspiré des sources hydrothermales naturelles pour transformer du dioxyde de carbone industriel et de l’hydrogène extrait de l’eau en acides gras complexes.
Contrairement à la viande cultivée ou aux substituts végétaux, cette technologie ne repose sur aucune source agricole ou biologique. L’objectif est de proposer une graisse « sans vache » ni plante, totalement indépendante des chaînes d’approvisionnement agricoles, réduisant ainsi l’empreinte carbone et la dépendance aux terres arables. Ce modèle permet aussi de contourner les risques liés au changement climatique, à la déforestation ou aux épidémies animales.
Le premier produit développé par Savor est une alternative au beurre, initialement pensée pour les chefs gastronomiques. Toutefois, après plusieurs phases de tests en restauration, l’entreprise a revu son approche, optant pour une version plus neutre et fonctionnelle, mieux adaptée aux usages professionnels. Grâce à sa flexibilité chimique, Savor est capable de reproduire différentes structures de graisses : beurre de cacao, suif animal, graisse de canard, etc.
Actuellement, la start-up opère dans une usine pilote de 2 300 m² à Batavia, dans l’Illinois. D’ici la mi-2025, elle prévoit de produire 100 kg de graisse par semaine et de commercialiser ses produits via des partenariats ciblés avec des marques alimentaires. Sont visés les secteurs de la restauration, du snacking et de la pâtisserie industrielle, où la standardisation des graisses est cruciale.
Ce projet attire l’attention pour son potentiel à transformer l’approvisionnement mondial en lipides, dans un contexte où les pressions environnementales et nutritionnelles sur les matières grasses animales et végétales sont de plus en plus fortes. Si le défi reste de convaincre les chefs et les consommateurs, la technologie de Savor pourrait ouvrir une nouvelle voie dans la formulation d’aliments durables, sans compromis sur la texture ou la saveur.
CNBC, Spirit makers face a sobering cocktail of challenges — from tariffs to teetotalers, 07/06/2025
Le secteur mondial des spiritueux traverse une période de turbulences, confronté à une conjonction de facteurs défavorables : tensions géopolitiques, évolutions des modes de consommation, et nouvelles pressions réglementaires. Trois géants du secteur – Diageo, Pernod Ricard et Rémy Cointreau – ont tour à tour révisé à la baisse leurs perspectives financières, signalant un essoufflement préoccupant de la demande mondiale.
En Chine, le marché du cognac est en nette régression. Rémy Martin enregistre une baisse de 22 % de ses ventes sur un an, tandis que LVMH annonce un recul de 17 % pour Hennessy. Cette chute s’explique notamment par l’intensification des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui pénalisent les marques occidentales dans leur ensemble. L’arrivée de droits de douane supplémentaires pourrait encore aggraver la situation.
Aux États-Unis, premier marché du cognac, le ralentissement est également visible. Après une période d’euphorie post-Covid, marquée par une forte consommation de produits premium, les consommateurs adoptent désormais des comportements plus prudents. Le segment haut de gamme recule, tandis que les ventes de cocktails prêts à boire (RTD) progressent. La montée du mouvement "sober curious", qui valorise la sobriété volontaire, amplifie cette tendance, en particulier chez les jeunes générations.
Un autre facteur inattendu vient s’ajouter : l’essor des médicaments de type GLP-1 (comme Ozempic), utilisés pour traiter le diabète et l’obésité, qui réduisent significativement l’appétit – et, par extension, la consommation d’alcool. Les premiers retours du terrain suggèrent un effet mesurable sur les comportements alimentaires et festifs.
Malgré ces signaux négatifs, les analystes sont partagés sur la nature du ralentissement. Certains y voient une correction conjoncturelle, liée à une surconsommation pendant la pandémie, d’autres estiment qu’il s’agit d’un changement structurel, annonçant une redéfinition durable du rapport à l’alcool. Selon UBS, la croissance annuelle du secteur pourrait perdre 1 à 2 points par rapport à ses performances historiques.
The Washington Post, What type of seafood is healthiest? Here’s what experts recommend, 11/06/2025
Malgré ses nombreux bienfaits nutritionnels, le poisson reste largement sous-consommé, en particulier aux États-Unis. Selon les experts en santé publique, près de 90 % des adultes américains ne respectent pas les recommandations qui préconisent au moins deux portions de poisson par semaine, soit environ 200 grammes. Pourtant, les produits de la mer sont riches en protéines de haute qualité, en vitamines (notamment D et B12), en minéraux (iode, sélénium) et surtout en acides gras oméga-3 (EPA et DHA), essentiels au bon fonctionnement du cœur, du cerveau et des yeux.
Parmi les meilleures options figurent le saumon (sauvage ou d’élevage), les sardines, le maquereau, la truite arc-en-ciel, les anchois, les moules et les huîtres. Ces espèces présentent l’avantage d’une faible teneur en mercure, d’un bon apport en oméga-3 et d’un impact environnemental relativement réduit, notamment lorsqu’elles sont issues d’une aquaculture durable. En revanche, certains poissons comme le thon en boîte, le tilapia ou les crevettes sont jugés moins intéressants sur le plan nutritionnel, du fait de leur pauvreté en oméga-3 ou de leur exposition à des polluants.
Les espèces prédatrices telles que l’espadon, le requin, le marlin ou le thon rouge sont déconseillées, en raison de leur forte concentration en mercure. Ces recommandations s’appliquent particulièrement aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes vulnérables. Pour les végétariens ou les personnes allergiques aux fruits de mer, des sources végétales d’oméga-3 existent sous forme d’ALA (acide alpha-linolénique), que l’on trouve dans les graines de lin, de chia, les noix et certaines huiles. Cependant, la conversion de l’ALA en EPA et DHA reste très faible chez l’humain.
Des études récentes montrent que la consommation régulière de poisson est corrélée à une baisse significative de la mortalité prématurée et à une amélioration de la santé cognitive avec l’âge. Au-delà des bienfaits individuels, il s’agit également d’un enjeu écologique et économique. Choisir du poisson local, durable et peu transformé peut contribuer à préserver les ressources marines tout en soutenant les filières de pêche responsables.
Eater, On Instagram, Recipe-Sharing Automation Is Here to Stay, 06/06/2025
Instagram connaît un bouleversement dans la manière dont les recettes sont partagées avec les abonnés. Face à l’impossibilité d’intégrer des liens cliquables dans les publications, de nombreux créateurs se tournent vers l’automatisation via des chatbots comme Manychat. Le principe est simple : lorsqu’un internaute commente une publication avec des mots-clés comme « recipe » ou « meatball », il reçoit automatiquement la recette en message privé.
Ce système permet de contourner la limitation structurelle d’Instagram, en assurant une réponse rapide et personnalisée, tout en augmentant le taux d’engagement. Des comptes populaires comme NYT Cooking ont institutionnalisé cette pratique, désormais largement répandue. Mais cette automatisation soulève aussi des interrogations éthiques et relationnelles.
Des créateurs comme Lisa Lin ou Erin Clarkson critiquent la perte de spontanéité qu’induit cette mécanique. Les commentaires, autrefois espaces d’échange authentique, deviennent de simples déclencheurs algorithmiques. Le lien entre l’auteur et son public s’appauvrit, laissant place à une transaction automatisée dénuée de chaleur humaine. En parallèle, les utilisateurs adoptent eux-mêmes une posture utilitariste, commentant mécaniquement sans même consulter les instructions données dans la publication.
Cette évolution reflète un enjeu plus large sur les réseaux sociaux : la tension croissante entre performance algorithmique et relation communautaire. Pour rester visibles, les créateurs doivent jouer le jeu des outils de growth hacking, au risque de transformer leur contenu en interface de service client. Ce phénomène participe à ce que certains chercheurs appellent l’"enschittification" des plateformes : un glissement progressif d’un espace d’expression libre vers un canal de marketing automatisé.
Taste, The Mung Bean Embraces Its Main Character Moment, 03/06/2025
Le haricot mungo, longtemps cantonné aux cuisines traditionnelles asiatiques, revient sur le devant de la scène culinaire mondiale. Originaire du sous-continent indien et largement utilisé en Chine, au Vietnam ou en Thaïlande, il est aujourd’hui redécouvert par les gastronomes et les industriels comme une source protéique végétale aux multiples vertus.
Le mungo se distingue par son excellente composition nutritionnelle : il est riche en protéines végétales, en fibres, en antioxydants et en micronutriments essentiels (fer, magnésium, acide folique). Facile à digérer, il est aussi apprécié pour sa polyvalence en cuisine : consommé entier, germé, sous forme de farine ou décortiqué, il entre dans la composition de plats salés (dal, soupes, currys) comme sucrés (desserts vietnamiens, crêpes indiennes).
Sur le plan agricole, cette légumineuse présente de nombreux avantages. Résiliente face aux épisodes de sécheresse, elle pousse rapidement, enrichit les sols en azote et nécessite peu d’intrants chimiques. Ces caractéristiques en font une culture de choix dans un contexte de changement climatique et d’agriculture durable. Plusieurs pays explorent d’ailleurs sa culture comme alternative aux légumineuses plus gourmandes en eau.
Le mungo séduit également les start-up de la foodtech. L’entreprise américaine Eat Just a lancé JUST Egg, un substitut d’œuf à base de haricot mungo, à grand succès aux États-Unis. D’autres projets alimentaires misent sur sa capacité à se substituer à des protéines animales dans des produits végétaliens riches en texture et en goût.
Parallèlement, une nouvelle génération de chefs occidentaux l’intègre dans des plats fusion, croisant tradition asiatique et modernité culinaire. Ils valorisent à la fois ses qualités nutritionnelles, son goût subtil et sa capacité à incarner une cuisine saine, responsable et créative.
New York Times, You’ve Heard of Fine Wine. Now Meet Fine Water., 09/06/2025
L’eau minérale entre dans une nouvelle ère de valorisation avec l’essor du marché des « eaux fines », présentées comme l’équivalent hydraté du vin de prestige. Des marques comme Svalbardi, qui récupére de l’eau de glaciers, ou Veen, qui vante une pureté exceptionnelle, proposent des bouteilles pouvant atteindre 100 € pièce. Le positionnement est résolument premium, misant sur l’origine, la minéralité, la rareté et le design.
Les promoteurs de cette tendance cherchent à éduquer les consommateurs à déguster l’eau comme un vin : en considérant ses caractéristiques organoleptiques (goût, texture, température de service) et en valorisant son association avec les mets. Des sommeliers de l’eau, à l’instar de Martin Riese, militent pour cette reconnaissance culturelle de l’eau comme boisson noble.
Ce phénomène est aussi une réponse à la montée des modes de vie sains et à la baisse de la consommation d’alcool, notamment chez les jeunes adultes. L’eau devient ainsi une boisson statutaire, pouvant se consommer dans des contextes festifs ou gastronomiques sans alcool. Le packaging, souvent raffiné, et les récits autour des sources naturelles contribuent à créer un imaginaire de luxe.
Cependant, cette “fine water culture” suscite aussi des critiques. Elle illustre une forme d’élitisme hydrique dans un monde où des millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. D’autres dénoncent son absurdité environnementale : transport longue distance, marketing carboné, surconsommation d’un bien commun. La controverse reflète un clivage entre innovation de marché et conscience écologique.
New York Times, A.I. Is Getting Smarter Every Day. But Can It Cook?, 02/06/2025
L’intelligence artificielle progresse rapidement dans le domaine culinaire, mais reste loin de rivaliser avec l’intuition et la créativité humaines en cuisine. Des outils comme ChatGPT, utilisés pour proposer des recettes ou générer des idées, démontrent des capacités intéressantes, mais souvent limitées en termes de cohérence, de goût ou de faisabilité technique.
Des chefs professionnels ont testé des recettes générées par IA, observant des résultats parfois inspirants mais fréquemment absurdes ou irréalisables. L’IA peine à tenir compte de la texture, du timing ou des techniques complexes. Elle ignore aussi des variables essentielles comme la saisonnalité ou l’approvisionnement local. En revanche, elle excelle dans la combinaison d’idées existantes, dans le soutien à l’organisation de menus, ou pour des suggestions de substitution d’ingrédients.
Les systèmes d’IA évoluent néanmoins : certains modèles intègrent désormais des données sensorielles, des bases de connaissances gustatives ou des interfaces vocales. À terme, ils pourraient servir d’assistants culinaires intelligents, notamment pour les novices ou les personnes en situation de handicap. Des start-up développent même des robots capables de cuisiner certaines préparations simples en autonomie.
Malgré cela, les créateurs et artisans de la gastronomie restent unanimes : l’essence de la cuisine repose sur l’humain. L’émotion, la mémoire, la narration, la sensibilité au détail et la capacité d’adaptation sont des dimensions inaccessibles aux machines actuelles. Si l’IA peut devenir un partenaire utile, elle ne remplacera pas l’expertise et la magie du geste culinaire.
The Grocer, Exclusive data on GLP-1’s impact on UK food and drink consumption, 13/06/2025
De nouvelles données exclusives révèlent l’impact significatif des traitements GLP-1 (comme Ozempic) sur la consommation de produits alimentaires et de boissons au Royaume-Uni. Ces médicaments, utilisés pour le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité, réduisent l’appétit et influencent directement les habitudes alimentaires.
Les enseignes de la grande distribution et les fabricants de produits alimentaires observent une baisse marquée des ventes de snacks sucrés, d’alcools et de produits ultra-transformés parmi les consommateurs utilisant ces traitements. Les produits riches en protéines, à faible teneur calorique ou perçus comme plus sains enregistrent, à l’inverse, une progression. Cela oblige les marques à repenser leur offre et leurs stratégies marketing.
Les données collectées via des panels consommateurs et des enquêtes ciblées montrent que les utilisateurs réguliers de GLP-1 modifient leurs comportements d’achat, mais aussi leurs pratiques sociales (moins de grignotage, réduction des repas au restaurant, consommation modérée d’alcool). Le secteur agroalimentaire s’adapte en ajustant les formats, les recettes et les positionnements nutritionnels.
Cette évolution pourrait se généraliser si l’adoption des GLP-1 se poursuit, bouleversant durablement le marché de l’alimentation et redéfinissant les attentes des consommateurs. Les acteurs de l’agroalimentaire doivent ainsi anticiper des transformations profondes, à la croisée de la médecine, du bien-être et des choix alimentaires de demain.
New Yorker, How a Hazelnut Spread Became A Sticking Point in Franco-Algerian Relations, 02/06/2025
Un simple pot de pâte à tartiner El Mordjene a ravivé les tensions historiques entre la France et l’Algérie, illustrant à quel point l’alimentation peut devenir un objet diplomatique sensible. L’affaire a débuté lorsqu’un nutritionniste français, lors d’une émission télévisée populaire, a cité en exemple la marque en question parmi les produits à éviter en raison de leur composition jugée peu saine (sucre, huile de palme, etc.). Bien que l’intervention se veuille strictement nutritionnelle, la réaction en Algérie a été immédiate et virulente.
De nombreux internautes, figures publiques et médias algériens y ont vu une attaque directe contre un symbole de la consommation locale et, plus largement, contre la souveraineté alimentaire du pays. Les réseaux sociaux algériens se sont enflammés, appelant au boycott des produits français, dénonçant une nouvelle forme d’arrogance postcoloniale et critiquant une « stigmatisation » systématique des produits maghrébins. Le débat a rapidement dépassé la sphère nutritionnelle pour devenir politique et identitaire.
La marque, très populaire en Algérie, est perçue comme un produit familial, accessible et national. Elle est souvent valorisée comme une alternative locale aux marques occidentales, et son évocation dans un contexte critique a été ressentie comme une remise en cause de cette légitimité. Des figures politiques algériennes ont même pris part à la polémique, accusant les autorités françaises d’ingérence symbolique.
Face à l’ampleur des réactions, plusieurs responsables français ont tenté d’apaiser les tensions, expliquant qu’il s’agissait d’un exemple parmi d’autres, sans connotation culturelle ou nationale. Mais dans un contexte de relations bilatérales historiquement tendues, notamment sur les questions mémorielles et migratoires, cet épisode a cristallisé des ressentiments latents.
Cet incident met en lumière l’importance croissante de ce qu’on appelle désormais la diplomatie alimentaire. Les aliments ne sont pas de simples marchandises : ils véhiculent des imaginaires, des attachements, des fiertés nationales. Lorsqu’ils sont perçus comme attaqués, la réaction dépasse souvent la raison nutritionnelle pour embrasser les enjeux de dignité, d’autonomie et de reconnaissance.
Fondation Jean-Jaurès, Obsoco, La France à Table, 2è édition, Tensions et mutations autour de notre rapport à l’alimentation, Juin 2025
Une étude de la Fondation Jean-Jaurès sur la base d'une enquête de L'ObSoCo qui vise à suivre, comprendre et mesurer comment évoluent les préoccupations, les représentations, les attentes, mais aussi les contraintes et donc les pratiques alimentaires des consommateurs.
Parmi les principaux points clés de l'étude :
57% des Français considèrent que leur alimentation leur procure du plaisir (-16 points depuis 2016). Le plaisir de manger s’érode, signe d’un rapport plus contraint à l’alimentation.
37% déclarent devoir restreindre leurs dépenses alimentaires pour des raisons économiques ; 11% évoquent des restrictions importantes. Un Français sur dix est confronté à une véritable précarité alimentaire.
43% dînent seuls à la maison, contre 29% vingt ans plus tôt. Le repas partagé se dissout progressivement dans les pratiques individuelles.
60% se disent préoccupés par l’impact des aliments qu’ils consomment (+4 points par rapport à 2021). Pourtant, l’attention réellement portée à ces effets diminue – une dissonance entre intentions et contraintes.
1 Français sur trois suit un régime alimentaire spécifique (sans viande, sans gluten, flexitarien...). Les pratiques se personnalisent, traduisant une autonomie accrue vis-à-vis des normes collectives.
40% estiment que la qualité des produits alimentaires s’est dégradée en cinq ans ; 22% jugent qu’elle s’est même fortement dégradée. Une défiance croissante envers l’offre, nourrie par l’expérience directe et un sentiment de déclassement alimentaire.
69% estiment que les marques de distributeur offrent une qualité équivalente à celle des grandes marques.
5,3 : c’est le nombre moyen de types de commerces alimentaires fréquentés régulièrement (contre 3,3 en 2019). Le parcours d’achat se diversifie et se fragmente, reflet d’une société de consommateurs plus stratèges, mais aussi plus
désorientés.
Agence Bio, Chiffres Clés 2024
La publication annuelle de l’Agence Bio pour tout savoir sur le bio.
Les chiffres à retenir :
61 853 fermes engagées, tout ou partie, en agriculture biologique soit
14,9% des fermes françaises.
La surface agricole bio française connait une baisse de 56 197 ha, soit une baisse de 2 %. Le total des surfaces bio, certifiées ou en cours de certification, représente 2,7 M ha soit 10,1% de la surface agricole française.
Le marché de la consommation à domicile des produits biologiques
s’élève en 2024 à 12,176 Mds €, soit une croissance de 0,8% par rapport
à 2023 (inflation comprise)
Le poids de l’alimentation biologique dans le panier des Français reste de
5,7% (en valeur, hors inflation)
Les ventes des produits bio ont progressé en valeur dans l’ensemble des circuits, à l’exception de la grande distribution qui voit ses ventes de bio reculer pour la 4è
année consécutive.
Avec la baisse du poids de la grande distribution, la diversification des circuits bio s’accroît : le circuit spécialisé bio a dépassé le stade de la reprise (+6,5% entre
2023 et 2024, contre +2,2% entre 2022 et 2023) et réalise désormais 29% des ventes de produits bio.
La vente directe de produits biologiques n’a pas connu d’année noire en 2022 comme les autres circuits, et sa croissance, déjà renforcée en 2023 (+8,3%, contre +3,7% en 2022) se maintient en 2024 (+7,4%).
French Food Boss est un nouveau podcast sur le monde de la gastronomie française outre-Atlantique proposé par la journaliste Anaïs Digonnet.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey