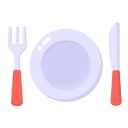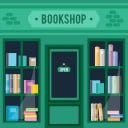🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-19
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, Brownie menstruel, abats contre les carences en fer… L’alimentation, une solution pour briser le cycle vicieux, 31/05/2025
The Grocer, ChatGPT: the next major shift in online grocery shopping, 30/05/2025
Financial Times, Tome sweet tome: London’s best bookshop bars, 27/05/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, La noisette, la petite filière emblème des défenseurs des néonicotinoïdes, 26/05/2025
Face aux restrictions pesant sur les produits phytosanitaires, notamment les néonicotinoïdes interdits depuis 2018, la filière française de la noisette a été mise en avant par les défenseurs de leur réautorisation, notamment dans le cadre de la proposition de loi « PPL Duplomb ». L’acétamipride, insecticide de la même famille, pourrait être réintroduit pour protéger les vergers contre divers ravageurs, illustrant les limites techniques d’une agriculture sans ces substances.
Pourtant, cette microfilière reste marginale : elle représente à peine 7 900 hectares cultivés et environ 350 producteurs, loin des 400 000 hectares de betteraves sucrières, autre culture friande de néonicotinoïdes. L’influence de la noisette dans le débat semble donc disproportionnée, même si son poids symbolique est fort. La coopérative Unicoque, avec Ferrero comme client principal (25 % de son chiffre d’affaires), illustre à quel point cette filière est orientée vers l’industrie agroalimentaire.
Depuis les années 2000, les plantations de noisetiers ont connu un regain, accompagnées d’initiatives techniques pour pallier le manque d’intérêt des fournisseurs phytosanitaires. Le balanin, insecte nuisible à l’amandon, et la punaise diabolique, parasite originaire d’Asie, menacent les récoltes et exigent des stratégies de lutte innovantes. Malgré une dérogation temporaire en 2018, la production est restée instable, en raison aussi d’aléas climatiques comme les gels de printemps en 2021 et 2022.
En 2025, les producteurs ont obtenu une nouvelle dérogation pour trois insecticides dont la deltaméthrine, et un projet de recherche sur cinq ans a été lancé pour développer des alternatives, doté de 7,5 millions d’euros.
Cependant, toute la filière ne plaide pas pour le retour des néonicotinoïdes. Damien Philibert, producteur bio en Isère, défend une approche alternative : il cultive une variété résistante au balanin et lutte contre la punaise à l’aide de phéromones et d’argile calcinée. Sa première récolte bio a atteint 750 kg pour 3 hectares, et il vise une productivité de 1 à 1,5 tonne par hectare. Son parcours incarne la transition possible vers une noisiculture durable, sans insecticides de synthèse.
Libération, Brownie menstruel, abats contre les carences en fer… L’alimentation, une solution pour briser le cycle vicieux, 31/05/2025
Cet article explore un mouvement croissant, porté par des femmes, des nutritionnistes et des influenceuses, qui vise à adapter l’alimentation en fonction des cycles hormonaux féminins. L’objectif : soulager des troubles tels que le syndrome prémenstruel (SPM), le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ou encore l’endométriose, en modifiant le contenu de l’assiette selon les différentes phases du cycle menstruel.
Alexia, une trentenaire, témoigne de la disparition de son SPM après avoir adapté son alimentation en 2023. Une approche confirmée par des recherches, comme celles publiées dans la revue Frontiers en 2023, qui soulignent le rôle central des carences nutritionnelles et des fluctuations hormonales dans ces troubles.
La nutritionniste Anaïs Da Silva, dans son ouvrage Bien manger au fil de son cycle, recommande une « alimentation hormonale » en trois phases : folliculaire, ovulatoire et lutéale. Chaque période requiert un apport spécifique en nutriments. Par exemple, pendant les règles, une alimentation riche en fer (lentilles, abats, viande rouge) est conseillée pour compenser la perte sanguine.
Rebecca Attali, ingénieure en alimentation atteinte du SOPK, raconte comment un changement de régime, notamment la réduction du sucre, a transformé son quotidien après l’échec de plusieurs traitements hormonaux. Elle a ensuite fondé le compte Instagram @spoon_of_becca, qui propose des recettes comme le « brownie menstruel », riche en fer et magnésium. En quelques mois, elle rassemble plus de 70 000 abonnés et contribue à une nouvelle pédagogie alimentaire.
Les témoignages de femmes atteintes d’endométriose abondent dans le même sens. Amaé, diagnostiquée en 2023, a vu ses douleurs disparaître en seulement deux cycles après avoir éliminé gluten et alcool. Bien que ces régimes n’aient pas valeur de traitement, ils soulagent les symptômes. Les professionnelles de santé, comme la diététicienne Laura Compagne ou la médecin Candice Bertheas, insistent toutefois sur la nécessité d’un accompagnement personnalisé pour éviter les dérives restrictives ou orthorexiques.
Cette dynamique, encore peu reconnue par le corps médical traditionnel, offre une voie prometteuse pour améliorer la qualité de vie de nombreuses femmes. Mais elle soulève aussi des enjeux d’accessibilité, de fiabilité des contenus, et appelle à une meilleure intégration de la nutrition hormonale dans les formations de santé.
Libération, Pouvoir d’achat : dans les restaurants, des «menus anticrise» pour rebattre les cartes, 02/06/2025
Dans un contexte d’inflation persistante, de tensions sur le pouvoir d’achat et d’une baisse de fréquentation, de nombreux restaurateurs français lancent des « menus anticrise » à prix cassés pour reconquérir leur clientèle et affronter une conjoncture difficile. L’article explore les stratégies mises en œuvre par le secteur pour rester attractif tout en maintenant une viabilité économique.
À Paris comme en province, des établissements revoient leurs cartes avec des formules déjeuner à moins de 20 €, des menus à thème à prix réduits, ou des plats « malins » conçus à partir de produits de saison, locaux et bon marché. Cette approche permet de réduire les coûts matières tout en mettant en avant la créativité des chefs.
Certains restaurateurs s’appuient sur des filières courtes, d’autres collaborent avec des plateformes comme Too Good To Go ou La Fourchette pour optimiser la rotation et limiter le gaspillage. Le recours à des produits moins nobles mais bien travaillés (abats, légumes oubliés, morceaux secondaires de viande) permet de valoriser des ressources tout en tenant les prix. Le tout dans une logique assumée de gastronomie accessible et durable.
Cette dynamique s’accompagne souvent d’une communication transparente. Le restaurateur devient pédagogue : il explique l’origine des produits, les choix budgétaires et l’importance de soutenir l’économie locale. On assiste à une forme de repolitisation de l’assiette, où manger devient aussi un acte citoyen.
Toutefois, ce modèle reste fragile. Les charges fixes (loyers, salaires, énergie) pèsent lourd. Certains professionnels dénoncent un effet vitrine où seuls les établissements les plus médiatisés peuvent se permettre ces offres attractives. Pour beaucoup, maintenir des prix bas implique des sacrifices sur les marges, la masse salariale ou la qualité. Le risque est alors de tirer toute la profession vers le bas.
Malgré tout, ces initiatives sont perçues comme une bouffée d’air dans un paysage sinistré. Elles témoignent d’une volonté de réinventer le rapport au client, d’instaurer une relation de confiance et de fidélité, et de repenser le modèle économique de la restauration, au-delà des logiques purement gastronomiques.
L’enjeu pour demain : parvenir à concilier accessibilité, rentabilité et exigence culinaire, sans renier l’identité de la cuisine française ni précariser davantage ses artisans.
Les Échos, Comment Lavazza surmonte la flambée des prix sur le marché du café, 03/06/2025
Face à une flambée historique des cours du café, Lavazza a réussi à préserver sa rentabilité en 2024, malgré un contexte économique extrêmement tendu. La hausse vertigineuse des prix du café – due à la combinaison de mauvaises récoltes (au Brésil et au Vietnam), de perturbations logistiques (canal de Suez) et de spéculations – a fait passer les coûts d’achat du groupe de 600 millions d’euros en 2019 à 1,6 milliard en 2024, sans variation de volume.
Pour résister, le groupe a lancé une série de mesures offensives : réduction des stocks (passés de neuf à six mois), optimisation des emballages et de l’énergie, et chasse systématique aux coûts, sans toucher à ses effectifs ni à ses investissements. Cette stratégie a permis à Lavazza d’absorber une surcharge de 600 millions d’euros en 2024. Le résultat : un Ebitda en hausse de 18,6 % (312 millions d’euros), un bénéfice net à +20,6 %, et un chiffre d’affaires en progression de 9 % à 3,35 milliards. Néanmoins, la marge reste inférieure à celle de 2022 (9,3 % contre 11 %).
La hausse des prix s’est inévitablement répercutée sur les consommateurs. En France, le paquet de café moulu Carte Noire est passé de 6 à 9 euros depuis 2023, entraînant une baisse des volumes vendus de 1,8 %, alors que le marché global restait stable. Lavazza a modéré les hausses sur les capsules et le café en grain, plus onéreux, mais n’échappe pas à la montée du phénomène de “trading down”, où les consommateurs se tournent vers des marques moins chères.
Giuseppe Lavazza insiste sur un changement de paradigme : « Pendant 130 ans, la priorité était les volumes ; aujourd’hui, il faut penser valeur. » Il espère que le recul de la demande entraînera à terme un rééquilibrage des cours mondiaux.
Malgré les turbulences, Lavazza reste proactif à l’international. Aux États-Unis, il vise 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ans, dopé par la production locale. En Chine, une coentreprise vise l’ouverture de 1 000 coffee shops d’ici 2028. En France, premier marché européen, le groupe investit dans le hors domicile premium, livrant notamment la moitié des palaces étoilés. Ce segment représente déjà 20 % de son activité française.
Le Monde, Gabriel Lepousez, neurobiologiste : « Pour le vin, notre cerveau va fortement fonder son jugement sur la couleur », 24/05/2025
Dans cet article, le neurobiologiste Gabriel Lepousez, spécialiste de la perception sensorielle, explique comment la vue domine notre expérience de dégustation du vin. Si le rituel du vin valorise tous les sens – observation de la robe, olfaction, goût –, c’est en réalité la couleur perçue qui influence le plus fortement le jugement du dégustateur.
Gabriel Lepousez rappelle que l’être humain, espèce essentiellement diurne, a vu ses capacités visuelles évoluer de manière prédominante. Le cortex visuel mobilise 15 % de l’activité cérébrale contre à peine 1 % pour les stimulations olfactives ou gustatives. Ainsi, notre cerveau hiérarchise les informations sensorielles en donnant la priorité à ce que perçoivent nos yeux.
Cette prééminence visuelle induit des biais cognitifs. Par exemple, des expériences ont montré que colorer un vin blanc en rouge modifie les descripteurs utilisés par les dégustateurs, qui adoptent alors le vocabulaire associé aux rouges. La mémoire associative joue aussi un rôle : le rouge évoque la maturité, la puissance, tandis que des couleurs claires comme le rosé pâle sont perçues comme plus légères.
Gabriel Lepousez dénonce la manière dont ces attentes visuelles orientent le langage du vin, parfois au détriment de la réalité organoleptique. Ainsi, face à un arôme d’orange dans un vin rouge, le cerveau préfère « orange sanguine », terme plus cohérent avec la couleur perçue. Cette distorsion influence aussi les comportements d’achat, notamment pour les rosés, dont les teintes pâles, perçues comme plus fines, sont devenues dominantes sur le marché.
Le scientifique recommande des dégustations en aveugle, voire avec un verre noir ou les yeux fermés, pour redonner sa juste place à l’odorat et au goût. Il évoque également d’autres biais, comme l’effet de l’étiquette, du prix ou des récompenses. Une étude californienne citée montre que le même vin, proposé à 5 ou à 50 dollars, est mieux noté lorsqu’il est plus cher, sans différence réelle de perception sensorielle.
Le Monde, Blanc sur rouge, ainsi vint le blouge, 24/05/2025
L’article s’intéresse à un phénomène émergent dans le monde viticole : le “blouge”, contraction de “blanc” et “rouge”, désignant des vins issus de l’assemblage de cépages blancs et noirs. Bien que cette pratique soit encore marginale dans les appellations contrôlées, elle connaît un regain de popularité dans les vins de France, notamment dans le segment des vins nature.
Apparu récemment dans le vocabulaire œnologique, le terme recouvre une tradition plus ancienne, particulièrement dans le sud de la France. Face aux effets du réchauffement climatique et à la tendance des vins rouges très puissants et tanniques, les vignerons cherchent à répondre à la demande croissante pour des vins plus frais, plus légers et plus accessibles, tant en bouche qu’en prix.
Le “blouge” incarne cette réponse. Il permet d’adoucir les rouges tout en apportant de l’acidité et de la complexité aromatique. Des domaines comme celui de Laballe dans les Landes, qui a assemblé chenin et syrah en parts égales, ou Peybonhomme-les-Tours en Gironde, qui mêle sémillon et cabernet franc, montrent la diversité des approches. Le résultat : des vins conviviaux, souples, à la robe limpide, souvent fruités, destinés à l’apéritif ou à accompagner des plats estivaux.
Le marketing joue également un rôle important : certains vignerons revendiquent l’appellation “blouge” avec humour et légèreté. Cette nouvelle catégorie, à mi-chemin entre le rouge et le blanc, séduit notamment la restauration, toujours en quête de propositions originales, et un public curieux, parfois indécis entre rouge ou blanc.
Chaque domaine développe sa propre méthode de vinification : vendanges simultanées, macérations mixtes, pressurages différenciés… Certains vont jusqu’à revendiquer un “blouge” à base exclusive de raisins noirs, vinifiés de manière originale, comme au domaine Villa Minna dans les Bouches-du-Rhône.
Le “blouge” illustre une évolution des codes et des usages du vin, avec une plus grande liberté de création hors des carcans des appellations traditionnelles. Il répond aussi à une demande croissante pour des vins hybrides, ludiques, faciles à boire, et s’inscrit dans une dynamique plus large de réinvention du vin pour les jeunes consommateurs.
LSA, Marques centenaires du petit déjeuner : Le Gall perpétue l’art du beurre sur les côtes bretonnes, 04/06/2025
Depuis plus d’un siècle, la Maison Le Gall, implantée à Quimper (Finistère), incarne le savoir-faire traditionnel du beurre artisanal breton. Fondée en 1923, cette entreprise familiale a su préserver son identité tout en évoluant avec son temps. Certifiée Entreprise du patrimoine vivant en 2023, elle perpétue une méthode de fabrication fondée sur la maturation naturelle au levain et un barattage lent, processus exigeant et long qui distingue ses produits dans le paysage laitier français.
L’article met en lumière les spécificités techniques de cette méthode artisanale : la crème maturée pendant 15 à 18 heures développe des arômes subtils de noisette, avant d’être barattée délicatement en tonneau, ce qui donne au beurre sa texture souple et homogène. Cette attention portée à chaque étape de la fabrication repose sur l’expertise de maîtres beurriers qui se transmettent leur savoir-faire en interne.
Le Gall se fournit exclusivement en lait auprès de producteurs locaux finistériens, dont 85 exploitations bio, dans le cadre de son appartenance au groupe Sill depuis 1998. L’entreprise décline ses produits en une quarantaine de références – beurres doux, demi-sel, cristaux de sel – disponibles en formats variés, du beurrier carton à la plaquette traditionnelle.
Consciente des nouvelles attentes des consommateurs, la marque mise sur l’innovation dans le respect des traditions. Elle développe notamment des mini-beurriers aromatisés pour séduire les jeunes générations, tout en engageant une transition vers des emballages plus durables. Une nouvelle charte graphique, un papier plus écologique et une plateforme de communication orientée vers la pédagogie autour de ses process sont prévus pour l’automne 2025.
Malgré un marché du petit-déjeuner en mutation – entre nouvelles habitudes, snacking et préoccupations santé – Le Gall conserve une clientèle fidèle grâce à la qualité constante de ses produits. Son positionnement premium, alliant terroir, authenticité et innovation, lui permet aussi de conquérir des marchés à l’export, notamment en Europe, Asie, Moyen-Orient et aux États-Unis.
Avec un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros en 2024 (+7,8 %) et 50 % de ses références certifiées bio, la Maison Le Gall illustre parfaitement comment une entreprise patrimoniale peut évoluer tout en gardant une forte cohérence identitaire.
LSA, Bjorg : comment Ecotone travaille l’image et l’offre de sa marque bio pour cibler les jeunes, 01/06/2025
La marque Bjorg, pilier du groupe Ecotone (anciennement Distriborg), poursuit sa stratégie de relance et de rajeunissement, dans un contexte où la consommation bio évolue. Malgré un marché sous tension, Bjorg affiche une croissance de +2,2 % en 2024 avec 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 25 % du CA du groupe, grâce à une diversification de ses produits et un repositionnement ciblé vers les jeunes adultes.
Depuis sa création à Lyon en 1988, la marque Bjorg a connu plusieurs évolutions, devenant leader sur des segments comme les boissons végétales (59,5 % de parts de marché), les céréales bio du petit-déjeuner (49,2 %) ou encore les biscuits bio (46,1 %). Face à une perte de clientèle senior en 2023 due à l’inflation, la marque concentre désormais ses efforts sur les moins de 35 ans, en adaptant ses produits, ses prix et sa communication.
L’axe stratégique repose sur deux piliers : l’innovation produit et l’engagement environnemental. Sur le plan produit, Bjorg développe de nouvelles boissons végétales aux profils gustatifs attractifs pour les jeunes (avoine-vanille, avoine-amande, barista amande), ainsi que des céréales sans sucre ajouté et des biscuits pour le snacking. La marque mise aussi sur une nutrition fonctionnelle pour répondre à des besoins spécifiques : produits protéinés, céréales crunchy, etc.
Côté environnemental, Ecotone multiplie les actions concrètes : réduction des emballages, bouchons en canne à sucre, affichage du Planet-score, retrait du Nutri-score sur les packagings (tout en le conservant en ligne). La marque affirme ainsi son positionnement militant pour une alimentation bio, végétale, sans pesticides et transparente.
La stratégie de communication s’est aussi adaptée avec la plateforme « Bjorg to be alive », plus émotionnelle et conviviale, diffusée à la télévision en plusieurs vagues, et fortement relayée sur les réseaux sociaux.
Enfin, Bjorg s’ouvre à de nouveaux circuits de distribution, notamment la restauration (10 % du CA Ecotone), les coffee shops (avec une gamme barista), l’e-commerce (13 % du CA européen) et les plateformes comme Amazon et Picnic. Clipper, l’autre marque phare d’Ecotone, est désormais servie dans tous les McDonald’s en France.
Ce renouvellement de Bjorg illustre un repositionnement agile et offensif d’une marque historique du bio face à la transformation des comportements alimentaires et à une concurrence accrue.
Le Monde, La filière du cognac, fragilisée par les taxes américaines et chinoises, s’interroge sur son avenir, 06/06/2025
La filière du cognac traverse une crise majeure sous l’effet combiné de tensions géopolitiques et de retournements de marché. La Chine, principal débouché du spiritueux français, prévoit d’appliquer au 5 juillet des droits de douane définitifs allant de 35 à 39 %, en réponse aux taxes européennes sur les voitures électriques chinoises. Aux États-Unis, les droits de douane de 10 % imposés depuis avril pourraient être renforcés si les négociations commerciales avec l’Union européenne échouent d’ici le 9 juillet. Ces menaces créent une situation d’incertitude sans précédent pour un produit dont 80 % des ventes se concentrent sur ces deux marchés.
Bernard Arnault, dont le groupe détient la marque Hennessy, évoque un « risque majeur » pour l’écosystème du cognac, qui fait vivre environ 80 000 personnes en Charente. Les effets de la crise se font déjà sentir : les rendements ont été revus à la baisse trois années de suite, passant de 14,7 à 7,65 hectolitres d’alcool pur par hectare entre 2022 et 2025. Les maisons de négoce réduisent leurs commandes jusqu’à -45 %, activant les clauses contractuelles prévues en cas de conjoncture défavorable.
Pour faire face à cette baisse de la demande, l’interprofession a mis en place un plan d’adaptation du vignoble, autorisant l’arrachage temporaire de vignes afin de diminuer les coûts de production. Ce redimensionnement progressif du parc viticole vise à maintenir les trésoreries tout en préservant la possibilité de replantation future. La chute du prix des vignes reflète la gravité de la situation : un hectare valorisé jusqu’à 100 000 euros il y a peu peut désormais perdre jusqu’à 50 % de sa valeur sans contrat d’achat associé.
Les grands groupes tentent de redresser la barre par des restructurations internes. LVMH a changé de direction à Moët Hennessy, Rémy Cointreau a suspendu ses objectifs 2029-2030, et Pernod Ricard a renouvelé ses équipes dirigeantes dans la branche cognac. Des plans sociaux sont en cours : 1 200 suppressions de postes chez LVMH, chômage partiel chez Rémy Cointreau, licenciements chez Camus.
La consommation, elle aussi, s’effrite. Aux États-Unis, l’euphorie post-Covid a laissé place à une contraction du marché liée à l’inflation. En Chine, la morosité économique pèse sur la demande. Résultat : les ventes mondiales sont passées de 223 millions de bouteilles en 2021 à seulement 165 millions en 2023. Les ambitions de porter la production à 350 millions de bouteilles d’ici 2035 apparaissent désormais irréalistes.
Selon Florent Morillon, président du Bureau national interprofessionnel du cognac, même dans l’hypothèse optimiste d’un apaisement diplomatique, il faudra deux à trois ans pour que le secteur se stabilise. La baisse structurelle de la consommation apparaît comme un défi durable, exigeant une refondation stratégique profonde de la filière.
Le Monde, Derrière les 100 ans de l’appellation roquefort, la mainmise de l’agro-industrie et une érosion des ventes, 07/06/2025
À l’occasion du centenaire de l’appellation d’origine Roquefort, célébrée les 7 et 8 juin à Roquefort-sur-Soulzon, l’article dresse un tableau contrasté de ce symbole de la gastronomie française. Si le fromage au lait cru de brebis, affiné dans les caves naturelles du Larzac, jouit d’un prestige historique et culturel, la réalité actuelle de sa production est marquée par une industrialisation massive, une concentration économique et une baisse continue des ventes.
Trois grands groupes – Lactalis, Savencia (Papillon) et Sodiaal (La Pastourelle) – contrôlent désormais plus de 95 % de la production. Lactalis, propriétaire de la marque Société, fabrique à lui seul près de 80 % des 14 400 tonnes produites en 2023. Le groupe est omniprésent dans le village de Roquefort : foncier, usine, restaurant d’entreprise, infrastructures sportives… Le maire reconnaît que, hors le cimetière, presque tout appartient à Lactalis.
Les ventes, elles, déclinent régulièrement : de 18 000 tonnes en 2007 à 14 400 en 2023, malgré les tentatives de redynamisation menées par la Confédération générale du roquefort. Face à cette érosion, certaines maisons artisanales, comme celle de Delphine Carles, misent sur le haut de gamme et les procédés traditionnels (Penicillium cultivé sur pain, affinage long). Mais ces initiatives restent minoritaires face à une logique industrielle ciblant les grandes surfaces.
La profession fait également face à une baisse dramatique du nombre d’éleveurs : de 4 000 dans les années 1980 à 1 330 aujourd’hui. Le prix du lait, fixé par les industriels, est régulièrement contesté. Les éleveurs dénoncent une perte d’autonomie dans un système où Lactalis, majoritaire, influence aussi la gouvernance interprofessionnelle. En parallèle, l’orientation de certaines productions vers d’autres fromages (Lou Pérac, feta, bleu des Causses) accentue cette perte d’identité.
Alors que les marques misent sur la modernisation, l’image du roquefort pâtit d’un déséquilibre croissant entre discours patrimonial et logique industrielle. Les tensions géopolitiques actuelles (droits de douane américains et potentiels droits chinois) menacent en outre un secteur dont 28 % des ventes sont réalisées à l’export, notamment vers les États-Unis.
Enfin, malgré la renommée mondiale du fromage, Roquefort-sur-Soulzon perd progressivement ses habitants et son tissu économique local, au profit d’un modèle concentré, tourné vers l’exportation mais fragile face à la volatilité du marché et aux dynamiques de désaffection alimentaire.
The Guardian, AI tool trial could save equivalent of 1.5m meals in food waste, 27/05/2025
Un essai pilote mené au Royaume-Uni montre comment l’intelligence artificielle peut devenir un outil puissant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un programme testé dans des établissements de restauration collective a permis de prévenir le gaspillage de l’équivalent de 1,5 million de repas, grâce à une meilleure gestion des stocks, des portions et des prévisions de consommation.
L’initiative repose sur l’outil IA développé par la start-up Winnow, déjà active dans plusieurs hôtels, cantines scolaires et hôpitaux. Le principe est simple : à l’aide de capteurs et d’une caméra connectée à une IA, les déchets alimentaires sont identifiés, pesés et analysés en temps réel. Cela permet aux cuisiniers de suivre avec précision ce qui est jeté, d’en comprendre les causes et d’adapter les achats et la préparation des repas.
Lors du projet pilote, mené en partenariat avec le gouvernement britannique, plusieurs établissements publics ont vu leurs déchets baisser jusqu’à 40 %. Ce succès s’inscrit dans une politique plus large du Royaume-Uni pour atteindre ses objectifs de réduction du gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030, conformément aux engagements des Nations Unies.
Les économies ne sont pas seulement environnementales : les établissements ont constaté des réductions de coûts significatives, renforçant l’intérêt économique de ces technologies. Le gaspillage évité permet aussi de libérer des ressources alimentaires qui pourraient nourrir des publics précaires.
Cependant, le déploiement généralisé de ces outils soulève certaines préoccupations. Le coût d’installation initial peut être un frein pour les petites structures. Il existe également des inquiétudes sur l’usage et la sécurisation des données, notamment dans les environnements publics.
Pour ses défenseurs, cette technologie permet de conjuguer efficacité logistique, impact écologique et responsabilité sociale. Elle incarne une nouvelle génération de solutions basées sur l’IA, qui s’attaquent à des problèmes concrets et systémiques, tout en favorisant une culture de durabilité dans le secteur alimentaire.
L’article souligne enfin que ce modèle pourrait être reproduit à grande échelle, notamment en Europe et dans les pays industrialisés, où le gaspillage en restauration collective reste un problème majeur, peu visibilisé mais aux conséquences lourdes.
The Guardian, From matcha lattes to Dubai chocolate – how supermarkets fight to cope with TikTok trends, 24/05/2025
L’article explore comment les tendances virales sur TikTok bouleversent la chaîne d’approvisionnement des supermarchés britanniques, contraints de s’adapter à une demande aussi soudaine qu’imprévisible. Des produits comme les matcha lattes, les “protein yoghurts” ou encore les fameuses tablettes de chocolat de Dubaï connaissent des pics de popularité fulgurants dès qu’ils deviennent viraux sur la plateforme.
Les chaînes de grande distribution anglaises comme Tesco, Asda ou Sainsbury’s doivent désormais intégrer dans leur veille commerciale et marketing les signaux faibles des réseaux sociaux. Des équipes sont spécifiquement chargées de surveiller TikTok afin de repérer rapidement les produits tendance et ajuster les commandes en conséquence. Ce phénomène, surnommé le « TikTok effect », peut provoquer des ruptures de stock en quelques jours, voire en quelques heures.
L’exemple des tablettes “Dubai chocolate” illustre bien cette mutation : ces confiseries importées, popularisées par des influenceurs britanniques, ont déclenché une frénésie d’achat inattendue, poussant les enseignes à sécuriser de nouveaux canaux d’approvisionnement à la hâte. Même constat avec le “feta pasta” ou les boissons à base de matcha, qui enregistrent des pics de ventes dès qu’une vidéo virale les met en avant.
Les marques indépendantes et les producteurs artisanaux, souvent mis en lumière par ces vidéos, peuvent ainsi connaître une explosion de visibilité sans pouvoir toujours suivre la cadence de production, ce qui crée des tensions logistiques mais aussi des opportunités commerciales inédites. En réponse, certains distributeurs lancent leurs propres produits “TikTok ready”, adaptés visuellement et gustativement aux standards du réseau social.
Cette transformation soulève aussi des défis : la volatilité des tendances complique la planification et génère du gaspillage potentiel si la hype retombe trop vite. De plus, elle bouleverse les logiques classiques du marketing alimentaire, où la demande est aujourd’hui dictée par des algorithmes plus que par les campagnes publicitaires traditionnelles.
Les enseignes se trouvent face à une équation inédite : comment réagir vite sans perdre en qualité ni en marge, tout en construisant une relation de confiance avec des consommateurs volatiles mais ultra-connectés ? L’article montre que les géants de la distribution n’ont plus le choix : TikTok est devenu un acteur incontournable de l’alimentation moderne.
The Grocer, ChatGPT: the next major shift in online grocery shopping, 30/05/2025
L’intégration récente de fonctionnalités d’achat dans ChatGPT pourrait bien transformer en profondeur les habitudes de consommation en ligne. Le chatbot d’OpenAI propose désormais, en plus de réponses classiques, des recommandations de produits alimentaires et des liens directs vers des enseignes partenaires, le tout via une interface conversationnelle. Un utilisateur demandant « un dîner sain pour moins de 5 £ » obtient une recette, les ingrédients associés, et peut les acheter immédiatement en ligne grâce à un bouton « Acheter ».
Avec plus de 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires, l’impact potentiel est massif. Selon Nina Goli (Modern Citizens), cette évolution « explose l’entonnoir d’achat traditionnel » en rendant l’expérience plus rapide, intuitive et directe. Contrairement à un moteur de recherche où l’on compare entre plusieurs onglets, ChatGPT délivre une réponse structurée et prête à l’achat.
Pour les marques, l’enjeu devient d’exister dans les réponses de l’IA, via une nouvelle stratégie baptisée LLM-EO (Large Language Model Engine Optimisation). Celle-ci consiste à formuler les fiches produits de manière naturelle et informative, adaptée à un langage oral. Des descriptions génériques comme « bon et pratique » risquent de ne pas être sélectionnées, tandis qu’un produit décrit comme « riche en protéines, prêt en 90 secondes, idéal pour les parents » a plus de chances d’être recommandé par l’IA.
Cette évolution modifie aussi le rôle des sites web : ils deviennent non plus des vitrines, mais des bases de données alimentant l’IA. Il ne s’agit plus de séduire uniquement les visiteurs humains, mais aussi les algorithmes. Les marques ne peuvent pas acheter leur place dans les réponses : OpenAI précise que les recommandations ne sont pas sponsorisées.
OpenAI travaille cependant à intégrer des flux produits fournis directement par les distributeurs, afin d’actualiser les informations et d’élargir les références. Ce changement intervient alors que, selon Adobe Analytics, le trafic en provenance d’IA vers les sites e-commerce britanniques a bondi de 500 % en six mois.
Pour Chris Camacho (Cheil UK), il s’agit d’une mutation profonde : « C’est la plus grande transformation des comportements d’achat depuis le smartphone. »
LA Times, Japan’s rice crisis: Prices soar, supplies dwindle and a minister resigns, 22/05/2025
Le Japon traverse une crise majeure du riz, son aliment de base et un pilier culturel. Depuis l’été 2024, les prix ont doublé, atteignant jusqu’à 35 $ pour 5 kg, tandis que les stocks chutent. Cette situation a conduit à la démission du ministre de l’Agriculture, Taku Eto, après des propos perçus comme déconnectés du quotidien des Japonais. Il a affirmé n’avoir jamais eu besoin d’acheter de riz, car ses soutiens lui en offrent. En pleine inflation, cette déclaration a provoqué un tollé.
Le nouveau ministre, Shinjiro Koizumi, est chargé de rétablir la situation, alors que la pénurie s’aggrave. À l’origine de cette crise : des politiques agricoles de longue date incitant à réduire les surfaces de culture de riz pour maintenir des prix élevés, combinées à une mauvaise récolte 2023 (chaleur et ravageurs), une hausse de la consommation liée à l’inflation du blé, et une forte reprise du tourisme et de la restauration.
La chaîne d’approvisionnement est également en cause : le système coopératif traditionnel (JA) cohabite avec des canaux alternatifs (vente en ligne, distributeurs privés), rendant les flux de riz moins lisibles. Le gouvernement a libéré des stocks d’urgence, mais seuls 10 % ont atteint les supermarchés, accentuant la colère des consommateurs.
Les capacités de transformation (du riz brun en riz blanc) seraient insuffisantes, et certains accusent les grossistes de spéculation. Les mesures gouvernementales sont jugées trop lentes et peu efficaces. L’économiste Kazuhito Yamashita critique une politique de réduction des surfaces cultivées contraire à la sécurité alimentaire, qui profiterait avant tout aux intérêts de JA.
Face à la pénurie, les grandes enseignes s’adaptent. Aeon va commercialiser pour la première fois du riz Japonica cultivé aux États-Unis (Calrose) en sachets de 4 kg à 20 $, dans 600 magasins. L’objectif est d’éviter un désintérêt des consommateurs pour le riz, ce qui pourrait durablement affaiblir la filière.
Cette crise révèle enfin une fragilité structurelle : la population agricole vieillit (69 ans de moyenne) et a chuté de moitié en 20 ans. Le Japon devra repenser sa stratégie agricole s’il veut garantir l’accès à son aliment emblématique.
Financial Times, Tome sweet tome: London’s best bookshop bars, 27/05/2025
À Londres, les librairies traditionnelles se transforment en véritables lieux de vie en intégrant cafés, bars à vin, ateliers d’écriture ou soirées de rencontres. L’article met en lumière cette nouvelle tendance où l’expérience sociale et culturelle autour du livre devient centrale, portée par une génération avide de lien, d’authenticité et de littérature populaire.
Des établissements comme BookBar à Highbury, Backstory à Balham, Bàrd Books à Bow ou Morocco Bound à Bermondsey illustrent cette mutation. Ces lieux hybrides mêlent librairie, bar, café et espace événementiel, avec des programmations incluant des clubs de lecture, des concerts, des open mics et même des soirées speed-dating littéraires.
La force de ce modèle réside dans sa capacité à capter les publics jeunes, influencés par BookTok (la communauté littéraire sur TikTok), qui redonne envie de lire et de fréquenter les librairies physiques. Les chiffres sont éloquents : près de 50 % des jeunes Britanniques de 16 à 25 ans déclarent avoir acheté un livre repéré sur BookTok, et beaucoup privilégient l’achat en magasin plutôt qu’en ligne.
Chaque lieu développe son identité :
BookBar, fondée en 2021, met l’accent sur la littérature contemporaine, les vins naturels et les événements intimes.
Backstory, imaginée par un ancien journaliste, propose un bar central animé, une programmation engagée, et attire les trentenaires avec des titres tendance.
Bàrd Books se veut un « third place » pour la communauté locale, alliant café, bar à cocktails, littérature indie et poésie.
Morocco Bound, avec sa sélection de titres internationaux et sa cave à bières artisanales, fait office de QG créatif pour les jeunes auteurs et musiciens.
Ces librairies nouvelles générations offrent aussi des abonnements littéraires personnalisés, des conseils de lecture en live, et des sélections pointues. Elles s’inscrivent dans un double mouvement : retour au local et résistance à la standardisation numérique. Leur succès repose sur une proposition rare : mêler lecture, sociabilité, gastronomie et culture dans un même espace chaleureux.
À l’heure de l’hyperconnexion, ces librairies-bar incarnent un refuge pour les lecteurs urbains, et un modèle économique innovant qui redonne vie aux quartiers tout en soutenant la scène éditoriale indépendante.
Wall Street Journal, Soaring Costs Expose a Trans-Atlantic Chocolate Divide, 30/05/2025
L’article met en lumière la fracture croissante entre l’Europe et les États-Unis face à l’explosion des prix du chocolat, conséquence directe de la hausse du coût du cacao sur les marchés mondiaux. Cette situation révèle des différences culturelles, économiques et industrielles profondes entre les deux continents dans la manière de concevoir, produire et consommer le chocolat.
Le prix du cacao a atteint des niveaux record en 2025, en raison de mauvaises récoltes en Afrique de l’Ouest (notamment en Côte d’Ivoire et au Ghana) et d’une spéculation accrue. Les industriels doivent faire des choix : réduire les volumes, augmenter les prix, reformuler les recettes ou rogner sur la qualité.
En Europe, où le chocolat est considéré comme un produit gastronomique et identitaire, les marques privilégient la qualité et la transparence. Des acteurs comme Lindt, Valrhona ou Bonnat préfèrent assumer une hausse tarifaire plutôt que de compromettre leurs standards. Ils communiquent sur la provenance du cacao, le pourcentage, le terroir et l’éthique. Les consommateurs européens, bien que sensibles au prix, acceptent encore de payer plus cher pour un produit premium ou artisanal.
À l’inverse, aux États-Unis, le marché est dominé par des géants comme Hershey ou Mars, dont les produits sont souvent plus sucrés, moins concentrés en cacao, et destinés à une consommation de masse. Pour maintenir leurs marges dans un contexte inflationniste, ces marques choisissent parfois d’utiliser des substituts, comme les huiles végétales ou le beurre de cacao partiel, voire réduisent la taille des portions (shrinkflation). Les reformulations sont souvent invisibles pour le consommateur moyen, mais dénoncées par certains analystes et défenseurs de la qualité.
L’article souligne aussi le rôle croissant des distributeurs (notamment aux États-Unis), qui imposent des pressions sur les fournisseurs pour contenir les prix. Les marques doivent alors arbitrer entre qualité, volume et compétitivité. Cette logique creuse une ligne de fracture entre un chocolat perçu comme un produit culturel et artisanal en Europe, et un produit industriel, standardisé et commodifié aux États-Unis.
Face à cette tension, certains chocolatiers américains indépendants tentent de se rapprocher du modèle européen. Mais ils restent confrontés à une culture de la consommation différente et à un public encore peu habitué aux critères de qualité “bean-to-bar”. La crise actuelle pourrait bien redéfinir les contours du marché mondial du chocolat pour les années à venir.
Financial Times, Robert F Kennedy Jr’s battle with Big Food, 26/05/2025
Depuis sa nomination au poste de secrétaire à la santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr, figure controversée et ancien avocat environnemental, mène une offensive spectaculaire contre l’industrie agroalimentaire américaine. Son objectif : réformer en profondeur les pratiques alimentaires responsables, selon lui, de l’explosion des maladies chroniques (obésité, diabète de type 2, troubles de l’attention).
Convaincu que les géants de l’agroalimentaire « font de l’argent en maintenant les Américains malades », Kennedy a lancé une série d’initiatives à travers la commission Make America Healthy Again. Son plan comprend l’interdiction progressive des colorants alimentaires synthétiques (comme le Red 3), la suppression du sucre ajouté des recommandations nutritionnelles, et la réforme du système d’autorisation des ingrédients.
Son approche, radicale, suscite l’enthousiasme d’une partie des experts en santé publique. Marion Nestle, éminente spécialiste en nutrition, salue son courage sur les enjeux de maladies chroniques, tout en regrettant ses positions anti-scientifiques passées sur les vaccins. La tension est palpable entre sa posture populiste anti-système et la rigueur attendue d’un haut fonctionnaire.
L’article montre aussi comment Kennedy mobilise des figures influentes des réseaux sociaux, comme la blogueuse Food Babe ou l’ancienne médecin Casey Means, pour appuyer ses positions. Le mouvement « Maha » (Make America Healthy Again) s’impose comme une force politique hybride, mêlant bien-être, critique du Big Pharma et nationalisme alimentaire.
L’industrie agroalimentaire, d’abord silencieuse, organise désormais la riposte. Les entreprises comme PepsiCo commencent à retirer certains additifs (colorants) de leurs produits, mais s’inquiètent de la volonté de restreindre l’usage des aides alimentaires (programme SNAP) à l’achat de produits jugés sains. Plusieurs États conservateurs soutiennent désormais ces restrictions, illustrant un glissement idéologique inédit, où des réformes autrefois portées par la gauche sont aujourd’hui défendues dans les États républicains.
Kennedy affirme que son objectif est un changement structurel, et que son administration ne négociera pas avec les lobbys. D’ici 2026, il promet une interdiction totale des colorants artificiels. Cette croisade soulève une question centrale : la santé publique peut-elle être réformée par une alliance entre médecine alternative, activisme digital et populisme politique ?
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey