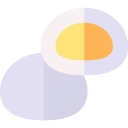🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-18
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Agriculture : après le sévère coup de rabot, la filière bio sonne le tocsin, 21/05/2025
Les Échos, Algorithme, recettes : comment HelloFresh tire son épingle du jeu en France, 23/05/2025
The Guardian, Climate crisis threatens the banana, the world’s most popular fruit, research shows, 12/05/2025
Eat’s Business fait le pont la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines!
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
L’Usine Nouvelle, Agromousquetaires veut se séparer de huit usines, 1200 salariés concernés, 22/05/2025
L’annonce faite par Agromousquetaires, le pôle industriel du groupement Les Mousquetaires (Intermarché), révèle une stratégie de restructuration industrielle d’ampleur. Alors que le groupe avait annoncé au sommet Choose France un investissement de 250 millions d’euros pour moderniser ses sites, il s’apprête parallèlement à céder 8 de ses 55 usines françaises. Cette décision, qui a été présentée aux instances représentatives du personnel le 23 mai, concernera 1200 salariés, soit plus de 10 % des effectifs.
Les usines concernées sont principalement dédiées à des produits dits transformés, en particulier dans le pôle mer, en difficulté depuis plusieurs années. Il s’agit notamment des sites Capitaine Houat à Boulogne-sur-Mer et Lanester, ainsi que de l’usine Capitaine Cook à Clohars-Carnoët spécialisée dans le surimi. D’autres unités sont également visées : l’usine de riz et d’épices Antartic II à Charmes-sur-Rhône, celle de jus de fruits Vertumnus (Oise), le site de pain de mie à Joué-les-Tours, et deux sites de production de fleurs coupées à Rezé et Ponts-de-Cé.
Cette annonce fait suite à une première cession en 2024, celle de l’usine Sveltic à What’s Cooking, un groupe belge. En deux ans, Agromousquetaires réduira donc son réseau industriel de 56 à 47 sites, marquant une inflexion stratégique majeure.
Cette réorganisation illustre la volonté du groupe de recentrer ses activités sur des produits bruts et plus rentables, au détriment de certains segments jugés moins stratégiques ou trop coûteux. Elle intervient dans un contexte d’ambition forte : Agromousquetaires vise un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros à horizon 2029, contre un peu plus de 4 milliards actuellement. Mais cette montée en gamme industrielle se fait au prix d’un impact social conséquent, avec des territoires et des salariés concernés par des fermetures d’usines qui restent, à ce stade, sans repreneur identifié.
L’Usine Nouvelle, Le géant français de la volaille LDC, en route vers les 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, confirme sa stratégie, 21/05/2025
Le groupe LDC, acteur majeur de la volaille en France et maison-mère de marques comme Loué et Marie, a publié ses résultats financiers 2024/2025 en affichant un chiffre d’affaires en légère hausse, à 6,3 milliards d’euros, et confirme son objectif d’atteindre 7 milliards dès l’exercice suivant, avec un an d’avance sur le calendrier initial.
Cette ambition repose sur une dynamique de croissance externe soutenue : LDC a mené six acquisitions en 2024, dont une en Pologne (acteur de la dinde, 200 M€ de CA) et une en Allemagne dans le segment des plats préparés (77 M€). Ces rachats, partiellement consolidés sur l’exercice, devraient rapporter 300 millions supplémentaires. Par ailleurs, l’entreprise attend la finalisation imminente du rachat de Pierre Martinet, ce qui renforcerait sa présence au rayon traiteur et ajouterait 200 M€ de chiffre d’affaires.
LDC doit néanmoins faire face à une rentabilité en baisse. L’EBITDA chute à 510 M€, la marge opérationnelle passant de 6 % à 5 %, conséquence des efforts tarifaires consentis pour rester compétitif. La croissance organique est à la peine (-1,6 % à périmètre constant), en raison d’une baisse de l’activité volaille en France (-1,9 %). Pour y remédier, LDC mise sur une hausse des prix en 2025 (6 à 8 % sur la volaille), justifiée par des besoins d’investissements importants dans la filière (400 nouveaux poulaillers, 3 millions de poules pondeuses).
Le groupe affirme également son attachement au développement international : près d’un milliard d’euros de revenus sont désormais réalisés hors de France, avec une croissance à deux chiffres tirée par la Pologne. Cette diversification géographique s’inscrit dans une stratégie de sécurisation des marchés et d’adaptation aux évolutions de la consommation.
LSA, Reportage : les secrets de fabrication de Carambar, 21/05/2025
Le célèbre Carambar, bonbon emblématique du patrimoine sucré français, est désormais produit à Bondues (Nord), depuis la fermeture de l’usine historique de Marcq-en-Barœul en 2021. Dans ce reportage, LSA dévoile les coulisses de sa fabrication, qui repose toujours sur une recette presque inchangée depuis 1954, enrichie récemment d’innovations techniques et d’un souci accru de naturalité.
Le processus débute par la fabrication du caramel à base de lait, sucre, glucose, eau, cacao et gomme d’acacia – cette dernière remplaçant peu à peu la gélatine animale. La cuisson, cruciale pour développer le goût typique, précède un refroidissement rapide de la pâte (120°C à 40°C) sur cylindre réfrigérant.
La pâte est ensuite roulée et calibrée pour former des boudins de 7 cm, avant d’être enveloppée dans un papier ciré imprimé de blagues – une tradition née en 1969. L’emballage est une opération délicate qui doit coller sans être impossible à ouvrir. Chaque année, 82 000 km de Carambar sont produits.
Les différentes saveurs (25 au total) sont fabriquées séparément puis assemblées dans les bons ratios avant mise en sachet. L’usine a produit près de 5 000 tonnes en 2024, bien loin des 10 000 tonnes annuelles d’il y a quinze ans. Le groupe Carambar & Co, qui réalise 450 M€ de CA, souhaite relancer la marque avec des ambitions à l’international.
Carambar joue aussi la carte de l’engagement citoyen. Les emballages incluent désormais des messages de prévention réalisés avec les sapeurs-pompiers de France, dans le cadre de l’opération Carahéros. Le bonbon se veut porteur d’un héritage mais aussi d’un renouveau, entre tradition, innovation et responsabilité.
Les Échos, Algorithme, recettes : comment HelloFresh tire son épingle du jeu en France, 23/05/2025
Alors que le groupe HelloFresh a vu sa croissance ralentir sur de nombreux marchés mondiaux après la pandémie, la filiale française affiche une dynamique inverse. Pour ses cinq ans d’existence en France, l’entreprise se félicite d’avoir livré 160 millions de repas et d’avoir vendu 5,4 millions de box en 2024, en hausse de 45 % par rapport à 2023.
Avec un positionnement à 3,75 € la portion, HelloFresh France a su conquérir 60 % de part de marché face à des concurrents comme Quitoque (7,74 €) et Les Commis (4,69 €). L’entreprise mise sur l’innovation produit (de 15 recettes hebdomadaires à 42 en cinq ans) et sur la logistique, avec un centre de distribution à Lisses (Essonne) de 23 000 m². Chaque semaine, 330 000 oignons y transitent, et les viandes utilisées sont 100 % françaises.
La personnalisation est au cœur de la stratégie. Les utilisateurs peuvent doubler les protéines ou remplacer certains ingrédients. À terme, tous les éléments d’une recette pourraient être substituables, favorisant les régimes végétariens ou végans. Pour optimiser l’expérience, un algorithme propose les recettes en fonction des préférences de chaque utilisateur.
Le développement de services annexes est également en cours : un « Marché HelloFresh » permet d’acheter les produits phares des recettes, et un système de click & collect est en phase de test. Le « Next Day Delivery » est envisagé pour répondre à des besoins de dernière minute.
HelloFresh s’appuie sur une équipe de plus de 1 000 salariés et cible désormais d’autres segments, comme les jeunes retraités et les couples actifs. L’entreprise parie sur la fidélisation grâce à une offre différenciante et à une couverture nationale efficace, dans un secteur où la qualité logistique fait la différence.
Les Échos, Agriculture : après le sévère coup de rabot, la filière bio sonne le tocsin, 21/05/2025
L’Agence Bio, bras armé du développement de l’agriculture biologique en France, subira une coupe budgétaire drastique de 15 millions d’euros en 2025. Cette décision intervient paradoxalement en pleine célébration des 40 ans du label AB et du lancement de la campagne « C’est bio la France ».
La suppression des 5 M€ alloués à la communication et la réduction du fonds Avenir bio de 18 M€ à 8,6 M€ sont perçues comme un « sabotage » par les représentants du secteur. Pour Jean Verdier, président de l’Agence Bio, cette coupe de 52 % constitue un « coup d’arrêt à 15 ans d’investissement structurant ».
Le gouvernement justifie cette décision par la fin du plan de relance et la nécessité de prioriser les crédits. Mais les professionnels dénoncent un signal contradictoire avec les objectifs affichés (18 % de SAU en bio d’ici 2027) et une inaction sur la réaffectation des aides européennes non utilisées.
La Fnab dénonce l’inaction de la ministre Annie Genevard et pointe une incohérence : 30 M€ ont été débloqués pour la filière noisette (350 fermes), quand le bio représente 60 000 exploitations. L’abandon du soutien au bio est perçu comme une rupture grave dans la politique agricole.
Le secteur craint un effondrement de la dynamique engagée depuis 15 ans. En 2022, la Cour des comptes recommandait de tripler le budget de l’Agence Bio. Aujourd’hui, c’est sa survie qui est en jeu. Ce désengagement intervient dans un contexte de baisse des conversions et de consommation de produits bio, et renforce le sentiment d’un « recul historique ».
Les Échos, Grande distribution : pourquoi la proximité est un marché « structurellement porteur », 21/05/2025
Alors que les hypermarchés peinent à attirer les consommateurs, le commerce de proximité tire son épingle du jeu avec une croissance de +2,6 % sur un an. Ce segment représente 54 milliards d’euros, dominé encore par les commerces traditionnels (50 %) et les indépendants (15 %), mais les grandes enseignes progressent rapidement.
Carrefour exploite déjà plus de 4 000 magasins de proximité (City, Contact, Montagne) et en ouvre 150 par an. Le nouveau Casino prévoit plusieurs centaines d’ouvertures, dont 170 nouveaux Franprix d’ici 2029. Intermarché Express vise un doublement de son parc.
La proximité répond à des évolutions sociétales majeures : télétravail, ménages plus petits, mobilité réduite, vieillissement de la population. Si les prix y sont 15 à 20 % plus élevés qu’en hypermarché, ces commerces apportent une réponse adaptée à des besoins fragmentés et réguliers.
Le potentiel reste fort, surtout en zones périurbaines où ces magasins ne représentent que 6 % des sorties de caisse, contre 24,6 % en urbain. La clé du succès réside dans une offre ajustée à la clientèle locale, dans un espace réduit. L’agilité, la diversité et la rapidité d’exécution sont donc essentielles.
Les Échos, Alimentation : les distributeurs accusés de promouvoir la malbouffe, 21/05/2025
Une enquête menée par sept associations de consommateurs, dont Foodwatch France et la Fédération française des diabétiques, alerte sur la surreprésentation de produits malsains dans les promotions alimentaires des grandes surfaces. L’analyse de 5 000 offres promotionnelles proposées par Carrefour, Leclerc, Lidl, Intermarché et Système U entre février et mars 2025 révèle que 66 % des promotions concernent des produits trop gras, sucrés ou salés.
Les associations dénoncent une contradiction entre les engagements affichés par les enseignes en faveur du « bien manger » et leurs pratiques promotionnelles. Seuls 12 % des produits promus sont considérés comme sains selon les critères du Programme national nutrition santé (PNNS). Les fruits, légumes et légumineuses sont largement sous-représentés, alors qu’ils sont pourtant insuffisamment consommés par les Français.
L’étude pointe également le risque de surconsommation lié aux promotions incitant à acheter en grande quantité, notamment sur des produits à limiter comme la charcuterie, les plats préparés à base de viande rouge et les boissons sucrées. 40 % des promotions visent ces produits à forte densité calorique.
Un autre constat préoccupant réside dans le décalage entre l’offre promotionnelle et les attentes des consommateurs : selon un sondage réalisé en mars, 88 % des Français souhaitent voir les enseignes mettre en avant des produits sains à prix abordables. Ce déséquilibre alimente ce que Foodwatch appelle un « marché à deux vitesses », où les produits ultra-transformés sont bradés tandis que les produits de qualité restent chers.
Les associations appellent à un changement de cap clair : elles exigent que 50 % des promotions soient consacrées à des produits sains et accessibles. L’objectif est de favoriser une alimentation équilibrée pour tous, notamment dans un contexte où l’inflation alimentaire pèse lourdement sur les foyers modestes.
Ce rapport ravive le débat sur la responsabilité des distributeurs dans les choix alimentaires des consommateurs et interroge leur rôle dans la transition nutritionnelle. Il relance également la discussion sur un encadrement réglementaire des promotions, à l’image de ce qui est déjà en place pour le Nutri-Score ou les encadrements sur la publicité infantile.
Libération, «A Tavola», une enquête culinaire pour savoir de quoi demain sera frais, 23/05/2025
La metteuse en scène Floriane Facchini lance « A Tavola », un projet pluridisciplinaire mêlant art, science et écologie autour de l’alimentation de demain. Cette démarche, initiée dans le cadre du festival Confit en Provence, mobilise chercheurs, agriculteurs, artistes et élus pour réfléchir collectivement aux enjeux alimentaires du futur dans les territoires du Lubéron et des Alpilles, particulièrement touchés par le changement climatique.
« A Tavola » s’appuie sur des « narrations culinaires », des mises en scène sensibles à travers la nourriture pour aborder des sujets complexes tels que la biodiversité, la pollution ou les transformations agricoles. Par exemple, un cocktail à base de plantes locales comme l’ortie ou le coquelicot devient le point de départ d’une discussion sur la Durance et ses enjeux environnementaux.
L’objectif est de construire une réflexion collective et située, ancrée dans les réalités locales, à l’inverse des modèles agro-industriels déconnectés des écosystèmes. Le projet s’inscrit dans le programme national Erable et la stratégie biodiversité 2030. Il prendra la forme d’une recherche-action sur deux ans, ponctuée de moments publics (banquets, performances), et culminera en 2027 par un grand banquet conçu avec la cheffe étoilée Nadia Sammut.
Floriane Facchini défend une posture de « redirection écologique », alternative au discours technocratique sur la transition. Ce concept admet que l’avenir ne viendra pas d’une adaptation marginale du système agroalimentaire dominant, mais d’un changement profond de nos modes de vie. La ligne est fine entre radicalité et pragmatisme : ni utopie hors-sol, ni conservatisme.
L’art devient ici un levier de transformation sociale. En impliquant les citoyens dans des expériences sensorielles et conviviales, « A Tavola » cherche à créer de nouveaux récits et usages, à reconnecter les mangeurs à leur territoire. C’est aussi une démarche participative, où les problématiques agricoles sont élaborées avec les acteurs concernés.
L’Informé, Foodtech : en difficultés financières, Swap (ex-Umiami) change de patron, 23/05/2025
La start-up Swap, anciennement Umiami, spécialiste de la viande végétale, traverse une passe difficile. Lauréate du programme French Tech 120 et forte de plus de 100 millions d’euros levés, elle fait face à des retards de production et de commercialisation qui ont miné ses résultats. Son chiffre d’affaires en 2024 plafonne à 1 million d’euros, malgré l’acquisition d’une usine de 14 000 m² en Alsace.
Le cœur du problème réside dans les surcoûts liés aux tests de production, aux taux de déchets élevés, et à une montée en cadence plus lente que prévu. Swap peine également à conclure des contrats de vente à grande échelle. Si les retours sur produits sont jugés positifs, les cycles de vente longs et l’adoption tardive du marché ont dégradé les prévisions de croissance.
Face à cette situation, des changements de gouvernance sont intervenus. Le cofondateur Tristan Maurel quitte son poste de CEO pour devenir président du conseil d’administration et responsable du développement en Amérique du Nord. Hervé Salomon, ex-dirigeant de Mondelez et Kraft Foods, prend les rênes opérationnelles.
Swap doit trouver environ 9 millions d’euros pour finir l’année 2025, et près de 30 millions pour tenir jusqu’en 2026. Elle tente de renégocier ses dettes et de différer leurs échéances afin de préserver ses fonds propres. Une levée de fonds série B est envisagée, mais risquerait de diluer fortement les actionnaires actuels.
Dans l’immédiat, l’entreprise poursuit son expansion commerciale. En avril 2025, elle a lancé un filet de poulet végétal en partenariat avec la société espagnole Heure, distribué dans 2 000 magasins en France, Espagne et Portugal.
The Guardian, It’s time to stop the great food heist powered by big business. That means taxation, regulation and healthy school meals, 21/05/2025
Une tribune qui dénonce la mainmise de quelques grandes entreprises sur le système alimentaire mondial, qui est qualifié de « casse organisé ». Initialement conçu pour éviter les famines, le système actuel est désormais accusé de générer des profits colossaux au détriment de la santé publique et de la planète. Il serait responsable d’un quart des décès adultes dans le monde, liés à des régimes alimentaires déséquilibrés.
Les aliments ultra-transformés, particulièrement ciblés, sont associés à l’explosion de l’obésité, du diabète et des maladies chroniques. Cette évolution touche tous les continents, y compris l’Afrique, où les produits industriels remplacent progressivement les cultures vivrières. La tribune pointe également l’impact environnemental massif de cette industrie, responsable d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre.
Face à ce constat alarmant, l’auteur plaide pour une réforme radicale du système alimentaire, en trois axes : des achats publics favorisant des aliments sains (comme les repas scolaires nutritifs au Kenya ou au Brésil), une réglementation stricte de la publicité et de l’étiquetage, et une fiscalité adaptée (taxes sur les produits sucrés et ultra-transformés, subventions pour les produits sains).
Des exemples existent : le Chili a instauré une réglementation pionnière en matière de marketing alimentaire, incluant des taxes et des interdictions de mascottes publicitaires. Résultat : en trois ans, l’exposition des enfants à la publicité a chuté de 73 % et la consommation de produits concernés a diminué d’un tiers.
Plus de 120 pays ont adopté des taxes sur les boissons sucrées, avec des résultats probants, notamment au Mexique. Le succès de ces politiques dépend toutefois d’un engagement politique fort, capable de résister au lobbying des industriels.
The Guardian, Should phone-obsessed diners be forced to stop scrolling? Not if restaurants want to stay open, 18/05/2025
Dans cet article d’opinion, la journaliste réagit aux propos du chef étoilé Giorgio Locatelli, qui déplore l’usage excessif des téléphones en salle. Pour lui, les clients passent plus de temps à prendre des photos ou à faire défiler leurs réseaux sociaux qu’à savourer l’instant présent ou à discuter entre eux. L’article prend le contre-pied : selon l’autrice, le téléphone est devenu un prolongement naturel de notre vie sociale, et interdire son usage reviendrait à se couper de la réalité contemporaine.
L’autrice insiste sur le fait que la restauration est un secteur fragile, qui dépend en partie de la visibilité offerte par les clients eux-mêmes. Les photos de plats partagées sur Instagram ou TikTok sont aujourd’hui un levier de marketing gratuit et puissant. Le dressage raffiné, la présentation millimétrée des plats – souvent avec des pinces ou des pinceaux – sont justement pensés pour séduire l’œil… et l’objectif.
L’autrice interroge aussi l’idée selon laquelle la conversation serait forcément plus noble que l’usage d’un écran. Elle plaide pour une vision moins normative du comportement à table : certaines personnes trouvent dans le téléphone une échappatoire ou un moyen de rester connectées avec leurs proches.
New York Times, American Breakfast Cereals Are Becoming Less Healthy, Study Finds, 21/05/2025
Une étude publiée récemment alerte sur la détérioration progressive de la qualité nutritionnelle des céréales pour petit-déjeuner aux États-Unis entre 2010 et 2023. Sur 1 200 produits analysés, la teneur en sucre, sel et graisses a nettement augmenté, tandis que les niveaux de protéines et de fibres ont diminué. Un paradoxe étonnant à l’heure où les consommateurs sont plus attentifs à leur santé.
Les céréales, particulièrement prisées des enfants âgés de 5 à 12 ans, sont devenues au fil du temps des aliments ultra-transformés, malgré les allégations de santé affichées sur les emballages. Selon les chercheurs, ces « reformulations » servent davantage à séduire les acheteurs qu’à améliorer l’apport nutritionnel réel.
La critique rejoint le discours du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui a récemment intensifié sa campagne contre les additifs alimentaires et les produits ultra-transformés. Son mot d’ordre : « le sucre est un poison ». Il milite pour une réforme réglementaire, à commencer par l’interdiction de certains colorants dans les produits destinés aux enfants.
Les marques concernées – Kellogg’s, General Mills ou Post – n’ont pas répondu à l’enquête. Mais plusieurs experts soulignent le décalage entre l’image « saine » véhiculée par les publicités et la réalité nutritionnelle des produits vendus. Peter Lurie, de l’association Center for Science in the Public Interest, qualifie la situation d’« extraordinaire », tant les grands industriels semblent peu enclins à corriger le tir.
L’étude souligne également une inégalité criante : alors que les versions canadiennes ou européennes des mêmes céréales sont parfois moins sucrées ou salées, les consommateurs américains – et surtout les enfants – restent exposés à des produits de moindre qualité. Des standards plus stricts sont pourtant appliqués aux repas scolaires depuis 2010, avec de nouvelles limitations prévues en 2027.
L’article conclut en appelant à une prise de conscience : la confusion orchestrée dans les rayons n’est pas accidentelle. Elle profite à une industrie puissante, mais met en danger la santé publique. Les parents, quant à eux, peinent à distinguer le bon grain de l’ivraie.
Forbes, How Vivien Wong Turned Little Moons Into A $66M Mochi Empire, 19/05/2025
Vivien Wong, cofondatrice de Little Moons, n’avait pas prévu de créer une marque internationale en lançant des mochis glacés en 2010. Et pourtant, quinze ans plus tard, l’entreprise est présente dans 34 pays et génère plus de 66 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. L’article retrace le parcours de cette entrepreneuse britannique, formée en finance mais influencée par l’esprit entrepreneurial de ses parents, boulangers asiatiques à Londres.
L’idée de départ : moderniser la tradition japonaise du mochi en l’associant à des crèmes glacées, pour créer une alternative premium et ludique aux desserts industriels. Après deux ans de développement sans machines adaptées en Europe, la marque est lancée auprès de chefs, puis dans la grande distribution. Le succès explose en 2021 grâce à TikTok : des vidéos virales propulsent la demande à +1 000 %, obligeant l’entreprise à tripler ses effectifs en urgence.
Little Moons reste fidèle à une croissance maîtrisée. La production reste interne, et l’entreprise n’a levé des fonds qu’en 2022, une fois sa vision bien définie. Aujourd’hui, elle diversifie ses produits : cheesecakes, sorbets mochis (« Refreshos »), et investit dans des pratiques responsables. En 2023, la marque a obtenu la certification B Corp.
Vivien Wong insiste sur le temps nécessaire à l’innovation alimentaire. Construire une nouvelle habitude de consommation, surtout dans le surgelé, demande de la patience, de la rigueur et une vision à long terme. Le leadership, selon elle, consiste désormais à transmettre cette expérience, à inspirer d’autres femmes entrepreneures, et à promouvoir une alimentation plaisir mais plus durable.
Financial Times, Alcohol groups face a sobering cultural shift, 21/05/2025
Le secteur des boissons alcoolisées subit une remise en question culturelle profonde, notamment de la part des jeunes générations. L’article analyse l’impact de cette évolution sur les géants de l’industrie comme Diageo, AB InBev ou Heineken, dont les actions ont perdu jusqu’à 40 % depuis 2020, alors que les marchés des actions progressaient globalement.
Plusieurs signaux d’alerte s’accumulent : mise en garde sur les risques cancérigènes par les autorités sanitaires, consommation en baisse dans les pays développés, montée des boissons sans alcool. Le Japon, par exemple, a vu sa consommation par habitant chuter de 25 % depuis 1995. En parallèle, les 18-34 ans boivent beaucoup moins que les générations précédentes.
Les industriels tentent de s’adapter : diversification vers les boissons sans alcool, stratégies de « premiumisation » (boire mieux, pas plus), innovations produits. Mais la mutation est difficile. Diageo a lancé un plan d’économies de 500 M$ et envisage des cessions d’actifs.
Le vieillissement de la clientèle accentue la pression. Aux États-Unis, la consommation progresse chez les plus de 65 ans, mais s’effondre chez les moins de 25 ans. Même dans les pays émergents, la croissance ne compense pas le déclin occidental.
La défiance envers l’alcool s’ancre dans les mentalités. En 2024, 65 % des jeunes Américains estimaient que boire un ou deux verres par jour était mauvais pour la santé – contre 30 % en 2000. Le modèle économique de l’industrie devient donc fragile face à cette prise de conscience généralisée.
The Guardian, Climate crisis threatens the banana, the world’s most popular fruit, research shows, 12/05/2025
Une nouvelle étude de Christian Aid met en lumière une menace inquiétante : la banane, fruit le plus consommé au monde et quatrième culture alimentaire en importance après le blé, le riz et le maïs, est en danger à cause du dérèglement climatique. D’ici 2080, près de deux tiers des zones de culture en Amérique latine et dans les Caraïbes pourraient devenir inadaptées à sa production. Ces régions, pourtant peu émettrices de gaz à effet de serre, subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement : températures extrêmes, événements climatiques violents et prolifération de maladies fongiques.
La variété Cavendish, qui domine largement les exportations mondiales pour sa résistance, son goût et son rendement, est particulièrement vulnérable. Cette dépendance à un clone génétique unique rend la filière très exposée aux aléas climatiques. Les bananiers nécessitent des conditions précises : une température entre 15 et 35°C, une humidité équilibrée et une protection contre les tempêtes. Or, ces paramètres deviennent de plus en plus instables.
Les conséquences sont dramatiques : baisse des rendements, pertes économiques et insécurité alimentaire. Des maladies fongiques comme le black leaf fungus, favorisées par l’humidité, réduisent la photosynthèse de 80 %. Le fusarium tropical race 4, un pathogène du sol, détruit les plantations entières de Cavendish à travers le monde, sans remède connu à ce jour.
En Amérique centrale, des communautés entières, dépendantes de la culture de la banane, voient leur subsistance menacée. Aurelia Pop Xo, productrice guatémaltèque, témoigne d’un effondrement total de son exploitation : « Ce qui se passe, c’est la mort. ».
Christian Aid appelle les pays industrialisés, principaux responsables de la crise climatique, à abandonner les énergies fossiles et à honorer leurs engagements financiers envers les pays du Sud. Il s’agit d’aider ces communautés à s’adapter, mais aussi de protéger une culture essentielle pour plus de 400 millions de personnes qui dépendent des bananes pour 15 à 27 % de leurs apports caloriques quotidiens.
Food Dive, How restaurants are tapping into the nonalcoholic beverage craze, 15/05/2025
Dans un contexte où les consommateurs, notamment les jeunes adultes, réduisent volontairement leur consommation d’alcool, les restaurants américains adaptent leur stratégie en élargissant considérablement leur offre de boissons sans alcool. L’article met en lumière cette tendance de fond, motivée par une recherche croissante de bien-être et une volonté de consommer autrement, sans pour autant sacrifier le plaisir ou la nouveauté.
Les chaînes comme Dutch Bros, Peet’s Coffee ou Taco Bell ont multiplié les initiatives pour séduire ce nouveau public. Dutch Bros, par exemple, propose un “menu secret” de boissons personnalisées – souvent sucrées, colorées, énergisantes – qui s’appuie sur la créativité des consommateurs et leur goût pour le sur-mesure. McDonald’s, de son côté, expérimente un nouveau concept baptisé CosMc’s, misant sur une offre orientée vers des boissons innovantes et modulables.
Une étude de NCSolutions révèle que près de la moitié des adultes américains comptent réduire leur consommation d’alcool en 2025. Parmi eux, les 18-34 ans affichent une appétence marquée pour des alternatives comme les mocktails, les boissons enrichies en CBD ou THC, ou encore les infusions fonctionnelles. Cette évolution constitue une opportunité majeure pour les chaînes de restauration, qui voient là un moyen de conquérir une nouvelle clientèle et d’augmenter la valeur moyenne du panier par une offre attractive et différenciante.
L’enjeu n’est pas seulement de diversifier le catalogue, mais aussi d’assurer une exécution sans faille : les boissons doivent être simples à préparer, visuellement attractives (notamment pour les réseaux sociaux), tout en garantissant cohérence et rapidité de service. Un excès de références pourrait en effet complexifier les opérations et nuire à la rentabilité.
En misant sur cette vague du “sans alcool”, les restaurateurs ne répondent pas seulement à une tendance passagère mais à une transformation structurelle des usages et des attentes. Le segment des boissons devient ainsi un levier stratégique à part entière, à la croisée du plaisir, de la santé et de l’image de marque.
Wall Street Journal, PepsiCo Is Pushing Back its Climate Goals. The Company Wants to Talk About It, 22/05/2025
Dans un contexte où certaines entreprises sont critiquées pour avoir discrètement reculé sur leurs engagements environnementaux, PepsiCo adopte une approche transparente : le géant de l’agroalimentaire admet ne plus pouvoir tenir une partie de ses objectifs climatiques initiaux et en redéfinit publiquement les contours.
Parmi les changements majeurs, PepsiCo repousse à 2050 (au lieu de 2040) son objectif de neutralité carbone. De plus, sa cible de réduction des émissions directes (Scope 1 et 2) est révisée à -50 % d’ici 2030, contre -75 % auparavant. Pour les émissions indirectes (Scope 3), elle vise désormais -42 % pour l’énergie et l’industrie, et -30 % pour l’agriculture et l’utilisation des terres, contre un objectif initial global de -40 %.
L’entreprise évoque plusieurs raisons à ces ajustements : la croissance de ses activités, mais aussi des facteurs externes comme le manque d’infrastructures de recyclage, de bornes pour véhicules électriques, ou encore l’absence d’un cadre réglementaire incitatif. « Le monde a changé depuis que nous avons fixé ces objectifs en 2020 », explique Jim Andrew, directeur du développement durable.
Sur les emballages plastiques, l’objectif de 50 % de plastique recyclé d’ici 2030 tombe à 40 %… mais pour 2035. L’engagement de rendre tous les emballages recyclables, compostables ou réutilisables à 100 % en 2025 est également réduit à 97 % d’ici 2030, et uniquement dans les marchés clés. D’autres objectifs sont carrément abandonnés, comme la réduction de 20 % des emballages par le réutilisable, ou l’élimination du plastique vierge non renouvelable.
Toutefois, PepsiCo affiche aussi de nouvelles ambitions, notamment en agriculture régénérative : la couverture passe de 7 à 10 millions d’acres (2,83 à 4,05 millions d’ha) cultivés selon ces principes d’ici 2030. Sur la question de l’eau, l’entreprise annonce avoir déjà atteint avec deux ans d’avance son objectif d’amélioration de l’efficience hydrique dans certaines zones.
Malgré ces révisions, PepsiCo affirme rester aligné avec l’Accord de Paris via l’initiative Science Based Targets. La société publie désormais un plan de transition climatique détaillé, censé être mis à jour régulièrement. Elle insiste sur sa volonté de concilier croissance économique et réduction de son impact environnemental, tout en reconnaissant que le chemin sera plus long et semé d’embûches.
BBC, Coffee Crisis: Why are Prices Breaking Records?
L’étude menée par sept associations de consommateurs mentionnée dans l’article des Echos.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A dans 2 semaines !
O. Frey