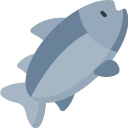🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-17
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Alpina Savoie innove avec des pâtes garanties sans pesticides, 15/05/2025
New York Times, Group Dining on Ozempic? It’s Complicated., 12/05/2025
Wall Street Journal, The App That Makes Rating Restaurants Fun Again—and Gets Better the More You Use It, 09/05/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
L’Usine Nouvelle, Pour les marques alimentaires, il est urgent de ne plus parler (que) de prix, 15/05/2025
Dans un contexte économique encore marqué par l’inflation et une consommation atone, la grande distribution et les marques alimentaires persistent à axer leur communication sur le prix. Cette stratégie, bien que compréhensible pour relancer les volumes de vente restés en deçà des niveaux de 2019, présente toutefois un risque réel : celui de banaliser l’offre et d’effacer les spécificités de chaque marque. L’obsession du prix nuit à la différenciation, alors même que l’accessibilité est devenue une attente basique, non un levier distinctif.
Le retour aux « fondamentaux » par la grande distribution met de côté des thématiques plus valorisantes comme la santé, la qualité, l’origine ou l’impact environnemental. Le logo « Origin’Info », par exemple, peine à se généraliser dans les rayons. Pourtant, certains segments parviennent à tirer leur épingle du jeu en capitalisant sur d’autres tendances : l’alimentation fonctionnelle (produits enrichis en protéines, boissons énergisantes), l’exotisme culinaire (cuisines italienne ou asiatique), ou encore la montée en puissance, bien que modeste, du végétal. Le lancement par Barilla de pâtes protéinées illustre cette volonté de croiser nutrition et innovation.
En revanche, le bio et les produits durables peinent à retrouver leur dynamique post-Covid. Selon Emily Mayer (Circana), la crise sanitaire avait artificiellement stimulé le bio et les circuits courts, davantage par effet de pénurie que par une prise de conscience durable. Depuis, le bio subit des baisses significatives, sauf dans les circuits spécialisés. La grande distribution, elle, n’a pas encore totalement réintégré les enjeux écologiques et de santé dans ses priorités, comme le souligne une étude du Réseau Action Climat. Cette dernière dénonce un manque de transparence et une faible valorisation de l’alimentation durable dans 200 supermarchés analysés.
Ce constat invite les marques à revoir leur copie. Miser uniquement sur les prix peut entraîner une forme de nivellement par le bas, alors que le contexte actuel offre aussi des opportunités de réaffirmer leur identité par la qualité nutritionnelle, l’innovation produit, ou des engagements environnementaux. La prochaine période de négociations commerciales pourrait être l’occasion pour les acteurs de la grande consommation de rééquilibrer leur discours et d’embrasser des stratégies de valeur plutôt que de volume.
Le Figaro, Des menus étoilés pour des personnes précaires: au Refettorio, la haute gastronomie pour la bonne cause, 16/05/2025
Dans la crypte de l’église de la Madeleine à Paris, le Refettorio accueille chaque semaine des centaines de personnes en situation de précarité, leur offrant bien plus qu’un simple repas : une véritable expérience gastronomique solidaire et écoresponsable. Depuis sa création en 2018 par le chef Massimo Bottura, l’artiste JR et l’entrepreneur Jean-François Rial, ce lieu unique conjugue excellence culinaire, lutte contre le gaspillage alimentaire et soutien aux personnes en difficulté.
Chaque soir de semaine, une centaine de convives – sans-abri, réfugiés, travailleurs pauvres ou personnes handicapées – sont orientés vers le Refettorio par un vaste réseau de 550 associations partenaires. Les repas, préparés exclusivement à partir d’invendus alimentaires, sont confectionnés par deux cheffes résidentes, Blandine Paris et Marine Beulaigue, accompagnées d’un noyau de bénévoles fidèles. À cela s’ajoute la participation hebdomadaire de grands chefs invités – souvent étoilés – qui relèvent le défi de composer un menu gastronomique en cinq services avec les ingrédients disponibles du jour.
Ce lundi-là, c’est la cheffe Lise Deveix, patronne du restaurant Sadarnac, qui signe le menu. Inspirée, engagée, elle improvise une cuisine de saison, inventive et raffinée, avec les produits fournis par la Banque alimentaire et des producteurs partenaires. Son menu associe radis beurre tempéré, carottes rôties aux suprêmes d’orange sanguine, pommes Anna croustillantes, tarte Tatin revisitée à la farine de maïs, et mignardise à base de citron et aquafaba. Ce défi culinaire, plus exigeant que certains concours télévisés selon elle, l’oblige à se recentrer sur l’essentiel : la cuisine comme acte de partage et d’attention.
Le Refettorio est aussi un lieu de rencontre et d’échange. Chaque soir, les équipes lancent une “question de la semaine” pour créer du lien entre bénévoles et bénéficiaires. L’ambiance y est bienveillante, rigoureuse et chaleureuse. Les chefs encadrent le service avec pédagogie, et tout est mis en œuvre pour que les invités repartent avec le sentiment d’avoir été considérés avec dignité.
En donnant une seconde vie aux aliments et en redonnant de la valeur à chaque repas, le Refettorio incarne une autre vision de la gastronomie, où l’excellence ne s’oppose ni à la solidarité, ni à l’écologie. Une initiative exemplaire qui réconcilie plaisir, utilité sociale et responsabilité environnementale.
Libération, Œuf-mayo, knack-frites ou à la poêle : voyage à travers 50 nuances de pizzas, 16/05/2025
Le journaliste et critique culinaire Ezéchiel Zérah nous propose un périple savoureux à travers l’Italie, à la découverte des nombreuses variantes régionales de pizza, loin de la seule – et parfois tyrannique – pizza napolitaine. En deux semaines, il traverse la Botte, de la Sicile à la Ligurie, en quête de recettes locales souvent méconnues, authentiques, étonnantes, voire transgressives aux yeux des puristes.
À Pesaro, dans les Marches, il découvre la pizzetta Rossini, petite tarte garnie de tomate, d’œuf dur et de mayonnaise, emblème culinaire local, souvent consommée au petit-déjeuner. En Sicile, à Palerme, la star s’appelle sfincione : une pizza moelleuse et épaisse, nappée d’un mélange d’oignons, d’anchois, de chapelure, de sauce tomate et de fromage caciocavallo, héritée de religieuses du XVIIIe siècle. À Trapani, la rianata se distingue par son goût puissant d’origan. À Messine, la focaccia tricotée associe scarole, anchois et fromage tuma.
Chaque région possède son identité, son style de pâte, ses garnitures et ses traditions. En Calabre, à Castrovillari, on parle de « pitta », une pizza cuite à la poêle avec tomates, poivrons et basilic. À Rome, la scrocchiarella est fine et très croustillante. À Milan, la pizza al trancio – en tranche – se présente sous la forme d’un matelas de fromage sur une base briochée. À Turin, la pizza al padellino est cuite dans une petite poêle ronde et précède la fameuse farinata aux pois chiches.
Zérah montre comment cette diversité reste peu reconnue en dehors de l’Italie, où l’Associazione Verace Pizza Napoletana tente de codifier la napolitaine comme l’unique référence. Pourtant, d’autres régions résistent, à l’image de la pizza al metro (en mètre), de la pinsa romana ou de la pizza parigina de Naples.
Le journaliste s’attarde aussi sur l’émergence de nouvelles formes de pizza à l’étranger : à São Paulo, avec ses disques aux trois garnitures, ou à New York, où la mozzarella est parfois déposée froide sur la part chaude. Il dénonce l’obsession normative et rappelle que la pizza, née d’un reste de pâte à pain, est un plat populaire, vivant, en perpétuelle mutation.
LSA, Agritech : les paris de la toute première ferme d'élevage de gambas française qui ouvre près de Rennes (reportage), 15/05/2025
Avec l’inauguration de son site "Mangrove 1" à Bréal-sous-Montfort, près de Rennes, la start-up française Agriloops signe une première européenne : une ferme aquaponique en eau salée dédiée à l’élevage de gambas. Après huit années de recherche et développement, ce projet industriel allie aquaculture et maraîchage, dans une démarche locale et circulaire.
Le principe d’Agriloops repose sur la réutilisation des effluents des gambas – riches en nutriments – pour irriguer des cultures maraîchères. Installée sur 2 000 m², la ferme est divisée en trois zones : production de tomates cerise, stockage (eau et produits), et culture de jeunes pousses. Grâce à une gestion informatisée, la température, l’humidité et l’irrigation sont automatisées. En dehors de la saison des tomates, Agriloops diversifie ses cultures avec des légumes comme le chou asiatique, optimisant ainsi ses rendements.
Le modèle repose sur une synergie complète : les tomates n’utilisent pas les nutriments contenus dans l’eau recyclée, qui sont en revanche très utiles aux jeunes pousses, notamment cultivées en plaques sur lit d’eau. Cette complémentarité permet une culture sans engrais chimiques. Commercialisés auprès des grossistes, primeurs et enseignes comme E.Leclerc, les produits sont pour l’instant positionnés en gamme premium. Le goût des légumes, notamment plus sucré, serait même bonifié par l’eau salée, selon Jérémie Cognard, cofondateur de l’entreprise.
Sur le plan aquacole, la production de gambas débutera à l’automne 2025, les premières larves étant attendues sous quinzaine. L’élevage se fera en six bassins de 80 m³ chacun, pouvant contenir jusqu’à 60 000 crevettes. Après un passage en nurserie pour surveiller leur santé, les gambas grossiront pendant trois à quatre mois avant d’être pêchées. Objectif : atteindre une production hebdomadaire de 800 kg sous un an.
Le projet a séduit investisseurs et élus locaux, et bénéficie du soutien de la French Tech Rennes. Il s’inscrit aussi dans un enjeu stratégique : réduire la dépendance française aux importations de gambas, évaluées entre 80 000 et 100 000 tonnes par an, alors que la production nationale reste marginale.
Mangrove 1 n’est qu’un point de départ. Pour Jérémie Cognard, cette ferme pionnière pourrait servir de modèle réplicable dans d’autres territoires, prouvant qu’il est possible de concilier production locale, durabilité environnementale et innovation agroalimentaire.
Les Échos, Steak de soja, jambon de lentilles… le secteur du traiteur végétal progresse en France, 16/05/2025
Porté par des préoccupations environnementales, de santé et de bien-être animal, le secteur du traiteur végétal connaît une croissance soutenue en France, bien qu’il reste encore en retrait par rapport à d’autres marchés européens. En 2024, le chiffre d’affaires du secteur a atteint 162 millions d’euros, soit une croissance de 13 % en valeur et 9,6 % en volume selon Nielsen. Le segment des substituts de viande (simili-carné) affiche des performances encore plus dynamiques, avec une hausse de 33,5 %, pour un total de 87 millions d’euros.
Une vingtaine d’acteurs se partagent ce marché en pleine structuration, mêlant start-up spécialisées et groupes agroalimentaires historiques. Deux leaders se démarquent : Garden Gourmet (groupe Nestlé), avec un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros, et HappyVore, entreprise française approchant les 30 millions. Chacun représente environ 20 % des parts de marché. Cette pluralité devrait bientôt évoluer vers une rationalisation, estime Guillaume Gachet (Garden Gourmet), au vu de la taille encore limitée du marché.
La consommation reste dominée par les végétariens, végétaliens et flexitariens réguliers. En 2022, seuls 10 % des 16-25 ans se déclaraient végétariens ou véganes, et un Français sur deux se considérait « flexitarien ». Malgré cela, moins d’un quart consomment régulièrement des produits végétaux transformés. Ce retard se constate dans la comparaison avec l’Allemagne ou les pays nordiques, où la pénétration du marché dépasse les 30 %, voire 50 %. En France, ce segment représente moins de 20 % du marché allemand.
Pour séduire au-delà des niches, les industriels misent sur deux leviers : le goût et la praticité. La recherche gustative est devenue centrale, avec des références qui s’inspirent des plats familiaux – cordons bleus végétaux, nuggets, steaks – pour rassurer les consommateurs. Les Nutri-Score favorables (souvent A ou B) et la réduction des additifs renforcent également leur attractivité. Certaines marques, comme HappyVore, innovent avec des produits gourmands et rassurants, comme le "Croq’coulis" vegan.
Une nouvelle tendance émerge : les plats cuisinés végétariens et végans, à fort potentiel selon les experts, car répondant à une demande croissante de praticité. Bien que ce segment en soit à ses débuts, il pourrait devenir une clé de croissance dans les années à venir.
En résumé, le traiteur végétal français est en pleine évolution : dynamique, prometteur, mais encore en phase de rattrapage. Son avenir repose sur sa capacité à convaincre une clientèle plus large, notamment les familles flexitariennes, avec une offre savoureuse, accessible et adaptée aux usages du quotidien.
Les Échos, Alpina Savoie innove avec des pâtes garanties sans pesticides, 15/05/2025
Le pastier savoyard Alpina Savoie, doyen de la filière française fondé en 1844, franchit une nouvelle étape en s’engageant dans la production de pâtes garanties sans résidus de pesticides. Cette innovation stratégique, qui vient renforcer son ancrage dans une alimentation plus durable, vise à répondre aux attentes croissantes des consommateurs, notamment les plus jeunes, pour des produits à la fois sains et locaux.
Alpina, déjà pionnier du bio avec la première filière française de blé dur bio lancée en 2010, refuse cependant d’abandonner le label biologique malgré les difficultés actuelles du secteur. Selon son président Nicolas Guize, le nouveau positionnement « zéro résidu » vient compléter cette démarche, en offrant une alternative crédible et contrôlée : les pesticides peuvent être utilisés de manière limitée en cas d’aléas, mais les pâtes finales ne doivent contenir aucune trace détectable de ces substances après analyse.
L’ensemble de la gamme – des classiques comme les vermicelles, les avoines, les perles, jusqu’aux spécialités régionales comme les crozets – basculera vers cette norme d’ici fin 2025. Cela représente 80 % de la production de l’entreprise, soit 50 000 tonnes de blé dur transformées chaque année dans son moulin de Chambéry. Ce blé, issu d’une filière 100 % française et contractualisée via des coopératives agricoles, est cultivé sur environ 12 000 hectares.
L’enjeu est aussi économique. Le marché des pâtes reste très concurrentiel, particulièrement sur les références classiques, dominées par les marques de distributeurs (MDD). Alpina, spécialisé dans les petites pâtes utilisées dans les soupes, risottos ou salades, souffre moins de cette pression. En 2024, bien que son chiffre d’affaires ait reculé de 5 % (85 millions d’euros), ses volumes ont progressé de 4,8 %, preuve d’un maintien de la demande malgré les turbulences. Grâce à la baisse des coûts des matières premières et de l’énergie, les prix ont même reculé de 10 % en 2024 et continueront de baisser cette année.
L’entreprise mise sur cette différenciation pour séduire de nouveaux consommateurs et soutenir une filière agricole fragilisée par la déprise de la culture de blé dur en France. Elle bénéficie aussi des synergies créées depuis le rachat des Pâtes Grand’Mère en Alsace. À terme, Alpina veut faire du "sans résidu" un nouveau standard de qualité dans les rayons, sans pour autant sacrifier le bio.
Les Échos, Eaux minérales : les industriels se déchirent sur le cas Perrier, 13/05/2025
L’affaire Perrier, au cœur d’un débat réglementaire et environnemental, agite profondément le secteur des eaux minérales naturelles. En cause : les pratiques de traitement mises en œuvre par Nestlé Waters sur la source de Vergèze (Gard), remettant potentiellement en cause l’appellation « eau minérale naturelle ». Face à cela, la Maison des Eaux Minérales Naturelles (MEMN), regroupant cinq acteurs majeurs du secteur, affirme son attachement à une stricte définition de cette appellation, fondée sur la pureté originelle et l’unicité minérale.
Selon le Code de la santé publique et la directive européenne de 2009, les eaux minérales ne peuvent subir aucun traitement modifiant leur flore microbienne. Or, pour répondre à des risques sanitaires, Nestlé a installé des systèmes de microfiltration à 0,2 micron, qui éliminent certains micro-organismes et modifient ainsi le « microbisme » naturel. Une pratique dénoncée par le rapport sénatorial à venir et critiquée par la préfecture du Gard, qui a demandé le retrait de ces filtres. Le rapport d’hydrogéologues évoque même des « déviations microbiologiques » préoccupantes.
Pour la MEMN, représentée par Cathy Le Hec (Danone), cette situation ne doit pas ouvrir la voie à un assouplissement des normes. Préserver l’image et la spécificité des eaux minérales naturelles passe par le respect strict des critères initiaux. Toute exception, même motivée par des impératifs sanitaires, risque de créer une catégorie à deux vitesses, au détriment de la confiance des consommateurs.
Mais cette position rigoureuse masque des tensions profondes. Perrier, marque emblématique, emploie un millier de personnes à Vergèze. Son éventuel déclassement menacerait des centaines d’emplois, notamment dans la verrerie voisine. Face à ces enjeux économiques, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, appelle à une évolution législative permettant d’adapter les méthodes de traitement à la réalité des ressources, tout en garantissant la sécurité sanitaire.
La MEMN, si elle reste inflexible sur les principes, n’exclut pas un débat sur la réglementation, notamment pour harmoniser les pratiques à l’échelle européenne. Toutefois, elle rejette l’idée d’une généralisation de la microfiltration, incompatible avec l’essence même de l’eau minérale naturelle. À travers le cas Perrier, c’est toute la filière qui est confrontée à un dilemme : préserver la pureté perçue par les consommateurs tout en faisant face aux réalités de l’évolution de la ressource.
L’Express, Le saumon de nos assiettes n’a plus rien de sauvage : enquête sur la face cachée d’une industrie prospère, 05/05/2025
Le saumon, aliment phare des assiettes françaises, est aujourd’hui à 99 % issu de l’élevage industriel, majoritairement en Norvège et en Islande. Si la France est le premier consommateur européen, avec 300 000 tonnes ingérées chaque année, ce succès dissimule une réalité bien moins reluisante : une industrie intensive, fortement critiquée pour ses impacts environnementaux, sanitaires et génétiques.
L’article s’ouvre sur une scène insolite mais révélatrice : l’évasion de 27 000 saumons d’élevage après une tempête, incitant le géant norvégien Mowi à offrir une prime pour leur recapture. Ce type d’incident, devenu fréquent, menace directement les saumons sauvages, déjà affaiblis par le changement climatique. Le croisement génétique entre individus d’élevage et populations sauvages compromet l’adaptabilité des seconds à leur environnement, affectant la biodiversité fluviale, comme l’expliquent chercheurs et ONG environnementales.
Au-delà des fuites, les installations en mer génèrent d’importants rejets organiques (déjections, nourriture non consommée) qui perturbent les écosystèmes des fjords. La promiscuité entre milliers de poissons accentue la propagation de maladies et de parasites, notamment les poux de mer, causant des plaies et un stress chronique. Le taux de mortalité atteint parfois 40 %, selon Icelandic Wildlife Fund. En 2023, la Norvège a enregistré 62,8 millions de saumons morts en élevage.
Face à ces dérives, les voix s’élèvent. Des figures locales comme la chanteuse Björk ou des ONG soutenues par Patagonia militent contre l’implantation de nouvelles fermes, comme celle projetée à Seydisfjordur. Ces mobilisations reflètent une opposition croissante à un modèle perçu comme destructeur de milieux vierges.
Pour réduire l’empreinte écologique, certains acteurs misent sur l’aquaculture terrestre en circuit fermé. Ces systèmes permettent de contrôler les rejets et d’éviter les évasions. Toutefois, ils posent d’autres défis : coûts élevés, gestion technique délicate, densité de population problématique. En France, deux projets à Boulogne-sur-Mer et Verdon-sur-Mer suscitent des résistances locales. Un moratoire de dix ans est même proposé par des députés écologistes.
Enfin, l’article interroge notre dépendance à ce produit devenu industriel. Des alternatives locales et durables existent : truite, dorade, bar… Autant de ressources à valoriser pour sortir d’un modèle fondé sur l’élevage de masse. Le saumon, jadis produit d’exception, est devenu le « poulet industriel de la mer », posant des questions fondamentales sur l’avenir de notre alimentation et de l’aquaculture.
Le Nouvel Obs, Pourquoi les vins grecs gagnent vraiment à être mieux connus, 10/05/2025
Longtemps réduits à quelques stéréotypes comme le retsina ou la feta, les vins grecs connaissent aujourd’hui une véritable renaissance en France, portée par une nouvelle génération de vignerons et de restaurateurs engagés. Cet article de Zazie Tavitian explore la montée en puissance de ces crus helléniques qui séduisent de plus en plus d’amateurs, loin des clichés et avec une forte identité terroir.
À Paris, le traiteur grec Etsi illustre cette dynamique. Sa fondatrice, la cheffe Mikaela Liaroutsos, a été l’une des premières à miser sur une carte exclusivement composée de vins grecs. Au départ confrontée à la méfiance du public, elle constate désormais une curiosité grandissante. Son parcours rejoint celui d’autres figures influentes comme les frères Chantzios (huile d’olive Kalios) ou Alexandros Rallis (Profil Grec), tous militants d’une gastronomie hellénique authentique.
Cette révolution œnologique repose sur un socle solide : plus de 200 cépages autochtones (assyrtiko, xinomavro, liatiko, etc.), des terroirs d’une incroyable diversité – entre montagnes, volcans et littoral – et une tradition viticole ancrée dans le quotidien. Apostolos Valleras, chef et exportateur de vins, souligne combien la viticulture est omniprésente en Grèce, parfois reléguée à l’arrière-plan pendant des décennies, mais désormais remise à l’honneur avec des méthodes naturelles, sans filtration et à faible teneur en soufre.
Cette nouvelle scène viticole a souvent émergé à la suite de la crise économique de 2008, qui a poussé de jeunes Grecs à se tourner vers l’exportation et à redonner sens à la production locale. Yorgos Ioannidis, ancien sommelier et fondateur d’Oenos LFP, a été un pionnier dans l’accompagnement des petits vignerons vers les marchés étrangers, notamment français. Les salons du vin d’Athènes deviennent ainsi un vivier de découvertes, même si les importations restent freinées par l’absence d’une filière structurée.
L’article met en lumière trois cuvées emblématiques de cette nouvelle vague : un retsina bio (Domaine Aoton) aux arômes d’agrumes et de pin, un blanc nature issu du muscat (Sous le végétal), et un rouge délicat à base d’avgoustiatis (Domaine Kefallinos). Toutes témoignent d’un savoir-faire retrouvé, d’un respect du terroir et d’un goût de l’expérimentation.
Loin d’une volonté de conquête massive, les acteurs du vin grec misent sur la singularité, l’authenticité et la finesse. Une stratégie qui commence à porter ses fruits auprès des amateurs français en quête d’alternatives aux standards internationaux.
The Guardian, Dairy companies ‘turning blind eye’ to global methane emissions, report suggests, 14/05/2025
Les grandes entreprises laitières et les chaînes de cafés négligent largement leur impact climatique, en particulier les émissions de méthane, selon un rapport de l’ONG Changing Markets Foundation. L’élevage bovin destiné à la production de lait est responsable de 32 % des émissions mondiales de méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO₂ sur 20 ans. Il est responsable de près de la moitié du réchauffement global depuis 1750.
Parmi les 20 entreprises analysées (représentant près de 420 milliards de dollars de chiffre d’affaires), très peu prennent le sujet au sérieux : la plupart n’ont ni objectifs clairs de réduction du méthane, ni plans d’action crédibles, ni réelle transparence sur leurs émissions. Seules Danone et Nestlé affirment avoir réduit leurs rejets. Danone se distingue comme la seule à s’être fixée une cible spécifique sur ce gaz. General Mills, deuxième du classement, a un objectif climatique global, mais sans volet méthane. Nestlé, troisième ex æquo avec Arla, est également la seule entreprise à soutenir une réduction de la consommation de produits laitiers.
Pour Nusa Urbancic, directrice de Changing Markets, cette inaction reflète un déni stratégique : “Les entreprises ferment les yeux sur un des leviers les plus puissants et faciles à actionner contre le réchauffement.” Selon elle, les engagements volontaires ne suffisent plus. Elle appelle les gouvernements, notamment européens, à imposer des objectifs de réduction contraignants, en cohérence avec leur rôle moteur dans l’initiative mondiale sur le méthane.
L’étude englobe les plus gros producteurs laitiers d’Europe et d’Amérique du Nord, les cinq principales chaînes de cafés, ainsi que les huit membres de la Dairy Methane Action Alliance, qui se révèle, pour l’instant, largement inefficace. Seule Arla a mentionné des objectifs "basés sur la science", mais sans précision sur les résultats obtenus.
Ce rapport met ainsi en lumière l’écart croissant entre les discours climatiques des industriels et leurs actions concrètes. Sans pression politique forte, la filière laitière risque de continuer à contribuer de façon significative au réchauffement climatique mondial.
Fast Company, Calorie labels may backfire when it comes to judging food healthiness, research shows, 15/05/2025
Contrairement à que l’on pourrait croire, l’affichage des calories sur les aliments pourrait nuire à la capacité des consommateurs à évaluer leur qualité nutritionnelle, selon une étude publiée dans le Journal of Retailing. Menée sur plus de 2 000 personnes à travers neuf expériences, la recherche révèle un effet contre-intuitif : les participants exposés aux informations caloriques ont jugé les aliments sains comme moins sains, et les aliments malsains comme moins malsains. Résultat : les écarts de jugement entre les deux se sont atténués.
Lorsque les calories n’étaient pas indiquées, les répondants distinguaient clairement une salade d’un cheeseburger en termes de santé. Mais l’ajout de l’information calorique a engendré une forme d’incertitude cognitive, poussant les participants à adopter des évaluations plus modérées. Cette incertitude ne s’est pas manifestée pour d’autres informations nutritionnelles comme les lipides ou les glucides, moins familières au grand public.
Les chercheurs appellent ce phénomène l’illusion de “calorie fluency” : parce que les calories sont omniprésentes, les gens pensent savoir les interpréter correctement. En réalité, cette familiarité masque un déficit de compréhension qui, lorsqu’il est mis à l’épreuve, fragilise la confiance du consommateur dans son propre jugement.
L’étude souligne ainsi une faiblesse majeure des politiques de santé publique qui misent sur la transparence calorique pour guider les choix alimentaires. L’information seule ne suffit pas. Pire, elle pourrait parfois conduire à des choix moins sains par excès de prudence ou de confusion. Cela ne signifie pas qu’il faille supprimer l’affichage calorique, mais l’accompagner de repères clairs, comme un code couleur de type « feu tricolore », un score nutritionnel global ou des indications sur les apports journaliers recommandés.
Cette recherche met en lumière un problème plus large : l’information nutritionnelle doit être compréhensible pour être utile. À défaut, elle peut induire en erreur, voire démobiliser. Il reste à explorer comment ces effets interagissent avec les outils numériques (applications de santé, IA, etc.) qui prétendent guider les consommateurs mais pourraient renforcer cette fausse impression de maîtrise.
New York Times, Group Dining on Ozempic? It’s Complicated., 12/05/2025
Avec la montée en flèche de l’usage des médicaments de type GLP-1 (comme Ozempic ou Mounjaro), initialement destinés au traitement du diabète mais largement détournés pour la perte de poids, les repas à plusieurs deviennent un nouveau terrain de tension sociale. Ces traitements réduisent considérablement l’appétit et la sensation de faim, ce qui modifie profondément la dynamique des repas partagés, notamment au restaurant.
Beaucoup de patients se retrouvent à grignoter à peine quelques bouchées tandis que leurs compagnons de table terminent les plats. Cela donne lieu à des situations inattendues : incompréhension des chefs, gêne des serveurs ou frustrations silencieuses entre convives. Certains restaurateurs vont même jusqu’à contacter les organisateurs d’événements lorsqu’un invité ne touche presque pas à son menu dégustation, craignant une critique implicite.
Pour s’adapter, les personnes sous GLP-1 modifient leur façon de sortir : elles privilégient les restaurants à service partagé ou les assiettes en petites portions, où leur faible consommation est moins visible. Beaucoup préviennent à l’avance leurs compagnons de table ou les serveurs, pour éviter les malentendus. Certaines, comme Lauren Wire à New York, en rient et en profitent pour revendiquer une nouvelle normalité, quitte à finir avec des restes soigneusement emballés.
De leur côté, les personnes non concernées par ces traitements peuvent se sentir mal à l’aise : culpabilité de manger davantage, assiettes à moitié pleines retournées en cuisine, ou encore perte du plaisir convivial du repas. D’autres y voient un avantage : plus de nourriture à partager et une influence positive sur leur propre comportement alimentaire, comme Nathaly del Carmen, qui se réjouit de manger moins lorsqu’elle est entourée de personnes sous GLP-1.
Au-delà de l’alimentation, ces traitements semblent aussi modérer la consommation d’alcool, certains utilisateurs ne supportant plus qu’un ou deux verres. Loin de les isoler, ces changements sociaux redéfinissent les codes du repas collectif.
Wall Street Journal, The App That Makes Rating Restaurants Fun Again—and Gets Better the More You Use It, 09/05/2025
Lancée en 2020 par Judy Thelen et Eliot Frost, Beli est une application de notation de restaurants qui ambitionne de redonner du plaisir à l’évaluation culinaire, en s’appuyant sur une approche personnalisée et communautaire (une sorte de Mapstr à l’américaine en quelque sorte). Née d’une frustration partagée par ses fondateurs – deux passionnés de restauration déçus par les recommandations trop génériques de plateformes traditionnelles – l’application cumule aujourd’hui plus de 58 millions de notations dans le monde.
Le concept est simple : plus un utilisateur évalue de restaurants, plus l’algorithme affine ses suggestions en fonction de ses goûts. Cette gamification du classement renforce aussi la fiabilité globale de la plateforme. Chaque utilisateur peut consulter une carte de ses restaurants testés, partager ses favoris, et recevoir des recommandations sur-mesure, loin des effets de mode ou des notations biaisées.
Thelen et Frost ont construit Beli dès leurs études à Harvard Business School, dans le cadre d’un projet entrepreneurial. Initialement financée par des bourses étudiantes et des proches, l’application a connu une croissance rapide sans recourir à une stratégie marketing agressive. 80 % des utilisateurs proviennent du bouche-à-oreille, preuve d’une forte adhésion organique.
La dimension sociale est au cœur de la stratégie de Beli. Sur Instagram et TikTok, le couple partage ses aventures gastronomiques sous le compte @beli_eats, cumulant plus d’un million d’abonnés. Mais leur objectif reste de créer une communauté centrée sur la découverte culinaire, et non sur leur personnalité. Leurs publications visent à inspirer, sans influencer.
Côté modèle économique, Beli reste prudent. Pas de publicité dans le flux : la transparence des recommandations est prioritaire. Un premier test de monétisation est lancé à New York avec le Beli Supper Club, un club sur abonnement proposant événements exclusifs et fonctionnalités avancées. Des partenariats avec OpenTable et SevenRooms permettent également de réserver directement via l’app.
Avec une équipe restreinte (cinq personnes), Frost et Thelen misent sur la qualité plutôt que l’expansion rapide. Leur ambition : bâtir un outil fiable, convivial et indépendant pour tous ceux qui aiment bien manger – chez eux ou à l’autre bout du monde.
Washington Post, Are seed oils bad for you? Here’s what the evidence actually tells us., 15/05/2025
Dans le débat très polarisé sur les huiles de graines (colza, soja, tournesol, maïs, etc.), certaines voix, notamment celle de Robert F. Kennedy Jr., les accusent d’être toxiques. Pourtant, une analyse rigoureuse de la littérature scientifique montre que les preuves tendent à indiquer qu’elles sont globalement sans danger — voire légèrement bénéfiques — pour la santé cardiovasculaire.
Les critiques des “seed oils” mettent en cause leur teneur en acides gras polyinsaturés (notamment les oméga-6 comme l’acide linoléique), leur transformation industrielle, ou encore des risques d’inflammation et d’oxydation du cholestérol LDL. Mais, comme le rappelle l’auteure Tamar Haspel, les mécanismes isolés ne suffisent pas à prédire les effets réels sur la santé.
Elle propose deux règles pour aborder toute question nutritionnelle :
Se méfier des théories trop simplistes.
Considérer l’ensemble des données disponibles, notamment les essais cliniques et les méta-analyses.
Or, les méta-analyses les plus fiables publiées ces dernières années vont presque toutes dans le même sens : les huiles de graines sont associées à un risque cardiovasculaire stable ou réduit, et à un risque plus faible de diabète de type 2. Certaines études anciennes (années 60-70), souvent citées pour critiquer ces huiles, présentent des limites méthodologiques majeures et aboutissent à des résultats contradictoires. Une méta-analyse isolée de 2010 pointe un risque accru, mais elle est désormais considérée comme une exception méthodologiquement discutable.
Pourquoi alors ce débat persistant ? D’abord parce que les “seed oils” sont l’opposé des graisses animales saturées, elles-mêmes au cœur d’un autre clivage nutritionnel. Ensuite, parce qu’elles sont omniprésentes dans les aliments ultra-transformés, souvent considérés (à juste titre) comme un facteur majeur de l’épidémie d’obésité. Or, accuser un ingrédient unique de l’impact de tout un système alimentaire est réducteur.
Financial Times, Alcohol sales hit more by screen time than health fears, Asahi head says, 18/05/2025
Selon Atsushi Katsuki, PDG du groupe japonais Asahi, la baisse de la consommation d’alcool dans le monde serait davantage liée à l’essor des loisirs numériques qu’aux préoccupations sanitaires. Jeux vidéo, réseaux sociaux et streaming captent aujourd’hui une part importante du "temps de divertissement", réduisant celle traditionnellement occupée par l’alcool dans les pratiques sociales.
Alors que certains experts comparent l’alcool au "nouveau tabac", Katsuki conteste cette analogie. Il estime que l’alcool, consommé avec modération, peut contribuer au bien-être et rappelle que, contrairement au tabac, le secteur n’a jamais nié les risques liés à l’abus de boisson. Il conteste par ailleurs la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle "aucun niveau de consommation d’alcool n’est sûr", affirmant qu’il existe des études suggérant des bénéfices potentiels à une consommation modérée.
Malgré un recul des ventes mondiales en volume de 1 % en 2023, la valeur du marché a progressé de 2 %, preuve d’un intérêt croissant pour les boissons haut de gamme et alternatives faiblement alcoolisées. Asahi entend capitaliser sur cette évolution en ciblant une clientèle nouvelle : blogueurs, gamers, influenceurs, qu’il espère séduire avec ses bières premium (comme Peroni ou Grolsch), ses alternatives à faible teneur en alcool et ses soft drinks de qualité, à consommer à domicile.
L’entreprise reste vigilante face à d’autres tendances susceptibles d’affecter les ventes, comme la montée en puissance des médicaments pour la perte de poids (Ozempic, Mounjaro), qui peuvent réduire l’appétit… et potentiellement la consommation d’alcool. Pour l’instant, Asahi ne constate aucun impact tangible, Katsuki suggérant même que l’amélioration de la santé des consommateurs pourrait, à terme, leur permettre de boire à nouveau avec modération.
Enfin, malgré les droits de douane imposés par l’administration Trump, Asahi reste résolument tourné vers les États-Unis, marché jugé stratégique pour son expansion, alors que ses activités sont déjà bien implantées au Japon, en Europe et en Océanie. L’entreprise, qui a récemment vu son cours boursier atteindre un record, affiche une stratégie offensive, misant sur l’innovation, la diversification des publics et des acquisitions ciblées.
Financial Times, How milk got its mojo back, 14/05/2025
Après deux décennies de déclin marqué, le lait de vache connaît un retour inattendu sur le devant de la scène aux États-Unis. En 2024, pour la première fois depuis 2009, la consommation de lait a augmenté, portée par une progression de 3,5 % en valeur. À l’inverse, les ventes de laits végétaux (amande, avoine, soja…) ont chuté de 8,4 % sur deux ans. Le recul spectaculaire de marques comme Oatly, dont l’action a perdu 98 % de sa valeur depuis 2021, illustre ce revirement.
Ce retournement résulte de plusieurs facteurs. L’industrie laitière, longtemps sur la défensive face aux critiques sur l’environnement, la santé ou le bien-être animal, a adopté une stratégie plus proactive. Plutôt que de s’opposer frontalement aux alternatives végétales, elle s’est adaptée à la demande : promesses de neutralité carbone, développement de gammes bio ou issues d’élevages respectueux, et surtout investissement massif (10 milliards de dollars prévus d’ici 2027) dans des outils de transformation modernes.
Le contexte sociétal a aussi évolué : la peur des graisses a reculé, remplacée par des préoccupations autour de l’apport en protéines ou la limitation des produits ultra-transformés. À ce titre, le lait de vache dispose d’arguments solides : calcium naturel, vitamine D, profil protéique complet et étiquette plus "propre" que les boissons végétales souvent enrichies en additifs ou édulcorants.
L’industrie a également su élargir sa base de consommateurs en développant une large gamme de laits sans lactose, destinés à une population historiquement sous-consommatrice, notamment d’origine hispanique ou asiatique. Ce segment connaît la plus forte croissance du secteur (+15,5 % en un an), et ses ventes dépassent désormais celles de toutes les boissons végétales réunies.
Mais des menaces planent sur ce renouveau. L’érosion des cheptels, la grippe aviaire et surtout les coupes budgétaires de l’administration Trump dans les agences sanitaires fragilisent la filière. Suspension de contrôles qualité, fermeture de comités de sécurité alimentaire… Le risque d’une crise sanitaire liée à du lait contaminé devient réel, alors même que le secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr promeut la consommation de lait cru, pourtant dangereux.
Financial Times, Moët Hennessy’s crisis: dubious deals, soaring prices and hubris, 14/05/2025
Moët Hennessy, la division vins et spiritueux du groupe LVMH, traverse une crise profonde marquée par une chute brutale des ventes, une stratégie tarifaire risquée et une série d’acquisitions contestées. Longtemps vache à lait du groupe, la filiale est passée d’un flux de trésorerie positif d’1 milliard d’euros en 2019 à une consommation nette de 1,5 milliard en 2024, selon des documents internes consultés par le Financial Times.
Le retournement s’explique en partie par la fin du boom du luxe post-Covid, mais aussi par des décisions managériales prises sous l’ex-PDG Philippe Schaus : hausses de prix agressives (+30 % depuis 2019), diversification coûteuse via des acquisitions, et lancement hasardeux de ventes directes aux consommateurs (boutiques physiques et e-commerce), aujourd’hui déficitaires.
En avril 2025, LVMH a annoncé une baisse de 9 % de son chiffre d’affaires vins et spiritueux, et une chute de 36 % du résultat opérationnel de Moët Hennessy. En réaction, 1 200 suppressions de postes ont été décidées. L’arrivée de Jean-Jacques Guiony, ex-directeur financier de LVMH, à la tête de la division, épaulé par Alexandre Arnault (fils du PDG Bernard Arnault), marque un tournant stratégique.
Guiony a admis que les hausses de prix étaient devenues "difficiles à avaler", certains distributeurs commençant à les rejeter. Malgré ces augmentations, les volumes ont chuté et les marges ont reculé à 23 % (contre un objectif affiché de 30 %). Le portefeuille est désormais en cours de réévaluation, notamment les acquisitions récentes, comme les marques de rosé (Minuty), de champagne (Armand de Brignac), ou de tequila (Volcan), qui auraient surtout "complexifié l’organisation et érodé les marges".
Le projet de vente directe au consommateur, jugé non rentable, est également revu. L’alliance e-commerce avec Campari (Tannico) est qualifiée d’échec. Guiony veut désormais ralentir l’expansion tous azimuts et recentrer l’activité sur les piliers rentables, à commencer par le cognac et le champagne.
Malgré les tensions internes et la pression de Bernard Arnault pour maintenir des objectifs ambitieux, la direction reconnaît la nécessité de réduire les coûts et de corriger les erreurs passées. Moët Hennessy, icône du luxe à la française, est désormais un cas d’école des excès de croissance et d’optimisme dans les industries du luxe.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey