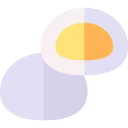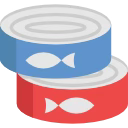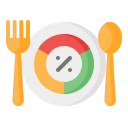🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-16
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Nitrites, sel… A quoi ressemblera le jambon du futur ?, 07/05/2025
Les Échos, Comment Petit Navire compte faire manger du thon à la Gen Z, 02/05/2025
Financial Times, The resilient coffee discovery that could save our morning brew, 07/05/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, La Cure gourmande, placée en liquidation judiciaire, cherche un repreneur, 06/05/2025
La Cure Gourmande, entreprise emblématique du sud de la France spécialisée dans les confiseries artisanales, traverse une crise majeure. Fondée en 1989 à Balaruc-les-Bains, dans l’Hérault, la société a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2025 par le tribunal de commerce de Montpellier. Cette décision intervient après plusieurs années de difficultés économiques, aggravées par l’inflation, la hausse des prix des matières premières et une concurrence accrue.
Malgré une activité qui semble florissante dans certaines boutiques – notamment celle de Nîmes récemment ouverte – la réalité économique de l’entreprise est alarmante. Elle emploie environ 120 salariés, dont 40 dans ses deux ateliers de production situés à Frontignan (Hérault) et à Narbonne (Aude). Ces emplois sont aujourd’hui en péril si aucun repreneur ne se manifeste avant le 30 juin 2025, date limite fixée par le tribunal.
Depuis sa création, La Cure Gourmande a bâti sa notoriété sur son identité visuelle rétro, ses produits régionaux (biscuits, chocolats, sucettes artisanales, etc.) et son implantation dans des zones touristiques. Avec près de 50 boutiques en 2023 – principalement dans le Sud-Est de la France mais aussi à Paris, dans des aéroports et à l’étranger – l’entreprise connaissait un rythme soutenu de développement, avec trois franchises et trois succursales ouvertes chaque année. Elle revendiquait alors 400 références produits et fabriquait près de 3 millions de sucettes par an.
La société avait déjà connu un redressement judiciaire en 2019, épisode durant lequel plusieurs points de vente avaient été fermés. Elle avait néanmoins réussi à rebondir, notamment après la crise sanitaire, en atteignant un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2023. Mais cette reprise n’a pas suffi à compenser la pression inflationniste et les difficultés d’approvisionnement.
Aujourd’hui en cessation de paiements, La Cure Gourmande symbolise les défis auxquels sont confrontées les PME du secteur agroalimentaire artisanal. L’absence de réponse de la direction à la presse laisse planer l’incertitude sur l’avenir de cette marque patrimoniale du terroir occitan. Le sort de ses salariés, comme celui de son modèle économique basé sur la gourmandise traditionnelle et l’attrait touristique, dépend désormais d’un éventuel repreneur.
Libération, Accusations de plagiat contre l’influenceuse Brooke Bellamy : les recettes de cuisine appartiennent-elles à quelqu’un ?, 07/05/2025
L’affaire de plagiat visant l’influenceuse australienne Brooke Bellamy a relancé un débat ancien mais toujours actuel : à qui appartiennent les recettes de cuisine ? Accusée par deux consœurs – Nagi Maehashi et Sally McKenney, toutes deux auteures et créatrices de contenus culinaires – d’avoir recopié mot pour mot une recette de baklava et une autre de gâteau à la vanille, Bellamy se retrouve au cœur d’une polémique alimentée par les réseaux sociaux. Son livre de recettes “Bake with Brooki”, vendu à près de 100 000 exemplaires depuis octobre 2024, est au centre des critiques.
Bellamy nie les accusations, affirmant que ses recettes sont issues d’années d’expérimentations personnelles, bien qu’elle admette s’inspirer d’autres créateurs. Elle a cependant pris la décision de retirer les recettes litigieuses dans les prochaines rééditions. Le cas révèle une zone grise du droit d’auteur : si la formulation littéraire d’une recette peut être protégée, la recette en tant que telle (les ingrédients et les étapes) ne constitue pas une “œuvre de l’esprit” juridiquement protégée, selon la jurisprudence française.
Le sujet n’est pas nouveau. Déjà au XVIIIe siècle, des chefs comme Vincent La Chapelle étaient accusés de copier des ouvrages antérieurs. Aujourd’hui, la viralité des contenus sur TikTok ou Instagram complexifie encore les choses. Beaucoup de créateurs demandent au moins une forme de reconnaissance par un simple “tag”, à défaut de protection légale.
Des moyens alternatifs existent cependant pour revendiquer une forme de propriété sur une création culinaire : le dépôt de brevets pour des techniques, comme l’avait fait Joël Robuchon, ou l’enregistrement de dessins et modèles pour protéger l’esthétique d’un plat, comme l’a fait Alain Passard.
Cette affaire souligne l’évolution du rapport à la propriété intellectuelle dans la gastronomie à l’ère du numérique, où le partage et l’appropriation de contenus sont instantanés. Si la protection stricte des recettes semble difficile à mettre en place, la reconnaissance de la paternité reste une revendication forte dans le milieu. L’affaire Bellamy en est l’illustration : même si la loi ne condamne pas directement ce type de reproduction, la pression morale et sociale des communautés peut suffire à remettre en cause une réputation.
L’Usine Nouvelle, Cette start-up transforme le CO2... en beurre, 06/05/2025
La start-up américaine Savor innove radicalement dans la production de matières grasses alimentaires en développant un “beurre” synthétisé à partir de dioxyde de carbone (CO₂) et de méthane, sans recours à l’agriculture. Fondée en 2022, l’entreprise s’inscrit dans une dynamique de rupture avec les pratiques alimentaires classiques en contournant l’étape animale ou végétale pour créer des lipides à partir de chaînes de carbone obtenues par transformation chimique du gaz.
Installée près de Chicago, Savor dispose d’un site industriel de 2 300 m² qui vise une production hebdomadaire de 100 kg d’ici la mi-2025. Sa première gamme cible le secteur de la restauration avec des équivalents au beurre de vache, au beurre de cacao ou à l’huile de palme. À terme, l’entreprise prévoit de produire aussi des lipides comparables au lard ou aux huiles végétales.
La technologie repose sur la capture de gaz comme le CO₂, qui est ensuite mis sous pression et chauffé pour former des chaînes d’acides gras. Ces composants sont ensuite assemblés pour créer des matières grasses mimant le goût et la texture de celles d’origine naturelle. Ce procédé innovant permettrait ainsi de s’affranchir des contraintes environnementales de l’agriculture et de réduire considérablement l’empreinte carbone des produits gras.
Soutenue par le fonds Breakthrough Energy de Bill Gates, qui investit dans des projets de réduction des gaz à effet de serre, Savor vise non seulement l’agroalimentaire mais aussi les cosmétiques, un secteur gourmand en huiles. L’entreprise développe également des acides gras hybrides, mélangeant ses lipides synthétiques à des dérivés végétaux, afin d’élargir ses débouchés.
En reproduisant les caractéristiques organoleptiques des graisses conventionnelles, Savor pourrait séduire les chefs et les industriels cherchant à combiner durabilité et performance culinaire. Reste à convaincre les consommateurs et les régulateurs de l’innocuité et de l’intérêt nutritionnel de ces produits encore expérimentaux.
Les Échos, Nitrites, sel… A quoi ressemblera le jambon du futur ?, 07/05/2025
L’Institut du porc (Ifip), situé près de Rennes, développe une approche globale pour réinventer la charcuterie française à l’aune des attentes sanitaires et nutritionnelles contemporaines. Né de la fusion d’entités techniques spécialisées dans l’élevage et la transformation, cet institut emploie une centaine de personnes et bénéficie d’un budget de 12 millions d’euros pour mener des recherches de pointe. L’un de ses axes majeurs concerne la réduction des nitrites, du sel et des matières grasses dans les produits de charcuterie, sans compromettre la sécurité alimentaire.
Dans ses installations, l’Ifip expérimente des recettes allégées, compare les résultats visuels et microbiologiques, et met au point des dispositifs technologiques pour améliorer les contrôles qualité. Une machine permet par exemple d’analyser en série jusqu’à 1 200 jambons crus à l’heure afin de prédire leur tenue à la cuisson. Un autre dispositif, basé sur la radiographie, sert à estimer automatiquement le rapport gras/maigre d’une carcasse, facilitant le suivi sans dissection.
Outre les innovations techniques, l’institut collabore avec les professionnels pour anticiper les normes à venir. Déjà, certains industriels se conforment à des seuils inférieurs à la future réglementation européenne sur les nitrites. Des pistes novatrices, comme l’usage de bactériophages pour lutter contre les bactéries pathogènes, sont aussi explorées.
Le secteur de la charcuterie est par ailleurs impacté par la réforme du Nutriscore, qui pénalise fortement la teneur en sel, rendant difficiles les efforts de revalorisation nutritionnelle engagés. L’Ifip cherche donc à conjuguer amélioration des recettes, maintien de la qualité gustative et maîtrise des risques sanitaires. Il s’intéresse également aux questions de bien-être animal et d’emballage durable, ce qui lui vaut une attention croissante à l’international.
Le jambon du futur, selon l’Ifip, sera donc plus sain, plus sûr, et produit avec des outils technologiques avancés. Mais cette transformation suppose un investissement conséquent et un équilibre subtil entre attentes sociétales, contraintes techniques et rentabilité économique.
Les Échos, De TikTok aux supermarchés : comment les mochis glacés ont conquis la Gen Z, 06/05/2025
Les mochis glacés, revisite occidentale du dessert japonais traditionnel, ont connu une ascension fulgurante dans la grande distribution française, notamment grâce à une vidéo virale sur TikTok en 2021. Ce format hybride de crème glacée enveloppée dans une pâte de riz a séduit un public jeune, influencé par les tendances asiatiques et les contenus « instagrammables ». L’entreprise bretonne Tiliz, à l’origine spécialisée dans les brochettes japonaises, a su réorienter sa production pour répondre à cette demande croissante, portée par la génération Z.
Installée à Crédin, Tiliz a investi massivement pour adapter ses lignes de production, passant d’une palette produite en 2017 à plus de 35 millions de mochis vendus en 2024. L’entreprise ambitionne d’en commercialiser 50 millions en 2025. Elle fournit aujourd’hui la majorité des distributeurs sous marques distributeurs, comme Franprix, Picard, puis Carrefour. Les réseaux sociaux dictent désormais une grande partie de l’innovation produit : mochis en forme de cœur, fourrages au chocolat Dubaï ou au matcha, ou encore formats à emporter, dits “on the go”.
Le phénomène dépasse les rayons des grandes surfaces : les cinémas Pathé proposent aussi les mochis de Little Moons, marque pionnière sur le marché. Ce succès repose sur plusieurs facteurs : un produit visuellement attractif, une origine exotique mais adaptée au goût local, et une consommation compatible avec les modes de vie rapides des jeunes adultes.
Les Échos, Comment Petit Navire compte faire manger du thon à la Gen Z, 02/05/2025
Face à un marché du thon en conserve en perte de vitesse, notamment auprès des jeunes, la marque Petit Navire tente un repositionnement stratégique. Appartenant au groupe thaïlandais Thai Union, l’entreprise subit une baisse de ses ventes depuis les accusations médiatisées autour de la présence de mercure dans certaines conserves. Pour reconquérir la génération Z, elle met l’accent sur les bénéfices santé, la praticité, et une communication modernisée.
Le message principal : le thon est riche en protéines et en vitamines, avec un Nutri-score A ou B. Petit Navire souhaite le faire savoir via une nouvelle campagne de communication au slogan « Petit Navire, grande vague d’énergie », qui s’adresse clairement aux jeunes actifs soucieux de leur alimentation.
Autre levier : l’innovation produit. La marque a lancé « Et Hop », une gamme de thon en sachet souple, micro-ondable, plus facile à consommer que les boîtes classiques. Les recettes sont variées, prêtes à l’emploi (citron-basilic, sauce tomate…), avec une durée de conservation de 18 mois. Le prix est supérieur de 30 % à une boîte standard, mais jugé justifié par la praticité. Cependant, ces sachets ne sont pas encore recyclables, un point sur lequel la marque promet des progrès d’ici 2026.
En parallèle, Petit Navire doit rassurer sur les risques sanitaires. Elle affirme avoir réalisé plus de 3 000 tests de contrôle sur le mercure en huit ans, sans dépassement des seuils réglementaires. Elle publie désormais ces résultats en ligne, et annonce un doublement des contrôles dès 2025. L’enjeu est de restaurer la confiance dans un contexte où les critiques d’ONG ont eu un impact commercial fort.
La diversification est aussi au programme. Petit Navire mise sur le frais (saumon fumé, truite) pour relancer son chiffre d’affaires, avec un investissement de 18 millions d’euros sur 4 ans dans l’usine de Quimper. L’objectif est d’augmenter la capacité de production de 30 %, en modernisant les procédés de tranchage et de fumage.
LSA, Dénatalité et évolution démographique : quels enseignements pour la grande consommation ?, 09/05/2025
L’article s’intéresse à l’impact des évolutions démographiques sur la grande consommation. Vieillissement de la population, recul de la natalité, urbanisation, essor du télétravail, migrations internes : autant de transformations qui modifient la manière dont les Français consomment, stockent, cuisinent et achètent.
Le premier constat est le vieillissement accéléré des ménages. En 2040, plus d’un tiers des foyers seront composés de personnes seules, souvent âgées. Cela pousse les industriels à revoir leurs formats (plus petits), leurs packagings (plus lisibles, faciles à ouvrir), et leurs portions (adaptées à des régimes spécifiques). Le pouvoir d’achat des seniors, relativement stable, en fait une cible stratégique pour les marques.
Autre transformation majeure : l’essor du télétravail. Les repas pris à domicile se multiplient, les achats de plats préparés et de produits snacking évoluent. Le commerce de proximité se renforce, tout comme la livraison à domicile, y compris en zone périurbaine.
L’article évoque aussi l’importance croissante de l’écoresponsabilité. Les jeunes générations, moins nombreuses, mais plus exigeantes, attendent des marques des engagements forts : circuits courts, produits bio ou durables, emballages recyclables. Les produits jugés “superflus” ou “trop industriels” sont en perte de vitesse.
La montée des inégalités territoriales impacte aussi la distribution. Les zones rurales souffrent de la fermeture de commerces, tandis que les grandes villes voient exploser les formats premium ou spécialisés. Cela oblige les enseignes à adapter leur offre localement, en tenant compte des spécificités sociologiques.
Enfin, l’individualisation croissante des choix de consommation pousse à la personnalisation : régimes spécifiques (végétarien, sans gluten, etc.), parcours client sur mesure, technologies de suivi nutritionnel. Les données collectées (via cartes de fidélité, applis, etc.) deviennent un levier crucial pour répondre à cette nouvelle segmentation.
En somme, la consommation de demain sera plus fragmentée, plus exigeante, plus locale… et plus âgée. Les marques et distributeurs doivent anticiper ces mutations pour rester en phase avec une société française en pleine recomposition.
Modern Retail, In the ‘MAHA’ era, brands are under a microscope as consumers more closely scrutinize what goes into food and beverages, 07/05/2025
Dans le contexte du mouvement « Make America Healthy Again » (MAHA), les marques alimentaires font face à une surveillance croissante des consommateurs. Alimentée par les réseaux sociaux, cette tendance voit émerger une nouvelle génération d’« experts en nutrition » autoproclamés qui n’hésitent pas à dénoncer certains ingrédients ou procédés de fabrication. L’article décrit comment des entreprises comme Banza, fabricant de pâtes à base de pois chiches, ou David Protein, une jeune start-up de barres protéinées, doivent désormais anticiper ou répondre à des accusations virales.
L’affaire Banza illustre cette pression : un rapport d’association l’accuse de contenir trop de glyphosate. L’entreprise a réagi publiquement, expliquant que ses tests internes révélaient des niveaux bien inférieurs aux normes autorisées. De même, David Protein, critiquée pour l’usage de matières grasses modifiées (EPG), tente de désamorcer les polémiques en communiquant directement sur X et TikTok.
Cette ère de transparence forcée pousse les marques à intégrer les attentes en matière de santé, naturalité et traçabilité dans leur stratégie produit. Certaines, comme Lexington Bakes, vont jusqu’à afficher l’origine de chaque ingrédient directement sur l’emballage, citant leurs partenaires (Bob’s Red Mill, Wholesome Sweets). Califia Farms, de son côté, a lancé une gamme “Simple & Organic” sans huiles ni gommes controversées.
Les marques doivent désormais justifier chaque ingrédient, et certains produits subissent des controverses récurrentes (huiles de graines, édulcorants, arômes). Des applications comme Yuka ou des filtres comme le “Seed Oil Free Certified” influencent l’achat, mettant en lumière le moindre composant suspect.
Le message est clair : la performance nutritionnelle ne suffit plus. Les entreprises doivent non seulement prouver leur efficacité, mais aussi leur éthique et leur transparence. Cette pression peut être contre-productive, mais elle reflète une demande réelle de clarté dans un monde alimentaire saturé de promesses marketing. L’article conclut sur la nécessité de dialogue honnête avec les consommateurs, dans une époque où l’émotion prime souvent sur les faits, et où la moindre faille de communication peut ruiner une image de marque.
The Guardian, Deliveroo agrees £2.9bn takeover by US rival DoorDash, 06/05/2025
Deliveroo, fleuron britannique de la livraison de repas à domicile, a accepté une offre de rachat de 2,9 milliards de livres par l’américain DoorDash, leader du secteur aux États-Unis. Cette opération marque une nouvelle étape dans la consolidation du marché mondial de la livraison, dominé par une poignée d’acteurs ultra-financés.
Fondée en 2013, Deliveroo a connu une forte croissance, amplifiée durant la pandémie, mais a vu la demande chuter depuis. L’offre de DoorDash, à 180 pence par action, est bien inférieure au prix d’introduction en bourse de 390 pence en 2021, une introduction qualifiée de fiasco à l’époque. Malgré cette décote, le conseil d’administration recommande la vente, voyant dans cette alliance une opportunité stratégique.
Le fondateur Will Shu, qui détient 6,4 % du capital, devrait toucher environ 172 millions de livres. Les salariés, qui détiennent collectivement 36,5 millions d’actions, recevront près de 66 millions au total si l’opération est validée.
Le nouvel ensemble, fort de 27 700 salariés, couvrira 40 pays. DoorDash, qui emploie 23 700 personnes et travaille avec plus d’un million de livreurs, étend ainsi sa présence en Europe et au Moyen-Orient. Deliveroo, actif dans neuf pays, a récemment enregistré son premier bénéfice annuel (12 millions de livres en 2024) sur un chiffre d’affaires de 2,1 milliards.
Si la fusion pourrait entraîner jusqu’à 830 suppressions de postes dans les fonctions support, DoorDash promet de limiter les licenciements via des départs naturels et des gels d’embauche. Le siège londonien de Deliveroo sera maintenu, et les contrats avec les livreurs ne seront pas modifiés à court terme.
L’opération s’inscrit dans un double contexte : une rationalisation post-Covid du secteur de la livraison, et une pression accrue sur la rentabilité des acteurs après des années de croissance financée à perte. DoorDash, qui a aussi racheté la plateforme de réservation SevenRooms, cherche à élargir son écosystème de services.
The Washington Post, Is apple cider vinegar good for your health? Here’s what the science says, 02/05/2025
Le vinaigre de cidre jouit d’une solide réputation comme remède naturel, supposé bénéfique pour la santé. L’article examine ce que dit réellement la science sur le sujet. Plusieurs études suggèrent que le vinaigre de cidre peut aider à réduire la glycémie, améliorer légèrement le taux de cholestérol et favoriser une modeste perte de poids. Il contient également des probiotiques lorsqu’il est non pasteurisé, ce qui en ferait un allié potentiel du microbiote intestinal.
Cependant, les experts nuancent ces bienfaits. Les études disponibles sont en général de petite taille et méthodologiquement limitées. Les résultats sont souvent modestes, et les bénéfices potentiels ne sont pas garantis. En outre, le vinaigre peut interagir négativement avec certains médicaments, notamment ceux pour le diabète ou l’hypertension, et causer des effets indésirables (hypokaliémie, irritation œsophagienne, érosion dentaire).
Il est déconseillé de consommer du vinaigre de cidre pur. Les diététicien·nes recommandent plutôt de l’intégrer dans l’alimentation — vinaigrettes, marinades — ou de le diluer dans de l’eau. À faibles doses (1 à 2 cuillères par jour), il est globalement sans risque pour une personne en bonne santé.
Historiquement, le vinaigre est utilisé depuis plus de 2 000 ans, notamment par Hippocrate, pour ses vertus antiseptiques. Il est obtenu par fermentation de matières végétales (pommes, raisins, céréales), une première fois en alcool, puis en acide acétique grâce à des bactéries. Le vinaigre de cidre brut, non filtré, conserve ces micro-organismes bénéfiques, appelés « mère de vinaigre ».
L’article souligne que certaines études montrent un ralentissement de la vidange gastrique, ce qui pourrait expliquer une réduction de l’appétit et un meilleur contrôle glycémique. D’autres recherches indiquent une légère perte de poids, mais il est difficile de déterminer si c’est dû au vinaigre lui-même ou au régime hypocalorique souvent associé
Forbes, Is Erewhon, With Its $22 Smoothies, Success Or Satire?, 06/05/2025
Erewhon, chaîne de supermarchés haut de gamme à Los Angeles, est devenue une icône culturelle. Entre smoothies à 22 dollars, fraises à 19 dollars pièce et rayons impeccablement éclairés, l’enseigne incarne une vision extrême de la santé comme luxe. Fondée en 1966 à Boston par des adeptes de l’alimentation macrobiotique, Erewhon a changé de cap en s’implantant en Californie, pour épouser pleinement le modèle du bien-être marchandisé.
Aujourd’hui, avec dix magasins, l’enseigne génère plus de 170 millions de dollars de bénéfices annuels. Son succès repose sur une stratégie d’exclusivité : Erewhon ne vend pas seulement des produits, elle vend une esthétique, un style de vie. Chaque article semble faire l’objet d’un choix moral : lait cru ou pasteurisé ? viande bio ou grass-fed ? Adaptogènes ou cryothérapie ?
Loin de se moquer de l’obsession santé, Erewhon la met en valeur jusqu’à l’extrême. Le moindre achat y devient un acte symbolique, renforcé par la présence de célébrités et de produits co-signés par Hailey Bieber ou Bella Hadid. Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel : être vu avec un smoothie Erewhon, c’est afficher un statut, une discipline, une performance de santé.
Cette logique rappelle étrangement celle du roman “Erewhon” de Samuel Butler, satire du XIXe siècle où la maladie est traitée comme un crime. Ici aussi, l’obsession de pureté aboutit à une forme d’élitisme sanitaire : si vous êtes malade, c’est que vous n’avez pas pris les bons compléments ou que vous n’avez pas assez dépensé pour votre bien-être.
L’article questionne ainsi la frontière entre bien-être et ostentation, transparence et marketing. Erewhon n’est pas une parodie du monde du wellness : elle en est l’apothéose. Elle traduit une époque où la santé est devenue marchandise, et où l’alimentation se confond avec la quête de perfection corporelle.
Le succès d’Erewhon interroge : sommes-nous encore capables de distinguer une démarche santé sincère d’un simulacre destiné à flatter l’ego ? Dans une société où pour certains 19 dollars la fraise ne choque plus, l’enseigne illustre les dérives les plus performatives de l’alimentation contemporaine.
Financial Times, The resilient coffee discovery that could save our morning brew, 07/05/2025
Une découverte botanique pourrait transformer l’avenir du café face aux défis du changement climatique. Aaron Davis, spécialiste des caféiers au Royal Botanic Gardens de Kew (Royaume-Uni), a exhumé une espèce oubliée : Coffea stenophylla, originaire des plaines chaudes de Sierra Leone. Contrairement aux variétés les plus consommées (arabica et robusta), stenophylla résiste mieux à la chaleur, à la sécheresse et aux maladies tout en offrant une saveur proche de l’arabica.
Historiquement cultivée mais tombée dans l’oubli, cette espèce a été redécouverte en 2018 grâce à une collaboration entre Davis, l’expert local Daniel Sarmu, l’université de Greenwich et des ONG comme Welthungerhilfe. Des plants sauvages ont été replantés dans des parcelles expérimentales en Sierra Leone, avec l’objectif de relancer une filière locale. Le premier café issu de ces cultures est attendu en 2025.
En parallèle, une autre espèce prometteuse, Coffea excelsa, est testée en Ouganda. Ses racines profondes lui permettent de mieux résister au stress hydrique. Sa première récolte est sur le point d’arriver sur le marché britannique. Les chercheurs explorent même des greffes combinant stenophylla (goût) et excelsa (résistance), afin d’optimiser les qualités agronomiques.
Ces espèces pourraient offrir une alternative durable aux caféiers classiques, menacés par l’élévation des températures, les sécheresses et les maladies. Alors que la consommation mondiale ne cesse de croître, notamment en Afrique et en Chine, la préservation de la biodiversité caféière devient un enjeu économique et environnemental majeur.
Le projet s’inscrit dans une vision à long terme : documenter finement les conditions climatiques de culture, sélectionner les plants les plus prometteurs et construire des filières de qualité. La présence dans stenophylla de la théacrine – molécule similaire à la caféine mais sans ses effets secondaires – pourrait aussi séduire de nouveaux profils de consommateurs.
Cette redécouverte rappelle que la biodiversité est une assurance face aux bouleversements futurs. En perdant des espèces oubliées, nous perdons aussi des solutions potentielles. Coffea stenophylla n’est pas seulement une curiosité botanique : elle incarne une piste concrete pour garantir notre dose quotidienne de café face à un climat de plus en plus instable.
Food & Wine, 12 Types of Honey, From Clover to Manuka — and How to Use Them, 06/05/2025
Le miel est bien plus qu’une simple alternative au sucre : c’est un produit de terroir dont le goût et les caractéristiques varient selon la plante butinée par les abeilles. Cet article propose un tour d’horizon de 12 types de miels, en expliquant leurs origines florales, leurs propriétés et les meilleures façons de les utiliser en cuisine.
On y découvre le miel d’acacia, clair et stable, parfait pour les boissons ou les sauces, et le miel de trèfle, très courant aux États-Unis, au goût floral et doux. Le miel de sarrasin, plus sombre et intense, se prête à des plats robustes comme le saumon ou les cocktails fumés. D’autres variétés plus exotiques sont mises en avant : manuka (Nouvelle-Zélande), connu pour ses vertus médicinales ; tupelo, issu de zones marécageuses ; ou encore fireweed, appelé le “champagne du miel” pour sa finesse.
L’article rappelle aussi les différences de traitement : le miel brut (non chauffé) conserve ses enzymes et probiotiques, tandis que le miel crémeux est volontairement cristallisé pour une texture tartinable. Le miel non filtré conserve les résidus naturels de pollen et de cire. Enfin, les miels peuvent être monofloraux (issus d’une seule espèce végétale) ou polyfloraux (mélanges de plusieurs).
Chaque miel a son usage culinaire : le miel d’oranger est idéal pour les vinaigrettes, celui de sauge pour des plats de pâtes, et le miel chaud (infusé au piment) pour napper des fromages ou des viandes. L’article conseille aussi d’acheter du miel local pour une meilleure traçabilité, et de bien lire les étiquettes pour identifier la provenance et le mode de production.
Eater, Every Food Collab Now Is Completely Bonkers, 05/05/2025
L’article s’interroge avec ironie sur l’explosion actuelle des collaborations alimentaires, devenues de plus en plus absurdes. S’inspirant du mouvement dadaïste du début du XXe siècle, l’auteure Jaya Saxena compare ces collabs à une forme de résistance au non-sens ambiant : quand le monde devient illogique, la réponse commerciale semble l’être aussi.
Si les collaborations entre chefs ou marques alimentaires avaient au départ du sens (croisement d’univers culinaires, stratégie marketing ciblée), le phénomène a dérivé. Aujourd’hui, on assiste à des associations inattendues et incohérentes : une sauce piquante créée avec une marque de shampooing, un dentifrice saveur cupcake, ou une boisson énergisante inspirée d’un rouge à lèvres.
L’objectif n’est plus vraiment gastronomique, mais de générer du “buzz”, attirer l’attention à tout prix sur les réseaux sociaux, et provoquer une réaction – même de rejet. Ce brouillage des genres reflète la logique du marketing numérique : un produit ne doit plus juste être consommé, il doit être vu, partagé, commenté. Plus c’est improbable, mieux c’est.
Certaines collaborations relèvent d’un véritable “branding croisé” : Fishwife et Fly By Jing pour un saumon au piment, ou Chamberlain Coffee avec une marque de cosmétiques pour une boisson parfumée. Mais d’autres semblent sorties d’un générateur aléatoire. Cette surenchère est symptomatique d’un marché saturé, où attirer un public volatile passe par le spectaculaire.
Le phénomène touche aussi les influenceurs, les chefs et les marques DTC (direct-to-consumer). Il révèle un changement plus profond dans la consommation : l’aliment devient un support de narration, une extension de l’identité du consommateur, un média à part entière. On n’achète plus une sauce ou un mochi pour le goût, mais pour la blague, la story Instagram, le “like”.
New York Times, WeightWatchers Files for Bankruptcy Amid Wave of New Weight-Loss Methods, 07/05/2025
WeightWatchers, géant historique de la minceur aux États-Unis, a déposé le bilan alors que le marché des solutions de perte de poids est bouleversé par l’essor fulgurant des médicaments comme Ozempic ou Wegovy. L’entreprise, qui misait depuis des décennies sur un modèle fondé sur le comptage des calories, les groupes de soutien et l’abonnement à long terme, se retrouve désuète face à des traitements médicaux jugés plus rapides et efficaces.
La popularité croissante des médicaments à base de sémaglutide, initialement destinés aux diabétiques mais rapidement adoptés pour la perte de poids, a radicalement changé les attentes des consommateurs. En quelques mois, les patients ont préféré ces traitements, souvent prescrits et remboursés, aux régimes classiques. Résultat : les abonnements WeightWatchers ont chuté, et la marque peine à se réinventer.
Pour tenter de se relancer, WeightWatchers avait investi dans l’acquisition de la start-up Sequence, spécialisée dans la télémédecine et la prescription de traitements amaigrissants. Ce virage vers le médical n’a cependant pas suffi à enrayer l’hémorragie financière. Le dépôt de bilan vise à restructurer la dette, tout en maintenant les activités numériques et les consultations.
L’article souligne une tendance plus large : la perte de poids devient un marché pharmaceutique, avec des promesses médicalisées qui séduisent bien plus que les régimes fondés sur la volonté individuelle. Cette bascule remet en question l’ensemble des programmes traditionnels, y compris ceux promus par les assurances ou les employeurs.
La faillite de WeightWatchers, emblème des années 90 et 2000, est ainsi le symbole d’un changement de paradigme : de la discipline collective à l’efficacité pharmacologique individuelle. Les experts interrogés s’inquiètent cependant des effets à long terme : dépendance aux médicaments, accès inégal, ou effets secondaires encore mal connus.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey