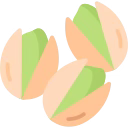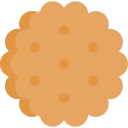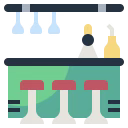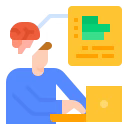🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-15
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Fauchon remet la pâtisserie au coeur de son ADN, 29/04/2025
Les Échos, Les promesses de la pistache française tout juste relancée, 29/04/2025
New York Times, Who Was Marie-Antoine Carême, the Father of French Gastronomy?, 30/04/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Libération, Nez fracturé, dénigrements, insultes… Le chef Jean Imbert accusé de violences par quatre ex-compagnes, 23/04/2025
Le médiatique chef Jean Imbert fait l'objet d'accusations graves de la part de quatre anciennes compagnes. L’enquête, publiée dans Elle le 23 avril 2025, met en lumière un "schéma répété, durable et concordant" de comportements violents et toxiques, mêlant violences psychologiques, dénigrements, jalousie maladive et dans un cas, violences physiques. L’affaire a pris une ampleur considérable dans le monde culinaire et médiatique.
Parmi les témoignages recueillis, celui de "Zoé", une ex-partenaire anonyme, évoque une emprise mentale progressive : contrôle sur ses fréquentations, commentaires humiliants sur son apparence, et surveillance constante. Un autre témoignage, signé "Éléonore", fait état de violences physiques, dont un coup de tête asséné par le chef, lui ayant fracturé le nez. Jean Imbert admet ce geste tout en affirmant qu’il aurait lui-même été victime de violences dans cette relation.
L'actrice Lila Salet, également parmi les plaignantes, affirme avoir porté plainte après que le chef a défoncé la porte de son domicile. Elle dénonce des gifles violentes et un climat de terreur psychologique. D’autres femmes, comme Kelly Santos, racontent avoir subi insultes sexistes et humiliations, entraînant des conséquences directes sur leur estime de soi et leur quotidien.
Face à ces accusations, Jean Imbert nie les faits, invoquant des "dysfonctionnements réciproques" dans ses relations. Il a transmis à la presse des messages d’ex-compagnes visant à illustrer une dynamique de couple conflictuelle et à sa décharge, produit des attestations de soutien d’autres femmes avec qui il a été en couple.
Révélé par Top Chef en 2012, Jean Imbert s’est construit une image de chef à la fois populaire et "bling-bling", proche des célébrités, de Beyoncé à Madonna. Malgré les critiques sur son manque de légitimité gastronomique lors de sa nomination au Plaza, il a décroché une étoile Michelin pour La Palme d'Or à Cannes. Cette affaire pourrait entacher durablement sa réputation et divise le milieu gastronomique entre soutien et rejet.
Libération, Soumission chimique dans la restauration : deux femmes témoignent avoir été droguées à leur insu chez Piccolo et Vecchio, 29/04/2025
L’univers branché de la restauration parisienne est secoué par des accusations de soumission chimique survenues dans deux établissements prisés de l’Est parisien : le bar Piccolo et le restaurant Vecchio. Deux professionnelles du secteur, Kim Chabaud et Adélie Vernhes, ont brisé le silence en témoignant de leur expérience, affirmant avoir été droguées à leur insu lors de soirées privées, dans un cadre à la fois festif et professionnel.
Kim Chabaud, communicante de 32 ans, dénonce un événement survenu en février 2025. Lors d’un échange amical avec Hubert Niveleau, cofondateur des deux lieux, elle affirme l’avoir surpris en train d’ajouter une poudre blanche dans son verre. Peu après, des symptômes typiques d’une intoxication au GHB apparaissent : bouffées de chaleur, désorientation, mâchoire serrée. Transportée aux urgences, les médecins évoquent la possible ingestion de GHB. Chabaud, soutenue par des témoins, a porté plainte pour "administration de substance nuisible avec préméditation". Elle souligne que son cas démontre que ce genre de danger peut survenir même dans un cadre réputé sûr.
Peu après la diffusion de ce témoignage sur Instagram, une autre femme, Adélie Vernhes, se reconnaît dans le récit. Elle évoque des symptômes similaires vécus en janvier 2024, alors qu’elle était en poste dans une agence de relations presse liée à Vecchio. Bien qu’elle n’ait pas vu qui aurait pu la droguer, elle raconte s’être sentie trahie par la structure dans laquelle elle travaillait et alerte sur le silence pesant autour de ces pratiques. Son témoignage suggère que ce ne sont pas des faits isolés, mais que d'autres victimes pourraient exister.
Face à ces accusations, Hubert Niveleau nie fermement les faits et parle de diffamation. Le groupe Perchoir, gestionnaire des lieux, a suspendu sa collaboration avec lui et ouvert une enquête interne. En parallèle, Time Out Paris a retiré Vecchio de sa sélection pour ses Food & Drink Awards.
Les Échos, Fauchon remet la pâtisserie au coeur de son ADN, 29/04/2025
Un an après son rachat par le groupe breton Galapagos, la maison Fauchon opère un retour stratégique à ses origines pâtissières en prenant une participation majoritaire dans la maison du célèbre pâtissier Arnaud Larher. Cette opération marque une nouvelle étape dans la relance de l'iconique marque parisienne, qui entend renouer avec sa vocation première : l’excellence en pâtisserie française.
Longtemps centrée sur les macarons, chocolats, thés et produits d’épicerie fine, l’offre de Fauchon s’était éloignée des créations pâtissières classiques telles que les éclairs, au grand dam d’une clientèle fidèle. Grâce à l’acquisition d’Arnaud Larher, Meilleur Ouvrier de France, Fauchon ambitionne de remettre ces produits phares au cœur de ses boutiques parisiennes. Le laboratoire de Larher — qui a d’ailleurs déjà travaillé chez Fauchon dans les années 1990 — servira de base commune pour développer une gamme renouvelée, nourrie de créativité et de tradition.
Pour Jérôme Tacquard, président de Fauchon, cette collaboration redonne un rôle central à la pâtisserie dans l’identité de la maison. Il compare cette alliance à la combinaison d’une partition riche en recettes avec un chef d’orchestre inspiré, capable de la sublimer. La démarche met fin à un paradoxe : à l’international, notamment au Japon, les boutiques Fauchon proposaient encore des pâtisseries, contrairement aux points de vente français.
Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation. Fauchon a déjà ouvert un atelier de production de macarons à Yerres, en Essonne, pour répondre à la demande croissante. Côté développement, l’enseigne accélère son expansion à l’international avec de nouveaux magasins prévus à Dubaï, Doha, New York et Nice. L’hôtellerie de luxe, désormais confiée à des partenaires sous licence, fait également partie de la stratégie de croissance, avec deux ouvertures prévues en Arabie Saoudite en 2026.
Malgré une année 2024 qualifiée de transition, les ventes annuelles de Fauchon restent stables à 100 millions d’euros. Le groupe entend désormais doubler de taille d’ici cinq ans en capitalisant sur ses investissements, son image de marque haut de gamme et son ancrage historique dans la pâtisserie française.
Les Échos, Petits pains, viennoiserie : le groupe Le Duff pousse les feux en Australie et aux Etats-Unis, 23/04/2025
Le groupe agroalimentaire breton Le Duff, propriétaire notamment de Bridor, accélère sa stratégie d’expansion à l’échelle mondiale en investissant massivement dans la boulangerie industrielle premium. Le 23 avril 2025, il a annoncé deux opérations majeures : le rachat de Laurent Bakery, leader australien de la viennoiserie, et la transformation de son site Frial de Falaise (Calvados) en une nouvelle usine Bridor. Un plan d’investissement de 100 millions d’euros accompagne cette initiative.
Fondée par le chef français Laurent Boillon, Laurent Bakery produit 40 000 tonnes annuelles de pain et viennoiseries depuis ses usines de Melbourne, avec une forte inspiration française. L’entreprise emploie 500 salariés, dispose de 18 points de vente en propre et réalise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros. Cette acquisition renforce la présence de Le Duff dans la zone Asie-Pacifique, où l’industriel avait déjà doublé la capacité de son site de Pékin.
En parallèle, la croissance du marché nord-américain, estimée à +3 % par an, pousse Le Duff à doubler la capacité de son site de Vineland, près de Philadelphie, et à construire de nouvelles unités au Texas et dans l’Utah. Cette dernière, avec un investissement de 200 millions d’euros, sera dédiée à des produits de haute qualité : pains de longue fermentation, ciabatta, viennoiseries fourrées sucrées ou salées. Ce sera la quatrième implantation du groupe aux États-Unis.
Le plan global d’investissement du groupe Le Duff prévoit 500 millions d’euros sur la période 2024-2027, répartis à 40 % pour l’Amérique du Nord, 40 % pour l’Europe, et 20 % pour l’Asie-Pacifique. Cette stratégie illustre la volonté de renforcer son outil de production tout en consolidant sa position de leader international dans le secteur de la boulangerie.
Toujours dirigé par son fondateur Louis Le Duff, le groupe est présent dans plus de 100 pays et prévoit de réaliser 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, dont 2,5 milliards grâce à sa filiale Bridor. Ce développement ambitieux témoigne d’un positionnement haut de gamme, fondé sur l’innovation, la qualité française et une logistique industrielle performante.
L’Usine Nouvelle, L'IA de la start-up lyonnaise M&Wine rivalise avec des sommeliers dans une dégustation à l’aveugle, 29/04/2025
La start-up lyonnaise M&Wine bouscule les codes de la dégustation œnologique grâce à une intelligence artificielle capable d’identifier l’origine et les caractéristiques d’un vin avec une précision inédite. Lors d’un concours organisé en mars 2025, son IA a surpassé des sommeliers professionnels dans une épreuve à l’aveugle, démontrant un potentiel technologique prometteur pour l’authentification des vins.
Fondée sur la méthode du Mineral Wine Profile (MWP), la technologie développée par M&Wine s’appuie sur l’analyse de la composition minérale du vin. Cette signature chimique unique, déterminée par la concentration en éléments métalliques naturels (zinc, cuivre, fer…), est moins sujette à variation que les arômes ou goûts, influencés par l’environnement, l’élevage ou le vieillissement. Deux millilitres de vin suffisent pour effectuer l’analyse, réalisée par spectrométrie de masse.
Lors du test, l’IA a identifié avec 100 % de réussite le pays d’origine des échantillons, 83 % des régions et des cépages. À titre de comparaison, les sommeliers n’ont obtenu que 50 % de bonnes réponses pour les pays et les cépages, et seulement 20 % pour les régions. Cette performance, bien que remarquable, s’appuie néanmoins sur une base de données préexistante contenant les profils analysés : l’IA ne peut identifier un vin inconnu sans référence préalable.
M&Wine ambitionne de faire du MWP un standard d’authentification dans un secteur viticole confronté à une augmentation des fraudes. Loin de vouloir remplacer les experts humains, la start-up positionne son outil comme un complément fiable et transparent, permettant de vérifier l’origine géographique d’un vin ou d’assister les œnologues dans les assemblages.
Avec plus de 35 000 profils minéraux déjà enregistrés, M&Wine prévoit d’élargir encore sa base de données. Elle envisage aussi d’orienter ses applications vers la personnalisation des recommandations pour les consommateurs, en associant préférences gustatives et signatures minérales. Si la technologie suscite déjà l’intérêt de nombreux acteurs du monde viticole, son adoption généralisée reste conditionnée à sa capacité à sortir du laboratoire pour se démocratiser auprès des professionnels et des consommateurs. Mais elle illustre un tournant dans l’œnologie moderne, où l’IA devient un nouvel allié de la traçabilité et de la transparence.
Les Échos, La guerre du tiramisu n'aura pas lieu, 19/04/2025
Le tiramisu fait l’objet d’un débat passionné en Italie sur ses origines exactes, opposant deux régions voisines : la Vénétie et le Frioul-Vénétie-Julienne. Loin d’être une simple querelle gastronomique, ce conflit autour de la paternité du tiramisu touche à l’identité culturelle et à l’héritage régional, révélant l’attachement viscéral des Italiens à leurs traditions culinaires.
À l’origine de cette rivalité, un décret de 2017 inscrivant le tiramisu du Frioul sur la liste des produits alimentaires traditionnels (PAT), provoquant l’ire du gouverneur de Vénétie, Luca Zaia. Ce dernier, revendiquant l’invention du dessert à Trévise dans les années 1960 au restaurant Le Beccherie, a tenté de faire enregistrer le tiramisu comme spécialité traditionnelle garantie (STG) au niveau européen, à l’image de la pizza napolitaine.
L’histoire du tiramisu reste floue. La version moderne est attribuée à Roberto "Loli" Linguanotto, qui l’aurait créée en associant mascarpone, jaunes d’œufs, sucre, biscuits cuillères, café et cacao, sans alcool. Mais d’autres voix s’élèvent : à Tolmezzo, le fils de Norma Pielli affirme que sa mère a inventé le dessert dans les années 1950, tandis qu’à Trieste, on cite le cuisinier Mario Coloso comme auteur d’une version en 1938. En 1981, le critique Giuseppe Maffioli publie une recette dans la revue Vin Veneto, la popularisant dans toute l’Italie.
Au-delà du débat historique, le tiramisu est devenu un phénomène mondial. Il se décline aujourd’hui en une multitude de versions créatives : au limoncello, au caramel, voire au jambon et melon. Une coupe du monde du tiramisu est organisée depuis 2017 à Trévise, attirant des centaines de candidats. Cette diversité n’efface pas la version canonique, mais démontre l’universalité du dessert.
Selon l’historien de l’alimentation Alberto Grandi, le tiramisu est un produit du boom économique des années 1960, rendu possible par la généralisation du réfrigérateur et la production industrielle du mascarpone. Ce dessert, devenu symbole du made in Italy, est aujourd’hui davantage une marque planétaire qu’un sujet de dispute régionale. Comme le résume un des organisateurs de la Coupe du Monde du Tiramisu : « la seule vraie recette, c’est celle qui vous plaît ».
Le Monde, Gastronomie : l’asperge, à la pointe du goût, 24/04/2025
L’asperge, légume printanier noble et exigeant, revient chaque année dans les assiettes entre février et juin, portée par un regain d’intérêt gastronomique. Cultivée majoritairement dans le Val de Loire, le Sud-Ouest, l’Alsace ou le littoral méditerranéen, elle reste cependant un produit coûteux, vendu jusqu’à 20 euros le kilo, ce qui en limite l’accès à une clientèle plutôt âgée et aisée.
Christophe Paillaugue, président de l’association Asperges de France, souligne cette image "embourgeoisée" du légume, souvent servi en majesté, seul, et accompagné d’une sauce hollandaise. Pour séduire une nouvelle génération de consommateurs, la filière mise sur des approches créatives et des transformations culinaires. Chefs et influenceurs réinventent l’asperge, la proposant panée façon japonaise, crue dans des poke bowls ou encore déclinée en chips sucrées dans des desserts.
Au château de Rochecotte, la cheffe Emmanuelle Pasquier détourne les codes classiques en associant l’asperge à des notes florales ou des influences asiatiques. À Paris, Michaël Gamet, du bistrot Mâche, ose la servir en entrée, en panna cotta, et même en dessert sur une mousse au lait d’amande.
Ce renouveau gastronomique s’accompagne d’un travail rigoureux en amont, notamment dans la quête de labellisation. Guillaume Thomas, producteur à Saint-Mathurin-sur-Loire, mène une démarche pour obtenir une Indication Géographique Protégée (IGP) pour l’asperge du Val de Loire d’ici 2027. L’IGP, comme le Label Rouge, permettrait de valoriser la qualité et l’origine des asperges françaises face à la concurrence des asperges étrangères, notamment hollandaises.
La culture de l’asperge reste difficile et dépendante d’une main-d’œuvre saisonnière fidèle et rapide. En raison de sa fragilité, elle doit être récoltée à la main, triée, refroidie rapidement et conditionnée dans les quatre heures. La mécanisation reste limitée pour ne pas altérer la qualité du produit.
Face au vieillissement de sa clientèle, la filière tente également de rajeunir son image en misant sur la version verte, plus fine, croquante, moins amère et plus facile à préparer. Portée par les réseaux sociaux et les tendances locavores, l’asperge verte rencontre un nouveau public, à même d’assurer la relève et de prolonger la place de ce légume d’exception dans la gastronomie française.
Le Monde, Les Grands Chais de France, un empire aussi puissant que discret, 21/04/2025
Peu connu du grand public mais incontournable dans le secteur viticole, le groupe Les Grands Chais de France (GCF) est le premier producteur de vins et spiritueux en Europe et le principal exportateur français. Fondé en 1979 à Petersbach en Alsace par Joseph Helfrich, ce groupe familial au chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros contrôle toute la chaîne du vin : de la vigne à la mise en bouteille, en passant par le marketing et la distribution.
La stratégie initiale de GCF repose sur le négoce : acheter des vins ou des jus en vrac, souvent dans le Languedoc, les assembler, les embouteiller, leur apposer une marque forte (comme J.P. Chenet, célèbre pour sa bouteille au col penché), et les commercialiser à grande échelle, notamment dans les supermarchés. Aujourd’hui, GCF écoule 500 millions de bouteilles par an dans 173 pays, et réalise 80 % de son chiffre à l’international.
Discret mais redoutablement efficace, le groupe ne se limite pas à la grande distribution. Il possède 75 domaines viticoles en France, Espagne et Chili, représentant plus de 3 500 hectares de vignes, et s’est récemment engagé dans une montée en gamme via des acquisitions prestigieuses en Bourgogne, Bordeaux, Loire ou encore Provence. Parmi les marques intégrées : Moillard, Calvet, Château Belles-Eaux ou Château Bastor-Lamontagne.
GCF développe aussi un important réseau industriel, avec des sites d’embouteillage de grande envergure comme celui de Landiras (Gironde), le plus vaste d’Europe. L’entreprise est capable de conditionner des millions de bouteilles par jour et attire des talents qu’elle fidélise, preuve de son attractivité dans un secteur concurrentiel.
Malgré son succès, le groupe n’échappe pas aux tensions. Son rachat de la maison Béjot à Meursault, contesté par un concurrent, a conduit à une enquête judiciaire, dont Joseph Helfrich est sorti blanchi après cinq années de procédure.
Allié à l’Allemand Gunther Bimmerle, son partenaire historique, Joseph Helfrich a aussi investi massivement en Allemagne, Hongrie et Europe de l’Est. Ensemble, ils forment un duo au sommet du classement des grandes fortunes françaises. Leur modèle unique d'intégration verticale et d’agilité commerciale place GCF comme un acteur central du vin mondial, aussi puissant que méconnu.
Les Échos, Les promesses de la pistache française tout juste relancée, 29/04/2025
Dans un contexte mondial marqué par une demande en forte croissance, la relance de la culture de la pistache en France ouvre de nouvelles perspectives agricoles. Après des décennies d’absence, la filière renaît progressivement, avec une première récolte significative réalisée en 2024, portée par une centaine de producteurs sur environ 500 hectares, principalement en Provence, Occitanie et Corse.
Cette dynamique s’inscrit dans une tendance globale : selon la FAO, la production mondiale de pistaches a crû en moyenne de 8 % par an au cours de la dernière décennie. Le succès commercial de produits comme le "chocolat Dubaï", fourré à la crème de pistache, a contribué à cette envolée. Parallèlement, les États-Unis, leaders mondiaux de la production, pourraient bientôt voir leurs exportations vers l’Europe taxées, en raison de tensions commerciales. Cette perspective renforce l’intérêt stratégique d’une production nationale, même encore embryonnaire.
Le redémarrage de la filière française s’est initié en 2018 avec la création de l’association Pistache en Provence, suivie en 2021 par la structuration en syndicat professionnel : France Pistache. À sa tête, André Pinatel, déjà artisan du retour de l’amande française, entend faire de la pistache une culture d’avenir. Patiente mais prometteuse, cette plante ne donne ses premiers fruits qu’après six ans, ce qui rend chaque récolte symbolique. En 2024, environ 700 kg de pistaches brutes ont été récoltés — un volume encore modeste, mais porteur d’espoir.
Les professionnels insistent sur le potentiel de diversification que représente cette culture pour les arboriculteurs ou vignerons du Sud, en particulier dans un contexte de changement climatique. Le pistachier, peu gourmand en eau, a été identifié comme espèce adaptée dans le cadre du Varenne agricole de l’eau. Certaines collectivités soutiennent les conversions avec des aides financières, tandis que les chambres d’agriculture forment des techniciens pour accompagner la transition.
À ce stade, la France se positionne sur un marché haut de gamme, à rebours du modèle espagnol basé sur la culture intensive (80 000 hectares en Espagne). Cette orientation sélective attire déjà l’attention de chefs renommés comme Pierre Hermé, et des entrepreneurs engagés comme Olivier Baussan, fondateur de L’Occitane, qui développe une enseigne dédiée à la pistache en Provence.
Le lancement de la marque “Pistaches de France” vise à créer une identité forte pour valoriser cette production locale. À moyen terme, la filière ambitionne l’obtention d’une Indication Géographique Protégée (IGP), gage de qualité et d’origine contrôlée. Si la route reste longue, l’engouement croissant autour de ce fruit sec pourrait bien ancrer durablement la pistache dans le paysage agricole français.
Le Monde, Le matcha, trop populaire, risque la pénurie, 30/04/2025
Le matcha, poudre de thé vert japonaise prisée pour ses vertus antioxydantes et son goût végétal légèrement amer, est victime de son immense succès mondial. Depuis fin 2024, une vague d’enthousiasme planétaire portée par les réseaux sociaux — avec plus de 8,6 millions de publications sous le hashtag #matcha sur Instagram — a provoqué une flambée de la demande, au point de mettre l’ensemble de la filière sous pression, menaçant l’approvisionnement mondial.
À Paris, l’engouement est particulièrement visible rue Sainte-Anne, où touristes et locaux font la queue pour un latte, une pâtisserie ou une glace au matcha. Des établissements comme Creamy Daily ou Shodai Matcha témoignent d’un bouleversement logistique. Là où les commandes se faisaient mensuellement, les délais de livraison s’étendent désormais sur deux à trois mois, contraignant les professionnels à anticiper fortement leurs besoins ou à limiter leur offre.
Au Japon, des producteurs historiques comme Ippodo ou Marukyu Koyamaen peinent à suivre le rythme. En décembre 2024, Ippodo a instauré une limitation à un produit par commande, faute de stocks suffisants. Le phénomène ne touche pas seulement la France : la chaîne de production est sous tension à l’échelle mondiale, selon plusieurs marques en ligne telles que Noka Matcha ou Matcha & Co, qui enregistrent des hausses de ventes allant jusqu’à +50 % en un an.
La situation est d’autant plus critique que la production de tencha (la feuille de thé brute utilisée pour le matcha) demande un travail manuel long, minutieux et hautement qualifié. Or, entre 2020 et 2023, le Japon a perdu près de 200 000 agriculteurs, majoritairement âgés de plus de 65 ans. Le manque de relève compromet la capacité de production, malgré une croissance déjà soutenue : la production de tencha a triplé entre 2012 et 2023, passant de 1 430 à 4 176 tonnes.
Face à cet emballement, les producteurs tentent d’augmenter les capacités de broyage et d’allonger les horaires de production, mais la pénurie de main-d’œuvre reste un obstacle majeur. La tension pourrait aussi limiter l’accès au produit pour les nouveaux clients professionnels.
Ce phénomène révèle un paradoxe : le matcha, symbole de tradition et de lenteur, se trouve confronté à l’accélération effrénée du monde digital et de la consommation mondialisée, au risque de devenir… victime de sa propre hype.
Inc, 9 Food Tech Companies to Watch, 21/04/2025
Dans un contexte où les levées de fonds pour la Food Tech ont fortement chuté – seulement 2,8 milliards de dollars au dernier trimestre 2024 –, certaines entreprises émergent malgré tout comme des acteurs clés de l’innovation alimentaire. L’article met en lumière neuf start-ups américaines qui transforment en profondeur les pratiques du secteur, en misant sur la nutrition fonctionnelle, la durabilité, l’intelligence artificielle et l’optimisation logistique.
Parmi les sociétés notables figure Aloha, basée dans le Connecticut, qui développe des barres et boissons protéinées à base de plantes. Grâce à une stratégie de sourcing hawaiien et une croissance de 80 % de ses revenus en un an, elle a dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires.
Bloom, spécialiste des compléments nutritionnels à base de “greens powder”, s’est diversifiée avec succès dans les boissons énergétiques et sodas sains. Forte d’un partenariat stratégique avec Keurig Dr Pepper, la marque s’apprête à concurrencer Olipop et Poppi.
C16 Biosciences, financée en partie par la Fondation Gates, produit une alternative de laboratoire à l’huile de palme, d’abord destinée aux cosmétiques et bientôt aux aliments. Leur produit phare, Palmless, repose sur un processus de fermentation durable.
FreshFry, à Louisville, propose des pods filtrants conçus à partir de déchets alimentaires pour prolonger la durée de vie des huiles de friture. Elle séduit les chaînes comme Church’s et IHOP grâce à une promesse d’économies et de durabilité.
Dans la logistique, Grip, cofondée par un ancien cadre de ButcherBox, permet aux marques D2C d’expédier des produits frais partout aux États-Unis en moins de 24 heures.
Grüns mise sur les gummies nutritionnelles comme alternative aux poudres. Avec 4 millions d’unités expédiées chaque jour et une valorisation de 500 millions de dollars, elle cible notamment les consommateurs sous traitement amaigrissant.
HumanN, experte des compléments à base de betterave, continue sa percée auprès d’athlètes et de consommateurs soucieux de leur tension artérielle.
Regrow Ag, à la croisée de l’agro et de l’IA, aide les agriculteurs à optimiser leurs cultures grâce à des outils satellitaires. L’entreprise travaille déjà avec Nestlé et PepsiCo.
Enfin, Voyage, basée en Californie, développe des substituts “beanless” pour le café et le chocolat. Remplaçant les matières premières traditionnelles par des alternatives plus durables (pois chiches, avoine, etc.), elle est soutenue par un prêt du USDA et un partenariat avec Cargill.
Ces start-ups dessinent les contours d’un nouvel écosystème alimentaire, à la fois technologique, responsable et adapté aux exigences nutritionnelles contemporaines.
The Washington Post, Is brown rice actually healthier than white rice?, 28/04/2025
La supériorité nutritionnelle du riz complet par rapport au riz blanc fait l’objet d’un consensus historique parmi les nutritionnistes. Le riz complet contient près de six fois plus de fibres, davantage de minéraux (magnésium, potassium, fer) et de vitamines B. Des études montrent que la consommation de céréales complètes, comme le riz brun, est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité et de certains cancers.
Cependant, ces dernières années, une controverse s’est installée autour de la présence d’arsenic dans le riz brun, relancée par des influenceurs santé sur les réseaux sociaux. L’arsenic, un métal lourd, est lié à des pathologies graves comme le cancer ou les troubles neurologiques. Le riz, et particulièrement le riz brun, tend à en accumuler davantage car l’arsenic se concentre dans le son, cette couche externe conservée dans le riz complet.
Des études récentes tempèrent toutefois ces inquiétudes. Les niveaux d’arsenic présents dans le riz consommé aux États-Unis sont en général faibles et bien en deçà des seuils de danger pour la majorité de la population. Il faudrait une consommation très excessive et régulière pour que cela devienne problématique. Des groupes vulnérables, notamment les jeunes enfants et les nourrissons, restent cependant plus exposés et doivent limiter leur consommation.
Il est possible de réduire la teneur en arsenic du riz grâce à des pratiques simples : par exemple, le faire tremper avant cuisson et utiliser une grande quantité d’eau pour la cuisson (technique du “rinçage à chaud”) permet de diminuer jusqu’à 60 % la teneur en arsenic.
Les experts interrogés soulignent que les bienfaits du riz complet surpassent largement les risques liés à l’arsenic, du moment que l’alimentation reste variée. Ils recommandent par ailleurs de diversifier les sources de céréales (quinoa, millet, avoine, etc.) pour réduire toute exposition excessive à une seule catégorie d’aliment.
Food & Wine, Here's the Surprising Secret History of America's Most Popular Snack Cracker, 24/04/2025
Derrière l’un des produits les plus emblématiques des rayons américains – les crackers Ritz – se cache l’histoire personnelle et méconnue d’un artiste de l’ombre, Sydney S. Stern, qui transforma une tragédie familiale en une carrière prolifique dans l’art commercial au sein de Nabisco. À travers les souvenirs familiaux de Daisy Alioto l’article retrace le parcours de cet homme qui a littéralement redéfini l’esthétique du snacking aux États-Unis.
Immigrant d’origine hongroise, Stern s’est affirmé comme illustrateur autodidacte dans les années 1920. Lorsque sa femme meurt en 1928, il se retrouve seul avec trois jeunes enfants. Il accepte alors un poste stable chez Nabisco, ce qui marque le début d’un partenariat durable et décisif. En 1935, en pleine Grande Dépression, Nabisco lui confie une mission cruciale : créer un emballage capable de concurrencer les crackers Sunshine. Stern trouve l’inspiration dans l’étiquette circulaire de son chapeau et conçoit le désormais célèbre logo bleu et jaune “Ritz”, incarnation d’un luxe accessible qui séduit instantanément le public.
Stern ne s’est pas arrêté aux crackers Ritz. Il a aussi marqué l’histoire de la marque avec le design de la boîte Barnum’s Animal Crackers, en y ajoutant un ours polaire blanc pour casser la monotonie chromatique, ainsi qu’une ficelle sur certaines versions pour que la boîte puisse être utilisée comme un ornement — innovation simple mais emblématique. Il a également participé à l’évolution de l’emballage des céréales Shredded Wheat, rendant peu à peu le produit plus visible que l’usine figurant en arrière-plan, une subtilité graphique qui a contribué à forger la mémoire visuelle des consommateurs.
Resté 31 ans chez Nabisco, Stern a pris sa retraite en Floride, où il s’est investi dans la scène artistique locale. À 95 ans, une exposition lui est consacrée à la Beaux Arts Gallery de Pinellas Park, et il est intronisé dans le Ritz Hall of Fame — une reconnaissance tardive, rendue possible par la persévérance de sa famille.
Cet hommage posthume rappelle que le packaging, longtemps ignoré comme forme d’art, a été réhabilité par le pop art. Sydney Stern, bien avant Warhol, a contribué à faire de l’emballage un objet culturel. Et si les produits qu’il a embellis continuent à trôner dans nos placards, c’est aussi parce qu’ils ont su marier accessibilité, nostalgie et une subtile sophistication graphique.
Punch Drink, Anatomy of a Modern “It” Bar, 25/04/2025
L’article explore les ressorts du succès des bars dits “It Bars”, ces établissements ultra-tendance qui captivent à la fois les critiques, les professionnels et les consommateurs urbains. Bien au-delà de leur carte de cocktails, ces lieux incarnent une esthétique, une ambiance et une stratégie commerciale à part entière, marquant un tournant dans la culture de la consommation nocturne.
Loin du modèle classique du speakeasy ou du bar à cocktails savamment codé, le “It Bar” moderne joue la carte de l’accessibilité cool, de la désinvolture bien étudiée et de l’hybridation des formats. Ce sont des bars souvent modestes en taille, mais extrêmement soignés dans leur mise en scène : lumière tamisée, mobilier vintage mais ergonomique, bande-son soigneusement choisie, personnel jeune, affable et stylé. L’ambiance semble improvisée, mais chaque détail relève d’un calibrage quasi scénographique.
Les boissons elles-mêmes participent à cet équilibre : des cocktails techniques, mais sans esbroufe, côtoient des bières locales, des vins naturels ou des highballs au soda artisanal. La carte change fréquemment, illustrant une agilité et une créativité permanente. L’accent est mis sur la saisonnalité, l’approvisionnement local et des ingrédients maison – sirops, infusions ou liqueurs customisées.
Ce qui distingue surtout ces bars est leur capacité à créer une communauté. Ils deviennent des lieux d’ancrage social, de retrouvailles culturelles, où la clientèle se fidélise autant pour l’atmosphère que pour les boissons. L’article insiste sur la force des “it bars” à fonctionner comme des micro-marques, dont l’identité se diffuse via Instagram, TikTok ou les recommandations de bouche-à-oreille d’une clientèle jeune et connectée.
Un autre pilier de leur succès réside dans leur ancrage local couplé à une esthétique globale. Ces établissements réussissent à incarner une ville ou un quartier tout en adoptant des codes universels du lifestyle contemporain, ce qui les rend réplicables ailleurs. Certains deviennent des incubateurs de talents ou le point de départ de groupes hôteliers plus ambitieux.
New York Times, Who Was Marie-Antoine Carême, the Father of French Gastronomy?, 30/04/2025
Marie-Antoine Carême, souvent désigné comme le "père de la gastronomie française", a profondément marqué l’histoire culinaire au tournant du XIXe siècle. L’article revient sur la vie et l’héritage de ce cuisinier visionnaire, qui a élevé la cuisine au rang d’art et a posé les bases de la haute gastronomie telle qu’on la connaît aujourd’hui.
Né à Paris en 1784 dans une famille modeste, Carême commence à travailler très jeune dans les cuisines pour fuir la pauvreté. Il est remarqué par le pâtissier Sylvain Bailly, qui lui donne sa première chance. Doué, Carême excelle dans l’art du sucre et de la pâtisserie architecturale, réalisant des pièces montées monumentales inspirées de monuments antiques. Il attire rapidement l’attention des élites.
Carême devient le chef attitré de grandes maisons aristocratiques, notamment celles de Talleyrand et du Tsar Alexandre Ier. Il est l’un des premiers à codifier la cuisine française, à lui donner un langage structuré et un raffinement systématique. Il formalise notamment la classification des sauces mères (espagnole, béchamel, velouté…), encore enseignées aujourd’hui en écoles de cuisine.
L’un de ses apports les plus durables est d’avoir conceptualisé le rôle du chef comme créateur, à une époque où la cuisine restait cantonnée aux coulisses. Carême voit la cuisine comme un art et le chef comme un artiste. Il rédige plusieurs ouvrages majeurs, dont L’Art de la cuisine française au XIXe siècle, véritables traités culinaires mêlant recettes, techniques, réflexions esthétiques et structures de menus.
Il est aussi l’inventeur du "service à la russe", où les plats sont servis successivement, remplaçant le "service à la française" (tous les plats sur la table en même temps). Cette approche, plus logique et plus lisible, influence durablement le déroulé des repas en Occident.
Mort à 48 ans, Carême laisse un héritage immense. Ses écrits et techniques inspireront Escoffier, Bocuse et d’autres figures majeures. Aujourd’hui encore, il est célébré comme le premier grand chef moderne, celui qui a fait passer la cuisine du statut de nécessité domestique à celui de discipline artistique et professionnelle reconnue à l’échelle internationale.
New York Times, A Sign That Consumers Are Anxious: They’re Cutting Back on Snacks, 24/04/2025
L’article analyse un indicateur révélateur des tensions économiques actuelles aux États-Unis : les consommateurs réduisent leurs achats de snacks, un segment traditionnellement résilient même en période de crise. Cette tendance inattendue témoigne d’un changement profond dans les habitudes de consommation, guidé par l’inflation, l’incertitude économique et un retour à une forme de frugalité.
Des géants comme PepsiCo et Mondelez, propriétaires de marques comme Doritos, Cheetos ou Oreo, constatent une baisse significative des ventes en volume. Les ménages américains, toutes catégories sociales confondues, achètent moins de produits impulsifs et privilégient les achats essentiels. Même les snacks considérés comme abordables sont devenus des postes de dépense secondaires dans des budgets de plus en plus contraints.
Cette baisse n’est pas uniquement due à la hausse des prix – bien que celle-ci ait été marquée ces deux dernières années. Elle reflète également une fatigue face à la consommation excessive et un recentrage sur des pratiques plus sobres. Dans certaines familles, le snack est désormais réservé aux enfants, et de plus en plus de consommateurs reviennent à des alternatives faites maison ou à des produits de base moins transformés.
L’article souligne que cette évolution touche aussi bien les produits salés que sucrés, ainsi que les formats pratiques comme les barres, les portions individuelles ou les biscuits à emporter. Les ventes baissent même dans les enseignes de discount ou lors des promotions. Des données d’IRI et de Nielsen confirment cette contraction du marché.
Ce changement de comportement inquiète les industriels, car le snack est historiquement un vecteur de marges élevées et de fidélité à la marque. Certains groupes testent donc des stratégies pour reconquérir les consommateurs : formats familiaux plus économiques, innovations nutritionnelles (protéines, fibres, moins de sucre), et messages marketing plus ancrés dans la “valeur”.
Forbes, Climate Change Serendipity: A Bordeaux Grand Cru Winery Makes Authentic Japanese Soy Sauce, 29/04/2025
Voilà un exemple inattendu d’adaptation climatique et de diversification agroalimentaire : le Chateau Coutet, à Saint-Émilion, s’est lancé dans la production… de sauce soja japonaise artisanale. L’article explore cette initiative surprenante qui conjugue tradition vinicole, savoir-faire fermentaire et innovation face aux effets du réchauffement climatique.
Le domaine a connu au fil des dernières années une succession de vendanges perturbées par des aléas climatiques : gel tardif, sécheresses, canicules. Cette instabilité pousse les viticulteurs à réfléchir à des solutions complémentaires pour préserver la viabilité économique de leurs exploitations. Inspiré par les similitudes entre les processus de vinification et de fermentation de la sauce soja (shoyu), le domaine entame une collaboration avec un maître brasseur japonais, expert en fermentations traditionnelles à base de koji (Aspergillus oryzae). Le projet vise à produire une sauce soja haut de gamme, en petites quantités, en utilisant du blé et du soja issus de l’agriculture bio locale, et une eau de source filtrée sur le domaine même.
Les premières barriques de shoyu sont affinées dans les mêmes chais que les vins, utilisant des techniques japonaises ancestrales. Le résultat est une sauce à la robe dense, au parfum umami complexe, et une profondeur aromatique que les chefs gastronomiques saluent déjà. Plusieurs restaurants étoilés en France et à l’étranger ont manifesté leur intérêt.
L’initiative illustre une tendance plus large dans les régions viticoles confrontées au changement climatique : la recherche de résilience économique via la diversification, sans pour autant renier leur identité. Ici, la production reste artisanale, respectueuse des terroirs et du temps long – des valeurs communes au vin et à la fermentation japonaise.
En parallèle, ce projet reflète aussi l’évolution des goûts des consommateurs haut de gamme, friands de produits hybrides, authentiques et exclusifs. La sauce soja, souvent industrialisée et banalisée, retrouve ici son statut de produit noble. Le domaine entend en faire une production régulière, complémentaire à son activité viticole, et potentiellement exportable.
The Spoon, From Starday to Shiru to Givaudan, AI Is Now Tablestakes Across the Food Value Chain, 28/04/2025
L’intelligence artificielle (IA) est désormais incontournable dans toute la chaîne de valeur agroalimentaire, du développement produit à la logistique, en passant par la formulation, le marketing et la durabilité. L’article explore comment des acteurs très divers – de jeunes start-ups comme Starday ou Shiru, aux géants comme Givaudan – intègrent l’IA comme un standard de l’innovation alimentaire contemporaine.
Starday, start-up fondée par l’ancien directeur marketing de Google, applique une logique radicalement data-driven à la création de produits alimentaires : les tendances consommateurs sont analysées via les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les feedbacks en ligne pour formuler des produits “prêts à vendre”. C’est ainsi qu’ils ont lancé des chips allégées en sodium ou une pâte à tartiner protéinée, conçues avec une vitesse et une précision quasi algorithmique.
Shiru, de son côté, utilise le machine learning pour identifier des protéines alternatives dans des bases de données biologiques. Objectif : remplacer les additifs issus d’animaux ou d’ingrédients controversés par des composés plus durables. Grâce à l’IA, l’entreprise peut modéliser les propriétés fonctionnelles d’un ingrédient avant même de l’extraire physiquement.
Quant au géant suisse Givaudan, fournisseur mondial d’arômes et d’ingrédients, il a mis en place un “culinary experience hub” entièrement piloté par IA, où les chefs et scientifiques testent en temps réel des prototypes optimisés en fonction des préférences régionales, des contraintes réglementaires ou des objectifs de réduction d’empreinte carbone.
L’article souligne que l’IA ne se limite plus à l’innovation produit : elle s’impose également dans la gestion des chaînes logistiques, l’anticipation des pénuries, la réduction du gaspillage et même la prédiction de comportements alimentaires futurs. La personnalisation à grande échelle devient possible, tout comme la création de formulations nutritionnelles adaptées à des profils spécifiques (sportifs, seniors, végétaliens, etc.).
Toutefois, cette sophistication algorithmique ne se fait pas sans limites. Les auteurs mettent en garde contre une dépendance excessive aux données, qui pourrait déshumaniser la créativité culinaire. La transparence et l’éthique dans la collecte et l’utilisation des données demeurent des enjeux centraux. L’IA, conclut l’article, n’est plus une option mais une infrastructure essentielle pour toute entreprise agroalimentaire aspirant à rester compétitive. C’est un changement de paradigme qui redéfinit ce que signifie “innover” dans le secteur alimentaire.
Wall Street Journal, How Chili’s Won When America Raged About Fast-Food Prices, 24/04/2025
Alors que les grandes chaînes de fast-food aux États-Unis font face à une vague de critiques sur la hausse fulgurante de leurs prix, Chili’s, enseigne de casual dining, a réussi à tirer son épingle du jeu. L’article retrace comment la chaîne, souvent perçue comme plus haut de gamme que les fast-foods, a paradoxalement su capter une clientèle en quête de bons rapports qualité-prix.
En 2024, des plateformes comme TikTok se sont enflammées autour de la flambée des prix dans des enseignes comme McDonald’s ou Wendy’s. Un menu basique dépassant les 18 dollars a choqué de nombreux consommateurs, alimentant une conversation nationale sur le coût croissant de manger "sur le pouce". Dans ce climat tendu, Chili’s a joué la carte de la transparence et de la simplicité en mettant en avant un menu à 10,99 dollars : cheeseburger, frites et boisson inclus.
Contrairement à d’autres chaînes qui ont privilégié les promotions numériques via leurs applications, Chili’s a misé sur une communication claire en salle, via des affiches et des menus physiques, atteignant une clientèle moins connectée, plus traditionnelle, et soucieuse de son budget. Cette approche a permis à la marque de regagner des parts de marché, en particulier parmi les consommateurs de la classe moyenne.
L’article souligne également que cette stratégie de “menu valeur” n’est pas une simple tactique marketing, mais une décision structurée au niveau de la direction. Le PDG de Chili’s, Kevin Hochman, ancien de KFC et Pizza Hut, a appliqué une logique “KFC-style” au casual dining : réduction de la carte, gestion rigoureuse des coûts et communication directe.
Grâce à cette stratégie, Chili’s a enregistré une hausse des ventes de 3 % au quatrième trimestre 2024, à rebours de la tendance générale dans le secteur. L’enseigne a aussi su conserver ses marges, en optimisant ses achats et en standardisant ses recettes, sans altérer la qualité perçue par les clients.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey