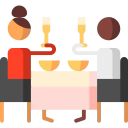🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-11
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Pourquoi Pepsi va échapper en partie à la surtaxe sur les sodas, 26/03/2025
Process Alimentaire, Egalim : vers un affichage sur la transparence de la rémunération des agriculteurs, 24/03/2025
Financial Times, Booze faces its big tobacco moment, 22/03/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Les enseignes de distribution bio retrouvent des couleurs, 21/03/2025
Après plusieurs années de crise marquées par des fermetures de magasins et un ralentissement brutal du marché, les enseignes spécialisées dans la distribution de produits bio (Biocoop, La Vie claire, Naturalia) renouent avec la croissance. En 2024, Biocoop a enregistré une hausse de 8,5 % de son chiffre d’affaires, qui s’est élevé à 1,67 milliard d’euros, tirée principalement par l’augmentation de la fréquentation. En janvier 2025, l’enseigne enregistre même une croissance à deux chiffres, portée par le retour des consommateurs vers les fruits et légumes frais.
La Vie claire affiche également une progression de 8 %, à 331 millions d’euros, même si la fréquentation reste en dessous des niveaux d’avant-crise. Naturalia, du groupe Casino, suit cette dynamique avec +4,7 %, contrastant avec la stagnation d’autres enseignes du groupe.
La crise entamée en 2021 avait contraint ces acteurs à revoir leurs stratégies. Fermetures ciblées, rénovation de magasins, recentrage sur les sites les plus performants ont permis d’assainir leur réseau. Biocoop a fermé une cinquantaine de points de vente, compensés en partie par de nouvelles ouvertures. La Vie claire prévoit de stabiliser son parc à 325 magasins en 2025.
Plusieurs facteurs expliquent cette embellie : la grande distribution, moins engagée sur le bio, a perdu du terrain, tandis que les distributeurs spécialisés ont renforcé leur attractivité en travaillant sur les prix. Biocoop a lancé une gamme de 160 produits à prix engagés, et La Vie claire propose 200 références bio à petits prix. L’inflation a également joué un rôle paradoxal en réduisant l’écart entre produits bio et conventionnels, notamment en raison de l’augmentation des coûts de transport pour les produits importés.
Les données de consommation confirment cette stabilisation : 30 % des Français déclarent consommer du bio au moins une fois par semaine, et 54 % au moins une fois par mois. Ces tendances laissent entrevoir une consolidation du secteur, recentré, plus agile et mieux adapté aux nouvelles attentes économiques et écologiques.
Ouest France, Les autorités sanitaires déconseillent les produits au soja dans la restauration collective, 24/03/2025
L’Anses recommande, dans un avis publié le 24 mars, de retirer les aliments à base de soja de la restauration collective. En cause : la présence d’isoflavones, des phytoestrogènes aux effets hormonaux, jugés potentiellement nocifs, en particulier chez les jeunes enfants. L’agence appelle également les industriels à revoir leurs méthodes de production pour réduire la teneur en ces composés.
Les isoflavones, présents notamment dans le tofu, les yaourts, les steaks végétaux ou les biscuits apéritifs au soja, peuvent interférer avec le système hormonal, surtout lorsqu’ils sont consommés en grandes quantités. L’Anses insiste sur le fait que le soja n’est pas en soi à proscrire, mais que ses concentrations actuelles en phytoestrogènes posent problème dans les repas pris hors domicile.
La restauration collective représente environ un repas sur cinq en France et touche toutes les catégories d’âge (enfants, salariés, personnes âgées, patients hospitalisés). L’étude de l’Anses révèle que 76 % des enfants de 3 à 5 ans qui consomment régulièrement des produits au soja dépassent les seuils toxicologiques de référence. Ce chiffre est de 53 % chez les adolescentes et de près de 50 % chez les adultes de 18 à 50 ans.
Face à ce constat, l’Anses recommande de limiter drastiquement l’usage de ces produits en restauration collective jusqu’à ce que leur formulation soit revue. Le message est aussi adressé à l’industrie agroalimentaire, sommée d’innover pour offrir des alternatives plus sûres.
L’article rappelle que le soja, en plein essor en France, est souvent promu comme une alternative durable à la viande. Mais cette mise en garde pourrait rebattre les cartes pour les filières végétales. Un équilibre est à trouver entre nutrition, durabilité et sécurité sanitaire.
Libération, BrewDog, du petit brasseur écossais cool au mastodonte laissant en plan ses fournisseurs, 24/03/2025
L’article retrace la trajectoire contrastée de la marque écossaise de bière artisanale BrewDog, passée du statut de start-up rebelle à celui de géant brassicole critiqué pour ses pratiques commerciales. En janvier 2025, la marque a brutalement fermé ses deux bars en France (Nice et Paris), laissant derrière elle des prestataires et fournisseurs impayés. Ces derniers, qui avaient tissé des liens solides avec l’enseigne et l’avaient même soutenue lors d’événements comme la Coupe du monde de rugby, dénoncent aujourd’hui un abandon injuste et un manque de professionnalisme.
Parmi les victimes figurent des brasseurs locaux comme la Blue Coast Brewery, ou encore des animateurs d’événements, à qui BrewDog doit des milliers d’euros. Face au silence de l’entreprise, certains envisagent une mise en demeure. L’entreprise assure que les paiements sont en cours, mais cette promesse reste floue et tardive pour des partenaires souvent précarisés.
L’article met en lumière une rupture avec l’esprit communautaire qui caractérise habituellement le monde de la brasserie artisanale, notamment sur la Côte d’Azur. Autrefois perçue comme une success story alternative, BrewDog est désormais vue comme une structure aux logiques purement commerciales. La fermeture de ses bars en France, ainsi qu’à Francfort et Shanghai, contraste avec l’ouverture de nouveaux établissements dans des zones jugées plus rentables comme Bangkok ou Perth. Cela suscite des accusations d’opportunisme : l’entreprise serait accusée d’utiliser les bars comme tremplins marketing avant de se désengager une fois la marque installée en grande distribution.
L’Usine Nouvelle, La souveraineté alimentaire, un principe "inintelligible" ?, 27/03/2025
L’article analyse la portée juridique et politique du concept de souveraineté alimentaire, mis à mal par la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2025, qui a censuré partiellement la loi d’orientation agricole. Si cette notion est devenue centrale dans les discours et politiques publiques, sa traduction juridique reste floue et contestée. Sur les 58 articles soumis, 18 ont été censurés, notamment l’article 2 qui introduisait un principe de « non-régression » de la souveraineté alimentaire.
Le Conseil a jugé ce principe trop vague, inintelligible et contraire à la séparation des pouvoirs, en ce qu’il imposait des obligations normatives à des textes réglementaires. Cette décision illustre la difficulté de donner un contenu concret à un concept aux contours avant tout politiques. D’autres dispositions, comme celle élevant le développement agricole au rang « d’intérêt général majeur », sont restées dans le texte, mais leur portée juridique demeure symbolique, sans réelle capacité contraignante.
La loi promulguée le 24 mars reste une loi de programmation, ce qui limite le contrôle de constitutionnalité à des erreurs manifestes d’appréciation. Certains acteurs saluent tout de même la reconnaissance de certaines orientations, comme le refus d’interdictions phytosanitaires plus strictes que celles des autres pays européens. Mais la majorité des mesures ne s’imposent pas juridiquement, se contentant d’orienter l’action publique.
Les Échos, Le nouveau pari de Barilla pour doper ses ventes de pâtes en France, 27/03/2025
Le groupe Barilla poursuit sa dynamique de croissance sur le marché français avec une stratégie offensive combinant baisse des prix, innovation produit et investissements marketing renforcés. En 2024, la filiale française du groupe a enregistré une hausse de 5 % de ses volumes et de 6 % de son chiffre d’affaires, atteignant 700 millions d’euros.
Pour 2025, Barilla innove avec une première en rayon : des pâtes enrichies en protéines végétales issues de petits pois, destinées à séduire les jeunes, les actifs, et les consommateurs à la recherche d’alternatives aux protéines animales. Ces nouvelles références, lancées en mars sous forme de fusilli et de pennes, contiennent 20 % de protéines et s’inscrivent dans la tendance des produits enrichis, déjà bien établie dans les produits laitiers. Ce segment représente déjà 7 % du marché aux États-Unis.
Cette démarche s’ajoute à d’autres succès récents du groupe. En dix ans, Barilla a quadruplé ses ventes de pesto en France, secteur où elle détient désormais 48 % de parts de marché. Le groupe fabrique lui-même ses sauces, un gage de maîtrise de qualité. En 2024, les volumes ont bondi de 30 %, en dépit d’un contexte de pouvoir d’achat contraint. Sous la marque Harrys, Barilla a également lancé une gamme de gâteaux fourrés pour le goûter, inspirée de best-sellers italiens. Le succès a été immédiat : les ventes ont dépassé de 50 % les prévisions en six mois.
Barilla a aussi adopté une politique de baisse des prix volontariste pour contrer les marques de distributeurs, très puissantes en France (plus de 50 % des volumes en pâtes, 40 % sur le pain de mie). Depuis juin 2023, les prix ont baissé de 6 à 8 % sur une cinquantaine de références, en anticipation de la détente des cours du blé dur. Si cette stratégie pèse sur la rentabilité, elle permet au groupe de regagner des parts de marché et de sécuriser des volumes indispensables dans un secteur à faibles marges.
Enfin, l’année 2025 sera marquée par une hausse de 30 % des investissements en France, dans le cadre d’un plan global d’un milliard d’euros sur cinq ans. Au programme : nouvelles sauces, lancement d’un pesto à la mozzarella di bufala AOP, et arrivée d’un pain pinsa italien sous la marque Harrys. Malgré les tensions sur certaines matières premières (œufs, cacao), Barilla entend rester fidèle à sa stratégie d’innovation, de proximité avec les producteurs et de pilotage des coûts.
Les Échos, Pourquoi Pepsi va échapper en partie à la surtaxe sur les sodas, 26/03/2025
Face à la nouvelle surtaxe française sur les boissons sucrées, adoptée pour lutter contre l’obésité, PepsiCo parvient à tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie industrielle de long terme centrée sur la réduction de sucre. Depuis 2006, le groupe a anticipé l’évolution des attentes nutritionnelles et réglementaires en retravaillant progressivement ses recettes. Résultat : aujourd’hui, 75 % de son offre boisson est sans sucre ou faiblement sucrée, et donc partiellement ou totalement exemptée de cette surtaxe, dont le seuil d’application commence à 50 g de sucre par litre.
Cette adaptation donne à PepsiCo un net avantage compétitif sur le marché français, où la fiscalité nutritionnelle devient un facteur clé de différenciation. Contrairement à Coca-Cola ou Orangina, qui doivent intégrer des hausses de prix estimées entre 10 et 15 %, Pepsi pourra maintenir des tarifs attractifs, renforçant ainsi son positionnement en rayon. Cet écart de prix pourrait doper les ventes de références comme Pepsi Max ou Lipton Ice Tea, déjà bien implantées.
Mais cette stratégie s’inscrit dans une transformation plus large du modèle de PepsiCo, qui vise à concilier performance économique et engagement environnemental et sanitaire. Dans la branche snacks, les chips Lay’s ont vu leur teneur en sel diminuer de 21 % et en matières grasses de 34 %. Côté emballages, depuis 2022, l’ensemble des bouteilles est fabriqué à partir de plastique 100 % recyclé. Ces efforts sont portés par Nuno Pinto Leite, le nouveau directeur général France, arrivé en 2024 après avoir dirigé 14 marchés en Europe centrale.
L’année 2024 a néanmoins été difficile pour PepsiCo France, avec des ventes repassant sous la barre du milliard d’euros, après une décennie de croissance à deux chiffres. En cause : l’inflation, une météo maussade et un contexte commercial tendu. Pour inverser la tendance, le groupe prévoit un printemps 2025 riche en lancements : nouvelle gamme Cheetos, saveurs originales pour Lay’s (“Tapenade”, “Champignon de Paris”) et partenariat avec Euro Disney pour tester des plats chauds à base de Doritos.
PepsiCo mise aussi sur le secteur hors foyer (cafés, fast-foods, restauration rapide), et sur une communication digitale renforcée pour mettre en avant sa démarche RSE. L’objectif est clair : capitaliser sur ses efforts passés pour relancer la croissance en 2025, tout en répondant aux attentes des consommateurs soucieux de santé, de durabilité et d’innovation.
Process Alimentaire, Egalim : vers un affichage sur la transparence de la rémunération des agriculteurs, 24/03/2025
Dans le prolongement de la loi Egalim 2, la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, a présenté une initiative innovante : expérimenter un affichage « rémunération du producteur » destiné à informer les consommateurs sur la part du prix qui revient réellement à l’agriculteur. Cette expérimentation, lancée le 18 mars lors d’un Comité de partenaires, prendra la forme d’un appel à projets ouvert jusqu’au 30 juin 2025.
Elle concerne plusieurs filières stratégiques : viande bovine, porcine et ovine, produits laitiers, œufs, fruits et légumes transformés. Les porteurs de projet devront proposer des méthodologies précises, objectives et contrôlables, compatibles avec la réglementation. L’enjeu est de tester, sur le terrain, différents dispositifs d’étiquetage pour en évaluer l’impact, la lisibilité et la pertinence.
Ce projet répond à une demande forte du monde agricole, en particulier après les mobilisations de l’hiver 2024-2025. Les agriculteurs dénoncent un déséquilibre chronique dans les relations commerciales avec les transformateurs et les distributeurs. La promesse de la loi Egalim – garantir une meilleure rémunération – peine à se concrétiser. En rendant visible la part réellement perçue par le producteur, cet affichage pourrait inciter les consommateurs à faire des choix plus éthiques.
Une mission d’évaluation a été confiée au CGAAER, qui devra analyser les expérimentations et formuler des recommandations pour un éventuel cadre réglementaire. L’idée serait, à terme, de généraliser cet affichage à l’échelle nationale, sur le modèle de l’origine ou de l’impact carbone, déjà présents sur certains emballages.
Outre sa vocation informative, l’initiative a une portée politique : renforcer le lien entre consommateur et agriculteur, dans un contexte où la souveraineté alimentaire devient un enjeu stratégique. C’est aussi un moyen de rééquilibrer le rapport de force dans la chaîne alimentaire, en renforçant la transparence sur la formation des prix.
Enfin, cette mesure pourrait servir de levier concurrentiel pour les marques et enseignes qui s’engagent à mieux rémunérer les producteurs, valorisant ainsi leur démarche auprès d’un public de plus en plus soucieux d’éthique, de traçabilité et de durabilité.
Le Figaro, «Un McDo à moins de vingt minutes de chez soi»: le géant américain redouble d’ambitions en France, 21/03/2025
McDonald’s France affiche des ambitions renouvelées pour 2025 avec l’ouverture de 50 nouveaux restaurants, principalement en location-gérance. Après une décennie marquée par une vingtaine d’ouvertures annuelles, le géant américain accélère son déploiement dans des communes toujours plus petites, comme La Châtaigneraie (Vendée) ou Saint-Geniès-de-Malgoirès (Occitanie), affirmant son ancrage dans le paysage français.
L’enseigne, qui compte déjà 1 560 points de vente, entend répondre à une consommation en berne dans un marché globalement tendu. Le contexte inflationniste et les arbitrages budgétaires des Français réduisent la fréquence des visites, mais McDonald’s reste plébiscité, avec deux millions de clients quotidiens. Son dirigeant marketing, Jean-Guillaume Bertola, affirme que chaque ouverture est un succès et défend une stratégie de proximité : chaque Français devrait avoir un McDo à moins de vingt minutes.
Malgré un contexte international difficile, notamment le boycott subi début 2024 suite à la position du franchisé israélien dans le conflit au Moyen-Orient, McDonald’s France a su rebondir. L’enseigne a mis en place une stratégie commerciale agressive : retour à un Happy Meal à 4 euros, offre McSmart à 5 euros, lancements fréquents de nouveautés (burgers, nuggets veggie, campagnes autour des JO ou de Minecraft).
McDonald’s joue également sur l’innovation culinaire avec des recettes au bœuf origine France, des burgers au poulet, et la montée en gamme des offres pour séduire une clientèle plus large. L’enseigne reste très rentable en France, avec le ticket moyen le plus élevé au monde et une rentabilité d’exploitation record. La concurrence, pourtant vive (Burger King, KFC, concepts de tacos, poke bowls, kebabs…), ne freine pas la dynamique du géant.
L’Informé, La famille Perrodo veut revendre Isla Délice, le roi du halal, 25/03/2025
Le groupe Isla Délice, leader incontesté du marché des produits halal en France, s’apprête à changer de main. Son propriétaire actuel, le fonds d’investissement Perwyn, détenu par la puissante famille Perrodo (également à la tête du groupe pétrolier Perenco), cherche à céder l’entreprise en 2025.
Acquise en 2018 pour environ 80 millions d’euros (soit un peu plus de 8 fois l’Ebitda de l’époque), Isla Délice s’est développée sous la direction d’Eric Fauchon, un ancien cadre de Ferrero et Unilever, qui a pris les rênes après le départ de son fondateur, Jean-Daniel Hertzog.
Sous l’impulsion de Perwyn, Isla Délice a poursuivi une stratégie de croissance agressive. Elle a conquis une place centrale dans les rayons halal de la grande distribution, notamment grâce à ses gammes de charcuterie, plats cuisinés et surgelés. Le chiffre d’affaires actuel est estimé à 140 millions d’euros, pour un Ebitda de près de 20 millions, avec un excédent brut d’exploitation attendu autour de 25 millions selon les estimations fournies aux potentiels acquéreurs. L’entreprise réalise désormais environ 15 % de son chiffre d’affaires à l’international, après plusieurs acquisitions en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Isla Délice conserve une nette avance sur ses concurrents comme Reghalal, Fleury Michon (gamme halal), Zakia halal ou Oriental Viandes. Elle reste cependant exposée aux aléas géopolitiques : elle a récemment été visée par des appels au boycott dans le contexte du conflit israélo-palestinien, ce qui l’a conduit à réaffirmer publiquement son absence totale de lien avec Israël.
Les Échos, Le géant de la boulangerie surgelée Délifrance passe sous pavillon belge, 28/03/2025
Le paysage européen de la BVP (boulangerie-viennoiserie-pâtisserie) est en passe de connaître une importante recomposition avec la vente de Délifrance au groupe belge Vandemoortele. Propriété jusqu’alors de la coopérative française Vivescia, Délifrance change d’actionnaire à l’issue d’un accord signé entre les deux parties. Bien que le montant de la transaction n’ait pas été révélé, l’opération devrait aboutir d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.
Cette fusion donnera naissance à un nouvel acteur majeur de la boulangerie surgelée à l’échelle mondiale, avec un chiffre d’affaires combiné estimé à 2,4 milliards d’euros. Délifrance apporte à l’ensemble ses 14 sites de production (dont 7 en France), ses 3 200 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 930 millions d’euros (arrêté à juin 2024). L’entreprise commercialise une large gamme de viennoiseries, pains, pâtisseries et produits de snacking surgelés, à destination des restaurateurs, de la grande distribution et des boulangeries artisanales.
Vandemoortele, pour sa part, est déjà solidement implanté dans le secteur de la BVP, avec 34 usines en Europe et aux États-Unis, 3 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliard d’euros. En plus de ses activités en boulangerie, le groupe belge est aussi un acteur majeur des matières grasses végétales (margarine, etc.). Cette complémentarité industrielle et commerciale laisse présager de « puissantes synergies », selon Yvon Guerin, PDG de Vandemoortele, notamment en matière d’innovation, de service client, de stratégie de marque et de gammes de produits.
Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance externe active de la part du groupe belge. Par le passé, Vandemoortele a déjà racheté en France les Pains Pérènes de Roland Cottes (2004) et Panavi (2008), et en 2015, le producteur italien LAG. Ces opérations, parfois coûteuses – Panavi avait été acquise pour 300 millions d’euros – ont ponctuellement entraîné des arbitrages lourds, comme la vente d’Alpro (produits au soja) à Danone en 2009. Pour Vivescia, la cession de Délifrance s’inscrit dans une stratégie de recentrage sur ses activités céréalières et coopératives. Elle ouvre aussi la voie à un éventuel partenariat long terme avec Vandemoortele, axé sur la valorisation de ses filières agricoles et de ses marques historiques comme Francine.
Food & Wine, Coffee Without the Beans? Atomo Is Leading the Change, 21/03/2025
L’entreprise américaine Atomo, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans Eat’s Business, bouleverse les codes du café en proposant une version sans grains. Son “café” est produit à partir de matières premières végétales recyclées (dattes, graines de tournesol, peaux de fruits) et recréé chimiquement pour imiter les composés aromatiques du café traditionnel. L’objectif est clair : réduire l’empreinte écologique du café, secteur particulièrement polluant.
Le café conventionnel pose plusieurs problèmes environnementaux : déforestation, usage intensif d’eau, dépendance à des conditions climatiques précaires. Atomo promet une alternative durable, produite localement avec une empreinte carbone réduite de 93 % et une consommation d’eau 94 % plus faible selon l’entreprise. De plus, la fabrication n’est pas soumise aux fluctuations des cours du café ou aux crises climatiques.
L’article détaille le processus technologique : l’équipe d’Atomo a identifié les composés clés responsables de l’arôme du café (plus de 1 000 molécules), et les reproduit à partir d’ingrédients upcyclés. Le résultat ? Un café au goût quasi-identique, qui mousse, se torréfie et se prépare comme un café classique. Des tests à l’aveugle montrent que certains consommateurs ne perçoivent pas la différence.
L’innovation s’inscrit dans un mouvement plus large : celui des aliments « sans » (viande, produits laitiers, etc.) issus de la food tech. Mais elle soulève aussi des débats sur l’authenticité, la naturalité et l’acceptabilité du public. Certains puristes restent sceptiques, tandis que d’autres y voient une réponse pertinente aux enjeux environnementaux.
Atomo cible d’abord les chaînes de coffee-shops et les acteurs de la grande distribution écoresponsable. Son ambition est de démocratiser un café éthique, savoureux et résilient face au changement climatique. Si l’accueil se confirme, le café sans grains pourrait, comme le lait végétal ou la viande de culture, devenir un incontournable de l’alimentation durable de demain.
Fast Company, What does fast food want with Nvidia?, 27/03/2025
L’article explore l’étonnante synergie entre les géants du fast-food et Nvidia, leader des puces graphiques et de l’intelligence artificielle. Depuis peu, des chaînes comme White Castle, Wendy’s ou McDonald’s collaborent avec Nvidia pour intégrer l’IA dans leurs opérations, notamment via des assistants vocaux pour les commandes en drive.
L’objectif ? Fluidifier les interactions clients, réduire les erreurs, accélérer les temps de service et pallier les pénuries de main-d’œuvre. Grâce aux technologies vocales dopées à l’IA, certaines enseignes parviennent à automatiser les prises de commande, voire à personnaliser les suggestions en temps réel. Nvidia fournit la puissance de calcul via ses puces et ses plateformes cloud, permettant aux fast-foods de traiter rapidement de grandes quantités de données.
Mais l’intérêt va au-delà des simples bornes vocales. L’IA sert aussi à optimiser la gestion des stocks, prédire la demande selon la météo ou les événements locaux, ajuster les prix dynamiquement et même surveiller les cuisines via des caméras intelligentes. Cela représente un tournant vers une restauration ultra-connectée, capable d’optimiser chaque étape du parcours client.
Nvidia, traditionnellement tournée vers les jeux vidéo et l’automobile, voit dans la restauration un nouveau terrain de croissance. Les fast-foods, confrontés à des marges réduites et à une main-d’œuvre instable, investissent dans l’IA pour sécuriser leur rentabilité. L’article interroge néanmoins les dérives potentielles : surveillance accrue des employés, uniformisation des services, perte d’humanité dans l’expérience client.
The New York Times, Why Is Dining Alone So Difficult?, 25/03/2025
Malgré une hausse notable des réservations en solo aux Etats-Unis (+64 % depuis 2019 selon OpenTable), les repas seuls au restaurant demeurent une expérience souvent inconfortable. L’article explore les raisons de cette gêne persistante : peur du regard des autres, sentiment de solitude, accueil tiède voire désagréable de la part des établissements.
Les témoignages de clients révèlent un malaise structurel. Les personnes seules sont parfois reléguées à des tables peu agréables, négligées par le service ou poussées à consommer rapidement. Le modèle économique des restaurants, centré sur la rentabilité par table, n’encourage pas la valorisation des clients isolés. Pourtant, ceux-ci sont souvent plus attentifs, fidèles et prêts à échanger avec le personnel.
Le phénomène touche toutes les catégories d’âge, dans un contexte post-pandémie où le nombre de célibataires et de voyageurs professionnels a augmenté. Mais la stigmatisation persiste, notamment pour les femmes ou les seniors. Les plats « à partager » dominent les cartes, rendant les repas solitaires plus coûteux ou déséquilibrés.
Certaines initiatives cherchent à inverser la tendance : menus adaptés aux solos, accueil plus chaleureux au comptoir, communication décomplexée. Des photographes comme Jerry Hsu ont tenté de redonner de la dignité à ces instants, perçus par certains comme des parenthèses apaisantes, introspectives, voire libératrices.
L’article appelle à une évolution des mentalités dans l’univers de la restauration : reconnaître les clients seuls comme des convives à part entière, avec leurs attentes spécifiques. Car derrière cette gêne sociale se cache une opportunité de diversification pour les restaurateurs, dans un monde où l’autonomie et le self-care deviennent des valeurs centrales.
Wall Street Journal, How Prevalent Are Dyes in Foods? We Crunched the Numbers, 23/03/2025
Les colorants artificiels sont aujourd’hui dans le viseur des autorités sanitaires américaines. Le président de la politique de santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., souhaite leur retrait du marché alimentaire avant la fin de son mandat, notamment en raison de leurs effets supposés sur la santé des enfants (hyperactivité, troubles du comportement). Plusieurs États comme le Connecticut ou la Virginie occidentale légifèrent déjà pour en limiter l’usage ou exiger des avertissements.
Une enquête du Wall Street Journal révèle que plus de 10 % des produits alimentaires référencés dans une base de données fédérale contiennent au moins un colorant artificiel, et plus de 40 % en contiennent trois ou plus. Les plus utilisés sont le Rouge 40, le Jaune 5 et le Bleu 1. Si leur présence est attendue dans les bonbons ou les boissons sucrées, elle surprend davantage dans des produits comme les cornichons, les pâtes à tartes ou les vinaigrettes.
Le Rouge 3, associé à des risques de cancer chez l’animal, sera interdit dès 2027. Il est encore présent dans des produits populaires comme les mashed potatoes Betty Crocker ou les substituts de bacon végétal de MorningStar Farms. Certaines entreprises anticipent déjà : Kellanova (ex-Kellogg) a supprimé les colorants de ses barres Nutri-Grain, tandis qu’Unilever utilise désormais des extraits naturels (spiruline, curcuma, jus de légumes) dans ses glaces Popsicle.
Toutefois, remplacer les colorants synthétiques n’est pas sans difficulté. Les versions naturelles sont plus coûteuses (jusqu’à 10 fois), moins stables et plus sensibles aux conditions de production. De plus, certaines alternatives naturelles comme le carmin (extrait de cochenilles) posent problème pour les produits certifiés casher ou végétariens. D’autres options émergent, comme les pigments issus de la spiruline ou de la fleur de pois papillon.
La pression croissante sur l’industrie pousse les grandes marques à revoir leurs recettes. Même si les colorants ne modifient pas le goût, ils influencent fortement la perception visuelle et sensorielle des produits. Le débat pose donc la question d’un compromis entre sécurité sanitaire, attentes marketing et faisabilité industrielle.
Financial Times, Polish wine is often excellent. Why is it so hard to find?, 21/03/2025
Le vin polonais gagne en qualité, mais reste encore trop peu connu hors de ses frontières. En Pologne, plus de 500 domaines viticoles sont enregistrés, dont environ 200 commercialisent leurs produits au-delà de la vente directe. Cette émergence est portée par le réchauffement climatique, qui rend désormais possible la culture du raisin sur de vastes zones du pays, notamment au sud et à l’ouest.
L’article souligne des similitudes avec la filière britannique : production encore jeune, forte présence de cépages hybrides (Solaris, Muscaris, Regent), forte créativité dans les étiquettes et les noms, essor des vins effervescents en méthode traditionnelle. Les vins blancs se distinguent par leur pureté aromatique, parfois préférés aux Rieslings classiques.
Adam Michocki, importateur basé au Royaume-Uni, promeut ces vins auprès des restaurants étoilés. Il mise sur le potentiel commercial des cépages hybrides, plus résistants et adaptés à un viticulture durable. Mais les coûts restent élevés en raison de la taille réduite des domaines, du manque d’infrastructures et des investissements matériels lourds. « Faire du vin en Pologne, c’est comme en faire sur la Lune », plaisante-t-il.
Le vin polonais souffre aussi d’un manque de reconnaissance. Lors d’un récent salon à Londres, les dégustateurs étaient curieux et conquis, mais la commercialisation reste un défi. L’absence d’AOC, les prix élevés et la méconnaissance du consommateur occidental freinent encore l’expansion du secteur. Pourtant, la qualité est bien au rendez-vous, et la filière pourrait bien faire parler d’elle dans les années à venir.
Financial Times, Booze faces its big tobacco moment, 22/03/2025
L’industrie de l’alcool traverse une période charnière qui n’est pas sans rappeler la chute de la consommation de tabac. En 2024, la consommation d’alcool par habitant a chuté de 3 % aux États-Unis — une baisse inédite depuis la Prohibition. Cette tendance inquiète les investisseurs, d’autant que l’OMS réclame désormais des étiquetages avec avertissements sanitaires, à l’image de ceux sur les paquets de cigarettes.
Le phénomène s’explique par un changement culturel profond : montée des préoccupations de santé, percée des boissons sans alcool, et impact des médicaments contre l’obésité comme le Wegovy ou l’Ozempic, qui réduisent aussi la consommation d’alcool. Ces bouleversements ont entraîné une baisse de 8 % de la valorisation boursière des groupes de spiritueux, autrefois très attractifs.
Certaines figures emblématiques du secteur s’adaptent : Diageo, par exemple, abandonne ses objectifs de croissance à long terme, tandis que les producteurs investissent massivement dans les gammes sans alcool. L’analyste Trevor Stirling de Bernstein parle d’un « moment tabac » pour l’alcool, tandis que des investisseurs comme Terry Smith se désengagent, jugeant le secteur trop risqué à moyen terme.
Les jeunes générations sont en partie à l’origine du phénomène. Moins enclins à consommer de l’alcool régulièrement, influencés par les réseaux sociaux, ils privilégient une hygiène de vie plus saine. Les géants des spiritueux misent sur cette mutation pour renouveler leur offre et éviter une perte structurelle de leur clientèle.
L’industrie, consciente des enjeux, cherche à présenter la modération non plus comme une menace, mais comme une opportunité stratégique, en promouvant une consommation « meilleure, pas plus ». À l’image du secteur du tabac qui s’est tourné vers les substituts nicotiniques, les groupes misent sur l’innovation et la transparence pour regagner la confiance des consommateurs.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey