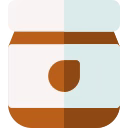🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-07
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, Nitrites : la farce cachée de la saucisse, 15/02/2025
Le Parisien, Sushis Yves Saint Laurent, café Dior… À Paris, les marques de luxe se diversifient pour attirer toujours plus, 20/02/2025
Wall Street Journal, ‘Gut Pop’ Is Injecting New Fizz Into the Beverage Aisle, 18/02/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Eat’s Business sera en mode vacances pour les 2 prochaines semaines.
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Aux Etats-Unis, pays de la malbouffe, un projet d’étiquette nutritionnelle sur les emballages, 17/02/2025
Face à une crise de l’obésité qui touche près de trois adultes sur quatre aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) veut imposer un nouvel étiquetage nutritionnel sur les emballages des produits alimentaires transformés. Cette mesure vise à alerter de manière simple les consommateurs sur les niveaux de graisses saturées, de sodium et de sucres ajoutés. Contrairement aux informations détaillées figurant déjà au dos des emballages, ce nouveau label apparaîtrait en face avant, avec un code couleur indiquant si les niveaux de ces nutriments sont faibles, moyens ou élevés.
L’objectif est de lutter contre les maladies chroniques liées à une alimentation déséquilibrée, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, qui coûtent chaque année plus de 4 500 milliards de dollars au système de santé américain. Inspirée de modèles déjà adoptés en Amérique latine, cette initiative pourrait inciter les industriels à reformuler leurs produits, comme cela a été observé au Chili, où un étiquetage similaire a entraîné une réduction de 25 % des achats d’aliments trop gras ou sucrés.
Cependant, la mesure suscite déjà des critiques. Certains experts, bien que favorables à un étiquetage obligatoire, estiment que le modèle choisi par la FDA est trop complexe et risque d’embrouiller le consommateur, contrairement à des systèmes plus simples comme le Nutri-Score européen. L’industrie agroalimentaire, de son côté, fustige une "méthodologie opaque" et défend son propre programme d’étiquetage volontaire, Facts Up Front, jugé plus pertinent.
L’avenir de cette réglementation reste incertain avec l’entrée en fonction de la nouvelle administration Trump, dont le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., est un fervent opposant aux aliments ultra-transformés, mais aussi un critique des régulations excessives. Si certains experts espèrent que cette initiative sera maintenue au nom de la transparence pour les consommateurs, d’autres redoutent qu’elle soit rapidement enterrée sous la pression des lobbies agroalimentaires.
L’Usine Nouvelle, Face à l'explosion du prix du cacao, les industriels s'adaptent, entre difficultés de trésorerie et reformulations, 21/02/2025
Face à la flambée du prix du cacao, les industriels du chocolat adoptent différentes stratégies pour préserver leurs marges et maintenir leur compétitivité.
Les fabricants de tablettes, comme Lindt ou Grain de Sail, n’ont d’autre choix que de réduire discrètement les grammages de leurs produits sans en modifier la recette. Certaines tablettes, auparavant de 150 g, passent ainsi à 147 g. D’autres marques misent sur des hausses de prix progressives pour amortir l’augmentation du coût des matières premières.
Les grands groupes agroalimentaires, comme Nestlé et Mondelez, qui intègrent le chocolat dans des produits transformés, adoptent une approche plus flexible. Ils modifient leurs formulations en augmentant la part d’ingrédients moins coûteux comme le sucre ou les matières grasses, réduisant ainsi la proportion de cacao sans altérer l’apparence ni la texture du produit.
Certains industriels se tournent vers des solutions technologiques alternatives. Le développement de la "cacao tech", qui vise à produire du cacao en laboratoire ou à utiliser des substituts végétaux, attire de plus en plus d’investissements. Nestlé collabore avec Barry Callebaut pour convertir 11 000 hectares à l’agroforesterie en Afrique de l’Ouest, tandis que d’autres explorent des sources d’approvisionnement alternatives en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où la production devrait fortement augmenter dans les prochaines années.
Les contraintes d’approvisionnement incitent également les entreprises à changer leurs modes d’achat. Alors qu’elles sécurisaient auparavant leurs volumes par des contrats long terme, beaucoup doivent désormais payer des acomptes plus élevés (jusqu’à 70 % du prix de la livraison) pour garantir leur accès à la matière première. Cette pression financière fragilise particulièrement les PME et les chocolatiers bio, certains producteurs de cacao abandonnant même les certifications biologiques, jugées trop contraignantes face à des prix record.
Dans ce contexte tendu, les industriels doivent trouver un équilibre entre l’augmentation des prix, la reformulation des produits et l’innovation, tout en évitant de faire fuir les consommateurs. La crise actuelle accélère ainsi la transformation du secteur, avec un repositionnement stratégique qui pourrait durablement modifier la composition et l’offre des produits chocolatés.
Le Figaro, Le roquefort, un siècle de fierté française, 15/02/2025
Le roquefort fête en 2025 le centenaire de son appellation d’origine. Premier produit alimentaire à avoir obtenu une Appellation d’Origine Protégée (AOP) en 1925, il reste une fierté nationale et un symbole du terroir français. Sa fabrication repose sur un cahier des charges strict, garantissant son authenticité et son lien exclusif avec le village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron. Pourtant, malgré son prestige et son rayonnement international, avec 28 % de sa production exportée dans 120 pays, sa consommation est en déclin, enregistrant une baisse de 3 à 4 % par an depuis 2022.
Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, les habitudes alimentaires évoluent, avec une réduction de la consommation de fromages en général, accentuée par les préoccupations sanitaires et nutritionnelles. D’autre part, les jeunes générations connaissent moins le roquefort et peuvent le percevoir comme un produit trop fort ou traditionnel. Face à ces défis, les acteurs de la filière cherchent à redynamiser l’image du roquefort et à diversifier ses usages.
Pour marquer son centenaire, l’AOP Roquefort mise sur une grande campagne de communication, avec pour slogan "Pour toujours au goût du jour". Elle vise à moderniser l’image du fromage et à le rendre plus attractif, notamment en mettant en avant ses atouts gastronomiques et en encourageant de nouvelles façons de le consommer, au-delà du traditionnel plateau de fromages. Plusieurs chefs étoilés, dont Sébastien Bras et Noémie Honiat, participent à cette opération en proposant des recettes intégrant le roquefort de manière innovante.
Le point d’orgue des festivités aura lieu les 7 et 8 juin 2025 à Roquefort-sur-Soulzon. Un grand événement réunira producteurs, affineurs et gastronomes autour de dégustations, visites de caves et démonstrations culinaires. L’objectif est de sensibiliser le public à la richesse de ce produit et de susciter un regain d’intérêt, notamment auprès des jeunes consommateurs. Malgré ces efforts, l’enjeu reste de taille : réussir à inverser la tendance à la baisse et garantir un avenir prospère au roquefort. Pour cela, les producteurs comptent aussi sur des partenariats avec la grande distribution et la restauration, afin de promouvoir ce fromage comme un produit d’exception, mais accessible et adapté aux nouvelles tendances culinaires.
Libération, Mort de Francesco Rivella, l’inventeur du Nutella : une tartine pour la route, 18/02/2025
Francesco Rivella, ce nom ne vous pas grand grand chose. Et pourtant, ce chimiste italien, décédé à l’âge de 97 ans le 14 février dernier a joué un rôle clé dans la mise au point du Nutella. Diplômé en chimie de l’université de Turin, Francesco Rivella a rejoint l’entreprise Ferrero en 1952, alors que la société n’était encore qu’une modeste confiserie familiale à Alba, dans le Piémont. Chargé du développement de nouveaux produits, il participe à la création de la Supercrema, la première version du Nutella, avant d’optimiser sa recette et de lui donner son nom définitif. Ce dernier, formé du mot anglais nut (noisette) et du suffixe italien -ella, est aujourd’hui mondialement reconnu.
Le Nutella s’est rapidement imposé comme l’un des produits phares de l’industrie agroalimentaire, devenant un symbole du goût sucré et de l’enfance pour des millions de consommateurs. Cependant, son succès ne s’est pas fait sans controverses. La pâte à tartiner est régulièrement critiquée pour sa forte teneur en sucre et en huile de palme, ainsi que pour son impact environnemental. Malgré cela, elle reste un incontournable des foyers du monde entier et l’un des produits alimentaires les plus emblématiques du XXe siècle.
Au-delà du Nutella, Francesco Rivella a également contribué à d’autres succès de la marque Ferrero, comme les Ferrero Rocher et les Mon Chéri, qui ont connu un rayonnement international. Proche de l’écrivain Primo Levi, il était respecté pour sa discrétion et son engagement envers l’innovation. Son influence sur l’agroalimentaire dépasse largement son rôle chez Ferrero, puisqu’il a contribué à transformer une recette artisanale en un produit de consommation de masse.
Son décès marque la fin d’une époque pour Ferrero et pour l’industrie agroalimentaire. Francesco Rivella laisse derrière lui un héritage indélébile, illustrant l’importance de la recherche et de l’innovation dans la création de produits iconiques.
Libération, Nitrites : la farce cachée de la saucisse, 15/02/2025
Les nitrites sont de plus en plus décriés. Classés comme potentiellement cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ils sont omniprésents dans de nombreux produits industriels, notamment les saucisses et autres charcuteries transformées. Pourtant, malgré les alertes sanitaires et les alternatives disponibles, l’industrie agroalimentaire peine à s’en passer.
Dans une enquête approfondie, Libération explore la réalité des nitrites dans nos assiettes. L’article met en lumière leur rôle dans la formation de composés chimiques nocifs pour la santé, notamment les nitrosamines, dont la consommation excessive est liée à des risques accrus de cancer colorectal. En 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a confirmé ces dangers, en s’appuyant sur plusieurs études scientifiques.
Face à ces constats, certaines enseignes commencent à proposer des alternatives "sans nitrites". Carrefour, par exemple, a récemment annoncé vouloir développer une large gamme de charcuteries exemptes de cet additif. Cependant, ces produits restent minoritaires et souvent plus chers, ce qui limite leur accessibilité pour les consommateurs les plus sensibles aux questions budgétaires.
L’industrie charcutière, représentée notamment par la Fédération des entreprises de charcuterie traiteur (FICT), affirme qu’il est difficile de se passer complètement des nitrites sans impact sur la qualité et la sécurité des produits. Selon ses porte-paroles, produire de la charcuterie sans nitrites nécessiterait des investissements conséquents et une adaptation des processus de fabrication, ce qui entraînerait inévitablement une hausse des coûts de production.
Des experts, comme le journaliste et auteur Guillaume Coudray, dénoncent cette position et affirment que de nombreuses entreprises ont déjà prouvé qu’il est possible de fabriquer des produits sans nitrites sans nuire à leur qualité. Certains artisans charcutiers, ainsi que des marques spécialisées, proposent d’ores et déjà des saucisses et jambons naturels qui rencontrent un certain succès auprès des consommateurs avertis.
Le débat autour des nitrites soulève également la question de la responsabilité des pouvoirs publics. Faut-il une interdiction pure et simple, ou privilégier une réduction progressive de leur utilisation ? Si la prise de conscience grandit, la transition vers une charcuterie plus saine reste un défi, entre les intérêts économiques des industriels et les préoccupations croissantes des consommateurs pour leur santé.
Les Échos, Le plan de Bruxelles pour l'agriculture, 20/02/2025
Face aux tensions croissantes dans le secteur agricole européen, la Commission européenne a présenté un plan stratégique visant à moderniser et simplifier la Politique Agricole Commune (PAC), tout en renforçant la protection des agriculteurs face à la concurrence internationale. Ce programme, qui couvre les quinze prochaines années, répond aux nombreuses revendications des exploitants, confrontés à une réglementation complexe et à des pressions économiques exacerbées par les exigences environnementales et les accords commerciaux internationaux.
Parmi les mesures phares de ce plan, Bruxelles propose de bloquer l’importation de produits alimentaires contenant des pesticides interdits sur le territoire de l’Union européenne. Cette décision, largement soutenue par la France, vise à garantir une concurrence plus équitable pour les agriculteurs européens, qui doivent respecter des normes sanitaires et environnementales strictes. L’Europe veut ainsi éviter que des produits traités avec des substances interdites puissent entrer sur son marché, une pratique jugée déloyale par de nombreux producteurs. Cette mesure pourrait notamment impacter les importations de thé et de café en provenance de Chine et d’Inde, ainsi que les fruits et légumes du Brésil.
En parallèle, la Commission européenne prévoit une réforme en profondeur de la PAC post-2027. L’objectif est de rendre cette politique plus simple et mieux ciblée, en concentrant les aides sur les exploitations les plus fragiles, les jeunes agriculteurs et les zones confrontées à des contraintes naturelles. La PAC pourrait également inclure un soutien renforcé aux pratiques agricoles durables, tout en limitant les obligations administratives jugées trop contraignantes par les agriculteurs.
Le plan met également l’accent sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, notamment les ventes à perte imposées aux producteurs. Une révision des règles en la matière est envisagée afin de mieux protéger les agriculteurs face aux grandes surfaces et aux distributeurs. Toutefois, l’un des principaux défis reste le financement de ces réformes. La PAC représente actuellement 30 % du budget de l’UE, mais certains États membres militent pour une réduction de ces dépenses. Bruxelles devra donc trouver un équilibre entre soutien au secteur agricole et contraintes budgétaires.
Le Parisien, Sushis Yves Saint Laurent, café Dior… À Paris, les marques de luxe se diversifient pour attirer toujours plus, 20/02/2025
Le luxe ne se limite plus aux vêtements et aux accessoires : il devient une expérience totale, englobant la gastronomie, l’art et le lifestyle. L’ouverture par Yves Saint Laurent d’un restaurant de sushis à Paris, au sein de sa boutique rénovée Saint Laurent Rive Droite, illustre cette tendance croissante où les grandes maisons de mode investissent la restauration pour renforcer leur image et fidéliser leur clientèle.
Ce phénomène s’accélère depuis plusieurs années. Dior, Louis Vuitton, Hermès, Ralph Lauren et Chanel ont tous intégré des cafés ou restaurants à leurs flagships parisiens. L’objectif n’est pas tant de générer du chiffre d’affaires direct que de proposer une expérience immersive, où le consommateur s’imprègne des valeurs et de l’univers de la marque. Selon Swannie Teboul, spécialiste du recrutement dans le luxe, cette évolution marque une rupture : "Ce n’est plus une simple addition de services, mais une réinvention du luxe."
Les maisons utilisent la gastronomie comme un levier marketing puissant. Chez Louis Vuitton, le café et la chocolaterie ouverte en 2022, signée par le chef pâtissier Maxime Frédéric, proposent des desserts à 18 euros en moyenne, une manière d’associer le prestige de la marque à une expérience gustative exclusive. Dior, avec son restaurant Monsieur Dior, et Hermès, avec son café-librairie Chaîne d’Encre, adoptent la même stratégie : faire vivre la marque autrement qu’à travers le produit.
Cette démarche offre aussi une porte d’entrée accessible pour un public plus large. Un sac ou un vêtement de luxe restent hors de portée de nombreuses personnes, mais un café ou une pâtisserie siglée offrent un avant-goût de l’univers de la marque, rendant le rêve plus tangible. Selon Benjamin Legourd, cofondateur d’Atelier Particulier, ces lieux sont avant tout des outils de storytelling et de fidélisation, destinés à ancrer la marque dans le quotidien des consommateurs.
Enfin, cette tendance dépasse le seul secteur du luxe. Zara, géant du prêt-à-porter, a récemment ouvert son propre Café Zara à Madrid, illustrant que cette stratégie immersive devient un modèle incontournable pour les enseignes souhaitant enrichir leur relation client.
Les Échos, Le caviar d'Aquitaine décroche son IGP après douze années d'efforts, 19/02/2025
Après douze années de démarches administratives et d’efforts de structuration de la filière, le caviar d’Aquitaine a enfin obtenu son Indication Géographique Protégée (IGP). Cette reconnaissance officielle par l’Union européenne permet aux producteurs du Sud-Ouest de mieux valoriser leur savoir-faire et d’apporter une garantie d’origine et de qualité aux consommateurs.
Le cahier des charges de l’IGP impose que l’ensemble du cycle de production, de la naissance des alevins jusqu’au conditionnement des œufs d’esturgeon, se déroule dans la zone géographique concernée. De plus, les élevages doivent respecter des pratiques rigoureuses, notamment l’interdiction d’utiliser des antibiotiques et des OGM. Cette certification concerne exclusivement l’esturgeon Baeri, espèce historiquement élevée en France, et ne s’étend pas encore à l’Osciètre, introduit plus récemment dans les élevages hexagonaux.
Cette distinction arrive dans un contexte de forte concurrence internationale, en particulier face à la domination du caviar chinois. La production française, estimée à environ 50 tonnes par an, est largement éclipsée par les 220 tonnes de caviar produites en Chine, dont une part croissante est exportée vers l’Europe. Cette compétition met les producteurs français sous pression, d’autant plus que les États-Unis imposent des droits de douane élevés sur les importations chinoises, laissant ainsi le marché européen comme débouché principal pour ces produits.
Pour les producteurs aquitains, l’IGP constitue un atout majeur pour se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel. Laurent Dulau, président de l’Organisme de Défense et de Gestion du Caviar d’Aquitaine et directeur général du groupe Kaviar, souligne que cette certification permettra de mieux valoriser la production locale, tout en rassurant les consommateurs sur l’authenticité du produit. Il espère également que cette reconnaissance attirera une clientèle plus exigeante, notamment dans la haute gastronomie et auprès des chefs étoilés, qui privilégient les produits locaux et de qualité.
L’officialisation de l’IGP sera célébrée le 27 février au Salon de l’Agriculture, où les producteurs présenteront leur démarche et les atouts de leur caviar. Ils espèrent ainsi sensibiliser davantage le grand public à l’importance de soutenir une filière qui se veut à la fois respectueuse des écosystèmes et garante d’un produit d’exception.
Les Échos, Pourquoi la fin du broyage des poussins menace la France d'une pénurie d'oeufs, 20/02/2025
À quelques jours du Salon de l’Agriculture, une crise menace l’approvisionnement en œufs en France. La Confédération française de l’aviculture (CFA) alerte sur un possible arrêt des livraisons vers Carrefour et E.Leclerc, faute d’accord sur le financement de l’ovosexage, une technique permettant d’identifier les embryons mâles avant l’éclosion. Cette méthode, adoptée en 2022 pour remplacer le broyage des poussins mâles, coûte 50 millions d’euros par an et repose sur une contribution volontaire obligatoire (CVO), actuellement financée par la grande distribution à hauteur de 58 centimes pour 100 œufs.
Cet accord arrive à échéance le 1ᵉʳ mars 2025 et devait être renégocié pour inclure les grossistes. Or, la grande distribution a annulé sa participation aux discussions, provoquant la colère des producteurs, qui dénoncent une volonté de leur faire porter seuls le surcoût. Le Syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf (SNIPO) souligne que cette charge représenterait un euro par poussin, soit un coût insoutenable pour de nombreuses exploitations.
Une solution proposée par le gouvernement prévoit d’étendre la CVO à tous les acheteurs d’œufs, ce qui permettrait de réduire la contribution des distributeurs à 39 centimes pour 100 œufs. Bien que cette option soit sur la table, aucun accord n’a encore été trouvé, et la menace de pénurie plane.
Les aviculteurs disposent d’un levier important : l’exportation. Les États-Unis, frappés par une épidémie d’influenza aviaire ayant entraîné l’abattage de 23 millions de volailles en janvier 2025, connaissent une flambée des prix des œufs (+15,2 % en un mois). Si les producteurs français privilégient ces marchés plus rémunérateurs, l’offre nationale pourrait diminuer, entraînant une hausse des prix pour les consommateurs.
Pour l’instant, la France est largement autosuffisante en œufs (94 % pour les œufs coquilles et 106 % pour les ovoproduits), et les prix restent stables grâce à la vaccination contre la grippe aviaire. Cependant, si aucun compromis n’est trouvé avant le 1ᵉʳ mars, la situation pourrait rapidement se détériorer et affecter l’approvisionnement des grandes surfaces. L’issue du conflit dépend désormais des négociations entre éleveurs, distributeurs et gouvernement.
L’Hôtellerie Restauration, Un couple cartonne sur les réseaux avec ses visites filmées des pires restaurants et hôtels, 20/02/2025
Depuis quelques mois, un couple parisien anonyme fait sensation sur les réseaux sociaux en documentant leurs expériences dans les pires restaurants et hôtels, sélectionnés à partir des avis les plus négatifs sur Google. Leur compte Instagram et TikTok, intitulé "On ne reviendra pas", connaît un succès fulgurant, avec des vidéos cumulant parfois plusieurs millions de vues. Leur concept ? Tester ces établissements décriés et vérifier si les critiques en ligne sont fondées ou exagérées.
L’aventure a débuté dans un restaurant asiatique du quartier de la gare Saint-Lazare, à Paris. Face à une expérience catastrophique, ils ont décidé de la filmer et de la partager avec leurs proches, qui ont rapidement été séduits par l’originalité du concept. Encouragés par l’engouement suscité, ils ont élargi leur champ d’action et se sont mis à traquer les pires établissements, non seulement en région parisienne, mais aussi dans d’autres villes comme Lille et même à l’étranger.
Leur démarche se veut à la fois critique et humoristique, oscillant entre constat accablant et surprise positive. Certains établissements confirment leur réputation déplorable, avec des services défaillants, des plats immangeables ou des conditions d’hygiène douteuses. Mais d’autres, au contraire, s’avèrent bien meilleurs que ce que les avis en ligne laissaient supposer. C’est ainsi qu’une pizzeria de Pontoise et une enseigne de la place de la Bastille, à Paris, ont obtenu une réhabilitation inattendue grâce à leur verdict plus nuancé.
Le couple se distingue des critiques gastronomiques traditionnels par son ton sincère et spontané. Ils se filment en caméra cachée, mais à visage découvert, et floutent les noms des établissements pour éviter tout acharnement injustifié. Cette approche leur permet de questionner la pertinence des avis en ligne, souvent subjectifs et influencés par des expériences individuelles biaisées.
Avec plus de 50 000 abonnés en quelques mois, leur audience ne cesse de croître, attirant même l’attention des médias et des professionnels de la restauration. Certains restaurateurs voient en eux une menace, tandis que d’autres apprécient leur objectivité et considèrent leur passage comme une opportunité de s’améliorer.
Désormais, le duo envisage d’élargir son concept en explorant d’autres destinations à l’international. Leur dernier voyage au Canada marque une première incursion hors d’Europe, confirmant que le format séduit bien au-delà des frontières françaises.
Food & Wine, Scientists Found a Surprisingly Simple Way to Cut Mercury Content in Canned Tuna by 35%, 19/02/2025
Des chercheurs de l’Université de technologie de Chalmers, en Suède, ont mis au point une méthode permettant de réduire jusqu’à 35 % la teneur en mercure du thon en conserve. Ce contaminant toxique, présent dans les poissons prédateurs comme le thon, constitue un risque pour la santé, notamment pour les femmes enceintes, en raison de son impact sur le développement neurologique du fœtus.
Plutôt que de recommander une baisse de la consommation, les chercheurs ont développé une solution technologique simple. Leur approche repose sur un conditionnement actif, où le thon est conservé dans une solution aqueuse contenant 1,2 % de cystéine, un acide aminé qui attire et élimine le mercure. Lors des essais, la réduction maximale de mercure (35 %) a été observée sur du thon haché en conserve, en raison de sa plus grande surface de contact avec la solution.
L’un des grands atouts de cette méthode est qu’elle ne nécessite aucun changement dans le processus industriel. Le mercure extrait est absorbé par des matériaux adsorbants, comme la silice thiolée et des polymères thiolés, qui pourraient être intégrés sous forme de sachets placés directement dans les boîtes de conserve. Les consommateurs pourraient alors simplement jeter la solution après ouverture, comme ils le font avec l’huile ou l’eau de certains thons en boîte.
Cette innovation pourrait représenter une avancée majeure pour la sécurité alimentaire, en complément des efforts visant à réduire la pollution au mercure. En rendant le thon en conserve plus sûr, cette technologie permettrait aux consommateurs de réduire leur exposition au mercure sans modifier leurs habitudes alimentaires. Elle pourrait également ouvrir la voie à d’autres emballages actifs pour améliorer la qualité des produits de la mer.
L’industrie agroalimentaire pourrait adopter cette innovation pour répondre aux préoccupations sanitaires croissantes des consommateurs, tout en maintenant une production efficace et inchangée. Cette solution offre ainsi une alternative prometteuse aux recommandations actuelles de limitation de la consommation de thon.
Slate, The Class War Comes for Condiments, 09/02/2025
Les condiments, autrefois simples accompagnements, sont devenus un enjeu de distinction entre tradition populaire et innovation gastronomique. L’article de Slate explore ce phénomène à travers le succès et la controverse entourant les nouvelles sauces artisanales, souvent jugées trop chères et élitistes.
Le point de départ est le lancement d’Ayoh!, une mayonnaise haut de gamme créée par Molly Baz. Vendue 10 dollars le tube de 35cl, elle propose des saveurs plus complexes que les marques traditionnelles, mais son prix suscite de vives réactions. Sur Reddit, certains consommateurs la qualifient de “bonkers expensive” (follement chère), tandis que d’autres saluent sa qualité sans vouloir en faire un achat régulier.
Cette critique des condiments artisanaux ne s’arrête pas à la mayonnaise. Le comédien Paul Scheer s’en est récemment pris au ketchup “fait maison”, estimant que les versions sophistiquées servies en restaurant sont inutiles. Pour lui et beaucoup d’Américains, le ketchup est un produit industriel par excellence, et Heinz en est l’incarnation parfaite.
L’article rappelle que cette guerre des condiments n’est pas nouvelle. Dans les années 1990, Grey Poupon, une moutarde française introduite aux États-Unis, est devenue un symbole de luxe grâce à une publicité mettant en scène un millionnaire dégustant son steak dans une Rolls-Royce. Ce type de marketing a contribué à associer certains condiments à un statut social privilégié, une tendance qui se poursuit avec l’essor des sauces artisanales.
Cependant, l’auteur reconnaît que certaines alternatives ont leur place. Il cite le ketchup à la betterave du chef Jesse Griffiths, élaboré pour répondre à des exigences de production locale au Texas. Bien que différent du ketchup industriel, il s’inscrit dans une approche gastronomique cohérente.
L’auteur conclut que les condiments artisanaux ne cherchent pas à remplacer les classiques mais à enrichir l’offre existante. Heinz et Hellmann’s resteront des références incontournables, mais l’innovation culinaire a sa place. Après tout, le ketchup lui-même a évolué au fil du temps, pourquoi refuser l’émergence de nouvelles versions ?
Wall Street Journal, ‘Gut Pop’ Is Injecting New Fizz Into the Beverage Aisle, 18/02/2025
Avec la baisse des ventes de sodas traditionnels, Coca-Cola et PepsiCo se lancent dans le marché en pleine expansion des sodas prébiotiques, dominé jusqu’ici par les start-ups Olipop et Poppi. Ces boissons, censées améliorer la digestion grâce à des fibres prébiotiques, séduisent les consommateurs en quête d’alternatives plus saines.
Les ventes combinées d’Olipop et Poppi ont atteint 817 millions de dollars aux États-Unis sur l’année écoulée, et Coca-Cola estime que ce marché pourrait dépasser 2 milliards de dollars d’ici 2029. Pour s’imposer, Coca-Cola lancera ce mois-ci Simply Pop, une gamme de sodas contenant 25 à 30 % de jus, six grammes de fibres prébiotiques, ainsi que de la vitamine C et du zinc. Pepsi prépare aussi une version qui arrivera au printemps.
Les sodas prébiotiques diffèrent des probiotiques comme le kombucha ou le kéfir : au lieu d’introduire de nouvelles bactéries dans l’intestin, ils nourrissent celles déjà présentes. Olipop et Poppi utilisent notamment de l’inuline, une fibre issue de l’agave ou de la racine de chicorée. Ces marques ont su imposer leur image, notamment grâce à des campagnes marketing percutantes : publicités lors du Super Bowl, collaborations avec des influenceurs et une forte présence en grandes surfaces et cafés. Olipop est ainsi disponible dans 12 000 Starbucks à travers les États-Unis.
Les consommateurs apprécient ces alternatives, bien que leur goût divise. Cullen Biever, un adepte d’Olipop et Poppi, reconnaît avoir eu des réticences initiales, mais a fini par adopter ces boissons pour limiter sa consommation de sodas sucrés. Cependant, les experts en nutrition restent prudents. Dr Sean Spencer, gastro-entérologue à Stanford, affirme que si ces sodas permettent de réduire l’apport en sucre, ils peuvent être une bonne option. En revanche, pour les personnes souffrant de syndrome de l’intestin irritable (IBS), l’inuline peut provoquer des ballonnements et des troubles digestifs. Jamie Allers, diététicienne, conseille plutôt de privilégier les aliments naturellement riches en prébiotiques, comme l’ail, les oignons ou les bananes.
Pour les géants du soda, ces boissons prébiotiques représentent une opportunité de croissance alors que les ventes de sodas classiques (Coca, Pepsi, Dr Pepper) ont baissé d’environ 1 % en un an. Pourtant, Olipop ne semble pas inquiet face à cette concurrence. L’entreprise vient de lever 50 millions de dollars et atteint une valorisation de 1,85 milliard de dollars. Son cofondateur Ben Goodwin se félicite d’avoir ouvert la voie : "Nous avons créé cette base, et maintenant tout le monde veut s’y installer."
Wall Street Journal, When the Michelin Star Becomes a Restaurant’s Curse, 13/02/2025
Loin d’être uniquement un symbole de prestige, une étoile Michelin peut aussi devenir une contrainte pesante pour certains restaurants, tant sur le plan financier que créatif. C’est ce qu’illustre l’exemple du restaurant Giglio, à Lucques en Italie, qui a demandé à se faire retirer son étoile Michelin du guide 2025. Lauréat d’une étoile en 2019, l’établissement a vu sa clientèle évoluer, attirée par le prestige du guide plutôt que par sa cuisine. Pour les chefs, cette distinction, bien qu’honorifique, est devenue une charge, les empêchant d’exprimer pleinement leur vision culinaire.
Depuis plus d’un siècle, le guide Michelin est une référence dans le monde mais certains restaurateurs affirment que cette reconnaissance peut être une "cage dorée", imposant un standard de perfection permanent. Scott Nishiyama, chef et propriétaire d’Ethel’s Fancy en Californie, confie que la peur constante d’être évalué par un inspecteur Michelin limite la liberté créative et augmente la pression sur son équipe.
En plus du stress, une étoile peut aussi affecter négativement les finances d’un restaurant. Simon Olesen, propriétaire de la brasserie Møntergade à Copenhague, explique que son établissement, listé dans le guide sans étoile, attire une clientèle régulière, y compris des professionnels qui y déjeunent plusieurs fois par semaine. Obtenir une étoile pourrait donner une image de luxe excessif et dissuader ces clients fidèles. Les coûts d’exploitation augmentent également, avec l’exigence de produits plus haut de gamme, la hausse des loyers et la pression pour offrir une expérience irréprochable.
Selon une étude de 2021 publiée dans le Strategic Management Journal, une étoile entraîne d’abord une hausse de fréquentation, mais souvent suivie d’une période de baisse des revenus, difficile à compenser. Certains restaurateurs préfèrent donc renoncer à cette distinction pour préserver leur équilibre financier et personnel.
Pour Gwendal Poullennec, directeur international du guide Michelin, ces cas restent rares : en six ans, seuls quatre restaurants ont tenté de rendre leur étoile. Michelin refuse cependant les demandes de retrait, considérant que seule la qualité culinaire détermine la présence d’un restaurant dans le guide. Malgré cela, le Giglio apparaît désormais sans étoile sur le site du guide, confirmant une tendance grandissante : pour certains chefs, le véritable luxe est de cuisiner sans contrainte.
Fast Company, Study finds gluten-free products often have more sugar, fewer nutrients than regular foods, 19/02/2025
Une étude récemment publiée dans le journal Plant Foods for Human Nutrition remet en question les bienfaits souvent attribués aux produits sans gluten. Alors que ces aliments sont de plus en plus populaires et souvent perçus comme plus sains, les chercheurs ont constaté qu’ils contiennent en réalité davantage de sucre et moins de nutriments essentiels que leurs équivalents contenant du gluten.
L’étude a comparé différents types de produits alimentaires, en examinant leur teneur en fibres, en protéines et en micronutriments. Il en ressort que de nombreux produits sans gluten sont moins riches en fibres et en protéines, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles à long terme. Par ailleurs, pour compenser l’absence de gluten et améliorer la texture des produits, les fabricants ajoutent souvent du sucre ou d’autres agents de charge, ce qui entraîne une augmentation des calories et un index glycémique plus élevé.
Les chercheurs rappellent que le gluten, présent naturellement dans le blé, l’orge et le seigle, apporte plusieurs bénéfices nutritionnels. Il est notamment associé à la présence d’arabinoxylane, un polysaccharide qui joue un rôle important dans la régulation de la glycémie et la santé du microbiote intestinal. En supprimant ces céréales, les personnes qui consomment des produits sans gluten risquent donc de passer à côté de ces bienfaits, sauf si leur régime est soigneusement équilibré avec d’autres sources de fibres et de protéines.
Paradoxalement, l’étude révèle que certaines variétés de pain sans gluten, notamment les pains aux graines, peuvent contenir plus de fibres que les pains classiques, grâce à l’utilisation d’ingrédients comme le quinoa ou l’amarante. Cependant, ces améliorations varient d’un fabricant à l’autre et ne sont pas généralisées à l’ensemble du marché.
La popularité croissante des régimes sans gluten repose souvent sur des idées reçues, alimentées par les tendances du marketing et les réseaux sociaux. Bien que ce régime soit indispensable pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou présentant une sensibilité au gluten, il est adopté par une large part de la population sans réelle justification médicale. En 2024, environ 25 % des Américains consommaient des produits sans gluten, alors que seuls 6 % étaient réellement concernés par une intolérance ou une allergie.
Les auteurs de l’étude appellent à un meilleur encadrement des allégations nutritionnelles et encouragent les fabricants à améliorer la qualité des produits sans gluten en intégrant des alternatives plus nutritives. Ils recommandent également aux consommateurs d’être attentifs à la composition des aliments et de privilégier une alimentation équilibrée, plutôt que de se fier aveuglément aux tendances alimentaires.
The Guardian, Extreme weather expected to cause food price volatility in 2025 after cost of cocoa and coffee doubles, 15/02/2025
Selon une étude du cabinet de conseil Inverto, la multiplication des événements climatiques extrêmes risque d’entraîner une forte instabilité des prix alimentaires en 2025. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où plusieurs produits de base, comme le cacao et le café, ont déjà vu leurs prix plus que doubler en un an.
L’année 2024 a été marquée par des records de chaleur, confirmés par plusieurs instituts météorologiques. Cette hausse des températures, couplée à des précipitations irrégulières, a gravement affecté les rendements agricoles dans plusieurs régions productrices. Par exemple, les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest ont souffert de sécheresses et d’épisodes de chaleur intense, entraînant une hausse spectaculaire des prix (+163 %). De même, les récoltes de café au Brésil et au Vietnam ont été perturbées par des conditions météorologiques extrêmes, provoquant une augmentation de 103 % des prix du café sur les marchés mondiaux.
D’autres denrées alimentaires ont également été impactées : le prix de l’huile de tournesol a grimpé de 56 %, en raison de la sécheresse en Bulgarie et en Ukraine, tandis que le beurre et le jus d’orange ont connu une hausse de plus de 30 %. Le bœuf, de son côté, a vu son prix augmenter de 25 % en raison de l’impact des sécheresses sur les pâturages et les coûts de production.
Les experts en sécurité alimentaire s’inquiètent des conséquences de cette volatilité. Selon Pete Falloon, spécialiste du climat au Met Office et à l’Université de Bristol, les phénomènes météorologiques extrêmes vont continuer à s’intensifier tant que les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas maîtrisées. La crise climatique affecte directement les rendements agricoles et, par ricochet, la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Face à cette incertitude, Inverto recommande aux entreprises agroalimentaires et aux distributeurs de diversifier leurs sources d’approvisionnement pour éviter une trop grande dépendance à certaines régions vulnérables aux aléas climatiques. Les gouvernements sont également appelés à renforcer les stratégies de résilience, notamment en soutenant l’innovation agricole et en adaptant les politiques de sécurité alimentaire.
En parallèle, la hausse des prix alimentaires aggrave l’insécurité alimentaire dans de nombreux pays. En décembre 2024, le gouvernement britannique a alerté sur l’augmentation du nombre de ménages en situation de précarité alimentaire, en grande partie à cause de l’inflation alimentaire provoquée par le changement climatique.
Max Kotz, du Potsdam Institute for Climate Impact Research, souligne que la situation est amenée à se détériorer tant que des actions concrètes ne seront pas mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la résilience des systèmes agricoles face aux nouvelles réalités climatiques.
L’année 2025 s’annonce donc particulièrement instable pour le marché alimentaire mondial, et la nécessité d’anticiper ces chocs devient un enjeu majeur pour les gouvernements et les industries concernées.
Le Demeter 2025, NOURRIR 2050 : de la fiction à la réalité
Alors que s’ouvre un nouveau quart de siècle, le champ des possibles d’ici 2050 est aussi imprécis qu’illimité. Devrions-nous, dès lors, en décréter son illisibilité ? L’affirmative serait chose facile, d’autant que les dérèglements géopolitiques et climatiques en cours peuvent nous emporter vers le pessimisme et l’immédiateté. Quand tout semble vaciller et aller plus vite, nos regards se détournent de l’essentiel. Or voir au loin est nécessaire, et pour ce faire, il faut voir tôt.
2050, c’est déjà demain, et les enjeux alimentaires et agricoles occuperont une place toujours centrale : davantage de personnes à nourrir, d’appétits et de profils différenciés chez les acteurs qui rythmeront la marche mondiale, de défis productifs à résoudre et d’ingéniosité à déployer. Sur ces terrains stratégiques, les déterminations, les compétitions et les tensions ne manqueront pas de s’amplifier.
Afin d’aller de l’avant et de préparer ces lendemains sans qu’ils déchantent inévitablement, la prise de recul s’avère indispensable.
Nourrir 2050 ne sera pas uniquement l’affaire de systèmes agricoles et alimentaires qui devront être à la hauteur. Il s’agit aussi de cette capacité de réfléchir autrement, de combiner des analyses, des idées et des expériences, de comprendre que la complexité nous impose modestie et motivation, de s’ouvrir pour penser, de penser pour agir et d’agir pour progresser.
Cette 31e édition du Déméter embarque pour le lointain, dans une série de futurs possibles et contradictoires, pour que les fictions alimentaires puissent dialoguer avec les réalités agricoles.
Pour le commander c’est ici.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A dans deux semaines !
O. Frey