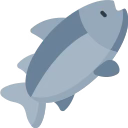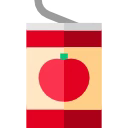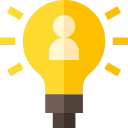🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2024-30
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Le tsunami du poulet frit, 17/10/2024
Libération, La quiche, les Lorrains en font tout un fromage, 12/10/2024
WholeFoods, Whole Foods Market Forecasts the Top 10 Food and Beverage Trends for 2025, 16/10/2024
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Cette semaine le magazine Challenges consacre un dossier à la malbouffe. Les articles ne sont pas encore disponibles en ligne.
Challenges, Malbouffe. Une addition salée, 17/10/2024
Le grignotage et les plats préparés connaissent un essor sans précédent en France, contribuant à une montée inquiétante de l’obésité. En marge du Salon international de l’alimentation (Sial) à Paris, les dernières données de Santé Publique France révèlent que l’obésité a doublé en vingt ans, touchant 17 % des Français et près de 50 % en surpoids. Le coût de cette crise est estimé à plus de 20 milliards d’euros par an, englobant les dépenses de santé et la perte de productivité.
Cette situation met en lumière une fracture alimentaire, les classes populaires étant les plus affectées par la malbouffe, en partie à cause de la hausse des prix des aliments sains et bio, jugés trop onéreux. L’industrie agroalimentaire, notamment des géants comme Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé, est pointée du doigt pour ses pratiques visant à maximiser les profits en vendant des produits ultra-transformés, riches en sel, sucre et graisses, à bas prix. Des voix critiques, comme celles du député Richard Ramos ou de Christophe Brusset, ancien cadre de l’agroalimentaire, dénoncent l’influence néfaste de ces entreprises sur la santé publique.
Le marché du snacking, désormais le premier secteur alimentaire en France avec 3,2 milliards d’euros de ventes, connaît une croissance rapide, dopée par l’augmentation du télétravail et des habitudes alimentaires fragmentées. Les chips, biscuits et produits extrudés (céréales, pâtes…) dominent les rayons, profitant aux multinationales mais aussi aux PME locales comme Brets, qui peine à suivre la demande.
Face à cette crise, le gouvernement explore des mesures pour lutter contre la malbouffe. Des initiatives telles que le chèque alimentaire pour les produits sains, le Nutri-Score obligatoire et une TVA majorée pour les aliments nocifs sont envisagées. L’Institut Montaigne plaide pour une action plus vigoureuse, tandis que des pays comme le Royaume-Uni prennent les devants en limitant les publicités de malbouffe.
L’évolution rapide des modes de vie, combinée à l’inflation, renforce cette tendance. Le temps passé devant les écrans et le télétravail favorisent le grignotage, tandis que la restauration rapide, avec une hausse de 11 % en 2023, séduit de plus en plus, notamment les jeunes attirés par des produits comme le « french tacos ». Cette situation alarmante appelle à des réponses politiques rapides pour endiguer le phénomène.
Challenges, La grande distribution carbure aux produits ultratransformés, 17/10/2024
Face à l’inflation et à la guerre des prix, la grande distribution en France accentue son offre de produits ultratransformés et à bas prix, au détriment de la qualité nutritionnelle. Michel Biero, vice-président de Lidl France, annonce le lancement d’une gamme de 300 produits de marque premier prix, affichant des tarifs jusqu’à 40 % inférieurs à la moyenne du marché. Leclerc, Carrefour et d’autres enseignes suivent cette tendance, ajustant leurs offres pour capter les consommateurs sensibles aux prix.
Les produits ultratransformés dominent les rayons, des saucisses aux pâtes à tartiner, et leur composition met en lumière un écart significatif avec leurs équivalents bio ou de qualité supérieure. Les consommateurs, contraints par la baisse de leur pouvoir d’achat, se tournent de plus en plus vers des produits économiques, accentuant la baisse des ventes de produits bio et sains. Selon NielsenIQ, même avec un ralentissement de l’inflation en 2024, la majorité des Français continuent de privilégier ces nouvelles habitudes alimentaires prises en période de crise.
Les associations de consommateurs, comme la CLCV et UFC-Que Choisir, critiquent les supermarchés pour leur rôle dans cette dégradation de l’assiette des Français. Elles pointent du doigt des promotions massives sur des produits mal notés par le Nutri-Score et le retour des bonbons en caisse, malgré des accords passés pour les retirer en 2008. Le marketing attractif de ces produits de snacking et de malbouffe encourage les consommateurs à acheter des articles peu nutritifs, au détriment de leur santé.
Le bio et les fruits et légumes frais sont les principales victimes de cette tendance. Alors que la marge des distributeurs sur les légumes atteint en moyenne 49,1 %, les prix restent élevés pour ces produits, favorisant les alternatives moins coûteuses mais moins saines. Face aux critiques, Carrefour a relancé son initiative Act For Food pour une alimentation durable, mais la pression des prix reste un défi majeur.
Le Monde, Saumon : les failles du label ASC qui prône un élevage « responsable », 14/10/2024
Le label ASC (Aquaculture Stewardship Council), censé garantir un élevage de saumons « responsable » et respectueux de l’environnement, est remis en question par plusieurs ONG spécialisées dans le bien-être animal et l’écologie. Bien que cette certification, qui couvre 40 % du marché mondial, promet un impact positif sur la planète, elle tolère des pratiques controversées, notamment en matière de surpopulation des bassins d’élevage et de méthodes d’abattage.
Le principal problème soulevé concerne la densité des élevages. Compassion in World Farming (CIWF) recommande un seuil de 10 kg par mètre cube pour permettre aux saumons de se mouvoir librement et éviter le stress et les maladies. L’ASC, cependant, n’impose aucune limite stricte pour l’instant. De même, bien que l’organisme prévoit d’exiger l’étourdissement avant abattage en 2025, cette pratique reste facultative pour le moment et contribue à la souffrance des animaux.
La question de la mortalité des poissons est également préoccupante. Des taux de mortalité de 27 % ont été observés dans certaines fermes certifiées, ce qui est bien au-delà du plafond théorique de 10 %. Ces mortalités sont souvent dues aux maladies et aux conditions de vie dégradées dans les bassins surpeuplés. Cependant, des dérogations sont parfois accordées par l’ASC, comme dans le cas de la ferme de Varden en Norvège, où un taux de mortalité de 27 % a été jugé acceptable.
Les échappements de saumons d’élevage dans les eaux naturelles constituent un autre point de friction. Ces fuites peuvent entraîner la propagation de maladies parmi les populations de saumons sauvages et compromettre leur génétique. Là encore, l’ASC accorde des exceptions en cas d’événements imprévus, ce qui interroge sur la rigueur de la certification.
Enfin, bien que l’ASC limite l’usage d’antibiotiques préventifs et de farines de poissons dans l’alimentation des saumons, son impact sur la réduction de l’empreinte carbone reste faible. L’organisme affirme cependant travailler en permanence à l’amélioration de ses critères, avec une révision majeure prévue pour 2025. Toutefois, pour les ONG, ces efforts demeurent insuffisants pour répondre aux défis environnementaux actuels.
Libération, La quiche, les Lorrains en font tout un fromage, 12/10/2024
La quiche lorraine, véritable emblème de la région Lorraine, fait l’objet de débats passionnés et de traditions bien ancrées. Au cœur de ces discussions se trouve la question cruciale du fromage : doit-il ou non figurer dans la recette ? Dans une région où ce plat est omniprésent, notamment à Dombasle-sur-Meurthe, autoproclamée « capitale de la quiche », la confrérie de la quiche lorraine veille jalousement à préserver la « vraie » recette, sans gruyère, comme l’a promulguée Jean-Pierre Coffe, natif de la région.
Evelyne Muller-Dervaux, grand maître de la confrérie depuis 2015, insiste sur l’importance de respecter la recette traditionnelle : une pâte brisée, de la crème fraîche, des œufs, des lardons fumés, du poivre et de la muscade, sans l’ajout de fromage ou d’autres ingrédients. Cependant, cette stricte orthodoxie culinaire n’est pas du goût de tout le monde. Certains boulangers, comme Fabrice Gwizdak à Nancy, préfèrent alléger leur version en n’utilisant que du lait, tandis que d’autres, comme le chef Olivier Streiff à Metz, avouent en toute discrétion ajouter du fromage à leur préparation.
Les origines de la quiche sont également source de débat parmi les historiens de la gastronomie. Patrick Rambourg souligne que les recettes évoluent au fil du temps et que les lardons n’ont été ajoutés que tardivement au XXe siècle. Pire encore pour les puristes : Auguste Escoffier, célèbre chef cuisinier du début du XXe siècle, incluait du gruyère dans sa recette de quiche lorraine, remettant ainsi en question l’idée d’une recette « authentique ».
Ce débat sur la « vraie » quiche ne fait que refléter l’importance de ce plat dans l’identité régionale lorraine. À Metz, par exemple, la quiche est presque un symbole de convivialité, souvent offerte en cadeau lors de repas entre amis. Les variations régionales, notamment entre Metz et Nancy, témoignent des influences locales, comme les traditions culinaires voisines d’Alsace et d’Allemagne. Au-delà des querelles sur la recette, la quiche lorraine continue d’incarner la générosité et la convivialité de la région. Que ce soit à Dombasle, Nancy ou Metz, ce plat reste une référence incontournable, qu’il soit dégusté avec ou sans fromage.
Les Échos, Le tsunami du poulet frit, 17/10/2024
Le poulet frit connaît un véritable essor en France, marquant une nouvelle étape dans l’américanisation des habitudes alimentaires, en particulier chez la génération Z. Alors que KFC domine le marché depuis son arrivée en 1991, d’autres chaînes américaines comme Popeyes et Wingstop s’implantent rapidement et séduisent les consommateurs avec leurs offres de sandwiches et tenders au poulet frit. Popeyes, après un premier essai infructueux en 2018, connaît cette fois-ci le succès et ambitionne d’ouvrir 250 restaurants en France d’ici dix ans. De son côté, Wingstop, spécialisé, comme son nom l’indique, dans les “wings” et tenders marinés dans des sauces variées, s’installe en région parisienne avec des commandes via Deliveroo.
Cette popularité croissante du poulet frit est visible sur les plateformes de livraison comme Uber Eats et Deliveroo, où il se classe désormais parmi les plats les plus recherchés, rivalisant avec la pizza et les burgers. En effet, le nombre de restaurants spécialisés dans le poulet frit en France est passé de 331 en 2019 à 510 en 2022, une augmentation notable, notamment dans les banlieues. Des enseignes comme Chicken Street et Pepe Chicken capitalisent sur cette tendance, tandis que d’autres se démarquent avec des concepts plus premium, à l’image de Buck Fried Chicken, qui associe poulet frit et vins naturels.
Le succès de ce plat repose en partie sur son faible coût de production par rapport à d’autres viandes. Le poulet, moins cher et à plus faible empreinte carbone que le bœuf, est perçu comme une option accessible et universelle. Toutefois, la majorité du poulet consommé dans ces établissements est importée, principalement de Pologne ou des Pays-Bas, ce qui limite les retombées pour les éleveurs français.
Cette déferlante du poulet frit s’accompagne également d’une réinvention culinaire. Le chef étoilé Mory Sacko, par exemple, revisite la recette avec des influences soul food et japonaises dans ses établissements parisiens. Ce mélange d’innovation et d’influences culturelles continue de faire du poulet frit l’un des plats phares de la restauration rapide en France.
L’Usine Nouvelle, Comment l’industrie agroalimentaire française pourrait s’inspirer de l'Italie pour la sauce tomate, 15/10/2024
La filière agroalimentaire française pourrait s’inspirer du modèle italien pour revitaliser son industrie de la tomate, en particulier dans le secteur des sauces. L’Italie, et plus précisément le Nord de l’Italie, domine largement le marché européen de la tomate d’industrie, transformant chaque année 5,4 millions de tonnes de tomates, soit un quart des besoins européens en concentrés utilisés dans les sauces. Grâce à une organisation bien rodée et à une coopération étroite entre agriculteurs et industriels, l’Italie continue de prospérer face à la concurrence chinoise et espagnole.
Le succès de la filière italienne repose notamment sur l’interprofession Opini, qui regroupe agriculteurs et industriels et négocie chaque année le prix des tomates à produire. Cette structure, rare en Italie, garantit une stabilité aux producteurs tout en favorisant une production mécanisée et une grande traçabilité, deux piliers de la compétitivité italienne. En outre, les industriels italiens bénéficient d’une organisation logistique dense, avec 28 usines dans le Nord du pays, et d’un marché intérieur solide qui consomme 2 millions de tonnes de tomates transformées.
En France, la situation est bien différente. Malgré un projet ambitieux baptisé Tommates, visant à satisfaire un tiers de la demande nationale de sauces tomates d’ici 2035, la filière peine à se redresser. Moins de 15 % de la consommation française est actuellement couverte par la production locale. Un épisode marquant a été le rachat de l’usine Le Cabanon par le groupe chinois Chalkis en 2004, qui a transformé l’établissement en simple point d’entrée pour du concentré de tomate chinois, signant la fin de la compétitivité de la filière française.
Malgré des efforts pour mécaniser la production agricole au même niveau que l’Italie, le secteur de la transformation reste un goulet d’étranglement en France. Le projet d’une nouvelle usine de sauce tomate à Entraigues-sur-la-Sorgue, mené par Panzani, aurait pu donner un nouveau souffle à la filière, mais a été abandonné en raison de priorités budgétaires. En conséquence, la France continue d’importer massivement des produits dérivés de tomates italiennes, renforçant ainsi la domination de l’Italie sur ce marché. Sans un investissement significatif dans les infrastructures de transformation, comme les 52 millions d’euros nécessaires à l’usine Panzani, la France aura du mal à rattraper son retard. Pour l’heure, l’Italie demeure le principal fournisseur de la France, avec 46 % des livraisons de tomates transformées.
Les Échos, En Allemagne, les urbains branchés plébiscitent les vins sans alcool, 15/10/2024
En Allemagne, le vin sans alcool connaît un engouement croissant, notamment dans les grandes villes. Ce marché, encore confidentiel, attire de plus en plus d’attention de la part des professionnels du secteur. Ludovic Piedtenu, fondateur du magasin Vinotopia à Berlin, admet avoir été surpris par cette demande en 2020. Aujourd’hui, il vend plusieurs références de vins sans alcool dans sa boutique. Dans d’autres enseignes, comme « Les Epicuriens » ou Weing’schäft, la tendance s’est aussi imposée. Cordt Schwäkendiek, gérant de Weing’schäft, souligne que 10 % de son chiffre d’affaires provient désormais de vins sans alcool.
Bien que ce segment représente encore moins de 1 % du marché global en 2023, il affiche une croissance impressionnante, avec une augmentation de 27 % des volumes et de 54 % du chiffre d’affaires l’année dernière, selon l’Institut allemand du vin. Dans le secteur des mousseux, le sans alcool atteint même 7 % des ventes. L’Allemagne, qui est l’un des marchés européens les plus dynamiques pour les vins sans alcool, bénéficie de son expérience avec la bière sans alcool, qui représente près de 10 % du marché. Philipp Rößle, fondateur de Kolonne Null, une start-up spécialisée dans la désalcoolisation des vins, souligne que le profil des consommateurs inclut non seulement les jeunes générations, mais aussi les personnes qui doivent conduire, les femmes enceintes et les personnes âgées. Ces consommateurs ne cherchent pas nécessairement à renoncer complètement à l’alcool, mais alternent entre des vins avec et sans alcool.
Produire du vin sans alcool présente cependant des défis techniques, notamment pour préserver les arômes tout en évitant une acidité excessive. Des entreprises comme Kolonne Null et la start-up danoise ISH ont réussi à se forger une bonne réputation dans ce domaine. De nouveaux acteurs comme Muri, qui utilise des techniques de reconstitution à base de plantes pour créer des alternatives au vin, élargissent également l’offre. À Berlin, la consommation de vin sans alcool devient un élément du mode de vie urbain, où le vélo, la cuisine vegan et l’attention portée à la santé se mêlent. Cette tendance semble prête à révolutionner l’offre dans les restaurants et les cavistes des grandes villes allemandes.
Les Échos, De plus en plus de Français se mettent au vin sans alcool, 15/10/2024
Les ventes de vin sans alcool connaissent aussi une croissance spectaculaire en France, selon les données de Circana. Alors que les ventes de vin traditionnel sont en baisse, les vins sans alcool, qu’ils soient rouges, rosés, blancs, ou effervescents, rencontrent un succès croissant. Ce phénomène, autrefois marginal, s’inscrit dans une tendance plus large de déconsommation de l’alcool dans l’Hexagone, et ce alors même que le vin tient une place centrale dans notre culture gastronomique.
L’entreprise Moderato, précurseur dans ce secteur, illustre bien cette expansion. Créée par Fabien Marchand-Cassagne, Moderato a levé 3 millions d’euros pour développer ses activités, notamment grâce à des investisseurs tels que la famille Hériard Dubreuil, actionnaire majoritaire du groupe Rémy Cointreau. La marque, qui a ouvert 1.000 points de vente en France et 500 à l’étranger, incarne cet engouement croissant pour le vin sans alcool. French Bloom, un autre acteur du marché, a également vu une prise de participation de 30 % par Moët Hennessy, soulignant l’intérêt grandissant des grands groupes pour ce secteur.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les huit premiers mois de 2024, les ventes de vin sans alcool ont bondi de 20 % en volume et de 28 % en valeur. Le marché global des boissons sans alcool, comprenant également bières, cidres et spiritueux, a enregistré une hausse de 57 % depuis 2019, avec des ventes atteignant 305 millions d’euros en 2023. Ce segment représente désormais 4,4 % du volume total des boissons alcoolisées vendues en France. Cette progression attire un nombre croissant d’acteurs : le nombre de producteurs dans ce marché a triplé en deux ans, et compte désormais 30 entreprises. Même des vignerons prestigieux, comme Coralie de Boüard, se lancent dans l’aventure en répondant aux demandes spécifiques, telles que celle du prince qatari, propriétaire du PSG, qui a sollicité un merlot sans alcool.
Cependant, l’un des défis majeurs pour les producteurs reste de maintenir les arômes lors de la désalcoolisation, car l’alcool contribue à préserver les notes aromatiques et la structure du vin. Fabien Marchand-Cassagne reconnaît que les vins de mauvaise qualité, souvent produits en Espagne, déçoivent les consommateurs. Il insiste sur la nécessité de partir d’un vin de qualité pour obtenir un résultat satisfaisant après désalcoolisation. Moderato, tout comme d’autres acteurs, investit dans la recherche pour améliorer les processus et surmonter ce défi technique.
Le Figaro, Taxer les produits sucrés pour favoriser l’achat de fruits et légumes : la proposition choc de l’Institut Montaigne, 16/10/2024
L’Institut Montaigne propose une mesure audacieuse pour lutter contre la malbouffe et la précarité alimentaire : taxer les produits sucrés pour financer un chèque alimentaire destiné aux plus démunis. Dans un rapport publié cette semaine, le think-tank suggère d’imposer une réglementation stricte aux industriels afin de réduire progressivement la teneur en sucre de leurs produits. Les aliments qui ne respecteraient pas ces objectifs seraient soumis à une taxe, avec des recettes fiscales estimées à 560 millions d’euros par an.
L’Institut Montaigne plaide également pour une harmonisation de la TVA sur les produits sucrés à 20 %, ce qui pourrait générer 1,2 milliard d’euros supplémentaires. Cette somme, combinée aux recettes de la taxe sur le sucre, pourrait financer quasi-intégralement un chèque alimentaire destiné aux Français en « très grande précarité », d’une valeur de 30 euros par mois, exclusivement utilisable pour acheter des fruits et légumes. Ce dispositif, déjà évoqué lors de la Convention citoyenne pour le climat en 2020, serait mis en place de manière temporaire jusqu’en 2027, pour être évalué à cette date.
L’objectif est de lutter contre l’épidémie croissante de surpoids et d’obésité en France, qui touche près d’un Français sur deux, et plus particulièrement les jeunes. En 2020, 20 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, et le sucre est pointé du doigt comme principal responsable. L’Institut Montaigne alerte aussi sur les inégalités alimentaires, notant que les populations les plus modestes consomment deux fois moins de fruits et légumes que le reste de la population.
En plus de la taxation, le rapport propose d’interdire les publicités pour les boissons sucrées en dehors du créneau de 21h à 5h, afin de réduire l’exposition des enfants à ces produits. La taxe sur les boissons sucrées, introduite en 2012, devrait également être renforcée pour inciter les industriels à diminuer la teneur en sucre de leurs produits. Cependant, ces propositions ne font pas l’unanimité. Les industriels de l’agroalimentaire, déjà mécontents des critiques récurrentes à leur égard, ont exercé des pressions pour tenter d’influencer le contenu du rapport. La participation de Dominique Schelcher, PDG de Système U et critique de l’industrie agroalimentaire, à la présidence du groupe de travail, a également suscité des réactions dans le secteur. Malgré ces oppositions, l’Institut Montaigne reste convaincu que ces mesures sont nécessaires pour enrayer l’épidémie de malbouffe en France et réduire les inégalités alimentaires.
WholeFoods, Whole Foods Market Forecasts the Top 10 Food and Beverage Trends for 2025, 16/10/2024
Comme chaque année à la même période, Whole Foods vient de dévoiler son top 10 des tendances Food & Boisson pour l’année 2025. En voici un aperçu :
1. Snacking international : les snacks qui fusionnent différentes saveurs mondiales, comme les chips de riz gluant à la mangue ou les mélanges d’édamame et de noix au chili oil, deviennent populaires, offrant une expérience culinaire internationale.
2. Dumplings prêts-à-consommer : les dumplings, traditionnels ou en version fusion, apparaissent dans de nouveaux formats pratiques, séduisant les consommateurs par leur diversité culturelle et leur versatilité.
3. Du crunchy à chaque repas : les textures croquantes, des noix germées fermentées aux chips de champignons, deviennent incontournables pour ajouter du croustillant à tous les repas, des salades aux desserts.
4. Hydratation innovante : les boissons hydratantes, enrichies en électrolytes et ingrédients innovants comme l’eau de cactus ou de coco, montent en flèche, offrant des alternatives aux boissons sucrées.
5. Montée du thé : le thé prend une place centrale dans les boissons, pâtisseries et desserts, avec des formats innovants comme les sachets pour infusion froide et les laits végétaux infusés au thé.
6. Emballages compostables : de plus en plus de marques adoptent des emballages compostables, voire compostables à domicile, réduisant leur impact environnemental.
7. Boissons éco-responsables : les boissons alcoolisées, comme le vin et la bière, intègrent des pratiques régénératives et des emballages plus légers pour minimiser leur empreinte carbone.
8. Levain revisité : le pain au levain, emblème de la pandémie, se décline désormais en produits divers, comme les pâtes, crackers et brownies, valorisant les bienfaits du levain.
9. Ingrédients aquatiques végétaux : les algues et plantes aquatiques gagnent du terrain grâce à leurs bienfaits nutritionnels, avec des produits à base de mousse de mer, lentilles d’eau et agar-agar.
10. Protéines enrichies : les consommateurs cherchent à intégrer plus de protéines sous forme d’aliments entiers, favorisant des produits comme les mélanges de viandes incluant des abats, riches en nutriments.
Modern Retail, How latte art and cafe partnerships are fueling the growth of Táche’s food service business, 14/10/2024
La marque de lait de pistache Táche connaît une croissance fulgurante, portée par l’intérêt croissant pour la pistache dans le secteur alimentaire. Selon la fondatrice Roxana Saidi, Táche est la seule marque véritablement spécialisée dans le lait de pistache, une alternative prisée pour sa saveur, sa nutrition et sa durabilité. En effet, les pistachiers nécessitent 75 % moins d’eau que les amandiers, un argument clé pour attirer une clientèle soucieuse de l’environnement.
Lancée en 2020, Táche s’est rapidement implantée dans plus de 3 000 cafés à travers le monde, qui représentent près de 50 % de ses revenus. Sa présence dans ces établissements, renforcée par des partenariats avec des chaînes comme Fellini à New York et Camel Coffee à Los Angeles, contribue grandement à la notoriété de la marque. En parallèle, la marque a fait son entrée dans les rayons de Target et sur Amazon, et continue d’élargir sa distribution, notamment grâce à la plateforme Faire. Cette dernière a permis à Táche de pénétrer de nouveaux marchés aux États-Unis, mais aussi à l’international, notamment à Bruxelles, Amsterdam et Vienne.
L’essor de la popularité du lait de pistache est aussi alimenté par les réseaux sociaux, où le “latte art” fait fureur, notamment sur TikTok et Instagram. Les vidéos de baristas utilisant le lait Táche pour créer des cafés spéciaux, parfois en partenariat avec des cafés, attirent une attention considérable. Cette visibilité a contribué à une croissance impressionnante, notamment sur le marché des services alimentaires, avec une augmentation des ventes de 200 % depuis avril 2024 sur Faire.
Pour consolider cette dynamique, Táche mise sur des événements marketing en partenariat avec les cafés, notamment à Los Angeles, où elle s’apprête à lancer un latte co-brandé avec la chaîne Hilltop et une campagne offrant 50 lattes gratuits dans plusieurs établissements. En parallèle, l’intérêt général pour la pistache, considéré comme un ingrédient “luxueux mais accessible”, alimente encore plus la demande pour les produits de Táche, qui espère devenir un leader dans cette catégorie en pleine expansion.
Eater, For Restaurants Cutting Their Carbon Footprint, Composting Food Scraps Is Just the Beginning, 15/10/2024
De plus en plus de restaurants s’engagent à réduire leur empreinte carbone, en allant bien au-delà du simple compostage des déchets alimentaires. Au Rifrullo Café, la propriétaire Colleen Marnell-Suhanosky a adopté des mesures comme l’installation de fours à induction, qui consomment moins d’énergie que les cuisinières à gaz et ne produisent pas de chaleur excessive. Ce changement, bien qu’onéreux, réduit les émissions de gaz à effet de serre et améliore le confort des cuisines. D’autres chaînes, telles que Clover Food Lab, ont électrifié leurs installations pour limiter leur dépendance aux combustibles fossiles.
Outre la consommation d’énergie, les restaurants sont également de grands consommateurs d’eau. Des solutions simples, comme des vannes de pulvérisation à faible débit, permettent de réduire significativement cette consommation. Certaines entreprises, telles que Budderfly, offrent même des systèmes permettant de financer des équipements économes en énergie, aidant ainsi les restaurants à réduire leur impact environnemental tout en économisant sur leurs factures d’électricité.
La réduction des plastiques est un autre enjeu majeur pour les restaurateurs. Marnell-Suhanosky a opté pour des contenants compostables et propose à ses clients des contenants réutilisables via le programme Recirclable, bien que cette initiative nécessite une éducation des consommateurs pour fonctionner à grande échelle. Certains restaurants, comme ceux de Chipotle, adoptent également des contenants compostables, bien que l’infrastructure de compostage aux États-Unis soit encore limitée.
Des restaurateurs innovants comme Edward Lee expérimentent des cuisines zéro gaz et zéro plastique dans des projets pilotes, espérant créer des modèles de durabilité pouvant être reproduits par d’autres établissements. Ces efforts visent à sensibiliser l’industrie de la restauration à l’importance de la réduction des déchets et de l’impact environnemental, tout en aidant les petits restaurants à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Financial Times, Inside Venice’s farm-to-table revolution, 16/10/2024
À Venise, une révolution “farm-to-table” se déploie sur l’île de Sant’Erasmo, connue comme le potager de la ville. Cette initiative, née d’une coopération entre chefs locaux, vise à préserver les saveurs uniques des fruits et légumes vénitiens, tout en soutenant une agriculture durable et locale. En 2020, alors que la ville se dotait de barrières pour se protéger des inondations, ces restaurateurs ont lancé leur propre plan de sauvetage : la création d’une ferme coopérative, Osti in Orto, pour fournir des produits frais et de saison aux restaurants de Venise.
Sant’Erasmo, la deuxième plus grande île de la lagune, fait face à de nombreux défis, notamment la diminution de sa population et la disparition progressive de ses petites exploitations agricoles. Cependant, sous la direction de Mario Saviolo, un jeune agriculteur de 24 ans, la coopérative Osti entend inverser cette tendance en cultivant des légumes locaux tels que des aubergines, des radicchietti, des tomates et des poivrons, dont les saveurs sont influencées par le sel de la lagune.
Les chefs de Venise, comme Francesco Agopyan et Cesare Benelli, sont des figures de proue de ce projet. Benelli, propriétaire du restaurant Al Covo, se souvient d’une époque où Venise comptait encore 160 000 habitants. Aujourd’hui, la ville n’en a plus que 50 000, mais Benelli reste optimiste. Il espère que des initiatives comme Osti in Orto revitaliseront la ville et protégeront ses traditions culinaires.
Les défis ne manquent pas pour Saviolo et son équipe. L’île, vulnérable aux changements climatiques, a subi des pertes importantes lors de la grande inondation de 1966, et la rentabilité de la ferme reste encore à atteindre. Toutefois, des plans d’expansion sont prévus, comme l’ajout de serres en 2024. La coopérative est également ouverte à de nouveaux membres.
Wall Street Journal, The Family That Went Against the Grain—and Built a Billion-Dollar Company, 11/10/2024
Siete Foods, une entreprise fondée par Veronica et Miguel Garza, est passée en dix ans d’une simple activité artisanale à un empire de la tortilla sans gluten, valorisé à 1,2 milliard de dollars suite à son acquisition il y a quelques jours par PepsiCo.
L’aventure a débuté lorsque Veronica, atteinte de plusieurs maladies auto-immunes, a commencé à fabriquer des tortillas sans céréales à base de farine d’amande dans sa cuisine au Texas pour suivre un régime paléo. Sa famille, également passionnée de CrossFit, a adopté ce mode de vie et soutenu son projet. Le déclic est venu lorsqu’ils ont proposé leurs tortillas à un magasin local, qui a accepté de les vendre. En peu de temps, elles se sont retrouvées en rupture de stock. Forts de ce succès, les Garza ont lancé Siete Foods, qui signifie « sept » en référence aux sept membres de la famille. La marque a rapidement élargi son offre avec des produits comme des chips, des sauces, et des snacks sans céréales.
Miguel, qui a quitté ses études de droit pour soutenir l’entreprise, a travaillé sans relâche pour faire entrer les produits Siete dans des enseignes plus grandes, notamment Whole Foods, après une série de tentatives et de connexions fortuites. Leur persévérance a payé, et la marque s’est imposée dans les rayons des épiceries à travers les États-Unis.
L’entreprise familiale s’est développée tout en restant fidèle à ses racines mexicaines-américaines. Elle a attiré l’attention des investisseurs, et en 2018, le fonds de capital-investissement Stripes a injecté 90 millions de dollars pour soutenir sa croissance. Siete Foods est ainsi devenue une référence sur le marché des produits alimentaires sans gluten et paléo.
Forbes, How Artificial Intelligence, AI, Can Help Achieve Precision Nutrition, 14/10/2024
L’IA pourrait révolutionner le domaine de la nutrition de précision, qui consiste à adapter les recommandations alimentaires aux spécificités de chaque individu. En effet, la nutrition de précision cherche à prendre en compte des facteurs complexes comme la génétique, le microbiome, les comportements alimentaires, le stress, l’environnement social et les conditions de santé. Cependant, comprendre comment ces multiples facteurs interagissent et évoluent dans le temps est un défi monumental pour les scientifiques. C’est ici que l’IA entre en jeu.
Les études scientifiques traditionnelles sont souvent limitées par la durée des observations, le nombre de participants, et les données qu’elles peuvent traiter. Elles peinent à intégrer tous les facteurs qui influencent la santé nutritionnelle, et leurs résultats ne sont pas toujours généralisables. L’IA, en revanche, est capable de combiner de vastes ensembles de données, d’identifier des tendances et des associations complexes, et de générer des recommandations nutritionnelles personnalisées plus rapidement qu’une équipe humaine ne pourrait le faire.
L’IA peut être utilisée de deux manières principales. D’une part, les approches basées sur les données analysent des ensembles de données pour trouver des corrélations entre des habitudes alimentaires et des résultats de santé, bien que ces corrélations ne révèlent pas toujours les mécanismes sous-jacents. D’autre part, les approches mécanistiques simulent des processus biologiques pour comprendre comment un aliment spécifique agit sur le corps, permettant de prédire ses effets à long terme sur différents individus. En combinant ces deux types d’approches, l’IA peut affiner les recommandations nutritionnelles en s’appuyant à la fois sur les données existantes et sur des simulations virtuelles. Par exemple, l’IA pourrait identifier un aliment bénéfique pour une population donnée, puis simuler son effet sur la santé de personnes présentant des caractéristiques différentes.
Toutefois, l’IA n’est pas infaillible. Comme toute méthode scientifique, elle dépend de la qualité des données et de la conception des algorithmes. Il est donc crucial de comprendre ses limites et d’utiliser ses résultats avec discernement.
Business Insider, Generation Snack Attack, 14/10/2024
La génération Z adopte une nouvelle forme de consommation en se tournant vers des produits alimentaires haut de gamme, privilégiant les aliments sains et coûteux plutôt que les objets de luxe traditionnels. Des jeunes, comme la TikTokeuse Jade Lily, exhibent fièrement leurs achats de produits premium, notamment des boissons probiotiques et des compléments alimentaires promus par des célébrités, souvent achetés dans des épiceries comme Erewhon, connue pour ses smoothies à 19 dollars. Cette tendance est en plein essor, avec les générations Z et milléniale qui dépensent désormais plus pour des produits d’épicerie que pour des sorties au restaurant ou des loisirs.
Une enquête McKinsey de 2024 a montré que cette génération dépense plus en alimentaire que les précédentes. Malgré la hausse des prix des denrées, certains jeunes privilégient les aliments coûteux et sains, voyant ces achats comme un investissement dans leur santé. Les produits haut de gamme, comme des céréales à 53 dollars ou des chips à 45 dollars, sont devenus des « objets de luxe » abordables pour une génération qui trouve de plus en plus difficile d’accéder à des biens coûteux comme la propriété.
Cette évolution s’explique par l’héritage des millénials, qui ont initié la tendance des aliments sains avec des modes comme l’avocat toast. Aujourd’hui, la Gen Z privilégie les options végétariennes, véganes et biologiques, même si elles sont plus onéreuses. Une étude de Whole Foods révèle que 70 % des membres de cette génération sont prêts à payer plus pour des produits de qualité.
L’alimentation est également devenue un symbole de statut social. Dans un contexte où l’achat de biens coûteux comme une maison devient inaccessible, les jeunes utilisent leurs choix alimentaires pour signaler leur position sociale. Des marques comme Poppi et Olipop, promues par des célébrités comme Camila Cabello, répondent à cette demande en misant sur des boissons probiotiques à faible teneur en sucre, habilement conçues pour attirer une génération soucieuse de son image et de sa santé.
Institut Montaigne, Fracture alimentaire. Maux communs, remède collectif, Octobre 2024
Le rapport dont parle l’article du Figaro un peu plus haut.
Sondage Ifop pour le Cercle de Giverny, Octobre 2024
Dans un contexte économique encore marqué par la crise inflationniste et où la possibilité d’augmenter les impôts fait son entrée dans le champ des possibles, l’alimentation est d’abord réfléchie par le prisme de son coût. C’est le premier critère dans le choix de l’alimentation des Français, cité par 69% des sondés. C’est même davantage le cas dans les ménages aux revenus les plus faibles (76% chez les catégories modestes, 82% chez les catégories pauvres). En parallèle, c’est l’élément décisif qui pourrait motiver un Français sur deux à intégrer davantage de végétal dans son alimentation (51%).
Le lien entre alimentation et santé est largement établi chez les Français : 87% estiment que les choix alimentaires impactent la santé. C’est le troisième critère décisif dans les choix alimentaires (42%), derrière le goût des aliments (68%). Le principal facteur pouvant motiver à équilibrer son alimentation est, de loin, la santé (86%), avec des scores supérieurs à 70% quelles que soient les caractéristiques des personnes interrogées.
Aux yeux des Français, l’alimentation durable est synonyme de produits locaux, non-transformés, avec moins d’emballage plastiques. Ce sont en tout cas, les efforts que consentiraient à faire respectivement 57%, 47% et 46% des Français. Les sympathisants de la majorité présidentielle sont davantage sensibles à la réduction des emballages plastiques (59% le mentionnent), alors que les sympathisants EELV se voient plus réduire leur consommation de viande (61%, vs 32% en moyenne) ou payer plus cher leur alimentation (20%, vs 7%).
Les Français pointent l’impact de la production de l’alimentation sur l’environnement. Plus criant, 40% estiment que cette industrie a des impacts négatifs sur l’ensemble des éléments proposés. Cette perception négative est traversée par une fracture politique : 56% des sympathisants de gauche déclarent que tous les impacts sont négatifs, contre 29% des sympathisants de droite.
Un trio est identifié comme les acteurs centraux pour faciliter l‘accès à une alimentation saine et durable : la grande distribution (60% la mentionnent), les industriels (53%) et l’Etat (51%).
Pascale Weeks a écrit un article très complet sur les sauces tomates dans sa dernière newsletter suite à un voyage en Italie organisé par l’interprofession des tomates d’industrie du nord du pays. Ce séjour lui a permis de découvrir les coulisses de la transformation des tomates destinées aux conserves, comme la polpa, la passata ou le concentré. Ces tomates, plus petites et moins juteuses que celles des étals, sont cultivées en plein champ et récoltées mécaniquement pour garantir une production rapide et locale. Contrairement au sud de l’Italie, où la récolte manuelle persiste avec parfois des conditions de travail précaires, le nord se distingue par une approche plus industrielle et contrôlée.
Elle y détaille le processus de fabrication de divers produits : la polpa (tomates concassées), qui conserve une texture proche de la tomate fraîche ; la passata, une purée lisse souvent vendue en bouteilles en verre pour rappeler la tradition italienne ; et le concentré de tomate, obtenu par réduction sous vide de la purée.
Les Echos, La Story, Rians, la laiterie familiale qui a tout d’une grande
Avec ses produits ultra-frais et ses principes équitables, la laiterie berrichonne est devenue multinationale et trace sa voie face aux géants du secteurs. Dans « La Story », le podcast d’actualité des « Echos », Pierrick Fay et Nathalie Villard dévoilent les secrets de la réussite de Rians.
Des amateurs de fridgescaping par ici?
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey