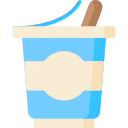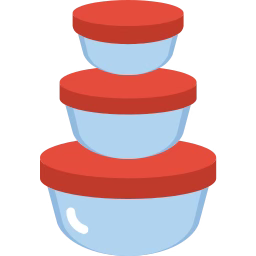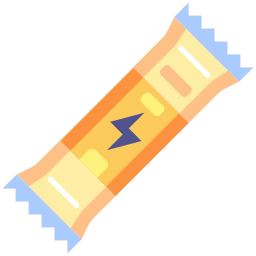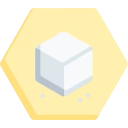🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2024-26
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Le Monde, En France, le succès grandissant des bars à vins, 19/09/2024
Le Figaro, Dalloyau, Fauchon, Hédiard, Lenôtre : la malédiction des traiteurs de luxe français, 20/09/2024
New York Times, The Hidden Environmental Costs of Food, 19/09/2024
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Un peu d’autopromo cette semaine
Rapport disponible à la vente ici : www.tendancesfood.com
Libération, La pâte à tartiner algérienne El Mordjene Cebon est interdite dans l’UE, tranche le ministère de l’Agriculture, 17/09/2024
Le ministère de l’Agriculture a annoncé mardi dernier l’interdiction de la pâte à tartiner algérienne El Mordjene Cebon au sein de l’Union européenne (UE). Ce produit, devenu viral sur les réseaux sociaux, ne répond pas aux normes européennes en matière de sécurité sanitaire, en particulier celles concernant les produits laitiers, selon les autorités. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment cette marchandise a pu contourner les réglementations et se retrouver sur le marché européen.
L’Algérie, pays d’origine de cette pâte à tartiner, ne remplit en effet pas « l’ensemble des conditions nécessaires pour exporter vers l’UE des marchandises contenant des produits laitiers », précise le ministère. Le respect des exigences strictes de l’UE en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments est pointé du doigt. Actuellement, deux envois d’El Mordjene Cebon sont bloqués aux postes de contrôle frontaliers français, empêchant leur distribution. Cette interdiction intervient quelques jours après que Carrefour ait annoncé son intention de commercialiser le produit d’ici deux à quatre semaines. Cependant, d’autres enseignes comme Auchan, Aldi, Casino et Lidl avaient décidé de ne pas suivre cette voie.
El Mordjene Cebon, bien que populaire en ligne, n’a pour l’instant pas eu l’opportunité de concurrencer le Nutella, leader incontesté du marché français des pâtes à tartiner. Avec près de 90 millions de pots vendus par Ferrero l’an dernier, Nutella détient plus des trois quarts de ce marché en France, selon les données de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD). L’interdiction d’El Mordjene Cebon met en lumière les obstacles auxquels se heurtent certains produits alimentaires importés face aux exigences sanitaires strictes de l’UE. Cette affaire souligne également l’importance des normes de sécurité pour les produits alimentaires, un enjeu crucial dans un marché globalisé où la concurrence reste féroce.
Le Figaro, Grâce à Lactalis et Sodiaal, Yoplait devient encore plus française, 12/09/2024
Les groupes français Lactalis et Sodiaal ont conclu une acquisition majeure en rachetant les activités nord-américaines de Yoplait, jusqu’alors détenues par le géant américain General Mills. Cette transaction, d’un montant total de 2,1 milliards de dollars, marque une nouvelle étape dans la réorganisation de la marque à la petite fleur. Sodiaal, coopérative fondatrice de Yoplait, reprendra les activités au Canada, qui génèrent un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros, ainsi qu’une usine employant 300 personnes au Québec. De son côté, Lactalis acquiert les opérations américaines de Yoplait, qui représentent un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, avec deux usines dans le Tennessee et le Michigan.
Cette opération permet à Sodiaal de renforcer son contrôle sur Yoplait, après avoir récupéré en 2021 les 51 % des parts de General Mills, devenant ainsi l’unique propriétaire de la marque à l’échelle mondiale. Sodiaal voit en cette acquisition une opportunité de poursuivre la croissance de la marque au Canada, où Yoplait détient 28 % du marché des yaourts, derrière Danone. La coopérative française a déjà démontré sa capacité à revitaliser Yoplait en Europe, avec une hausse de 26 % du chiffre d’affaires dans les deux ans suivant la reprise des activités détenues par General Mills. Pour Lactalis, cette acquisition est une percée stratégique dans son expansion sur le marché américain, deuxième marché du groupe après la France. Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis, se réjouit de devenir un acteur clé du secteur laitier aux États-Unis grâce à cette opération.
Cette transaction est également une alliance inattendue entre deux rivaux historiques en France, Lactalis et Sodiaal, désormais associés autour de la gestion de Yoplait en Amérique du Nord.
Le Monde, En France, le succès grandissant des bars à vins, 19/09/2024
Les bars à vins connaissent un véritable boom en France, notamment dans les grandes villes et les zones viticoles, où ils attirent une clientèle variée. Cette tendance, en plein développement depuis les années 2010, est marquée par une augmentation impressionnante du nombre d’établissements, bien que le chiffre exact reste difficile à évaluer. Selon une étude de Businesscoot, on compterait environ 2 000 bars à vins en France, contre seulement 500 en 2005.
Ces lieux se distinguent par une large offre de vins, souvent servis au verre, et accompagnés de petites bouchées à grignoter. Cependant, la définition d’un « bar à vins » reste floue, car ces établissements varient énormément en termes d’ambiance, de services et de clientèle. Si le phénomène s’inscrit dans un contexte où la consommation de vin en France a diminué de 70 % en soixante ans, il reflète un changement des comportements. Les consommateurs privilégient désormais une consommation plus occasionnelle, orientée vers la qualité et l’expérience.
Les bars à vins séduisent particulièrement les jeunes et les femmes, attirés par des lieux plus conviviaux et accessibles, loin des cadres formels des restaurants traditionnels. L’émergence des vins naturels contribue également à cette popularité, proposant une approche plus décontractée de la dégustation de vin.
Avec une offre flexible de tapas et une ambiance détendue, les bars à vins répondent à une demande croissante d’expériences gastronomiques plus légères et moins formelles. Toutefois, certains se demandent si cette tendance ne finira pas par suivre le même destin que d’autres modes éphémères comme les coffee shops ou les brasseries artisanales.
Les Échos, Comment l'icône Tupperware est tombée de son piédestal, 18/09/2024
Tupperware, autrefois icône mondiale des boîtes de conservation, traverse une période difficile, symbolisée par sa mise sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Confronté à une baisse significative de ses ventes et à un chiffre d’affaires réduit à 1,3 milliard de dollars en 2022 (contre 2,6 milliards en 2014), le groupe floridien cherche à se réinventer. Ce processus de transformation, centré sur le numérique et la technologie, est une tentative pour redresser une situation qui s’est dégradée progressivement au fil des ans.
La vente directe à domicile, qui a fait la renommée de Tupperware, est aujourd’hui perçue comme dépassée dans plusieurs marchés. Malgré des efforts pour moderniser son modèle de distribution avec des ateliers interactifs et des webinaires, l’entreprise n’a pas su s’adapter assez rapidement aux nouveaux comportements des consommateurs, notamment aux États-Unis, où elle a tardé à revenir à la vente en magasin. Ses produits sont maintenant disponibles dans les supermarchés Target, mais cela ne semble pas suffisant pour séduire un public plus jeune.
L’image du plastique, longtemps associée à Tupperware, est également en cause. Avec la montée des préoccupations environnementales et de santé liées au plastique, les matériaux perçus comme plus durables, tels que le verre ou l’acier, ont gagné en popularité, en particulier auprès des jeunes générations. De plus, Tupperware peine à diversifier son image et à promouvoir ses innovations au-delà de ses produits iconiques.
Face à ces défis, la marque a déjà réduit sa capacité de production, notamment en fermant son usine française en 2018 et en transférant ses activités de production aux États-Unis vers le Mexique. L’avenir de Tupperware reste incertain, alors qu’elle cherche à retrouver sa place dans un marché concurrentiel où ses produits sont souvent perçus comme plus chers que ceux de ses concurrents.
Les Échos, Quand le snacking fait trembler le sacro-saint repas français, 18/09/2024
Le marché du snacking en France connaît une croissance fulgurante, atteignant 18 milliards d’euros et remettant en question la tradition des trois repas à table. Inspirée par les habitudes alimentaires américaines, cette tendance se traduit par une forte augmentation des dépenses des Français dans les produits apéritifs, comme les chips, biscuits salés, et noix, qui surpassent désormais celles consacrées à des produits plus traditionnels comme les pâtes, les œufs, ou le lait.
Selon une étude de Circana, les produits apéritifs ont généré 3,2 milliards d’euros de ventes sur un an, soit une hausse de 5 %. Ce chiffre est trois fois supérieur à celui des pâtes alimentaires et presque deux fois celui des œufs ou du jambon, des aliments pourtant très prisés en France.
La pandémie a joué un rôle clé dans cette évolution, notamment avec l’essor du télétravail et des apéros dînatoires. Le télétravail a contribué à déstructurer les repas traditionnels, favorisant des pauses gourmandes tout au long de la journée. En effet, plus de deux tiers des actifs grignotent en milieu de matinée, et 25 % des Français optent désormais pour des solutions de snacking le soir, contre seulement 11 % en 2021. Les industriels s’adaptent à cette transformation, avec une multiplication des lieux de vente et des offres de produits de snacking, comme les sandwichs, wraps, et pizzas, dans les boulangeries et les supermarchés. Ces derniers représentent désormais 65 % des achats de repas à emporter, une hausse de 8 % en deux ans.
Les Échos, La France surfe sur l'explosion de la demande de pommes de terre dans le monde, 16/09/2024
Face à une demande mondiale croissante, notamment en Asie, la filière française de la pomme de terre est en pleine expansion. La demande mondiale de pommes de terre devrait augmenter de 40 millions de tonnes d’ici 2030, portée par l’évolution des habitudes alimentaires et l’essor des chaînes de fast-food en Asie, où la pomme de terre commence à remplacer le riz. Avec 6,8 millions de tonnes produites en 2023, la France est le deuxième producteur européen, derrière l’Allemagne, mais reste le premier exportateur mondial, avec une pomme de terre sur deux destinée à l’export.
Malgré des défis environnementaux et techniques, les rendements pour 2024 s’annoncent prometteurs grâce à des conditions climatiques favorables et une hausse de 7 % des surfaces cultivées. Cette croissance permet de répondre à la demande des industriels, notamment des fabricants de frites et chips, qui représentent plus de 50 % des débouchés. Les entreprises belges et néerlandaises, telles qu’Ecofrost et Agristo, investissent également en France, tandis que McCain projette un investissement de 350 millions d’euros dans ses sites français.
Toutefois, la filière doit relever plusieurs défis. Les rendements tendent à stagner, notamment à cause des sécheresses répétées. Pour y faire face, des recherches sont en cours pour développer de nouvelles variétés de pommes de terre, plus résistantes au changement climatique et aux maladies comme le mildiou. La modernisation des infrastructures et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires figurent également parmi les priorités pour sécuriser la production et répondre à la demande croissante mondiale.
Le Figaro, Dalloyau, Fauchon, Hédiard, Lenôtre : la malédiction des traiteurs de luxe français, 20/09/2024
Les traiteurs de luxe français, autrefois symboles d’excellence gastronomique, traversent une période difficile. Des entreprises emblématiques telles que Dalloyau, Fauchon, Hédiard et même Lenôtre, autrefois incontournables, peinent à s’adapter aux évolutions du marché. Dalloyau, fondé en 1682, est en redressement judiciaire et suscite l’intérêt de grands groupes comme Elior, Accor et le Groupe Bertrand pour une éventuelle reprise. Malgré ses 60 % d’activités en tant que traiteur pour des événements, la maison n’a jamais su réellement décoller financièrement, surtout après la crise du Covid.
Le déclin de Dalloyau n’est pas un cas isolé. Hédiard a également été mis en difficulté après son rachat en 2014 et Fauchon a dû fermer plusieurs de ses boutiques phares, dont celles de la place de la Madeleine à Paris. Le modèle traditionnel de ces traiteurs ne parvient plus à séduire une nouvelle génération de consommateurs, davantage attirés par des solutions modernes comme la livraison à domicile via des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats. De plus, des pâtissiers et fromagers contemporains, agiles sur les réseaux sociaux, captent désormais l’attention d’une clientèle urbaine et touristique.
Face à ces défis, Lenôtre, passé sous le contrôle de Sodexo en 2011, parvient à tirer son épingle du jeu grâce aux opportunités offertes par les grands événements internationaux tels que les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby. Lenôtre, tout en maintenant un artisanat d’excellence, voit son chiffre d’affaires croître de 25 % en 2024 grâce à son intégration dans l’offre événementielle de Sodexo Live!
Modern Retail, How pop-ups are helping food and beverage startups grow their business, 17/09/2024
Face à la montée en puissance de la concurrence dans le secteur du retail, les pop-ups se sont imposées comme une stratégie essentielle pour les startups alimentaires et de boissons. Ces événements temporaires permettent non seulement d’attirer l’attention des consommateurs grâce à leur caractère exclusif, mais aussi de tester de nouveaux marchés à moindre coût.
Selon l’étude de Modern Retail+ Research, 17 des 21 startups interrogées ont organisé des pop-ups entre juillet 2023 et août 2024. Ces entreprises, comme Liquid I.V., Lucky Energy ou Graza, se servent de ces événements pour mieux comprendre les préférences des consommateurs, tester de nouveaux produits et concepts, et affiner leur stratégie de distribution. Le format pop-up, par sa flexibilité, permet à ces jeunes marques d’établir une présence dans plusieurs villes tout en limitant les investissements nécessaires à une boutique permanente. Parmi les lieux les plus prisés pour ces activations figurent New York, Los Angeles, mais aussi des villes comme Austin, Chicago, et San Francisco.
Les startups, notamment celles du secteur des boissons, voient dans les pop-ups une opportunité de mettre en avant l’expérience client, un facteur clé de différenciation. Par exemple, Lucky Energy conçoit chaque activation autour d’une expérience unique, qui varie selon les villes. Ce format leur permet de capter l’attention d’un public large, malgré un budget marketing limité. Les pop-ups offrent également une exclusivité qui incite les consommateurs à participer, renforçant ainsi l’engouement pour la marque.
Toutefois, la mesure du retour sur investissement (ROI) des pop-ups reste complexe. Pour la plupart des marques, le véritable succès se mesure à travers les retours des consommateurs, les mentions sur les réseaux sociaux et la notoriété accrue. Comme le souligne Liquid I.V., l’objectif premier est de renforcer l’attachement à la marque et d’élargir la communauté autour de celle-ci. Certaines marques vont plus loin en utilisant les pop-ups pour distribuer des produits exclusifs, organiser des rencontres avec les fondateurs ou créer des événements immersifs, comme l’a fait Poppi avec son pop-up VIP animé par Paris Hilton à Los Angeles.
Modern Retail, Protein bars continue to evolve with new better-for-you brands, 18/09/2024
Le marché des barres protéinées continue d’évoluer en réponse aux changements des préférences alimentaires. De nouvelles marques, comme David, cofondée par Peter Rahal, ancien de RXBar, cherchent à combler un besoin croissant de nutrition. Avec 28 grammes de protéines, 150 calories et zéro sucre par portion, les barres David reflètent un changement dans le paysage des snacks. Elles témoignent de l’importance croissante des ingrédients « clean » et des saveurs améliorées pour attirer une audience plus large.
La demande croissante en protéines aux États-Unis renforce cette tendance. Selon un récent sondage, 71 % des Américains cherchent à augmenter leur apport en protéines, contre 56 % en 2022. Les barres protéinées, auparavant perçues comme des compléments alimentaires, sont désormais vues comme des aliments à part entière, fabriqués avec des ingrédients familiers. Aloha, une marque qui a misé sur des sources de protéines végétales, comme le riz brun et les graines de courge, illustre cette évolution. Son succès s’explique par un recentrage sur des ingrédients simples et une présentation audacieuse. Depuis 2017, Aloha a atteint une croissance de 500 % et prévoit un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars en 2024, avec une présence dans 14 000 points de vente tels que Kroger et Walmart. Le PDG Brad Charron attribue ce succès à une base de consommateurs de plus en plus exigeante, qui attend que la saveur soit à la hauteur de la qualité nutritionnelle.
Trubar, une autre marque de barres protéinées, a suivi une voie similaire. Connue pour ses saveurs gourmandes comme “Oh Oh Cookie Dough”, elle cible un public majoritairement féminin. Fondée en 2018, Trubar a ajusté sa formule en augmentant sa teneur en fibres et en supprimant les huiles de graines (colza, tournesol…), répondant ainsi à l’évolution des préférences des consommateurs. Erica Groussman, fondatrice de Trubar, insiste sur l’importance de l’innovation continue pour répondre à la demande tout en restant fidèle aux valeurs de la marque.
Alors que la concurrence dans le secteur des barres protéinées s’intensifie, l’innovation et la flexibilité restent cruciales. Les marques qui réussissent sont celles qui offrent des produits savoureux, avec des ingrédients de qualité, tout en restant à l’écoute des consommateurs et de leurs attentes en constante évolution.
FoodBev, Snack attack: What you need to know about the UK ban on junk food adverts before 9pm, 17/09/2024
À partir du 1er octobre 2025, le gouvernement britannique mettra en place une interdiction des publicités pour les produits riches en graisses, en sel et en sucre (HFSS) avant 21h à la télévision et interdira complètement les publicités payantes en ligne pour ces produits. Cette mesure vise à lutter contre l’obésité infantile, un problème de plus en plus préoccupant au Royaume-Uni, où plus d’un tiers des enfants sont en surpoids ou obèses avant de terminer l’école primaire. Cette décision, portée par le ministre de la Santé Andrew Gwynne, reflète une promesse clé du manifeste du Parti travailliste, cherchant à réduire l’influence des publicités de malbouffe sur les enfants. Gwynne estime que cette mesure permettra de protéger les jeunes consommateurs, particulièrement vulnérables à ce type de marketing.
Christina Vogel, directrice du Centre de Politique Alimentaire à l’Université de Londres, souligne l’importance de cette interdiction pour réduire l’exposition des enfants à la malbouffe, mais appelle également à des actions supplémentaires, notamment une mise à jour du modèle de profil nutritionnel pour mieux refléter les dernières recommandations diététiques. L’interdiction vise plusieurs catégories de produits, notamment les boissons sucrées, les snacks salés, les céréales pour petit-déjeuner, les confiseries, les glaces, les biscuits, les pâtisseries, les plats préparés et certaines variétés de pizzas et de produits à base de pommes de terre. Ces produits, souvent riches en graisses saturées, sucre et sel, sont directement liés à la mauvaise alimentation et à l’obésité infantile.
Face à ces restrictions, les fabricants devront adapter leurs produits et stratégies marketing. Parmi les options envisagées figurent la reformulation des produits, l’investissement dans la recherche pour des alternatives plus saines, et le recours à des canaux de marketing moins touchés par l’interdiction, comme les partenariats avec des influenceurs. Cette législation s’inscrit dans une tendance internationale. Des pays comme l’Espagne, le Portugal et la Norvège ont déjà adopté des mesures similaires, et d’autres pays, y compris l’Union européenne, envisagent de suivre cet exemple.
Vox, When did sodas, teas, and tonics become medicine?, 12/09/2024
Les boissons fonctionnelles, qui promettent des bienfaits pour la santé au-delà de simplement étancher la soif, connaissent un véritable boom. Des sodas prébiotiques aux eaux enrichies en collagène, ces produits attirent de plus en plus de consommateurs, notamment les millénials, dont la demande pour ces boissons a augmenté de plus de 50 % aux États-Unis depuis 2020. Des marques comme Olipop misent sur des ingrédients naturels pour offrir des bénéfices tels que la santé digestive ou une peau plus lumineuse.
Ces boissons s’inscrivent dans une longue tradition où les humains ont cherché des élixirs pour améliorer leur bien-être. Pourtant, malgré l’explosion de ce marché, la science derrière ces boissons est souvent mitigée. Si certaines d’entre elles contiennent des ingrédients connus pour leurs bienfaits, comme les vitamines ou les probiotiques, de nombreuses autres reposent sur des promesses spéculatives. Les composants actifs de ces boissons, exposés à différents éléments comme la chaleur ou l’oxygène, peuvent perdre de leur efficacité avant même d’être consommés.
Cependant, leur popularité ne cesse de croître. En effet, les consommateurs cherchent de plus en plus à obtenir des solutions rapides pour améliorer leur santé, dans un contexte où l’angoisse de vieillir et les comparaisons constantes via les réseaux sociaux accentuent cette quête du mieux-être. Les influenceurs, qui promeuvent ces produits comme partie intégrante d’un « style de vie sain », renforcent l’idée que ces boissons fonctionnelles sont la clé pour ressembler à ces modèles de santé et de beauté.
Cette demande croissante pour des aliments et boissons qui « font plus » est enracinée dans la “médicalisation de la vie quotidienne”. Depuis le début du XXe siècle, la science et l’industrie alimentaire ont cherché à ajouter des nutriments bénéfiques à nos aliments, renforçant ainsi l’idée que tout ce que nous consommons doit avoir une valeur ajoutée pour la santé. Cette tendance s’est accélérée avec la déréglementation dans les années 1980, qui a permis aux fabricants d’apposer des allégations santé sans réelle preuve scientifique.
Aujourd’hui, consommer une boisson fonctionnelle, qu’il s’agisse d’un soda aux prébiotiques ou d’un tonique aux champignons, devient une façon de revendiquer un engagement envers un mode de vie sain. Pourtant, ces produits répondent souvent à une vision individualiste de la santé, loin des pratiques communautaires de consommation. Boire ces boissons devient un moyen d’essayer de contrôler son corps, face à l’idée persistante que celui-ci est constamment « défaillant ».
New York Times, The Hidden Environmental Costs of Food, 19/09/2024
Le prix que nous payons pour la nourriture au supermarché omet souvent un élément crucial : l’impact environnemental de sa production. Aux Etats-Unis, le bœuf coûte par exemple environ 5,34 $ la livre, mais ce prix ne prend pas en compte les dégâts écologiques liés à la déforestation, l’utilisation de l’eau ou les émissions de gaz à effet de serre. Si ces coûts étaient inclus, le prix réel pourrait dépasser 27 $ la livre.
Le concept de « comptabilité du vrai coût » cherche à intégrer les coûts environnementaux cachés des aliments dans leur prix. Cette méthode, soutenue par des organisations comme True Price, vise à sensibiliser les consommateurs, les producteurs et les gouvernements à l’empreinte écologique des produits alimentaires. L’objectif n’est pas nécessairement d’augmenter les prix, mais de rendre visibles ces coûts afin de modifier les comportements de consommation et inciter à la production durable. Selon Claire van den Broek, directrice de True Price, ces coûts, bien qu’invisibles à l’achat, finissent par être payés, que ce soit par les systèmes de santé ou des mesures d’adaptation climatique. Des études menées par cette organisation ont montré que les produits comme le bœuf, le fromage ou même le poulet comportent des coûts environnementaux importants. Par exemple, le bœuf est particulièrement coûteux en termes de terres nécessaires pour cultiver l’alimentation du bétail, tandis que le fromage, bien que moins impactant que le bœuf, a des coûts élevés en termes d’eau et de terres.
En revanche, les aliments d’origine végétale, comme le tofu ou les pois chiches, ont un impact environnemental bien moindre. Le tofu, par exemple, ne coûterait que 2,63 $ la livre en tenant compte des coûts écologiques, principalement en raison de son efficacité dans l’utilisation des ressources par rapport aux protéines animales. Certains gouvernements, comme le Danemark ou l’État de New York, commencent déjà à utiliser cette méthodologie pour ajuster leurs politiques alimentaires. Ils cherchent ainsi à réduire les impacts écologiques de la production alimentaire en incitant à la consommation de produits plus durables.
Wall Street Journal, Forget Cutting Sugar—New Tech Makes It Healthier Instead, 31/07/2024
Les scientifiques cherchent de plus en plus des moyens d’atténuer les effets néfastes du sucre sans le supprimer complètement de nos aliments. Parmi ces innovations, une technologie développée par l’Institut Wyss de l’Université Harvard pourrait révolutionner le marché : elle transforme le sucre en fibres bénéfiques pour la santé. Un enzyme, encapsulé dans une substance comestible, est ajouté à des aliments sucrés comme le chocolat, permettant de réduire la quantité de sucre absorbée par le corps. Cette enzyme pourrait réduire l’absorption du sucre de 30 % et convertir une partie en fibres bonnes pour l’intestin, sans changer le goût ni la texture des aliments.
Ce projet s’inscrit dans un contexte où la réglementation autour du sucre devient plus stricte aux États-Unis, avec des limites imposées sur le sucre ajouté dans les produits alimentaires, en particulier dans les repas scolaires. Les entreprises alimentaires, sous pression pour réduire la teneur en sucre de leurs produits, explorent des alternatives comme les édulcorants naturels ou des technologies comme celle de l’Institut Wyss.
D’autres entreprises innovent également. Biolumen, une start-up de San Francisco, a lancé un produit appelé Monch Monch, un mélange de boisson contenant des éponges microscopiques qui absorbent le sucre dans l’estomac pour limiter son absorption. Cette technologie, bien que prometteuse, doit encore faire l’objet de recherches approfondies sur son efficacité à long terme.
Cependant, toutes ces solutions technologiques ne sont pas exemptes de critiques. Certaines, comme l’additif Olestra des années 1990, ont été associées à des effets secondaires désagréables. Les chercheurs affirment avoir pris des mesures pour éviter ces problèmes, mais des doutes persistent quant à la sécurité à long terme de ces produits.
Parallèlement, des alternatives comme l’allulose, un sucre naturel, commencent à être utilisées par des entreprises comme Magic Spoon, qui exploite cette substance pour sucrer ses céréales tout en respectant les nouvelles normes nutritionnelles américaines. De même, la société Incredo a physiquement modifié le sucre pour le rendre plus sucré, permettant ainsi de réduire de moitié la quantité utilisée.
En dépit de ces innovations technologiques, certains experts, comme Nick Fereday de Rabobank, suggèrent que la solution la plus simple pour réduire l’impact négatif du sucre reste d’en consommer moins.
The Guardian, Artisans turn to ancient recipes for UK cheese revival, 15/09/2024
Le Royaume-Uni connaît un véritable renouveau de ses fromages artisanaux, avec des producteurs qui se tournent vers des recettes anciennes et redécouvrent des variétés oubliées. Longtemps éclipsées par l’industrialisation et les effets de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses variétés locales, autres que le cheddar et le stilton, avaient presque disparu. Dans les années 1950, la quête d’une production de masse a failli anéantir des fromages emblématiques comme le Wensleydale ou le Lancashire. Cependant, grâce à des artisans passionnés, ces fromages font peu à peu leur retour sur la scène gastronomique britannique.
Des fromagers comme Carrie Rimes, fondatrice de Cosyn Cymru, réintroduisent des recettes traditionnelles telles que le Caerphilly du nord du Pays de Galles. D’autres, comme Roger Cowgill, ravivent la production du fromage Lancashire en se basant sur un livret du ministère de l’Agriculture datant des années 1930. Ce mouvement s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation du terroir britannique. Les producteurs utilisent des races de vaches locales, comme les Shorthorns laitiers, et font pâturer leurs troupeaux sur des terres riches en biodiversité, ce qui confère aux fromages des saveurs uniques.
Sally et Andrew Hattan, qui produisent du Stonebeck dans les Yorkshire Dales, témoignent de cette approche où chaque fromage reflète les pâturages et les saisons. Le couple suit des méthodes traditionnelles, ne produisant que pendant les mois où les vaches peuvent paître, entre le printemps et l’automne, et utilise une ancienne race de vaches indigènes. Ils s’appuient sur des travaux d’historiens locaux et les souvenirs des rares producteurs qui se rappellent encore des goûts d’autrefois.
Cette résurgence des fromages traditionnels a été soutenue par des acteurs clés du secteur comme Neal’s Yard Dairy, fondée en 1979 par Randolph Hodgson. Des fromageries comme La Fromagerie à Londres ou Courtyard Dairy dans le Yorkshire participent également à la promotion de ces produits locaux.
La demande croissante des consommateurs pour des produits artisanaux et authentiques offre aux petits producteurs une opportunité unique de restaurer des traditions disparues, tout en renouvelant l’intérêt pour des variétés régionales oubliées. Des fromages comme le “Suffolk bang”, encore à redécouvrir, montrent que le patrimoine fromager britannique recèle encore bien des surprises à explorer.
The Guardian, Fresh starch: how TikTok helped spark a baked potato revival in the UK, 14/09/2024
Le simple « jacket potato », ou pomme de terre au four, connaît un renouveau spectaculaire au Royaume-Uni, grâce aux algorithmes de TikTok qui ont donné une nouvelle vie à ce plat traditionnel. Cette renaissance est portée par de jeunes vendeurs de pommes de terre, comme les Spud Bros à Preston, qui ont réinventé ce classique britannique avec des garnitures modernes et des vidéos en direct sur les réseaux sociaux. Jacob et Harley Nelson, les Spud Bros, ont accumulé plus de 2,6 millions de followers sur TikTok et leurs vidéos ont été visionnées plus de 1,5 milliard de fois, attirant des clients de pays aussi éloignés que l’Australie, l’Afrique du Sud, et même des célébrités comme les Jonas Brothers.
Le succès des Spud Bros ne repose pas uniquement sur la nostalgie du plat, mais aussi sur leur approche innovante des ingrédients. Par exemple, leur chili est assaisonné avec du cacao et une dizaine d’herbes et épices, tandis que leur fromage râpé provient d’un mélange de trois variétés locales. Ces améliorations, ainsi que leur habileté à utiliser les réseaux sociaux, ont transformé un plat autrefois considéré comme démodé en une véritable sensation.
L’histoire de cette entreprise familiale a commencé avec Tony Nelson, le père, qui a repris un stand de pommes de terre vieux de plus de 60 ans et a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux. Rapidement, Jacob et Harley ont rejoint l’aventure, contribuant à faire exploser la popularité de l’entreprise. Leurs vidéos en direct montrent le quotidien du stand et ont attiré des clients venus de loin. Des jeunes fans, jusque-là peu intéressés par les pommes de terre au four, affluent désormais vers Preston, parfois dès l’aube, pour goûter ces pommes de terre devenues virales.
Le phénomène ne se limite pas aux Spud Bros. Ben Newman, connu sous le nom de Spudman à Tamworth, a également utilisé TikTok pour revitaliser son commerce après la pandémie, accumulant 3,7 millions de followers. Ce succès numérique a non seulement redonné vie aux ventes de pommes de terre au four, mais il a aussi inspiré de nombreux autres vendeurs à travers le pays.
Vinepair, Millennials Drive Non-Alcoholic Drinks Sales in the U.S., 09/09/2024
Les ventes de boissons non alcoolisées connaissent une croissance spectaculaire aux États-Unis, et contrairement aux idées reçues, ce sont les millennials, et non la génération Z, qui en sont les principaux moteurs. Selon les données récentes de l’International Wine and Spirits Record (IWSR), les personnes âgées de 28 à 43 ans sont celles qui consomment le plus de produits non alcoolisés, avec 22 % d’entre eux déclarant consommer à la fois des boissons alcoolisées et non alcoolisées en avril 2024, contre seulement 13 % de la population américaine globale.
Les millennials ne se limitent pas à une seule catégorie de boissons : ils stimulent la demande dans les segments de la bière, du vin et des spiritueux sans alcool. En 2024, 61 % des consommateurs américains de bière non alcoolisée étaient des millennials, une augmentation par rapport aux 45 % de l’année précédente. Ils représentaient également 59 % des consommateurs de vin sans alcool et 66 % pour les spiritueux sans alcool.
La popularité croissante des boissons sans alcool s’explique par plusieurs facteurs, selon l’IWSR. D’abord, les millennials bénéficient de meilleures situations financières, ce qui les incite à sortir plus souvent. Lors de ces sorties, ils remplacent parfois les boissons alcoolisées par des alternatives sans alcool. Ensuite, ils sont plus ouverts à essayer de nouvelles tendances comme les mocktails ou des défis comme le « Dry January », où environ 31 % d’entre eux affirment s’abstenir d’alcool pendant un mois complet.
Malgré cette tendance, il est peu probable que les consommateurs abandonnent définitivement l’alcool pour des boissons non alcoolisées. Ils tendent plutôt à alterner entre les deux, par exemple en choisissant une bière sans alcool lors d’une soirée entre amis. Les prévisions de l’IWSR indiquent que l’industrie des boissons non alcoolisées continuera de croître, avec un taux de croissance annuel de 17 % de 2023 à 2028, mais l’alcool traditionnel reste une part importante des habitudes de consommation des millennials.
Fédération Française des Diabétiques, Secours Catholique, CIVAM et Solidarités Paysans, L'injuste prix de notre alimentation, 16/09/2024
Le rapport examine les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires cachés de notre système alimentaire actuel. Il met en lumière les effets négatifs de ce système agroalimentaire sur les plus précaires, les agriculteurs, et sur l’environnement.
Les points clés :
1. Impacts sur la santé : le rapport révèle que notre système alimentaire est responsable de maladies liées à une mauvaise alimentation, telles que l’obésité et le diabète, représentant un coût de 12,3 milliards d’euros en dépenses de santé publique. Les personnes en situation de précarité sont particulièrement vulnérables à ces maladies.
2. Dommages environnementaux : les pratiques agricoles intensives contribuent à la pollution, la dégradation des sols et la perte de biodiversité, avec des coûts écologiques estimés à 3,4 milliards d’euros. Ces coûts incluent la gestion des déchets, la dépollution de l’eau et les impacts sur la biodiversité.
3. Soutiens publics inefficaces : le rapport souligne que les aides publiques (48,3 milliards d’euros) ne sont pas alignées sur les besoins d’une agriculture plus durable et d’une meilleure répartition des revenus. La majorité de ces soutiens bénéficie à des acteurs engagés dans des pratiques agricoles à haut volume et peu respectueuses de l’environnement.
4. Précarité alimentaire : le rapport dénonce l’iniquité du système alimentaire, où les personnes les plus pauvres n’ont pas accès à une alimentation de qualité. Environ 8 millions de Français sont en situation d’insécurité alimentaire, et les aides alimentaires existantes sont insuffisantes pour répondre à ce besoin croissant.
5. Partage inéquitable des revenus : les agriculteurs reçoivent une part infime des prix de vente des produits alimentaires, souvent inférieure à 10 % du prix final payé par le consommateur. Cette situation perpétue la précarité des producteurs, notamment ceux qui cherchent à adopter des pratiques agroécologiques.
Le rapport propose plusieurs solutions :
• Réforme des soutiens publics pour les orienter vers des pratiques agricoles durables et socialement équitables.
• Accès universel à une alimentation de qualité en développant des systèmes comme les cartes alimentaires prépayées pour les plus démunis.
• Transition agroécologique massive pour garantir à la fois la durabilité environnementale et une juste rémunération des agriculteurs.
Ecole de Guerre Economique, L’Agriculture dans la guerre économique, Anatomie d’un intérêt vital à l'heure de dérèglements climatiques, géopolitiques et sociétaux.
L’étude s’inscrit dans un contexte mondial marqué par des bouleversements climatiques, géopolitiques et économiques. Elle souligne que l’agriculture française, au cœur de la souveraineté alimentaire, est exposée à des dynamiques de guerre économique où les États et entreprises se battent pour le contrôle des ressources, la domination des marchés, et la définition des normes agricoles.
La crise du Covid-19, la guerre en Ukraine et les bouleversements climatiques récents ont mis en exergue la fragilité du système agricole français, rendant essentielle une réflexion stratégique sur la manière dont l’agriculture peut maintenir sa compétitivité tout en répondant aux enjeux de durabilité.
Points clés :
1. Souveraineté alimentaire en péril : l’agriculture est un pilier vital pour la France, à la fois sur le plan économique et stratégique. Pourtant, elle est menacée par des logiques de marché qui favorisent les grandes puissances agricoles mondiales. L’Union européenne, en poursuivant des politiques environnementales strictes sans mesures protectrices adéquates pour les producteurs locaux, fragilise la compétitivité de l’agriculture française.
2. Dépendances stratégiques : le rapport met en lumière les fortes dépendances de la France vis-à-vis des intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires, machines). Ces dépendances, en particulier envers des pays étrangers, affaiblissent la souveraineté agricole française, tout en exposant les producteurs aux fluctuations des marchés internationaux.
3. Impact des réglementations européennes : l’étude souligne l’impact négatif des régulations européennes sur la compétitivité de l’agriculture française. La transposition de normes environnementales strictes, parfois plus rigides que celles imposées aux autres membres de l’UE, pénalise les agriculteurs français. En parallèle, le dumping social pratiqué par certains pays européens et la concurrence des puissances agricoles émergentes affaiblissent la capacité de la France à se positionner sur le marché global.
4. Transition environnementale et énergétique : l’agriculture française doit relever des défis majeurs liés au changement climatique. Les mesures de la stratégie européenne Farm to Fork visent à rendre l’agriculture plus verte, mais elles risquent de réduire la productivité de manière significative. L’évolution vers des pratiques plus durables est inévitable, mais elle nécessite des investissements importants et une adaptation des structures agricoles.
5. Renouvellement générationnel et mutation du métier : le vieillissement de la population agricole constitue une menace pour la continuité du secteur. Le rapport appelle à un soutien accru pour les jeunes agriculteurs afin de préserver la capacité de production française et d’assurer le renouvellement des générations dans un métier en profonde mutation.
6. Concurrence internationale et guerre économique : le rapport met en évidence la compétition féroce entre les pays pour dominer les marchés agricoles mondiaux. La France, malgré ses produits de qualité, se retrouve en position de faiblesse face à des concurrents bénéficiant de coûts de production plus bas et de régulations plus souples. L’agriculture devient ainsi un instrument de soft power dans un cadre géopolitique global.
PlushCare, The Most Unhealthy Menu Items at America’s Fast-Food Chains
Une étude intéressante pour ceux qui vont partir aux Etats-Unis dans les prochains mois. Elle analyse les options alimentaires proposées par les chaînes de restauration rapide aux États-Unis, en réponse à une prise de conscience croissante des consommateurs concernant la santé. Alors que certaines chaînes ajoutent des choix plus sains comme des salades et réduisent la teneur en sodium et en calories, la plupart des options restent fortement caloriques et riches en graisses saturées. Par exemple, McDonald’s a supprimé plusieurs options saines depuis la pandémie, arguant que la demande des consommateurs pour ces produits était faible.
L’objectif de cette étude est de comparer la valeur nutritionnelle de cinq produits classiques de restauration rapide (cheeseburgers, frites, nuggets de poulet, milkshakes à la vanille) dans 24 chaînes de fast-food populaires aux États-Unis. Les produits sont évalués en fonction de leur teneur en calories, en sucre, en graisses saturées et en sodium, pour attribuer un score global d’« insalubrité ». L’étude souligne bien évidemment que, bien que certaines chaînes de fast-food proposent des options plus saines, ces alternatives ne sont souvent que des compléments au menu traditionnel, largement dominé par des aliments riches en graisses, en sucre et en sel.
Les principaux résultats
1. Cheeseburgers :
• Five Guys a le cheeseburger le plus malsain, avec un score d’insalubrité de 50, dû principalement à une teneur en graisses saturées 73 % plus élevée que celle des autres chaînes.
• McDonald’s et Burger King sont parmi les plus « sains », avec des scores faibles de 18 points, grâce à une teneur réduite en graisses saturées.
2. Burgers de poulet :
• McDonald’s McChicken (14 points) est le burger de poulet le moins malsain parmi les chaînes étudiées, bien qu’il reste riche en sodium et en graisses.
• À l’opposé, le Chicken Sandwich Classic de Popeyes est l’un des plus malsains, avec 39 points.
3. Nuggets de poulet :
• Les nuggets de Popeyes sont les plus malsains avec un score de 30 points, en raison de leur teneur élevée en graisses saturées.
• McDonald’s offre les nuggets les moins malsains avec seulement 18 points.
4. Frites :
• Les frites de Five Guys sont les plus malsaines, ajoutant 953 calories à un repas, avec un score de 28 points.
• Les frites de McDonald’s sont les moins malsaines, avec un score de seulement 7 points.
5. Milkshakes à la vanille :
• Le milkshake à la vanille de Fatburger est le plus malsain de sa catégorie, avec 63 points, contenant 890 calories et des niveaux très élevés de sucre et de graisses saturées.
• Le milkshake de McDonald’s est le plus sain, avec un score de 26 points.
Chefs Talk, La place de l’enfant au restaurant
Peut-on emmener son enfant dans n'importe quel restaurant? Est-ce que les chefs envisagent cette clientèle? Comment réinventer le très ancré menu enfant et plus globalement comment le restaurant accueille un public qui a priori n'a pas forcément les codes et un ticket moyen qui ne séduit pas le comptable…??
Radio France, Food-trucks, la cuisine au coin de la rue
Ils sont 3000 à sillonner la France, avec leurs fours ambulants et leurs marmites. On trouve des food-trucks un peu partout dans l'hexagone, en ville ou à la campagne. lls ne sont pas toujours bien vus et ne font pas toujours recette. Balade culinaire à leur bord et paroles de "food-truckers".
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey