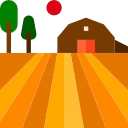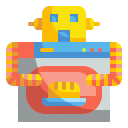🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2024-01
Avant toute chose je vous souhaite une belle et heureuse année 2024 ! Qu’elle soit remplie d’agapes et de belles découvertes gastronomiques.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Le Monde, Un Nutri-score plus exigeant à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, 31/12/2023
Le Monde, Alimentation et climat : la bataille de l’étiquetage environnemental a commencé, 30/12/2023
Wired, The Foods the World Will Lose to Climate Change, 29/12/2023
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, Alimentation et climat : la bataille de l’étiquetage environnemental a commencé, 30/12/2023
L'article se penche sur l'introduction imminente d'un nouvel étiquetage environnemental pour les produits alimentaires en France, souvent décrit comme le "Nutri-score du climat et de la biodiversité". Ce projet, prévu par la loi Climat et résilience de 2021, vise à fournir aux consommateurs des informations sur l'impact environnemental des produits alimentaires, mais sa mise en œuvre rencontre des difficultés.
D’un côté, nous avons le Planet-score, une initiative de l’Institut technique de l’agriculture biologique et plusieurs ONG, qui est actuellement le dispositif le plus avancé de ce type et est présent sur les emballages de 80 marques. De l’autre, plusieurs outils similaires ont été développés, comme par exemple l'Eco-score de Yuka et OpenFoodFacts.
L’affichage environnemental officiel, bien que prévu par la loi, n'est pas encore défini en termes d'objectifs, de méthodologie et de forme. Il ne sera pas obligatoire dans un premier temps et pourrait coexister avec d’autres outils. L’idée principale de cet étiquetage est d'aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés en matière de durabilité, de valoriser les produits ayant le moins d’impact environnemental et d’inciter les industriels à améliorer leurs pratiques.
La méthodologie pour calculer l'impact environnemental des produits alimentaires est toutefois complexe et controversée. L'« analyse de cycle de vie » (ACV), actuellement utilisée, présente des limites, notamment en ne prenant pas suffisamment en compte des aspects comme la biodiversité ou le bien-être animal. Par exemple, des poulets issus d’élevages intensifs peuvent se retrouver avec une meilleure note que des poulets bio élevés en plein air selon l’ACV, en raison de leur efficacité en termes d'empreinte carbone par kilogramme de produit.
L'enjeu est donc de compléter l'ACV par d'autres paramètres pour corriger ses biais, une tâche à la fois scientifique et politique. Le conseil scientifique de l’affichage environnemental travaille à proposer des méthodes et formats améliorés. Cependant, le gouvernement français n'a pas encore tranché sur la question, et il y a des préoccupations quant à l'intégration du bien-être animal dans la note principale.
Cet effort de la France pour développer un affichage environnemental est suivi de près en Europe, où des débats similaires sont en cours. L’article souligne par contre que l’étiquette environnementale ne sera pas suffisante pour une transition alimentaire complète et devra être accompagnée d'autres mesures politiques, dont la direction reste incertaine tant au niveau national qu’européen.
Le Figaro, «Shrinkflation»: le gouvernement compte rendre plus explicite la hausse des prix dans les rayons, 03/01/2024
L'article aborde le projet d'arrêté soumis par le gouvernement français à Bruxelles concernant la pratique de la « shrinkflation » dans les supermarchés et qui, comme nous l’avons déjà vu, consiste à réduire les quantités d'un produit tout en laissant son prix inchangé (voire même en l’augmentant). Cette pratique, également connue sous le nom de « réduflation », est légale tant que la mention du poids est modifiée sur l'emballage. Cependant, le gouvernement souhaite rendre ces changements plus transparents pour les consommateurs.
Selon le projet, ce sont les supermarchés qui devront indiquer sur les produits concernés l'ancienne et la nouvelle quantité, ainsi que le pourcentage ou le montant de l'augmentation de prix. Cette mention devrait être visible et lisible sur l'emballage ou une étiquette proche du produit. Le but est de permettre aux consommateurs de se prémunir contre ces nouvelles pratiques et de mieux comprendre les évolutions de prix.
Le projet d'arrêté, qui doit encore recevoir l'approbation de la Commission européenne, pourrait entrer en vigueur fin mars 2024 si aucun commentaire n'est émis par la Commission.
L’Hémicycle, Souveraineté alimentaire, un copieux défi, 22/12/2023
L'article aborde les défis auxquels l'agriculture française est confrontée dans le cadre de la souveraineté alimentaire. La France, malgré son statut de premier producteur agricole européen, fait face à un déclin préoccupant de sa production agricole, avec une grande partie de ses fruits et légumes ainsi que de la viande et du poisson qui sont importés. Ce modèle agricole, qui a émergé à l'époque gaullienne, est fragilisé, notamment en raison de la réduction des subventions qui soutenaient auparavant les exportations.
Les producteurs français sont confrontés à des coûts de main-d'œuvre élevés, une administration complexe, et un manque de formation. De plus, il existe un manque de collaboration entre les producteurs et les industriels, contrairement à d'autres pays européens. Il y a un décalage notable entre la consommation croissante de produits sains et la production nationale, ce qui entraîne une forte dépendance aux importations de légumes, fruits et produits biologiques.
La souveraineté alimentaire est considérée comme essentielle, mais l'autosuffisance totale est vue comme irréaliste. La France doit donc trouver un équilibre entre l'autosuffisance et la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Pour répondre à ces défis, une transformation majeure est suggérée, avec l'adoption de pratiques agricoles plus durables et moins dépendantes des énergies fossiles et des intrants chimiques.
Des innovations technologiques et génétiques pourraient jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité de la production agricole. Cependant, le secteur est également confronté à une crise démographique, avec un âge médian des agriculteurs élevé et une diminution du nombre d'exploitations.
Enfin, les changements dans les goûts et les habitudes alimentaires mondiaux représentent un défi culturel et gastronomique pour la France. La cuisine française, perçue comme élitiste et éloignée des plaisirs simples, pourrait perdre de son influence au profit de cuisines valorisant la convivialité et l'authenticité.
Le Monde, Un Nutri-score plus exigeant à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, 31/12/2023
Depuis le 1er janvier, le Nutri-score est devenu plus strict en pénalisant davantage le sucre, le sel, les mauvaises graisses, et l'absence de fibres. Cette mise à jour vise à mieux refléter les connaissances actuelles sur l'impact de l'alimentation sur la santé. Par exemple, les céréales Chocapic voient leur note baisser de A à C, et les laits demi-écrémé et entier sont respectivement notés B et C.
Le nouveau classement distingue mieux les produits selon leur composition nutritionnelle. Les mueslis sans sucre restent classés A, tandis que les céréales très sucrées sont classées D ou E. Les pains à farine complète, plus riches en fibres, sont mieux notés que ceux à farine raffinée. Certains fromages à pâte pressée pauvres en sel, comme l'emmental, sont reclassés en C. Les huiles riches en oméga-9 et oméga-3 sont notées B. Les charcuteries et la viande rouge sont fortement pénalisées.
Les changements s'appliquent également aux boissons, avec une rétrogradation des notes pour les boissons lactées sucrées et celles contenant des édulcorants. Seule l'eau peut maintenir la note A.
Ces changements, qui s'appliquent dans les sept pays ayant officiellement adopté le Nutri-score (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suisse), doivent être mis en œuvre sur les sites d'achat en ligne. Les industriels auront deux ans pour écouler leurs stocks avec les anciennes étiquettes. Bien que le Nutri-score ne soit pas obligatoire, les marques qui choisissent de l'utiliser doivent l'afficher sur l'ensemble de leurs gammes.
Libération, C’est quoi la «menu anxiety» dont souffrirait la génération Z ?, 27/12/2023
L'article traite du phénomène de la "menu anxiety" (anxiété liée au menu) qui affecte particulièrement la génération Z (ceux nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010). Selon une étude menée au Royaume-Uni par la chaîne de restaurants italiens Prezzo sur 2 000 membres de cette génération, 86% des jeunes de la génération Z ressentent de l'anxiété à l'idée de devoir choisir dans un menu, contre 67% dans la population générale. En outre, 38% des représentants de la génération Z déclarent consulter le menu en ligne avant de se rendre au restaurant.
Le sondage révèle également que le choix des plats par les jeunes est souvent influencé par leur potentiel esthétique pour des publications sur Instagram ou TikTok, avec un tiers des moins de 34 ans sélectionnant des plats en fonction de leur apparence. Les jeunes sont aussi plus influencés par les recommandations sur les réseaux sociaux que par celles trouvées sur des moteurs de recherche classiques comme Google.
Cette anxiété conduit un tiers des répondants de la génération Z à laisser les personnes avec qui ils mangent commander pour eux, et certains craignent même de ne pas savoir prononcer correctement les noms des plats. Cependant, cette anxiété n'est pas seulement liée à l'indécision ; elle est également liée au coût du repas, à la peur de ne pas trouver d'options appétissantes ou de regretter son choix. Plus d'un tiers des jeunes estiment qu'un menu trop long et plein d'options est intimidant. L'article suggère que cette anxiété pourrait être bénéfique, car un menu trop long a souvent moins de chances d'être composé de produits frais, impliquant ainsi un choix plus éclairé en faveur de la qualité des aliments.
Les Échos, L'appli de notation Yuka s'exporte pour faire mieux manger les Américains, 30/12/2023
Yuka a connu une croissance soudaine en Amérique après la diffusion d'une vidéo TikTok, qui a boosté le nombre d'utilisateurs de 16 000 en décembre 2021 à 500 000 un mois plus tard. Comme “ce n'est jamais retombé, parce qu'il y a eu d'autres vidéos” et que Luka n'avait personne sur place, les fondateurs sont donc partis s’installer à New York pour développer leur activité.
Bien que les consommateurs européens utilisent Yuka principalement pour évaluer la valeur nutritionnelle des aliments, les Américains ont d'abord été intéressés par les informations sur les cosmétiques. Cependant, l'objectif est de les orienter davantage vers l'alimentaire. Le marché américain, caractérisé par un fort taux d'obésité et une préoccupation croissante pour la diététique, présente des différences significatives par rapport à l'Europe, notamment en matière de réglementation sur les additifs et d'informations sur les emballages.
Yuka a facilement accès aux données grâce aux bases de données publiques de l'USDA, le ministère de l'Agriculture américain. Aux États-Unis, Yuka attire entre 300 000 et 500 000 nouveaux utilisateurs par mois, représentant 40 à 50 % des nouveaux utilisateurs globaux de l'application et 60 % de la croissance du chiffre d'affaires. Julie Chapon souligne que les Américains sont plus enclins à payer pour des services, contribuant ainsi à la rentabilité de l'application.
Malgré le défi de naviguer contre les intérêts des industriels dans un pays influencé par les lobbys, Yuka ne cherche pas à s'engager dans le dialogue politique, mais plutôt à influencer à travers les consommateurs. Avec 99 % des utilisateurs utilisant la version gratuite et seulement 1 % optant pour les services premium, l'entreprise vise à atteindre un tiers de la population américaine, soit entre 50 et 100 millions d'utilisateurs, pour impacter significativement les pratiques industrielles. Yuka, qui se finance sans publicité, mise sur son indépendance pour réaliser cet objectif.
Les Échos, Boissons alcoolisées : la revanche de la canette, 28/12/2023
L'article traite de l'évolution de l'utilisation de la canette dans le secteur des boissons alcoolisées, en particulier pour le vin et la bière. Historiquement associée à la bière de basse qualité consommée dans la rue, la canette connaît une renaissance, notamment dans les microbrasseries artisanales. En 2022, les ventes de canettes ont augmenté de 3,2 % par rapport à 2021, selon le groupement d'intérêt économique La Boîte Boisson.
Christian Maviel, PDG de Cacolac (la fameuse boisson chocolatée), a investi 10 millions d'euros dans une nouvelle usine à Léognan, en Gironde, dédiée au conditionnement en canette de vin et autres boissons, avec une capacité de production allant jusqu'à 40 millions de canettes par an. La canette est considérée comme un format complémentaire à la bouteille, adaptée aux vins destinés à être bus dans les deux ans, permettant de conserver la fraîcheur et l'acidité du vin.
Plusieurs entreprises françaises ont commencé à commercialiser du vin en canette, s'inspirant des pays nordiques et des États-Unis où cette pratique est plus courante. L'entreprise française Canetta propose par exemple du vin nature en canette, avec un packaging coloré, vendu à environ 5 euros pour 18,5 cl.
La canette présente de nombreux avantages pour la conservation du vin : plus nomade, légère, facile à entreposer, rapide à refroidir, plus recyclable et moins chère à produire. Ces atouts pourraient aider à contrer la baisse de la consommation de vin, notamment auprès des jeunes générations qui privilégient la bière ou les boissons non alcoolisées. En février 2022, un sondage OpinionWay a révélé que 72 % des Français seraient prêts à boire du vin en canette.
Du côté de la bière, les microbrasseries artisanales tentent de changer l'image négative de la canette. Luc Viguié, fondateur de la microbrasserie Noiseless, souligne que la canette est un meilleur contenant pour la bière en raison de son opacité et de son herméticité. La tendance est confirmée par Magali Filhue, déléguée générale de la fédération Brasseurs de France, même si la croissance reste modeste.
Le Figaro, «C’est le nouveau commerce de proximité» : pain, huîtres, pizzas… Bienvenue dans la France des distributeurs automatiques, 24/12/2023
L'article discute de l'évolution et de la popularité croissante des distributeurs automatiques en France, en particulier dans les zones rurales et semi-rurales. A l’image de Ludovic Casrouge, un ostréiculteur de Gouville-sur-Mer, qui connaît un grand succès avec son distributeur automatique proposant des produits comme des huîtres, des crevettes, de la soupe de poisson, et du saumon fumé. Ces distributeurs ne se limitent pas aux snacks traditionnels, mais offrent une variété de produits frais et locaux, y compris du pain, des pizzas, des fruits, des légumes, et même des spécialités régionales comme le comté dans le Jura ou les rillettes dans la Sarthe.
Ces équipements sont particulièrement utiles dans les zones où les commerces traditionnels sont en déclin. Par exemple, la boucherie Dulin Villain à Coutances utilise un distributeur comme un "troisième magasin", proposant des plats cuisinés et des produits de charcuterie.
Les distributeurs automatiques représentent une alternative économique à l'ouverture de nouveaux commerces, avec des coûts d'installation et de fonctionnement relativement bas. Ils offrent également une flexibilité en termes d'horaires, permettant aux clients d'acheter des produits à tout moment.
Cependant, cette tendance n'est pas sans critiques. Certains soulignent le manque de contact humain et les éventuelles nuisances sonores des distributeurs. De plus, il existe des défis en matière de gestion, comme le maintien de l'approvisionnement et la prévention des vandalismes.
Dans les villes, des entreprises comme JCDecaux explorent également le marché des distributeurs automatiques, proposant des produits frais dans des casiers connectés. Mais malgré leur commodité, les distributeurs ne sont pas considérés comme une solution complète aux défis du commerce en zone rurale, avec un accent mis sur la réintroduction de "vrais commerces" pour maintenir le contact humain.
GQ, Blanquette, joue de bœuf, pot-au-feu… : oui la cuisine bourgeoise est bien vivante, même chez les jeunes, 28/12/2023
L'article explore la résurgence de la cuisine bourgeoise, notamment parmi les jeunes restaurateurs et chefs. La cuisine bourgeoise, caractérisée par des plats en sauce, des recettes précises, et une cuisine faite maison, est souvent décrite comme rassurante et conviviale. Historiquement, elle diffère de la haute cuisine aristocratique par sa simplicité et l'utilisation d'ingrédients moins coûteux.
Loïc Bienassis, historien spécialiste de l'alimentation, indique que la cuisine bourgeoise a commencé à se distinguer au XVIIe siècle. Jules Gouffé, dans son livre de 1867, met en lumière des recettes emblématiques de cette cuisine, soulignant l'importance du respect des bons produits, des saisons, et de l'utilisation complète des animaux.
Le renouveau de la cuisine bourgeoise est illustré par des restaurateurs modernes comme Thomas Cassagnes à Paris, qui s'inspire de recettes familiales pour moderniser la cuisine bourgeoise. Ces restaurateurs choisissent cette approche non seulement pour son attrait nostalgique mais aussi pour des raisons pratiques, comme la facilité de reproduire ces plats classiques.
Emmanuelle Jarry, journaliste gastronomique, souligne que la cuisine bourgeoise n'a jamais vraiment disparu en France. Elle voit la cuisine comme un équilibre entre création et tradition. Cependant, Paul Ariès, dans son ouvrage sur l'histoire politique de l'alimentation, critique la cuisine bourgeoise comme étant conservatrice et représentative d'une minorité de Français.
Un exemple contemporain de l'adaptation de la cuisine bourgeoise est le restaurant Faubourg Daimant d’Alice Tuyet, qui propose une version entièrement végane. Le restaurant s’inspire des techniques traditionnelles pour sublimer les légumes sans utiliser de substituts de viande ou de fromage.
L'article pose la question de savoir si ces interprétations modernes et inclusives peuvent toujours être considérées comme de la cuisine bourgeoise. Bienassis souligne que l'essentiel est la démarche derrière la cuisine, la sincérité et l'attention portée à la préparation. Les plats du Faubourg Daimant, bien que non orthodoxes, sont présentés comme totalement réjouissants, illustrant la capacité de la cuisine bourgeoise à évoluer tout en restant pertinente.
Le Parisien, « Le resto est en bas de chez moi mais je me fais livrer » : Paris, capitale de la flemme ?, 16/12/2023
L'article aborde l'augmentation significative des livraisons de repas à domicile à Paris. Cette tendance est particulièrement marquée parmi les jeunes, comme Ariane, une consultante parisienne de 24 ans, qui mentionne la facilité et la tentation des applications de livraison, malgré une certaine honte associée à cette pratique.
Selon l'Observatoire société et consommation (ObSoCo), 50% des Parisiens ont recouru à la livraison de repas à domicile au cours des douze derniers mois, contre 25% des Français. Selon Food Service Vision, en 2023, 73% des Parisiens ont commandé un repas livré contre 66 % en 2021.
Ce phénomène a été accéléré par la crise du Covid-19 et continue de croître. L'arrivée en France de sociétés comme Uber Eats et Deliveroo en 2015 a également contribué à cette croissance de “l’économie de la flemme”. La crise sanitaire et les confinements ont poussé les gens à se faire livrer alors qu'ils étaient bloqués chez eux.
L'étude indique que les principales raisons de ce choix incluent la rapidité du service, la possibilité de décider au dernier moment et la variété des plats disponibles. À Paris, la petite taille des cuisines et des appartements contribue également à cette tendance, bien que l'inflation récente ait quelque peu ralenti la croissance du marché.
Emmanuel Grégoire, premier adjoint socialiste de la capitale, refuse de considérer cette pratique comme de la fainéantise, soulignant plutôt le manque de temps des urbains et leur désir de liberté. Toutefois, les implications environnementales et sociales de ces habitudes, comme les déchets supplémentaires, la pollution et la précarité des livreurs, sont des problèmes importants.
Ariane, qui avait l'habitude de commander fréquemment, a presque arrêté ses commandes Uber Eats, se tournant plutôt vers un service qui lui livre des recettes et des ingrédients chaque semaine. Bien qu'elle admette quelques rechutes occasionnelles, elle trouve cette alternative meilleure et plus saine.
Le Figaro, Pizza à l’ananas et au ketchup: un chef star crée la polémique à Naples, 05/01/2024
Voilà la première controverse food de l’année. Le chef napolitain Gino Sorbillo, connu pour ses pizzerias à travers le monde, a osé ajouter une pizza à l'ananas et au ketchup à son menu, suscitant un débat animé, particulièrement dans sa ville natale de Naples.
La pizza à l'ananas, originaire du Canada et popularisée dans les années 1960, est souvent rejetée par les puristes italiens, en particulier à Naples, berceau de la pizza. La décision de Sorbillo d'ajouter cette pizza, une variante blanche (sans sauce tomate) garnie d'ananas frais caramélisé, de fromages divers et de basilic, vendue 7€ dans sa pizzeria historique sur la via dei Tribunali, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont réagi avec scepticisme et indignation, certains allant jusqu'à accuser Sorbillo de trahison culturelle.
En réponse à un commentaire suggérant ironiquement l'ajout de ketchup, Sorbillo a posté une vidéo où il recouvre sa pizza de ketchups rouge et blanc faits à partir de tomates datterino italiennes, ajoutant à la controverse.
Dans une interview avec CNN, Sorbillo a expliqué qu'il souhaitait "lutter contre les préjugés culinaires". Il a mentionné que, bien qu'initialement sceptique sur l'association de l'ananas et de la pizza, il s'est décrit comme un puriste curieux, désireux d'expérimenter avec de nouveaux ingrédients comme le speck, les pistaches, et même des confitures.
La polémique a reçu une large couverture médiatique en Italie et a rappelé d'autres controverses similaires, comme les déclarations du président islandais en 2017 suggérant d'interdire l'ananas sur les pizzas, une position à laquelle le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait réagi en défendant cette création.
Wired, A Demographic Time Bomb Is About to Hit the Beef Industry, 21/12/2023
L'article met en lumière une tendance préoccupante dans l'industrie du bœuf aux États-Unis. Dans les années 1970, la consommation de bœuf atteignait son apogée avec environ 90 livres par personne et par an, mais elle a depuis diminué pour s'établir autour de 57 livres et c’est le poulet qui est désormais la viande la plus consommée.
Une étude de l'Université Tulane publiée mi-2023 a révélé que seulement 12% des Américains sont responsables de la moitié de la consommation totale de bœuf, et ce groupe tend à être composé d'hommes âgés de 50 à 65 ans, correspondant à la génération des baby-boomers. Les personnes âgées de 66 ans et plus sont moins susceptibles d'être de gros consommateurs de bœuf, peut-être en raison de conseils médicaux.
Les données montrent que la consommation de bœuf varie selon les générations. Dans les années 1990, les hommes mangeaient beaucoup plus de bœuf que les femmes, mais leur consommation diminuait après 39 ans. Les personnes qui consommaient beaucoup de bœuf dans les années 1990 pourraient être les mêmes qui apparaissent dans l'étude de l'Université Tulane comme les principaux consommateurs d'aujourd'hui.
Hillary Makens, de la National Cattlemen’s Beef Association, conteste les conclusions de l'étude de l'Université Tulane. Selon elle, les données montrent que les générations Z et Y étaient plus susceptibles que les générations plus âgées d'avoir mangé du bœuf le jour précédent. La diminution de la disponibilité du bœuf peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment une réduction du cheptel due à des conditions météorologiques difficiles.
L'industrie du bœuf cherche à attirer l'attention des jeunes Américains. Midan Marketing, une agence de marketing de la viande, a publié des articles de blog appelant la génération Z "l'industrie de la viande de demain" et incitant les spécialistes du marketing du bœuf à promouvoir la teneur élevée en protéines de leur viande pour séduire les jeunes consommateurs. L'industrie pourrait également tenter de commercialiser le bœuf comme étant « faible en carbone » pour attirer les jeunes générations plus préoccupées par le changement climatique.
Daniel Rosenfeld, doctorant à l'UCLA, affirme que nos choix alimentaires sont étroitement liés à notre image de soi et à la manière dont nous nous comparons aux autres, ce qui signifie que les gens peuvent réagir fortement aux suggestions de réduction de certains aliments. La consommation de viande est devenue hautement politisée, comme en témoigne la réaction médiatique et politique à une étude de 2020 sur les réductions des gaz à effet de serre si les Américains réduisaient leur consommation de viande.
Wired, The Foods the World Will Lose to Climate Change, 29/12/2023
L'article aborde les défis posés par le changement climatique à l'agriculture mondiale. L'année 2023 a été particulièrement difficile pour les agriculteurs en raison de conditions météo extrêmes, qui ont entraîné des pénuries alimentaires et une hausse des prix.
Les scientifiques du monde agricole travaillent à s'adapter à ces conditions météorologiques instables en envisageant des changements au niveau des systèmes de culture et des plantes elles-mêmes. Cependant, l’amélioration végétale est un processus lent et les changements climatiques actuels pourraient aller plus vite que l'innovation agricole. Selon les prévisions, le changement climatique réduira les rendements agricoles jusqu'à 30 % d'ici 2050, impactant particulièrement les 500 millions de petits agriculteurs dans le monde.
Parmi les solutions explorées, il y a notamment la relocalisation des cultures. Par exemple, la production d'avoine dans le Midwest américain, autrefois importante, a été réduite en raison de températures plus élevées et la plupart des avoines consommées aux États-Unis sont maintenant cultivées au Canada. D'autres cultures, comme les olives, les oranges et l'orge sont également menacées.
Les scientifiques cherchent à exploiter la diversité génétique des cultures pour trouver des variétés résistantes aux ravageurs ou tolérantes à la sécheresse. En France, par exemple, l'INAO a autorisé l'utilisation de six nouveaux cépages adaptés au réchauffement climatique pour la production de vins de Bordeaux.
Une autre approche est de remplacer les cultures traditionnelles par celles mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Aux États-Unis, le millet proso est envisagé comme une alternative au maïs dans les régions à faibles précipitations et ressources en eau limitées. D'autres cultures comme le colza, le tournesol, le chanvre et un autre type de millet, le millet perlé, sont également testées dans le Midwest.
Forbes, Here Are The Foods Hit Hardest By Climate Change In 2023, 31/12/2023
L'article traite des conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale en 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Des conditions météorologiques extrêmes, telles que des vagues de chaleur prolongées, des sécheresses, des incendies de forêt et des inondations, ont eu des impacts graves sur la production alimentaire.
Voici quelques-uns des aliments les plus touchés :
1. Raisins et Vin : La production mondiale de vin a chuté à son plus bas niveau en plus de 30 ans en 2023, avec une réduction de 7% des rendements de raisin par rapport à 2022. Des sécheresses et des incendies de forêt ont provoqué une baisse de 20% de la production au Chili, et une diminution similaire a été observée en Australie et en Espagne.
2. Myrtilles : D'importantes vagues de chaleur en Amérique du Sud, en particulier pendant la saison de floraison des myrtilles, ont affecté la production au Pérou, le plus grand producteur mondial, entraînant une baisse de plus de 50% des exportations.
3. Olives et Huile d'Olive : Des conditions de chaleur et de sécheresse ont réduit de 50% la production d'huile d'olive en Espagne, le plus grand producteur mondial, entraînant une hausse sans précédent des prix et une diminution des stocks.
4. Riz : Les fournitures mondiales de riz se sont resserrées en 2023 en raison des impacts climatiques aux États-Unis, en Asie et dans l'Union Européenne. Les prix du riz ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans, avec des augmentations de 40 à 45%.
5. Pommes de Terre : Une étude indique que les rendements mondiaux de pommes de terre pourraient diminuer de 18 à 32% au cours des 45 prochaines années sans adaptation. En 2023, des pluies abondantes au Royaume-Uni ont conduit à une des plus faibles récoltes de pommes de terre enregistrées.
Ces impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale s'étendent au-delà des cultures terrestres, affectant également le bétail et les espèces marines. Les pays dépendant des importations de cultures de régions vulnérables au climat sont exposés à des chocs d'approvisionnement et de prix. Une évaluation des données commerciales gouvernementales par l'Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) montre que le Royaume-Uni importe pour 2,55 milliards de dollars de nourriture de huit des pays les plus vulnérables au climat.
CNBC, From specialty beans to trendy products and accessories — coffee is getting cool again, 29/12/2023
L'article révèle un regain d'intérêt pour le café de spécialité et les méthodes de préparation du café, stimulant à la fois les cafés indépendants et les grandes entreprises de café. Cette tendance est partiellement attribuée aux confinements et à l'influence des médias sociaux, où des boissons comme le café Dalgona sont devenues virales.
La premiumisation du café est devenue évidente, avec une préférence croissante pour les cafés de meilleure qualité, tant dans la manière dont ils sont infusés que dans leur origine. Cette évolution se reflète dans la croissance des ventes et de l'intérêt pour les accessoires de café, comme illustré par l'entreprise AeroPress, qui a vu ses ventes au Royaume-Uni augmenter de 40% entre décembre 2022 et 2023.
Les méthodes de préparation du café, telles que les cafetières à piston ou les cafetières goutte à goutte (comme les V60 ou les cafetières Chemex), ont gagné en popularité à l'échelle mondiale. Cette tendance a été renforcée par la Génération Z et TikTok, qui façonnent la culture du café, avec des hashtags comme #CoffeeTok gagnant en popularité (5,2 milliards de vues tout de même…).
Les tendances émergentes dans le monde du café incluent l'ajout de vitamines ou de ginseng, créant ce qu'on appelle le "café fonctionnel". De plus, des styles de café spécifiques de différents pays, comme le café vietnamien et le Kopi indonésien, gagnent en popularité. Enfin, l'article souligne que les innovations dans les appareils de préparation du café à domicile et les technologies associées continuent d'évoluer, indiquant une poursuite de cette tendance à l'avenir. .
Intelligence Coffee, Chobani & La Colombe: Why going from yoghurt to coffee isn’t as crazy as it seems, 22/12/2023
L'article traite de l'acquisition récente de La Colombe, une entreprise de café, par Chobani, une société de yaourt grec, pour 900 millions de dollars. Cette transaction est le dernier développement d'une relation de longue date entre les deux marques, qui a commencé lorsque Hamdi Ulukaya, PDG de Chobani, a investi 60 millions de dollars dans La Colombe en 2015.
Auparavant, Keurig Dr Pepper avait investi 300 millions de dollars dans La Colombe pour une participation de 33%, se concentrant sur des accords de distribution pour les produits de café prêts à boire (RTD) de la marque. L'accord d'acquisition comprend un prêt de 550 millions de dollars, des liquidités disponibles et l'échange de la participation minoritaire de Keurig Dr Pepper dans La Colombe contre des actions Chobani.
L'expert en alimentation et boissons, Jake Leonti, note que les deux entreprises partagent des valeurs communes, notamment un intérêt pour des ingrédients sains et naturels. Les processus de production et de distribution de La Colombe et Chobani sont similaires, offrant des opportunités de synergie et d'efficacité, notamment dans la distribution, le marketing et la chaîne du froid.
L'acquisition souligne également deux tendances importantes dans l'industrie du café : l'augmentation des produits RTD et l'utilisation de laits végétaux. Ces tendances reflètent la demande croissante des consommateurs pour la commodité et la personnalisation, éloignant le marché du café de spécialité de son focus sur les cafés de single origin ou de micro-lots.
Pour les torréfacteurs cherchant une croissance significative, cibler ces marchés devient essentiel. L'adaptation aux tendances du marché et aux préférences des consommateurs est cruciale, contrairement à l'approche traditionnelle de conversion des consommateurs aux cafés noirs de haute qualité.
L'article souligne que la stratégie de croissance pour les marques de café de spécialité doit s'aligner sur les préférences du marché de masse pour les tendances axées sur la commodité, telles que le café RTD, les boissons aromatisées et les laits végétaux. Il s'agit de reconnaître et de s'adapter aux tendances du marché, plutôt que d'essayer de les modifier. En résumé, cette acquisition est un appel aux marques de café de spécialité qui souhaitent se développer : s'adapter ou risquer de prêcher dans le vide.
Grubstreet, Steve Ells Is Still Trying to Solve Lunch, 04/01/2024
L'article se concentre sur Steve Ells, le fondateur de la chaîne Chipotle Mexican Grill, et son nouveau projet, Kernel. Après avoir révolutionné la restauration rapide avec Chipotle, Ells s'oriente désormais vers un concept novateur : un restaurant végétarien et automatisé par des robots. Situé sur Park Avenue South à New York, Kernel vise à minimiser les interactions humaines et à proposer un menu simplifié, marquant une rupture avec le format de service en ligne qu'Ells a popularisé auparavant.
Chez Chipotle, Ells mettait l'accent sur des ingrédients frais et de qualité, se distançant des normes du fast-food. Son engagement pour l'excellence culinaire comprenait l'embauche de chefs primés et la poursuite de projets tels que le développement d'une tortilla à quatre ingrédients sans additifs. Cependant, sa quête de perfection chez Chipotle a parfois créé des tensions avec ses collègues.
Kernel s’est inspiré en partie des préoccupations écologiques d'Ells et les limites économiques du modèle de restauration rapide. Inspiré par un livre de Bill Gates sur le changement climatique, Ells se concentre sur un menu à base de plantes qui a un impact environnemental moindre qu’un menu à base de viande. Sur le plan économique, le modèle de restauration rapide est devenu coûteux en raison des frais de main-d'œuvre et d'espace. Kernel adopte donc un modèle économique allégé avec un menu simplifié et des processus automatisés pour réduire les besoins en main-d'œuvre.
Le design et le fonctionnement de Kernel reflètent l'intérêt d'Ells pour l'efficacité et le contrôle. Le restaurant dispose d'une ligne d'assemblage en forme de L avec un bras robotique et un personnel minimal, conçu pour optimiser la production et réduire les déchets. Les clients commanderont via une application et récupéreront leurs repas dans des casiers métalliques, éliminant le désordre des expériences de retrait traditionnelles.
L'initiative d'Ells dans l'automatisation et la minimisation des interactions humaines dans la restauration fait partie d'une tendance plus large dans l'industrie, où la commodité et l'efficacité sont de plus en plus privilégiées par rapport aux expériences de restauration traditionnelle. Ells croit que les consommateurs privilégient la vitesse, le prix et la commodité, une perspective qui s'aligne sur les tendances historiques et contemporaines des habitudes de déjeuner urbain.
Tech 45’, #106 - Revendre FoodCheri et se relancer avec un logiciel à impact - Patrick Asdaghi (Carbon Maps)
Un épisode consacré à Patrick Asdaghi, ex-Lafourchette, ex-Foodchéri revendu à Sodexo et qui a co-fondé Carbon Maps, une véritable plateforme de comptabilité environnementale pour les producteurs, marques et distributeurs. Pour eux, il dresse les bilan carbone des scopes 1, 2 et 3 c’est-à-dire qu’ils remontent toute la chaîne jusqu’aux fournisseurs et réalisent une analyse complète du cycle de vie (ACV).
Alimentation Féminine, #part 1. Mangeuses : quand le genre passe à table
Des siècles d'injonctions et de stéréotypes ont façonné la relation tumultueuse entre les femmes et la table.
Bien avant les années 1970 et le diktat de la minceur, les femmes étaient déjà soumises à l'injonction paradoxale de s'entourer de nourriture sans vraiment manger. De Pandore à Ève, en passant par les premiers cafés parisiens du XVIIe siècle, découvrez comment l'alimentation féminine a été teintée d'interdits et de stéréotypes.
Les femmes ont été présentées comme des ménagères ou des gloutonnes, tandis que les hommes étaient chefs ou gourmets. Et aujourd’hui, bien que l'évolution soit palpable, la gastronomie demeure souvent une affaire masculine, un boys band de grands chefs un peu à part.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey