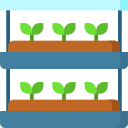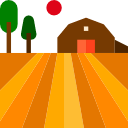🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2022-8
Bonjour à toutes et à tous, je vous propose cette newsletter dans laquelle vous trouverez quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Echos, La volaille française fragilisée par son pari de la qualité, 23/02/2022
Financial Times, Kaya, the super ingredient of 2022, 18/02/2022
The Guardian, Wine crime is soaring but a new generation of tech savvy detectives is on the case, 27/02/2022
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Les Echos, La volaille française fragilisée par son pari de la qualité, 23/02/2022
Si tout va pour le mieux en ce qui concerne la consommation de volaille en France, c’est loin d’être le cas pour la filière volaille française.
Pourtant, la filière volaille française est, d’après l’article, “une exception à bien des égards”. En effet, “elle est la seule au monde à compter autant d'espèces différentes”. De plus, elle est également “celle qu i a le plus développé de signes de qualité”. Ainsi, la volaille dite standard ne représente chez nous que 60% des volumes de production. De même, l’article précise qu’une volaille française sur cinq est élevée en plein air, soit dix fois plus que la moyenne des autres pays européens.
Alors où est-ce que le bât blesse?
Tout d’abord, la France exporte beaucoup moins de volailles qu’auparavant. Ainsi, à l’heure actuelle, seulement 8% de la production nationale de poulet est exportée, contre 25% il y a dix ans. Cela s’explique en partie par la disparition des subventions européennes à l'export. De l’autre côté, les importations ont continué à augmenter à un rythme soutenu. Si bien qu’actuellement, 45% des poulets consommés en France sont importés (contre 25% en 2000) depuis le Brésil, la Thaïlande, l’Ukraine ou encore la Pologne. Ce sont les restaurants et les cantines qui privilégient ces importations à bas coûts. Comme l’explique l'interprofession Anvol, “entre un filet de poulet ukrainien à 3,10 euros et son équivalent français à 5,80 euros, le choix est vite fait”. Autre problème auquel la filière doit faire face en ce moment : la flambée des prix de l'alimentation animale (blé, maïs, soja ...), qui représente près de 65% du coût de revient des volailles.
Le Parisien, Quotas, surpêche... les raisons d’être optimistes pour nos poissons, 23/02/2022
Voilà quelques bonnes nouvelles concernant la filière pêche française.
D’après le bilan réalisé par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), sur les 350 espèces de poissons, coquillages et crustacés pêchés par les bateaux de pêche français, 56 % des volumes étaient issus de populations exploitées durablement en 2021, contre seulement 15 % il y a 20 ans. De plus, la part des espèces en bon état de conservation (qui ne risquent pas à court terme de disparaître) est passée de 9 % en l'an 2000 à 52 % aujourd'hui.
Un poisson est emblématique de ces progrès : le thon rouge de Méditerranée. Alors qu’il était surpêché pendant des décennies, sa population est actuellement en état de reconstitution.
Toutefois, certaines espèces restent encore surpêchées. Selon l'Ifremer, cela concerne 11 % des populations de poissons. 10 % des populations de poissons sont même considérées comme « effondrées », comme par exemple le merlu de Méditerranée et le cabillaud pêché en mer du Nord et en Mer Celtique.
Les consommateurs ont donc un rôle à jouer et l'association Bloom conseille par exemple de diversifier son assiette et d'opter pour des espèces comme le merlu (du golfe de Gascogne ou de la mer du Nord), le tacaud, le merlan bleu, l'anchois ou la sardine. Ce sont, selon elle, des poissons « très peu valorisés mais pourtant très bons gustativement ». L'ONG suggère également de lire les étiquettes et de privilégier les engins de pêche dits “dormants” dans lesquels les poissons viennent eux-mêmes se piéger (hameçons, casiers etc.) plutôt que ceux dits “traînants”.
Le Figaro, Agriculture: les fermes verticales prennent de la hauteur en France, 25/02/2022 + Le Figaro, Agriculture: radis, courgettes et tomates s’épanouissent au cœur des villes, 25/02/2022
Deux articles consacrés à l’essor de l’agriculture urbaine en France.
A ce jour, l’Association française d'agriculture urbaine (AFAUP) regroupe plus de 110 structures d'agriculture urbaine, qui représentent 1 150 emplois. Toutefois, comme le précise Anne-Cécile Daniel, coordinatrice nationale de l'AFAUP, les fermes urbaines occupent en fait plus de monde que cela car toutes n'ont pas vocation à être des entreprises rentables. Ainsi, “elles ont des formes juridiques variées”. On trouve des associations, des SAS et quelques entreprises agricoles.
Le premier article cite plusieurs exemples, notamment l'association Toits vivants et Topager à Paris, Au Potager de la cantine à Nantes ou encore le Potager des ducs à Dijon.
Le second article s’intéresse à une agriculture indoor plus technologique. On y découvre par exemple un projet développé par le groupe LSDH afin de relocaliser de la production de salades en France toute l’année. Le groupe a investi près de 10 millions d'euros, via sa filiale Les Crudettes, dans une serre de 7 000 m2. Celle-ci fonctionnera grâce à un système d'aéroponie mobile automatisé qui permettra de réaliser 97 % d'économie d'eau. La construction a débuté fin janvier 2022 et à partir de l’été prochain elle produira des salades, mais aussi à terme, 70 tonnes d'herbes aromatiques par an (aneth, basilic...).
L’article mentionne également le projet de Jungle, en 2016, qui a levé 42 millions d'euros en 2021 pour construire deux nouvelles fermes verticales en France. L’entreprise vise 10 millions de plantes et salades produites en hydroponie.
Toutefois, l’article met en avant le fait que le prix de revient d’une salade cultivée indoor reste encore souvent supérieur à celui d’une salade cultivée en plein champ. Il est par exemple de 15 % à 20 % supérieur chez LSDH et de 5 % chez Jungle.
Par ailleurs, plusieurs projets ont été perturbé par la crise sanitaire, car “la pandémie les a privés de débouchés hors du domicile”.
Le Parisien, Guerre en Ukraine : le conflit va faire grimper les prix des matières premières agricoles, 26/02/2022
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les cours des matières premières agricoles s’envolent. Le prix du blé meunier a par exemple atteint son niveau record sur le marché européen, avec un pic à 344 euros la tonne sur Euronext. Comme le met en perspective Sébastien Abis, chercheur à l'Iris, en affirmant qu’« on était à 120 euros la tonne au début du Covid ».
Sébastien Poncelet du cabinet Agritel explique quant à lui que « L'Ukraine est une région agricole historique (...) Elle est le sixième pays producteur de blé au monde, la Russie est le premier pays exportateur (et troisième pays producteur derrière la Chine et l'Inde). Les deux ensembles représentent un tiers du commerce mondial de blé”. Par conséquent, comme les ports ukrainiens sont fermés et qu’aucun armateur n'envoie de bateau sur la Mer Noire actuellement, les acheteurs de blé vivent sur leur stock. Par ailleurs, comme le blé ukrainien est semé à l'automne, il doit être récolté en juillet et donc “si la moisson ne peut pas se faire, les pays acheteurs seraient face à un autre problème”.
Autre produit agricole concerné par ce conflit : l’huile. En effet, comme l’explique Sébastien Poncelet “à cause des faibles récoltes de colza et de palme, le marché des huiles était déjà en surtension. Or l'Ukraine est le premier pays producteur et le premier exportateur d'huile de tournesol du monde. Elle compte pour la moitié de l'huile de tournesol mondiale”. Le prix de l’huile risque donc d’augmenter dans les prochains mois.
Parmi les filières agricoles qui vont souffrir il y a l'élevage, et en particulier la filière porcine. En effet, comme le précise Thierry Pouch, des chambres d'agriculture de Paris, “50 à 70 % des tourteaux de tournesol que mange notre bétail viennent d'Ukraine”.
Les Échos, Guerre en Ukraine : l'industrie agroalimentaire française retient son souffle, 25/02/2022
Plusieurs entreprises agroalimentaires françaises ont des intérêts en Ukraine et en Russie et pourraient subir les conséquences de la guerre entre ces 2 pays. L'industrie laitière, les céréales et les semences sont les filières les plus exposées aux conséquences de cette guerre
En Ukraine, on dénombre une quinzaine d'entreprises agroalimentaires et agricoles françaises, dont Soufflet, Louis Dreyfus et Malteurop dans les domaines de la production, du négoce et de la transformation des céréales.
Dans le lait, Danone, Lactalis et Savencia ont des usines en Russie et en Ukraine. Lactalis déclare un chiffre d'affaires de 100 millions en Ukraine, où il exploite trois sites de production pour la consommation nationale et un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros en Russie où il possède quatre usines fromagères. Danone, qui contrôle le leader russe Unimilk depuis plus de dix ans, réalise 5 % de son chiffre d'affaires mondial en Russie et y possède une dizaine d'usines.
Dans le secteur des semences végétales, les coopératives Limagrain, Maïsadour et Euralis ont des unités de production sur place.
RFI, Chine: un riz marin pour assurer la sécurité alimentaire, 23/02/2022
Depuis les années 50, les agronomes chinois cherchent à faire pousser du riz sur des sols salés.
En 2012 les recherches ont été relancées quand Yuan Longping, le père du « riz hybride » s’y est intéressé. Il semble que les Chinois aient enfin réussi leur pari. En effet, un essai réalisé à Tianjin sur la côte est du pays à partir d’un gène de riz sauvage augmenté afin de résister à l’eau de mer, a été concluant. Ce sont 11,5 tonnes à l’hectare qui ont été produites en 2021, soit un résultat supérieur à la moyenne nationale pour la production de riz standard.
L’institut de recherches agronomiques sur le riz d’eau de mer de Qingdao prévoit de récolter à terme 30 millions de tonnes de riz marin sur 6,7 millions d’hectares de terres autrefois considérées comme non fertiles.
Cette découverte permettrait de nourrir environ 80 millions de personnes supplémentaires!
Le Parisien, Grande distribution : les stratégies des enseignes pour s’implanter en Île-de-France, 27/02/2022
Les outils utilisés par les distributeurs pour mettre en place leur stratégie d'implantation sont nombreux. Ils s’appuient à la fois sur des études de marché, des logiciels de géomarketing, une analyse des projets d'aménagement urbain ou encore l’exploitation des données de l'Insee (démographie, densité de population, habitudes de consommation des ménages, concurrence, catégories socioprofessionnelles).
Une représentante de Monoprix explique la manière dont procède l’enseigne. Ainsi, Monoprix définit “la zone d'attraction en fonction de la concurrence, nos logiciels de géomarketing nous aident à déterminer le chiffre d'affaires précis du futur point de vente”. Quand on sait que l’enseigne ambitionne d'ouvrir plus de 800 magasins de proximité en 2022 dans toute la France on se doute que ces outils sont très précieux.
L’article précise d’ailleurs qu’avec le projet du Grand Paris et le développement de nouvelles lignes de transports en commun, les enseignes historiquement implantées à Paris lorgnent désormais vers la grande banlieue,
Wired, Online Shopping Is Reshaping Real-World Cities, 22/02/2022
Un article qui est consacré à la manière dont les dark stores remodèlent les grandes villes américaines. Aux Etats-Unis, comme un peu partout ailleurs dans le monde, les dark stores se sont en effet imposés pendant la pandémie.
Les ventes en ligne ont représenté environ 13 % de toutes les dépenses d'épicerie en 2021 aux Etats-Unis. Mais à mesure qu'ils se répandent aux Etats-Unis, les dark stores risquent de remodeler le design et surtout l'ambiance des quartiers dans lesquels ils s'installent.
Comme en France, le plus grand moteur du boom des dark stores à l'heure actuelle est la multiplication de startups, principalement européennes, qui ont entamé une campagne éclair aux États-Unis l'été dernier. Ces startups se sont dans un premier temps focalisées sur New York. Ainsi, au moins six startups de Q-commerce y opèrent aujourd'hui et elles y ont implanté au total plus de 110 dark stores. Mais désormais elles se développent également dans les autres villes du pays. Buyk est désormais à Chicago, Jokr et Getir sont à Boston, et GoPuff a démarré à Philadelphie.
Les dark stores s'installent en général dans les locaux d'anciennes boucheries, petites épiceries, salles de sport ou encore magasins de matelas. Ils occupent donc des espaces qui étaient autrefois destinés à être ouverts au public. Cette mutation de l’espace urbain inquiète les urbanistes car les dark stores sont “techniquement occupés, mais fonctionnellement vides” et “ils risquent d'ancrer les pires impacts que l'immobilier vacant peut avoir sur une communauté”. L’article explique ainsi que “les vitrines vacantes sont mauvaises pour les villes. Lorsqu'il y en a beaucoup dans un périmètre restreint, cela signifie que moins de personnes se promènent dans la rue et que moins de liens se créent entre voisins”. Or “avoir des gens dans la rue augmente la sécurité publique, car plus de gens voient ce qui se passe”. Par conséquent, “les quartiers où le nombre de vitrines vacantes est élevé voient augmenter les taux de criminalité, les risques d'incendie et l'activité des rongeurs”.
De plus, selon Alex Bitterman, professeur d'architecture et de design à l'Alfred State College, le remplacement d'une épicerie ouverte au public, en particulier dans les quartiers à faibles revenus, par une épicerie réservée à la livraison pourrait exacerber les problèmes d'accès à la nourriture.
Une dernière inquiétude concerne la façon dont les dark stores, avec leurs livraisons constantes, modifieront la circulation des voitures et des piétons dans un paysage urbain restreint. Selon un urbaniste, les dark stores devraient choisir des zones où "il n'y aurait pas de demande pour cet espace", où le flux constant de livraisons ne peut pas perturber la circulation piétonne et où "ils n'évincent pas vraiment d'autres personnes".
Financial Times, Beyond Meat takes a beating as plant-based sector reports slowing sales, 25/02/2022
Les temps sont durs pour Beyond Meat et ses confrères des alternatives végétales à la viande.
L’entreprise a en effet annoncé des pertes de 80,4 millions de dollars lors des trois derniers mois de 2021, ce qui représente plus du triple des pertes de l'année précédente. Le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 1,3 % à 100,7 millions de dollars. Pour expliquer cette baisse, Beyond Meat met en avant la faiblesse des ventes au détail aux États-Unis en raison d’une demande atone, l’augmentation des remises et la perte de parts de marché.
Pour 2022, Beyond Meat prévoit des revenus inférieurs aux estimations, avec des ventes totales de 560 à 620 millions de dollars sur l’année en cours.
Après plusieurs années de croissance spectaculaire, les ventes sur le marché de la viande d'origine végétale ont soudainement ralenti l'année dernière. Aux États-Unis, une hausse de 46 % en 2020 a été suivie d'une baisse de 0,5 % en 2021, selon Spins. Au Royaume-Uni, les chiffres de Kantar ont montré que les ventes se sont tassées au second semestre de l'année dernière, même si elles ont connu un rebond en décembre.
D’après une étude réalisée par Maple Leaf Foods, un concurrent de Beyond Meat, les consommateurs ne font pas d'achats répétés parce que les produits ne répondent pas aux attentes en termes de prix et de mode de fabrication. Après avoir augmenté de 59 % en 2019 et de 75 % en 2020, les ventes au détail de viande végétale n'ont augmenté que de 1 % l'année dernière selon Maple Leaf. L’entreprise a déclaré que les consommateurs considéraient la viande d'origine végétale comme une "nouveauté coûteuse", ce qui a conduit à des taux d'essai élevés mais à de faibles achats répétés. Maple Leaf prévoit que le marché de la viande d'origine végétale pèsera entre 6 et 10 milliards de dollars d'ici 2030.
Financial Times, The best independent coffee shops in the world, 28/02/2022
Voilà un article sympa pour tous ceux qui veulent préparer leurs futures vacances. Il s’agit d’une liste des meilleurs coffee shops indépendants du monde réalisée par les contributeurs du Financial Times.
De Sidney à Palerme en passant par Buenos Aires, les amateurs de café y trouveront forcément leur bonheur.
Financial Times, Kaya, the super ingredient of 2022, 18/02/2022
Focus sur la kaya, la confiture malaisienne à base de noix de coco, d'œufs et de caramel qui est, selon le Financial Times, “en passe de devenir la sensation gustative de l'année”.
Elle est née au sein de la communauté hainanaise de la péninsule malaise, qui a modifié les confitures traditionnelles à base de noix de coco que l'on trouve ailleurs en Asie. Dans les cafés traditionnels hainanais (kopitiams), que l'on trouve encore un peu partout à Singapour et en Malaisie, elle est étalée sur des toasts de pain de mie beurrés puis trempés dans des œufs "brouillés" à peine cuits et enfin arrosés de soja et de poivre blanc. Désormais, toute une nouvelle vague d'artisans l'introduit dans le reste du monde, où elle est considérée comme le nouveau caramel salé et adoptée par les boulangers et les chefs dans les produits de boulangerie, les glaces et les plats salés.
La marque anglaise Madam Chang's cherche également à faire connaître la kaya et met en avant sa polyvalence en proposant une gamme plus large de variétés, notamment la Rum Kaya, composée de rhum de coco grillé et de gula melaka (sucre de palme issu de la fleur de coco). D’après l’article, la kaya s’accorde également très bien avec du fromage, en particulier les fromages bleus plus salés, les graisses du lait du fromage coupant la douceur du kaya, et la saumure du fromage l'équilibrant.
The Times, All hail cauliflower, king of the veg, 24/02/2022
Voilà un article qui fait une ode au chou-fleur.
Le chou-fleur peut être consommé sous forme de riz ou de steak, il peut être frit dans une pâte délicate et transformé en tempura, il peut être rôti entier et prendre la place du poulet ou de l'agneau, il peut être des "ailes", du "popcorn" et même une base pour la pizza.
Il n'y a pas que dans les restaurants que le chou-fleur occupe le devant de la scène. Dans les supermarchés les ventes augmentent également. Ainsi, au Royaume-Uni, chez Waitrose, les ventes de chou-fleur ont augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière. Sur Instagram, le deuxième clip vidéo de Yotam Ottolenghi le plus regardé, avec 2,8 millions de vues, est une salade de chou-fleur.
Quand l'ascension du chou-fleur au rang de roi des légumes a-t-elle commencé ? En 2013, le New York Magazine a décidé qu'il s'agissait du "légume le plus susceptible d'être confondu avec un morceau de viande" et depuis, la tendance à le couper en tranches épaisses et à le griller comme un steak ou à le transformer en "ailes" a vraiment décollé.
Sabrina Ghayour, auteur d'un livre de cuisine sur le chou-fleur, explique que le secret de son succès fou réside dans sa texture. Elle l’affirme ainsi “je suis une mangeuse de viande, donc je n'essaie pas de créer des substituts, mais si vous l'êtes, le chou-fleur est parfait. Il tient sa forme et offre texture et volume. Vous pouvez le servir comme plat principal alors que vous ne pourriez pas le faire avec, par exemple, un chou”.
The Guardian, Wine crime is soaring but a new generation of tech savvy detectives is on the case, 27/02/2022
Un article très intéressant sur la fraude dans le monde viticole.
Il explique que depuis des siècles, les escrocs et les voleurs sont attirés par le monde très lucratif de la criminalité viticole. Mais que désormais une nouvelle génération de détectives férus de technologie les combattent.
C’est le cas par exemple de Philip Moulin, qui est responsable de la qualité et de l'authentification chez Berry Bros, un négociant en vins londonien qui a pignon sur rue depuis 1698. Philip Moulin s'intéresse au vin depuis son enfance et a parfois été qualifié de "détective du vin". Berry Bros est le premier négociant britannique à employer un authentificateur, reconnaissant ainsi que sa réputation repose sur la confiance et que les vins frauduleux constituent un problème sérieux dans le commerce.
Comme l’explique Philip Moulin, il existe des dizaines de façons de vérifier l'authenticité d'un vin sans le goûter. Cela va du poids de la bouteille au niveau du vin qu'elle contient, en passant par les filigranes, le papier au tissage unique, l'encre à l'ADN spécial, les micropuces dans la bouteille.
L’une des problématiques mise en avant concernant la criminalité dans le monde du vin : c’est une faible priorité pour la police. Or, comme le vin est devenu plus précieux, la criminalité liée au vin est en hausse. En effet, le vin a tendance à être moins bien gardé que les bijoux, mais il peut être une cible tout aussi tentante. Ainsi, en octobre dernier, une bouteille d'Yquem d'une valeur de 295 000 £ faisait partie des 45 bouteilles volées dans un complexe touristique en Espagne. En 2019, des voleurs ont percé un trou dans une cave située sous un restaurant parisien et se sont emparés de 600 000 € de vin.
Aujourd'hui, on estime qu’un quart des vins vendus dans le monde ne sont pas conformes à leur description. Cela couvre tout un éventail d'altérations de la bouteille et du liquide, depuis le mauvais étiquetage, le mauvais mélange et la fausse certification jusqu'à la contrefaçon. Ainsi, “bien que le vin soit souvent comparé à l'art, une peinture est soit de la main de l'artiste, soit elle ne l'est pas. Mais des bouteilles de vin de 1 000 € peuvent passer pour des bouteilles de 10 000 € lors de ventes aux enchères”. De plus, “contrairement à l'authentification d'un tableau, l'art de tester un vin consiste le plus souvent à l'ouvrir, ce qui lui enlève une grande partie de sa valeur. Il existe des moyens de tester le vin depuis l'extérieur de la bouteille, mais ils sont coûteux et complexes”.
Une affaire a changé beaucoup de choses par rapport à la prise en compte du problème de la fraude. Rudy Kurniawan, un énigmatique Indonésien est apparu sur le marché américain du vin haut de gamme au début des années 2000 avec un stock apparemment inépuisable de vins rares. En 2009, il a été poursuivi par Bill Koch, le collectionneur milliardaire. Koch était l'un des rares collectionneurs suffisamment riches et engagés pour risquer de dévaluer sa propre collection afin de révéler les arnaques à l'œuvre. Lorsque les enquêteurs du FBI ont perquisitionné la maison de Kurniawan en 2012, ils ont trouvé un tas de matériel de faussaire : bouchons, timbres, étiquettes et bouteilles vides. En 2014, il a été condamné à 10 ans de prison. Il a purgé six ans avant d'être libéré et expulsé fin 2020. Ce scandale a fait l'objet d'un documentaire en 2016, Sour Grapes.
Maureen Downey a été enquêtrice principale dans l'affaire Kurniawan. Travaillant comme commissaire-priseur à la fin des années 90 et au début des années 2000, elle a commencé à remarquer un nombre alarmant de contrefaçons. Les étiquettes étaient fausses, les millésimes impossibles, les vins eux-mêmes ne correspondaient pas à leur description. En 2005, elle a quitté les ventes aux enchères pour se consacrer à l'authentification. Elle explique par ailleurs les difficultés d’être une femme dans un tel milieu. Elle affirme ainsi “j'étais une fille qui pissait sur le feu de camp des garçons. J'en parlais haut et fort et personne ne voulait me croire. J'ai dû emmener des gardes du corps à des dégustations de vin, et j'ai été agressée physiquement. C'est beaucoup d'argent. C'est aussi une question d'ego masculin fragile”. Elle reconnaît que l'affaire Kurniawan a tout changé. Depuis cette affaire, ses services sont constamment sollicités par des collectionneurs, des marchands et des maisons de vente aux enchères qui cherchent à garantir leur stock. Elle a par ailleurs formé des centaines d'autres experts, dont M. Moulin.
Elle a créé un système appelé "Chai Vault", qui utilise la blockchain pour authentifier les bouteilles stockées. Ce système peut mettre à jour les informations au fur et à mesure que les vins changent de mains. Selon elle, “la blockchain fait partie de la solution. Dans 50 ans, lorsque quelqu'un ira acheter cette bouteille, il pourra voir exactement à qui elle a appartenu”.
Food Navigator, Consumers unwilling to pay premium for regenerative agriculture claims, survey finds, 24/02/2022
Selon une récente enquête du International Food Information Council (IFIC) menée auprès de 1 000 adultes représentatifs de la population américaine, plus de la moitié d'entre eux ont déclaré avoir entendu parler de l'agriculture biologique, de la rotation des cultures et de l'agriculture durable. En revanche, ils sont moins nombreux à connaître des termes tels que "santé des sols" (33 %) et "agriculture régénérative" (19 %).
L'enquête a ensuite fourni aux répondants une définition de l'agriculture régénératrice, à savoir "une agriculture qui vise à restaurer et à maintenir des niveaux optimaux de nutriments et de micro-organismes dans le sol", afin d'évaluer la perception du public en matière de pratiques agricoles et de consommation. Une fois la définition en main, les personnes interrogées ont été invitées à indiquer les pratiques ayant l'impact le plus bénéfique sur les terres où sont cultivés les aliments. Parmi les deux premières réponses, on trouve l'agriculture écologiquement durable (40 %), suivie des aliments et boissons fabriqués sans pesticides (35 %) et des produits issus de l'agriculture régénérative (30 %).
Si plus d'un répondant sur trois (36 %) considère que les aliments issus de l'agriculture régénérative sont plus nutritifs, les personnes interrogées ne pas nécessairement prêtes à payer plus cher pour bénéficier de ces avantages supplémentaires. 66 % ont déclaré qu'ils choisiraient une céréale de petit-déjeuner standard plutôt qu'une version plus chère étiquetée "cultivée avec l'agriculture régénérative".
Tamika Sims, directrice principale des communications sur les technologies alimentaires à l'IFIC, explique ce résultat par le fait que "le goût, le prix et la commodité sont les principaux facteurs d'achat, tandis que la durabilité environnementale vient après ces caractéristiques".
Sojaxa, Résultats du 4ème Baromètre Sojaxa 2021-2022 « Les Français et les aliments au soja », 25/02/2022
Sojaxa a présenté les résultats de son 4è baromètre sur le thème “Les Français et les aliments au soja”.
En 2021, le végétal continue de séduire les Français : 60 % des interrogés se déclarent consommateurs d’alternatives végétales, et parmi eux, 42 % consomment des produits à base de soja. Autre fait marquant, la fidélité des consommateurs progresse : ils sont 2/3 à consommer du soja depuis 3 ans minimum, alors qu’ils n’étaient qu’1/3 il y a deux ans.
Enseignement fort de cette 4ème édition, le profil du consommateur de produits à base de soja a significativement rajeuni : 50 % des consommateurs ont moins de 40 ans, versus 39 % en 2019. Les produits au soja s’inscrivent pleinement dans les attentes de cette nouvelle génération de consommateurs qui souhaite intégrer plus de végétal dans son alimentation, pour une plus grande diversité alimentaire au quotidien et avec des bénéfices pour leur santé comme pour l’environnement.
Assemblée Nationale, Rapport d’information sur l’évaluation de l’alimentation saine et durable pour tous, Février 2022
La problématique de l’alimentation saine et durable pour tous permet de faire le point sur un sujet au centre des besoins fondamentaux de l’individu mais aussi au cœur de différentes politiques publiques déterminantes : l’éducation, la santé, la consommation, l’information, la production agricole et industrielle.
Ce rapport est découpé en 5 parties : (I) la problématique de la consommation alimentaire, (II) l’évolution de l’offre et de la demande dans le contexte de la crise sanitaire, (III) la façon dont sont conduites et suivies les politiques publiques de l’alimentation, (IV) le développement foisonnant de l’information alimentaire, sur les inégalités qui marquent cette problématique centrale et sur l’impact du marketing sur les consommateurs, (V) la question fondamentale de l’éducation à l’alimentation dans le cadre scolaire.
Il débouche sur 21 propositions :
Réaliser une étude sur l’ensemble des activités et pratiques agricoles et sylvicoles qui pourraient être incluses dans les critères d’éligibilité de la vente de crédits carbone, afin d’inciter plus largement au développement du travail agricole favorable à la préservation de l’environnement et des milieux naturels.
Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, entreprendre la révision du règlement sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires de 2011 (INCO) afin de rendre obligatoires les informations relatives à l’origine géographique des produits alimentaires.
Assortir les projets alimentaires territoriaux (PAT) d’un référentiel d’évaluation mesurant l’atteinte des objectifs formulés lors de la création du PAT, au moyen d’indicateurs de réalisation et d’impact.
Établir un calendrier de négociation et une méthode permettant de mettre en œuvre rapidement les engagements volontaires sur des seuils limite de nutriments, en prévoir les indicateurs d’évaluation et en cas d’échec, introduire une règlementation des seuils de sucre, de sel et de gras dans les produits agroalimentaires.
Renforcer la recherche sur l’impact des aliments ultra‑transformés (AUT) sur la santé, afin de mieux les définir et de satisfaire aux engagements du PNNS 4 (action 4 de l’axe 1), lequel instaure un objectif d’amélioration des pratiques industrielles de transformation et d’ultra-transformation, afin d’atteindre une réduction de la consommation des aliments ultra‑transformés de 20 % au terme de sa durée.
Développer l’effort de recherche au plan national sur les impacts sur la santé des pesticides, des additifs et des produits alimentaires ultra‑transformés ; fixer un délai d’aboutissement afin de statuer sur leur nocivité éventuelle et prendre les mesures réglementaires en conséquence.
Fusionner les Plan national nutrition santé et Programme national pour l’alimentation et les intégrer dans la Stratégie nationale de santé en établissant des priorités, des objectifs chiffrés et des indicateurs de suivi et d’évaluation.
Réaliser une véritable évaluation du Nutri‑Score intégrant des indicateurs et en particulier les catégories de consommateurs qui s’y réfèrent, leur répartition territoriale, sa diffusion par produits ; Évaluer la qualité alimentaire des produits passés de la notation D/E à A/B, dans le cadre d’une sélection aléatoire annuelle.
Prévoir l’affichage du Nutri‑Score dans les distributeurs automatiques de produits alimentaires.
Mettre en œuvre l’action « Janvier sobre » en 2023 avec le soutien des pouvoirs publics et de Santé publique France.
Évaluer la mise en œuvre de la Charte d’engagements responsables relative à la vente d’alcool signée en 2019 par la Fédération du commerce et de la distribution ; tirer les conséquences de cette évaluation avec des mesures renforcées de contrôle du respect de l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique interdisant la vente d’alcool aux mineurs.
Promouvoir une initiative, au plan européen, visant à soumettre les boissons alcoolisées aux mêmes exigences d’étiquetage nutritionnel que les produits alimentaires.
Étendre le Nutri‑Score à la restauration collective et commerciale, conformément à la préconisation de l’action 7, objectif 2 du PNNS 4.
Réviser les messages sanitaires associés aux annonces publicitaires selon les préconisations formulées par Santé publique France en 2019, en améliorant la qualité des messages (être simples, délivrer des informations pratiques, éviter les injonctions imprécises) et leur adaptation aux destinataires ; intégrer les messages sanitaires en amont du passage des publicités ; imposer l’insertion des messages sanitaires aux nouvelles techniques de publicité digitales.
Renforcer les campagnes de prévention de l’alcoolémie par une communication sur la dimension alimentaire de l’alcool, en y soulignant notamment la proportion de sucre et le risque lié de diabète et d’autres maladies.
Renforcer le pilotage de la politique publique de santé scolaire et en particulier des dispositifs de promotion de la santé afin de favoriser une approche globale et cohérente et éviter la démultiplication des dispositifs.
Évaluer la participation des industries agroalimentaires dans les dispositifs d’éducation à l’alimentation.
Prévoir, chaque fois que possible, la présence d’un interlocuteur chargé de la restauration scolaire lors des réunions de parents d’élèves de rentrée scolaire afin de favoriser la transmission d’informations.
Associer l’ensemble de la communauté scolaire (en particulier les personnels encadrant les pauses méridiennes et les agents territoriaux) aux actions d’information et de formation portant sur l’alimentation.
Prévoir chaque fois que possible des points d’accès à l’eau et des aménagements de la restauration scolaire favorisant la limitation du gaspillage (distribution de pain à la demande, limitation des portions, possibilité de se resservir...).
Remplacer la justification individuelle demandée dans le cadre du programme européen « Fruits et légumes, lait et produits laitiers à l’école » par une référence au programme scolaire d’éducation alimentaire afin de limiter la lourdeur administrative liée à ce programme.
Depuis le 1er mars il y a plus de transparence sur l’origine des viandes
Eat’s Business #44 | Les français et l’agriculture, les anti-régimes et l’abonnement aux restaurants
Food Karma #23 | François-Xavier Delmas – Fondateur du Palais des Thés | Le bon thé
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey